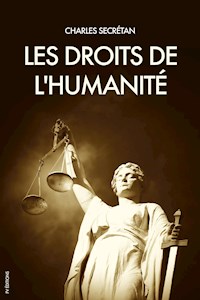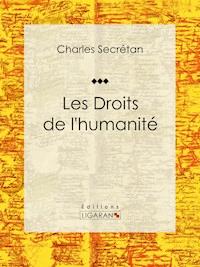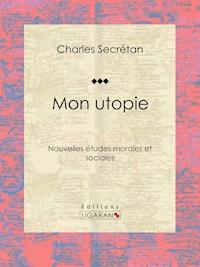
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : " Nous marchâmes un moment en silence : la surprise, la discrétion nous fermaient la bouche à tous les deux..."
Das E-Book Mon utopie wird angeboten von Ligaran und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335028881
©Ligaran 2015
Obsédé par de tristes pensées, j’avais erré longtemps sur les plateaux agrestes de ce frais Punjab où les sources de deux minimes affluents du Rhône, de trois modestes affluents du Rhin tracent un lacis indéchiffrable, et où le promeneur, débouchant des forêts, voit, suivant le hasard des sentiers, la patrie de Vaud se dérouler en longs rideaux, pour se relever, comme la vague marine, ici contre le mur noir du Jura, là contre les Alpes crénelées. Las du soleil, je m’endormis sous un poirier sauvage. Étais-je réveillé, dormais-je encore lorsque je me trouvai au bord de la côte, saluant le matin, dont la première flèche dardait entre Branleire et Follièra, sentinelles de la Gruyère ? Je ne comprenais pas comment j’étais arrivé là. Un bonjour cordial interrompit ma recherche inquiète. L’homme qui me saluait était une énigme nouvelle. Cheveux bruns rejetés en arrière, chemise ouverte, brune aussi, mais fort propre, tunique de drap à la Père Enfantin, bottines fortes, mais presque élégantes, où se perdait le pantalon, le costume de cet étrange concitoyen ne donnait point tant à penser que sa figure : un front élevé, creusé vers le milieu d’un sillon perpendiculaire, un œil fouillant la profondeur, les coins tombants d’une bouche âne, ces traits de savant et de poète y contrastaient bizarrement avec un teint hâlé et des mains calleuses.
« Vous plairait-il de vous reposer un instant chez moi ? fit-il ; ma maison est à deux pas, vous y verrez le pays plus à l’aise, car vous avez l’air de venir de bien loin à cette heure matinale. » Sa curiosité semblait presque égaler la mienne, son regard me parcourait de la tête aux pieds, la forme cylindrique de mon chapeau lui donnait à penser. Bientôt, suivant le mouvement de ses yeux, je vis qu’ils se portaient sur ma barbe, et je constatai (sans trop d’émotion) qu’elle avait grandi de plusieurs décimètres et me couvrait comme une sorte de tablier. Nous marchâmes un moment en silence : la surprise, la discrétion nous fermaient la bouche à tous les deux.
Couverte au nord par une éminence, à l’occident par un bouquet de sapins, la maison de mon hôte se détachait sur le bord du plateau ; une longue véranda, dominant un jardin en terrasses, offrait toute commodité pour admirer des splendeurs qui depuis longtemps m’étaient familières. Le côté nord du bâtiment était occupé par une forge, dont la découverte mit le comble à mes étonnements. « Et c’est vous, lui dis-je, qui battez le fer sur cette enclume ! moi qui vous prenais pour un de ces messieurs qui sont toujours dans les livres ! j’aurais quasiment dit un ministre, n’était la couleur de vos habits. » Sa bouche se crispait, mais les yeux riaient à sa place et je vis qu’il faisait un énergique effort pour réprimer les secousses de son diaphragme. Dès qu’il s’en crut maître, il répondit : « Vous pensez donc, vénérable débris des anciens âges, qu’on ne peut pas étudier le matin et forger le soir ? vous datez peut-être de l’époque où le clerc aurait cru déroger s’il avait fait œuvre de ses dix doigts et le noble s’il avait su lire. Nous n’en sommes plus là ! Nous mettons le travail cérébral au-dessus du travail musculaire, nous pensons que l’intelligence est le plus précieux des trésors ; c’est pourquoi nous nous efforçons de discerner les bonnes têtes, de les signaler, de les utiliser toutes au profit de la société. Et c’est aussi pourquoi nous tâchons de les fortifier et de les conserver le plus longtemps qu’il nous est possible. De votre temps, on savait déjà, sans doute, que la santé de l’esprit ne va pas sans la santé du corps ; on savait que la santé n’est que l’équilibre entre la rentrée et la dépense, et la maladie une rupture de cet équilibre ; on savait que si le pauvre languit et meurt prématurément par l’effet d’une restauration insuffisante pour le travail auquel il est astreint, l’homme à son aise, en revanche, souffre le plus souvent d’embarras, d’encombrement, d’un ralentissement dans les échanges, d’une oxydation imparfaite des matériaux accumulés par les repas. Contre ces misères du bien-être vous aviez vos jeux de paume, vos jeux de quilles, vos gymnases, vos salles d’armes, vos chaloupes, vos canots, vos bicycles, votre cricket, vos footballs, vos chasses au lièvre, au renard, au chamois, au loup, au sanglier, vos rallye-papers, votre alpinisme, travaux fatigants, parfois dangereux, qui ne laissaient rien après eux. Et pourtant vous n’ignoriez pas que, pour être utile à d’autres égards, un labeur ne perd point ses vertus hygiéniques. Dans notre vieille Europe, sans passer l’étang, vous aviez eu déjà vos rois serruriers et vos premiers ministres bûcherons. Nous avons conservé toutes vos formes de sport, nous en avons même imaginé quelques-unes dont le siècle coiffé du carton-peluche ne s’était point avisé, mais passé vingt ans, nous ne les cultivons guère. Nos enfants fréquentent l’école aussi longtemps qu’ils peuvent y apprendre quelque chose, et l’étude proprement dite n’y remplit pas toutes les heures. Chacun y fait l’apprentissage d’un métier ; plus tard nous continuons presque toujours à l’exercer. Ceux qui sont voués aux professions lettrées que vous appeliez – un peu sottement, sauf votre respect – les professions libérales, travaillent de leurs bras, pour varier. Ceux qui tirent d’une occupation manuelle le principal de leur subsistance, lisent, enseignent, écrivent parfois, pour leur amusement, sans en dédaigner le profit. Après quelques essais infructueux, nos pères ont abandonné l’idée d’assurer à tous leurs enfants le même esprit et la même taille ; nous possédons un certain nombre d’hommes d’élite et beaucoup de médiocrités ; néanmoins quelque niveau qu’il lui soit donné d’atteindre, chacun de nous s’efforce d’être un homme complet. Je ne vous garantis pas qu’on y parvienne, mais on y vise. Ainsi travaux de force, travaux d’adresse, travaux d’esprit se partagent en proportions variables cette moitié des vingt-quatre heures que nous ne passons pas à manger, à dormir et à nous divertir.
– À vous divertir ? Juste ciel ! il vous faut encore des divertissements.
– À nous divertir du travail, ou, si le mot vous choque, à jouer, à nous reposer, car vous savez assez que, sauf le cas d’une prostration complète, l’immobilité ne repose pas. Et se divertir du travail, pour plusieurs d’entre nous, c’est avant tout se recueillir. Nous ne cherchons pas à sortir de nous-mêmes, parce que nous sommes heureux en nous possédant, c’est-à-dire en sentant que Dieu nous possède. Ce qui remplit avant tout nos loisirs, c’est Celui qui nous soutient dans la fatigue. Le culte n’est pas un jeu, si vous voulez, mais ce n’est pas non plus un travail, c’est une joie. Les mots, vieux professeur (d’où savait-il donc que j’étais professeur ?), ont une étrange destinée. Récréer signifie à peu près la même chose que régénérer, il est seulement un peu plus fort. Mais combien ces deux verbes ne se sont-ils pas éloignés l’un de l’autre ! Eh bien, nous essayons de les rapprocher. Qu’elle en soit le but, qu’elle soit le point de départ ou la source, la régénération est toujours au fond des récréations qui nous plaisent. »
Ce maréchal ferrant me semblait terriblement ferré sur l’étymologie, il rendait la grammaire fort édifiante, mais je n’osai pas m’engager dans les grands sujets qu’il venait d’ouvrir. « De mon temps, lui dis-je, l’ouvrier n’avait qu’un métier, il y travaillait toute la journée et s’estimait très heureux lorsqu’à ce prix il pouvait élever une famille, sans que sa compagne fût obligée de travailler aussi pour un salaire.
– Oui, répondit mon favre, mais de votre temps, chaque journée de travail devait fournir aux besoins de plusieurs journées. Vous aviez des oisifs de toute espèce : les propriétaires fonciers, leurs valets et les parasites, les capitalistes, dont l’unique soin était de toucher leurs intérêts semestriels chez le banquier, des fonctionnaires civils, militaires, ecclésiastiques de tout grade, qui s’étageaient nu-dessus des producteurs ; puis à côté d’eux ceux-ci trouvaient des compagnons sans travail, pour cause de grève ou de chômage imposé par le défaut de commandes ; à leurs pieds enfin les invalides, les mendiants d’occasion ou de profession, dont on se faisait un devoir d’entretenir la misère, malgré les réclamations de vos économistes et de vos philosophes, qui prétendaient que mourir de faim n’est pas le pire des maux et qu’avant tout il fallait empêcher les incapables de faire souche. Aujourd’hui que chacun a de l’ouvrage et que chacun travaille, une fonction de six heures suffit parfaitement aux besoins d’un homme et de ses enfants dans toutes les professions qui exigent quelque talent, quelque adresse et quelque apprentissage : on se relaie dans les ateliers où le jeu des machines ne souffre pas d’interruption ; ainsi chacun peut jouir du plein air et s’y fortifier par l’exercice sans que la production industrielle en soit affectée. Ceux qui risqueraient, en maniant la hache ou la bêche, de se gâter la main pour des travaux plus délicats, peuvent au moins soigner les fruits et les fleurs, et, s’il leur faut rester à l’établi une ou deux heures de plus que le grand nombre, ils sont d’autant plus libres à la maison.
– Vous avez donc aboli la propriété ? Vous avez installé le travail forcé ? On en parlait déjà de mon temps, mais nous pensions que ce régime ne pouvait aboutir qu’à la misère universelle, et qu’il ne s’établirait jamais.
– Nous ne sommes pas tombés si bas que cela, respectable ancêtre, quoique nous ayons longtemps côtoyé l’abîme. Le programme communiste n’était pas bien attrayant. Nous possédions déjà des maisons où de trop nombreux pensionnaires échangeaient la liberté de leurs mouvements contre une pitance assurée, sans qu’on leur eût demandé la permission de les y placer. La généralisation de ce régime ne semble pas un but digne de grands efforts, cependant bien des gens s’y seraient pliés de bonne grâce pour le plaisir d’y soumettre ceux dont ils enviaient la position. Mais en pareille matière, la minorité ne se soumet pas aux décrets d’une assemblée : réalisable ou non, l’essai du communisme ne pouvait s’imposer que par une guerre d’extermination. Admirez donc une merveilleuse dispensation de la Providence : Lorsque le suffrage universel amena pour la première fois au palais législatif une majorité favorable aux revendications du prolétariat, cette majorité, d’ailleurs peu considérable, accordait sa confiance à des chefs humains et de bonne foi. Ceux-ci convinrent de faire l’expérience du collectivisme dans un district limité, dont les terres qui n’appartenaient pas encore au domaine public purent être acquises de gré à gré. L’épreuve dura aussi longtemps que le permirent les ressources du canton choisi. Elle échoua complètement, parce qu’il fut impossible de conserver et de renouveler les capitaux. Comment obtenir l’épargne de gens qui ont mis tout en commun dans le but exprès de se procurer une existence plus large et qui trouvent tout au plus ce qu’ils estiment un minimum de bien-être dans la répartition des produits annuels ? On comprit que pour s’infliger à soi-même les privations nécessaires au maintien du capital, il ne suffit pas d’y être intéressé pour quelques millionièmes, mais qu’il faut l’être pour toute son épargne, et que par conséquent l’État ne saurait trouver ses capitaux que dans les fortunes particulières. Charger l’État d’amasser, lui qui ne savait que grever l’avenir, autant faire garder le chou par la chèvre !
– Mais, alors, si vous avez laissé la richesse aux particuliers, comment n’avez-vous plus d’oisifs ?
– Nous avons bien des rentiers et des rentières, mais nous n’avons guère d’oisifs que les incapables, dont le nombre tend à baisser. La lésinerie et la paresse ne rencontrent chez nous que le mépris, et pour tenir quelque rang dans le monde en vivant de son revenu, il faut une fortune si considérable que la gestion en devient un travail sérieux. Comptez un peu : sur le pied de 1 à 2 francs par heure, le simple ouvrier gagne en moyenne 3 000 francs, l’intérêt d’environ 200 000 en titres de sécurité. Vous voyez ce qu’il faut posséder aujourd’hui pour vivre en seigneur.
– À ce compte, en effet, le capital mobilier ne peut plus faire vivre un bien grand nombre de fainéants. Mais la propriété foncière ? Car tout ce qu’a perdu l’intérêt, la rente a dû le gagner. Puisqu’il y a tant de capital et tant de travail disponibles, l’agriculture doit avoir été singulièrement perfectionnée, et réellement je crois en voir des indices, même sur ces pauvres hauteurs, qui m’ont toujours paru si belles.
– Ne dites point belles mais plaisantes ! Dans la langue de nos campagnes, un beau pays c’est un pays gras ; elle nomme plaisants ceux où, comme ici, l’air est vif et l’horizon vaste.
– Restons à notre sujet, je vous en supplie. Avec l’abondance du capital dont vous tirez gloire, la rente doit s’être énormément accrue ; les propriétaires du sol sont vos maîtres, car enfin sans eux vous ne pouvez rien.
– Si l’agriculture a fait les progrès que vous soupçonnez, et réellement elle en a fait de considérables, c’est que le sort n’en dépend plus de particuliers ignorants, endettés, sans avances, jaloux les uns des autres et toujours prêts à se contrecarrer. La propriété foncière n’existe plus qu’à titre exceptionnel et inoffensif, ainsi pour les habitations, aussi longtemps qu’elles sont occupées par la même famille, mais non pour les terres de rapport ou pour les chantiers, ni même pour les maisons locatives, dont l’impôt varie avec les mouvements de la rente foncière. Nous considérons la propriété comme un effet et comme une garantie de la liberté. Chacun est propriétaire de son œuvre, parce qu’il est propriétaire de lui-même. Il peut donner, vendre, léguer ce qui est à lui. Mais ce qu’il n’a point fait et qu’il ne tient point de ceux qui l’on fait n’est pas à lui. La propriété du sol n’a jamais existé nulle part qu’en vertu des lois de l’État, et les lois ne doivent plus rester en vigueur lorsqu’elles ont cessé d’être utiles. Nécessaire à son jour pour assurer une meilleure culture des champs répondant aux besoins d’une population croissante, nécessaire alors et par conséquent légitime, la propriété du sol ne fonctionnait plus bien : nous l’avons rachetée. Quelques théoriciens parlaient de la confisquer. C’eût été spoliation toute pure : une fois les terres dans le marché, elles représentaient le produit du travail pour la totalité de leur valeur, et par conséquent une propriété légitime relativement à leurs possesseurs. Mais le droit de l’État à les racheter n’était pas contestable d’après la législation existante. Chacun est demeuré où il était ; les propriétaires ont reçu en obligations du Trésor l’équivalent capitalisé de ce que leur terrain rapportait en moyenne, et ceux qui l’ont désiré sont restés fermiers de l’État, sans qu’on puisse les déposséder, eux ni leurs familles, sinon contre indemnité spéciale, aussi longtemps qu’ils satisfont aux conditions du contrat. Mais le taux des fermages est révisé tous les dix ans.
– L’établissement d’un tel régime a dû coûter beaucoup de sang.
– Les résistances n’ont été ni bien vives ni bien tenaces, parce que lorsqu’on a proposé des mesures législatives, la liberté de la terre avait déjà gagné son procès dans l’opinion. Le mouvement, commencé par la force des choses, s’est propagé par imitation ; les succès obtenus ailleurs ont conduit à nationaliser la terre même dans les pays qui pouvaient, à la rigueur, s’en passer.
– Et cette force des choses, où s’est-elle manifestée en premier lieu ?
– Vous n’ignorez pas, mon père, de quelle façon les Anglais ont traité l’Irlande, comment les cultivateurs du sol ont été expropriés, le plus souvent au profit d’étrangers, et quelquefois au profit des chefs de clan les plus prompts à se soumettre ; vous savez comment les Anglais ont détruit systématiquement l’industrie de l’île sœur. Vous savez que les pauvres Irlandais, n’ayant pour subsister qu’un morceau de terrain concédé à titre précaire, n’en pouvaient tirer qu’une nourriture insuffisante ; si bien que, vers le milieu du XIXe siècle, une seule famine en fit disparaître à peu près le tiers. Vous savez que, réduits à l’extrémité, ils prétendirent arrêter eux-mêmes le chiffre de leurs fermages, que les efforts tardifs, mais sincères, du gouvernement anglais ne réussirent point à rétablir l’harmonie entre les seigneurs terriens et les tenanciers. La guerre civile était en permanence. Cet état de choses eut pour effet une très forte émigration d’Irlandais en Amérique, où chaque parti s’efforça de se concilier les suffrages de ces nouveaux citoyens, dont l’unique désir était d’affranchir et de venger leur ancienne patrie. Mais, par le mouvement naturel des choses, chaque année augmentait la prépondérance des États-Unis. La situation finit par devenir si menaçante que la nécessité de pacifier l’Irlande à tout prix s’imposa au Parlement anglais, dont l’extension progressive de la franchise électorale avait peu à peu modifié sensiblement la composition. Après un essai de constituer une classe d’agriculteurs propriétaires, qui n’aurait pu réussir qu’à la condition de fournir un capital à chaque famille et dont le succès même aurait infailliblement éternisé le prolétariat, le Trésor anglais racheta la terre irlandaise et consentit à de longs baux qui permissent à l’agriculteur d’épargner quelque chose et d’utiliser son épargne à l’amélioration de ses champs. Alors on vit bientôt se réaliser les prévisions de ceux qui avaient combattu cette liquidation d’un passé déplorable. Le bien-être et la liberté nouvelle du fermier parcellaire irlandais donnèrent à penser aux montagnards du Sutherland et aux journaliers du Devonshire. Ils se dirent qu’après tout, pour être un peu plus anciens, les titres des lords anglais n’étaient pas essentiellement supérieurs par leur origine à ceux des propriétaires de l’autre côté du Canal. On comprit qu’un régime où quelques messieurs peuvent requérir la force armée pour chasser un peuple entier du pays natal, en vertu du droit qu’ils possèdent d’user de leur propriété comme il leur plaît, n’est pas un régime normal. On comprit qu’un tel droit n’est pas le droit ; et, sans racheter toute la Grande-Bretagne comme on avait fait de l’Irlande, l’État frappa de tels impôts sur les terrains en friche, il intervint si péremptoirement dans les contrais entre le seigneur et le tenancier que son domaine éminent devint bientôt la propriété effective, et qu’au point de vue économique, le propriétaire nominal ne fut plus guère entre le cultivateur et le Trésor qu’un intermédiaire, toujours autorisé, d’ailleurs, à se liquider et à disparaître lorsqu’il y trouverait son avantage.
– Je commence à vous comprendre. Lorsque je me suis… endormi, on parlait déjà beaucoup de la nationalisation du sol. Henry George aux États-Unis, en Angleterre, Russell Wallace, naturaliste de grand renom, l’un des pères de l’évolutionnisme, qui taisait alors beaucoup de poussière, Colins sur le continent, préconisaient cette mesure ; mais on n’y faisait pas grande attention. Leurs adversaires affectaient d’englober cette question dans celle de la propriété personnelle en général. À vrai dire, on ne prenait pas la peine de les réfuter, on levait les épaules, ou, lorsqu’on commençait à s’inquiéter, on menaçait.
– Ce que vous me dites ne me surprend pas ; la thèse de l’appropriation exclusive du sol à titre permanent ne se présente pas bien sur le terrain de la doctrine pure. Le poignard et la corde étaient les vrais arguments contre les fils de Cornélie.
– Les fils de Cornélie. Dieu que c’est littéraire ! mais n’est-ce pas un peu pédant ?
– Pédantesque, s’il vous plaît, pédantesque ! mais pédantesque ou non, vous me comprenez : ces grands messieurs plébéiens de Rome, Tibérius et Caius Gracchus, voulaient contraindre les patriciens à restituer les domaines qu’ils s’étaient taillés dans les terres de l’État, ager publicus, et ils en furent les mauvais marchands. Eh bien ! au fond, tous les domaines privés quelconques sont partout taillés dans les terres de l’État. La propriété de la terre et la domination sur les personnes sont de leur nature inséparables ; car il n’y a point de travail ni d’existence possibles sans la faculté d’habiter et d’agir quelque part, comme il n’y a pas de liberté possible si cette faculté n’est pas garantie. Aussi bien ne trouvons-nous, en remontant à l’origine des domaines particuliers, que des concessions de l’État temporaires ou perpétuelles, à titre gratuit ou à titre onéreux, puis des usurpations faites sur l’État ou sur ses concessionnaires. Les familles entre lesquelles s’est trouvé partagé le territoire ont exercé l’autorité, soit individuellement, soit collectivement ; et quand, ensuite du développement des villes et de l’industrie, le pouvoir politique a réellement cessé de leur appartenir, les titres de la propriété foncière se sont trouvés mis en question par le fait même. La propriété du sol et la propriété privée en général, qui ont eu si longtemps les mêmes défenseurs et les mêmes adversaires, reposent sur des principes absolument différents, pour ne pas dire opposés : la propriété mobilière, c’est la libre disposition de mon travail, c’est une question de liberté, c’est une question de droit naturel. Et la distinction que faisaient les collectivistes entre l’objet de consommation, qui peut être approprié, et le capital, qui ne pourrait pas l’être, n’est défendable ni dans son principe – parce que tous deux ont la même origine, ni dans sa fin – parce qu’elle aboutit à l’esclavage universel. La propriété du sol, en revanche, est une question de droit positif, c’est-à-dire une question de convenance, une question d’utilité, et finalement une question de force.
– Aussi conçois-je bien que la terre ait fait retour à l’État dans les pays où les propriétaires fonciers étaient peu nombreux ; mais dans ceux où ils conduisaient la charrue de leurs propres mains, comme ils le faisaient ici même, dans ceux où ils étaient le nombre et la force, l’armée et la loi, alors je ne comprends plus du tout.
– Un tel changement n’était pas possible en effet, aussi longtemps que le paysan n’y trouvait pas son compte lui-même ; mais si les trop grands domaines sont mal cultivés, les trop petits morceaux deviennent incultivables. En avilissant le prix des récoltes, la concurrence de l’étranger oblige le laboureur à perfectionner ses procédés : il faut réunir les parcelles pour y tracer un sillon, et l’agriculture dévient sociétaire. On a résisté longtemps à cette évidence ; il a fallu finir par y céder. Et cela n’a pas suffi. L’agriculture ne peut se protéger qu’en renchérissant la subsistance de l’ouvrier. On ne pouvait pas y songer, dans ce pays. Abandonner le travail des champs ou leur faire rendre davantage : telle était l’alternative, et toute augmentation de production sérieuse exigeait des connaissances que le simple paysan ne pouvait pas acquérir, des capitaux qu’il ne savait où prendre, enfin des travaux collectifs de canalisation, d’irrigation, d’endiguement, de dessèchement et tant d’autres, trop considérables pour un Trésor dont l’impôt formait l’unique ressource.
Quand le cultivateur aurait été propriétaire en fait comme il l’était nominalement, je ne pense pas que la réforme eût jamais abouti ; mais s’il ne trouvait pas de préteur pour acheter des machines agricoles et des engrais chimiques, c’est que ses terres étaient hypothéquées pour la totalité de leur valeur décroissante. Et quels étaient les détenteurs de ces créances ? Des crédits fonciers, des banques publiques dont l’administration appartenait à l’État. Lorsque l’opinion, excitée par les succès obtenus ailleurs, commença à se prononcer dans le sens du rachat des terres, le public, sinon l’État, s’en trouvait déjà propriétaire plus qu’à moitié ; il s’agissait moins d’opérer la révolution que de l’avouer, de la régulariser et d’en tirer parti. On en avait déjà les inconvénients, il était temps de s’en procurer les avantages. C’est ce qui explique comment il y eut si peu de résistance, et comment l’État trouva le crédit nécessaire à cette immense opération. On ne racheta d’ailleurs que ceux qui le voulaient bien, ou qu’on pouvait forcer à se liquider par l’application des lois antérieures. Pour tous les autres, on attendit, en prenant les droits de mutation sur les biens-fonds non plus en argent, mais en nature, autant que cela pouvait se faire sans détriment pour le reste des héritages, en limitant l’aptitude à succéder des collatéraux quant aux immeubles, en accourant à l’État le droit de préemption et en prenant les mesures nécessaires pour que le propriétaire d’un fonds enclavé dans le domaine public ne pût pas en gêner l’exploitation. La propriété privée de la terre n’est plus aujourd’hui qu’une exception qui tend à disparaître et ne confère plus de privilège. Le sol arable est divisé en fermes de diverses grandeurs, exploitées soit par des familles, soit par des associations d’agriculteurs, qui s’en partagent les produits.
– Mais alors, docte forgeron, si votre agriculture perfectionnée exige tant de connaissances et tant d’appareil, tout le profit doit aller aux capitalistes et aux entrepreneurs qui font exécuter les travaux sous leur direction moyennant salaire.
– Non, vieillard, celui qui voudrait travailler ainsi de nos jours n’y trouverait pas son avantage. La main-d’œuvre reviendrait trop cher. Chacun ayant où s’occuper à son compte ne fait de journées au profit d’autrui que moyennant un salaire supérieur à ce qu’il aurait pensé gagner dans sa propre affaire.
– Ce n’est donc plus le salaire qui fournit à l’ouvrier son entretien ? De mon temps, on s’agitait aussi contre lui dans quelques cercles ; mais cette opposition de cabinet ne semblait pas de taille à réaliser jamais ses utopies. Quant aux ouvriers, les plus ambitieux, s’ils étaient habiles, parvenaient à s’établir, pour bénéficier à leur tour d’une mieux-value sur le travail de leurs anciens compagnons. La masse ne comprenait pas d’autre moyen de subsister que la paie de la semaine ; les ouvriers allemands, les Belges, beaucoup de Français auraient voulu que l’État devint l’unique patron. Les Anglais et les Américains n’avaient pas foi dans cette centralisation de l’industrie et se bornaient à s’associer pour débattre le montant des salaires avec leurs maîtres ; tandis qu’ils réclamaient l’intervention des gouvernements pour limiter la durée du travail dans les usines et sur les chantiers. Des ouvriers étaient parvenus à diminuer leurs frais d’entretien en faisant concurrence aux revendeurs avec des magasins dont ils étaient propriétaires eux-mêmes, et qu’ils appelaient coopératifs ; mais la coopération de production ne jouait qu’un rôle très effacé ; les simples ouvriers qui avaient essayé de s’associer pour l’exercice de quelques industries avaient échoué presque constamment par défaut de crédit, de direction, de discipline ou d’économie. Cinq à six ouvriers sûrs les uns des autres réussissaient quelquefois à monter de petites affaires, et, lorsqu’ils échouaient, les perles n’étaient pas considérables ; mais l’association coopérative proprement dite ne pouvait pas s’attaquer à la grande industrie, qui exige des millions d’avances, qui occupe des milliers de bras et qui défie toute concurrence par le bon marché de ses produits. Cependant quelques exceptions fameuses prophétisaient déjà les révolutions dont vous m’informez. De leur côté, certains patrons avaient essayé d’associer tout ou partie de leurs ouvriers à leurs bénéfices, sans abandonner la propriété et la direction souveraine de leurs entreprises. Quelques-uns avaient brillamment réussi ; plusieurs avaient abandonné ce système au bout de peu d’années, soit qu’ils n’eussent pas obtenu de leurs ouvriers la reconnaissance qu’ils croyaient avoir méritée, soit qu’ils aient reculé devant l’humiliation de n’avoir rien à partager à la fin d’une campagne malheureuse.
– Ces tentatives, monsieur, n’ont pas été perdues. Ce qui, de votre temps semblait un rêve est devenu la réalité. Nous avons, je vous l’ai dit, écarté le collectivisme, l’intérêt personnel du travailleur est resté le mobile de la production ; mais toute notre industrie est sociétaire aussi bien que notre agriculture. L’État n’est chez nous, pour ainsi dire, qu’une association d’associations. Tous les ouvriers d’une mine ou d’une fabrique en sont plus ou moins copropriétaires. Le capitaliste est tantôt simple créancier moyennant un intérêt fixe, tantôt actionnaire pour son capital ; le directeur, les gérants, les hommes de main sont actionnaires pour le montant de leur épargne, et cette épargne commence automatiquement dès le jour de leur entrée dans rétablissement social. Seuls, les auxiliaires de quelques jours touchent intégralement le prix de leur journée ; ceux qui sont agréés pour une occupation permanente subissent une retenue qui se capitalise à leur profit dans la maison. Quant à la direction, au commandement et à la discipline, l’organisation en varie dans chaque affaire suivant son origine et sa nature. La coopération, la participation des ouvriers aux bénéfices, qui en est l’avenue, se partagent le champ de l’industrie et se combinent suivant des modes que l’expérience a ramenés à quelques types définis.
– Et comment, je vous prie, un tel régime a-t-il pu s’établir.
– Par la volonté des ouvriers, qui est devenue toute puissante du moment où ils sont parvenus à s’entendre. Le suffrage universel a placé le riche à la merci du pauvre et commis à l’ignorance la charge de la civilisation. Il eût mieux valu sans doute laisser le gouvernement de la société entre les mains des classes instruites et fortunées, si les savants et les riches avaient jamais gouverné dans l’intérêt du grand nombre et non dans leur intérêt particulier ; mais toujours et partout, on a vu les privilégiés user de leurs prérogatives pour les affermir et pour les étendre. Il a fallu que le peuple prit en main lui-même le soin de ses affaires. Il a voulu qu’on l’éclairât, et les progrès de l’instruction l’ont amené graduellement à l’intelligence de ses intérêts économiques. Quatre millions d’hommes étaient casernés en Europe à la fin du XIXe