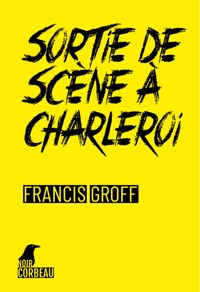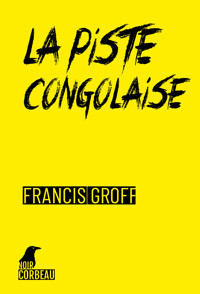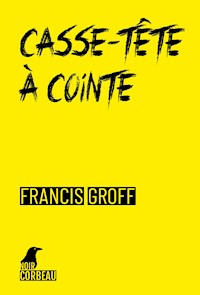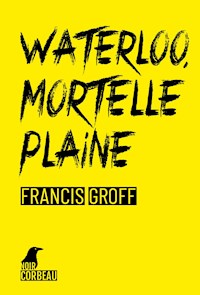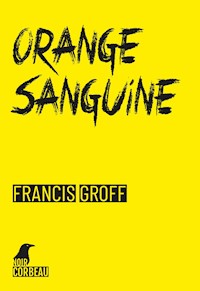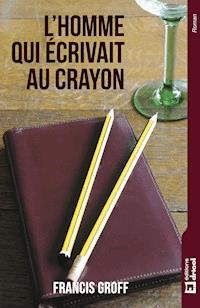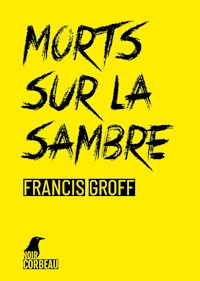
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Stanislas, un bibliophile passionné, fait une escale à Charleroi et se retrouve mêlé à la mort d'un juge d'instruction à la drôle de réputation...
Bibliophile passionné, Stanislas Barberian parcourt la France et la Belgique à la recherche de pièces rares. En visite à Charleroi, au cœur du Pays noir où il est né, il se trouve mêlé à la mort accidentelle d’un juge d’instruction à la réputation sulfureuse. Accidentelle ? Voire… Le bouquiniste met le doigt sur un élément troublant, au grand dam du commissaire chargé de l’enquête et qui goûte fort peu l’intrusion d’un « civil » dans ses affaires.
Persuadé qu’il y a eu crime, Stanislas mène ses propres investigations et croise une ex-épouse mutique, des truands violents, des escort girls, des enquêteurs au comportement étrange…
Dans ce polar troublant, Stanislas va se lancer dans ses propres recherches au coeur de son Pays noir, parmi une série de personnages décidément bien étranges.
EXTRAIT
Cette silhouette figée avait quelque chose de déroutant et d’inquiétant à la fois. En se rapprochant, il se dit que l’homme attendait sans doute un chien divaguant à quelques mètres, derrière une haie ou dans le fossé séparant le chemin du halage des prairies avoisinantes. Machinalement, il ralentit sa course, car il ne connaissait que trop bien les réactions parfois dangereuses d’animaux effrayés par le passage d’un coureur. Au moment où il arrivait à hauteur de l’homme dont le visage était protégé par une large écharpe, il eut un brusque pressentiment, puis tout se passa très vite. L’homme tendit les bras en avant, comme pour le stopper par les épaules, puis pivota vivement sur la gauche en pliant le genou et en courbant le dos. Emporté par son élan, Jean-Régis de Chassart bascula vers la droite, piqua du nez vers le bord du chemin, tenta désespérément de se retenir à une touffe d’herbes et bascula la tête la première dans l’eau. Sans un cri.
Dans la seconde, il sentit comme une gifle glaciale lui cingler le visage. L’eau était tout au plus à deux ou trois degrés et le contact avec son front en sueur lui fit l’effet d’un électrochoc. Que se passait-il? Il n’en savait rien, mais il avait compris que sa chute n’était pas un accident. Il s’accrocha à une grosse pierre, sortit la tête de l’eau et vit son agresseur à trois mètres à peine, penché vers lui.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste en presse écrite, radio et télévision, réalisateur de documentaires pour la télévision et scénariste,
Francis Groff a écrit une douzaine de livres à caractère journalistique avant de se lancer dans l’écriture de fictions.
Morts sur la Sambre est son deuxième roman. Il étrenne une série d’enquêtes menées par Stanislas Barberian au hasard de ses rencontres dans diverses régions de Belgique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Une enquête de Stanislas Barberian
DESCRIPTIF
La collection de romans policiers Noir Corbeau bénéficie du regard averti de François Périlleux, Commissaire Divisionnaire (e. r.), ancien chef de la Crime à la Police Judiciaire Fédérale de Liège.
PROLOGUE
Comme toujours à cette heure matinale, les abords de l’écluse de Landelies étaient déserts. Dans leur haute maison dont deux fenêtres laissaient passer une lumière jaunâtre, chaudement tamisée par des filets de brume, l’éclusier et sa famille terminaient probablement le petit déjeuner, mais nul bruit ne filtrait au-dehors.
Jean-Régis de Chassart arrêta son véhicule à l’entrée du chemin de halage, sur le petit parking réservé à cet effet, puis il jeta un coup d’œil à l’indicateur de température extérieure. Celui-ci affichait deux degrés sous zéro. Il soupira et coupa le moteur en pensant au froid qui allait lui scier le bas des reins et la nuque quand il quitterait l’habitacle.
Depuis une petite année, il s’efforçait de courir deux fois par semaine pour tenter de préserver une forme physique qu’une cinquantaine naissante avait largement entamée. À la vérité, cet exercice bihebdomadaire n’avait que peu d’effets visibles sur son corps trapu aux rondeurs confortables, mais le bénéfice psychologique qu’il en retirait était à la mesure des efforts déployés. Le fait de s’astreindre régulièrement à un footing qui l’ennuyait profondément et le faisait souffrir tout autant lui procurait paradoxalement un sentiment de bien-être qu’il associait à une forme d’hygiène mentale.
Lorsqu’il regagnait sa voiture, trempé de sueur et les genoux douloureux après trois quarts d’heure de course, il était invariablement envahi par une sorte de sérénité qu’il tentait d’entretenir le plus longtemps possible au cours de la journée. À l’inverse, si la soirée s’était prolongée la veille ou si, le jour même, les devoirs de sa charge l’empêchaient de courir, il en concevait une profonde amertume.
Depuis quelques semaines, les séances matinales réclamaient de plus en plus de volonté en raison du froid qui s’installait progressivement et du manque de clarté. Les fêtes de fin d’année étaient déjà oubliées, mais pas le supplément de poids enregistré sur la balance. Et le vent de cette fin janvier était particulièrement mordant au bord de l’eau.
Il était à peine sept heures trente. Jean-Régis appréciait les petits matins dans ce coin verduré de la région de Charleroi où coule la Sambre. S’il n’y avait pas ce foutu vent…
Il soupira à nouveau et sortit en remontant la fermeture éclair de son vieux blouson. Il ouvrit le coffre, enfila prestement un coupe-vent, et jura en constatant qu’il avait oublié ses gants. Après avoir bouclé autour de sa taille une ceinture banane dans laquelle il glissa ses clés de voiture, son portable et son iPod, il ajusta ses écouteurs, dépassa la maison de l’éclusier, puis s’élança le long du chemin de halage.
Le sol était sec et il ne risquait pas de glisser. En quelques secondes, il quitta la zone éclairée, puis il se tint volontairement du côté droit du fin ruban d’asphalte en attendant que ses yeux s’habituent à l’obscurité ambiante. D’expérience, il savait que les canards – souvent nombreux à cet endroit – dormaient encore par petits groupes du côté gauche, au bord de l’eau. Il n’avait aucune envie de piquer une tête dans la rivière après avoir trébuché sur un volatile.
Autour de lui, la brume s’étendait mollement au-dessus de l’eau et des prairies. Sur l’autre bord, le versant boisé de la vallée dessinait une masse sombre dont la crête commençait lentement à se détacher sur un ciel naissant. Un faible courant parcourait la Sambre et un poisson fit naître un frisson fugitif à la surface de l’eau. Le bruit des Nike s’écrasant régulièrement sur le bitume n’était troublé que par la respiration encore irrégulière du coureur.
Après une dizaine de minutes, Jean-Régis de Chassart ouvrit légèrement le col de son survêtement. Son corps s’était réchauffé et des gouttes de sueur commençaient à envahir son visage. Il avait parcouru environ un quart du chemin et il longeait maintenant une voie de chemin de fer surélevée d’une demi-douzaine de mètres sur sa droite. C’était l’endroit le plus exposé au vent qu’il prenait de face en cette saison, mais il n’aurait pas pu conserver son col fermé plus longtemps. Il passa rapidement un mouchoir sur son visage et entreprit de faire le point sur la journée qui se préparait. À l’origine, lorsqu’il avait commencé à courir l’année précédente, il avait naïvement cru qu’à la faveur de l’exercice physique, ses pensées l’orienteraient vers des sujets futiles, mais ça n’avait jamais été le cas. Il s’en était accommodé et profitait depuis lors de ses séances de footing pour réfléchir à des dossiers en cours ou préparer ses entretiens de la journée.
Lorsque le coureur fit demi-tour à hauteur du panneau annonçant l’écluse suivante, une lumière ouatée commençait à prendre le dessus sur la pénombre ambiante et, en maints endroits, les canards se secouaient vigoureusement avant de se laisser glisser dans l’eau. Un héron cendré passa silencieusement à une dizaine de mètres et se posa dans un pré, non loin d’un filet d’eau serpentant dans l’herbe sombre et qui drainait vers la rivière le trop-plein des pluies de la nuit.
À l’entame de l’avant-dernière courbe, alors qu’il n’était plus qu’à trois ou quatre minutes de course du parking où il avait rangé sa voiture, Jean-Régis de Chassart aperçut un homme planté au beau milieu du chemin, à une centaine de mètres devant lui. L’individu était immobile, ce qui ne laissa pas de l’intriguer. À cette heure matinale, les rares promeneurs qu’il croisait marchaient d’un bon pas, seuls ou accompagnés d’un chien. Plus rares encore étaient les cyclistes amateurs ou les joggeurs qui, comme lui, venaient sacrifier un peu de sueur sur l’autel de leurs ambitions pondérales.
Cette silhouette figée avait quelque chose de déroutant et d’inquiétant à la fois. En se rapprochant, il se dit que l’homme attendait sans doute un chien divaguant à quelques mètres, derrière une haie ou dans le fossé séparant le chemin du halage des prairies avoisinantes. Machinalement, il ralentit sa course, car il ne connaissait que trop bien les réactions parfois dangereuses d’animaux effrayés par le passage d’un coureur.
Au moment où il arrivait à hauteur de l’homme dont le visage était protégé par une large écharpe, il eut un brusque pressentiment, puis tout se passa très vite. L’homme tendit les bras en avant, comme pour le stopper par les épaules, puis pivota vivement sur la gauche en pliant le genou et en courbant le dos. Emporté par son élan, Jean-Régis de Chassart bascula vers la droite, piqua du nez vers le bord du chemin, tenta désespérément de se retenir à une touffe d’herbes et bascula la tête la première dans l’eau. Sans un cri.
Dans la seconde, il sentit comme une gifle glaciale lui cingler le visage. L’eau était tout au plus à deux ou trois degrés et le contact avec son front en sueur lui fit l’effet d’un électrochoc. Que se passait-il? Il n’en savait rien, mais il avait compris que sa chute n’était pas un accident. Il s’accrocha à une grosse pierre, sortit la tête de l’eau et vit son agresseur à trois mètres à peine, penché vers lui. Il voulut lui hurler une insulte, mais son cri se noya. Quelque chose ou quelqu’un venait de lui enfoncer brutalement la tête sous la surface en l’éloignant du bord. Comme un gros poisson piégé dans une nasse trop petite, il eut quelques soubresauts désespérés, s’écorcha les mollets contre les pierres qui consolident la berge à cet endroit et tenta de se libérer de l’étreinte qui le maintenait sous la surface. Il réussit finalement à saisir un bras, mais ses doigts crochaient dans une matière caoutchouteuse. Il continua ainsi à lutter durant une éternité tandis que son cœur battait à tout rompre.
Il allait mourir là, loin de tous, dans cette eau froide et puante, sans savoir pourquoi. À cette pensée, il se révolta. Il mobilisa l’énergie qui lui restait pour peser de toutes ses forces sur son pied droit qui avait enfin trouvé un appui. La manœuvre surprit son adversaire et il réussit à sortir le visage de l’eau, aspirant à pleins poumons l’air glacial. Mais l’intermède salvateur ne dura que deux ou trois secondes. À nouveau, il sentit une main faire pression sur le sommet de son crâne. En voulant prendre une nouvelle goulée d’oxygène, il avala une gorgée de liquide fétide et s’étouffa en voulant la recracher. Il sentait maintenant le corps de son meurtrier s’enrouler autour du sien, jambes et bras serrés comme des liens impossibles à défaire.
Il eut comme un éclair violent devant les yeux et, soudain envahi par une immense détresse, il décida de ne plus lutter.
Il ouvrit la bouche, hurla comme un fou en recrachant les dernières bulles d’air saturé qui se trouvaient encore dans ses poumons en feu, puis il avala une dernière gorgée de cette eau au goût de vase qui allait devenir son triste et glauque linceul…
CHAPITRE PREMIER
«Un accident regrettable et dramatique», conclut Oscar Lambermont d’un ton de circonstance, en mirant son verre d’alcool dans les reflets changeants du feu de bûches qui ronflait dans la cheminée en pierre.
Bien calé dans le profond fauteuil que lui avait indiqué son hôte en passant au salon, Stanislas Barberian luttait contre une indicible envie de fermer les yeux. Non pas que la conversation fut assommante, mais les mets préparés par Madame Lambermont et les vins généreusement servis par le maître de maison avaient pour effet de le plonger dans ce que les écrivains appellent généralement une «douce torpeur».
Stanislas, il est vrai, avait quelques circonstances atténuantes… Parti tôt de Paris le matin même, il avait envisagé de prendre un petit déjeuner léger à la frontière belge et d’arriver à Bruxelles vers neuf heures, avant l’ouverture du magasin de son amie Martine. Une collision en chaîne en avait décidé autrement et l’avait bloqué durant plus d’une heure dans la région de Valenciennes. Le ventre vide, il avait ensuite goûté aux plaisirs relatifs d’une entrée au pas dans la ville de Manneken Pis. À quelques centaines de mètres du centre où il se rendait, le semblant de bonne humeur qu’il s’efforçait de conserver malgré un sort contraire s’était définitivement effacé lorsqu’un piéton pressé de gagner la Gare Centrale avait donné un coup d’attaché-case dans l’aile avant droite de sa voiture. Sans même se retourner ni s’excuser.
Stanislas Barberian n’était pas un grand amateur de voitures, mais il avait un jour eu un coup de foudre pour une Facel-Vega rouge de 1963 qui se momifiait à l’arrière d’un garage de la région de Charleroi, son Pays noir natal. Il avait convaincu un carrossier italien du coin de remettre en état l’ancêtre. L’artisan avait réalisé un travail remarquable, moyennant une somme rondelette, discrètement payée de la main à la main. Durant de nombreuses années, sa Facellia avait intrigué nombre de connaissances ou de simples passants. Puis la série télévisée Les petits meurtres d’Agatha Christie avait remis sous les feux de l’actualité cette voiture mythique de l’industrie automobile française, conduite par l’acteur Samuel Labarthe sous les traits du distingué commissaire Swan Laurence.
À la vérité, Stanislas n’avait que peu goûté cette intrusion télévisuelle dans son petit jardin secret. Mais il reconnaissait en souriant que, depuis lors, certaines femmes croisées au hasard des rues de Paris ou de Bruxelles lui jetaient un regard empreint de curiosité. Peut-être s’attendaient-elles à voir le comédien suisse au volant de la belle sportive?
Quoi qu’il en soit, Stanislas tenait à sa Facellia comme un académicien à son épée et il ne tolérait pas la moindre agression, fut-elle involontaire, envers la respectable vieille dame. Ceci explique pourquoi, lorsqu’il poussa la porte du Vieux Lutrin, la librairie que Martine exploitait non loin du quartier du Sablon, Stanislas avait le visage contrarié, le regard lourd et des idées de meurtre dans la tête.
Martine l’accueillit par un long et tendre baiser qui eut l’heur de le détendre quelque peu. La quarantaine souriante, la «fiancée» de Stanislas faisait partie de ces personnes éternellement de bonne humeur et que rien – ou presque – ne semble atteindre. D’une résistance à toute épreuve face aux désagréments de la vie, elle était d’un naturel optimiste et considérait que la plupart des aléas du quotidien ne valaient pas la peine que l’on s’y attarde. Selon le vieil adage qui veut que «quand la santé va, tout va», elle s’efforçait de mener une vie saine, exempte de tout stress et agrémentée d’un zeste de sport. Cette philosophie basique ne lui avait pas trop mal réussi et son dynamisme faisait l’admiration de son entourage.
Martine était fille unique, divorcée et sans enfant. Son ex, prénommé Jan, était un graphiste non dénué de talent avec qui elle avait passé quelques années de vrai bonheur. Puis l’ambition professionnelle du jeune homme l’avait conduit à sacrifier de plus en plus de temps à son travail. Lorsqu’il avait décidé de créer sa propre entreprise, cette addiction était devenue problématique. Soucieux de développer son réseau et sa clientèle, Jan ne comptait plus les soirées et les week-ends consacrés à ses contrats et ses projets.
Martine, à qui son diplôme de romaniste avait ouvert les portes d’une bibliothèque communale bruxelloise où elle travaillait à trois quarts temps, souffrait de cette situation et s’en était souvent plainte à son mari. Celui-ci comprenait, bien sûr. Mais son statut de jeune indépendant ne lui laissait, disait-il, pas le choix. Il fallait sans cesse faire la chasse aux clients et, pour remporter des contrats, travailler à prix cassés tout en multipliant les heures pour payer le loyer, acheter le matériel, investir dans des projets novateurs. Chaque fois que le sujet revenait sur le tapis, il prenait les mains de Martine, tentait de la rassurer, et lui promettait que tout cela n’aurait qu’un temps. Qu’elle devait prendre patience. Qu’il réussirait bientôt. Et qu’il ferait alors appel à d’autres graphistes plus jeunes pour l’aider.
Un beau matin, alors que le couple déjeunait en silence et que Jan consultait ses mails comme chaque jour en avalant distraitement ses céréales, Martine s’était levée et avait commencé à préparer ses valises. Tout s’était passé sans heurt, sans un mot plus haut que l’autre. D’abord incrédule, Jan avait promis qu’il allait «lever le pied», qu’ils allaient prendre quelques jours de repos en Alsace pour oublier tout cela et qu’il ferait le nécessaire pour consacrer désormais plus de temps à leur vie de couple. Mais il avait vite compris que rien ne ferait revenir Martine sur sa décision.
Jamais Jan ne travailla autant qu’au cours des mois qui suivirent cette rupture. Martine, elle, était revenue vivre chez ses parents, le temps de faire le point et de trouver un autre logement.
Le hasard voulut qu’à la même époque, un ami de son père mette en vente sa librairie située au cœur de Bruxelles. En fait de librairie, il s’agissait d’un commerce de vente et d’achat de vieux livres, doublé d’une petite activité similaire consacrée aux affiches, principalement des publicités pour des voyages transatlantiques du début du xxe siècle, le thermalisme et le tourisme balnéaire.
Passionnée de vieux bouquins, grande «coureuse» de brocantes et de salles de ventes, Martine n’était certes pas une spécialiste, mais son amour des livres et son travail de bibliothécaire adjointe l’avaient dotée d’une vraie culture en la matière. L’opportunité était belle et les parents de Martine proposèrent à leur fille de lui offrir une partie de la somme nécessaire au rachat de la boutique, à charge pour elle de compléter avec un emprunt personnel aux mensualités raisonnables.
Comme s’il était écrit qu’un tel changement de vie doit avoir un corollaire au plan sentimental, c’est aussi une histoire de livres qui fit se rencontrer Martine et Stanislas quelques mois plus tard. L’occasion était la braderie de Lille, le décor un stand tenu par un bouquiniste réputé et l’étincelle, une édition originale de sa célèbre Physiologie du goût publiée par Jean Anthelme Brillat-Savarin en 1826, deux mois avant son décès.
En fait d’étincelle, celle-ci se produisit suite à un malentendu. Il faut savoir qu’à l’origine, le magistrat gastronome avait publié son œuvre de façon anonyme, à compte d’auteur et en deux tomes. Martine achevait d’en feuilleter un et se préparait à examiner le second lorsqu’elle eut la mauvaise idée de reposer le premier volume sur une pile voisine. Stanislas, qui venait lui-même de déposer une vieille bible, aperçut le livre et s’en empara, ignorant tout de l’intérêt manifesté par Martine. Après avoir examiné l’ouvrage avec soin, il interpella le bouquiniste en lui demandant s’il possédait l’autre tome. On devine la suite: face à deux clients potentiellement intéressés, le bouquiniste annonça son prix en se réjouissant intérieurement d’une probable surenchère au terme de laquelle il vendrait le lot au mieux-disant.
Mais ses clients n’étaient pas des amateurs. Tous deux firent d’abord état de leur profession et réclamèrent la réduction généralement accordée entre «collègues». Puis, au cours d’une confrontation digne du Secret de la Licorne d’Hergé où Tintin, le collectionneur Sackharine et le bandit Barnabé se disputent la maquette du célèbre navire, ils se chamaillèrent sur le point de déterminer qui avait priorité sur qui. Pris à témoin, le marchand sentit sa chance revenir et proposa à ses interlocuteurs une enchère à deux. C’est alors que, devant les protestations véhémentes de la jeune femme, le second protagoniste accepta subitement de renoncer à son achat. «À condition, enchaîna-t-il en souriant, que vous acceptiez de prendre un verre en ma compagnie. Après tout, nous sommes collègues et nous avons peut-être des intérêts communs.»
C’est ainsi que le bouquiniste lillois dut renoncer à la plus-value espérée et que les deux amateurs d’ouvrages anciens firent leurs premiers pas vers ce qui allait devenir une aventure commune.
À quarante-quatre ans, Stanislas Barberian présentait un bilan de vie plutôt satisfaisant pour un homme qui avait réussi à faire d’une passion son gagne-pain.
Né dans la ceinture industrielle de Charleroi, d’un père belge et d’une mère française, il y avait vécu une enfance sans souci avant d’entamer des études en Histoire à l’Université de Liège. À l’origine, il se destinait à l’enseignement, mais de nombreux travaux en bibliothèque lui avaient progressivement donné le goût des livres, et singulièrement celui des écrits relatifs à l’époque médiévale.
À vingt-quatre ans, après avoir suivi une formation complémentaire en commerce d’antiquités tout en exerçant divers emplois alimentaires, il avait quitté la cité de Simenon pour gagner Paris où un oncle de sa mère tenait une librairie spécialisée dans les ouvrages universitaires. Ce parent éloigné était un homme charmant et un lien de confiance s’était rapidement tissé entre eux. Lorsque, moins d’un an plus tard, Stanislas avait proposé d’ouvrir un petit département de livres rares, l’oncle avait accepté de bonne grâce en lui accordant un budget de départ et quelques heures de temps libre par semaine pour fouiner chez les bouquinistes.
En peu de temps, le jeune Belge avait fait montre d’un flair et d’un sens des affaires remarquables, développant «sa» section avec un succès tel qu’après quelques années, il ne fut plus possible de maintenir la nouvelle activité dans les locaux pourtant spacieux de la librairie universitaire. Au terme d’un accord passé avec l’oncle, Stanislas s’installa à son compte dans une rue improbable, proche du quartier du Montparnasse, où il trouva son bonheur dans une ancienne quincaillerie fermée depuis des lustres. Les lieux étaient restés en l’état, avec de grandes étagères en bois, des dizaines de tiroirs qui se révélèrent précieux pour ranger de vieux papiers, et une arrière-cour que Stanislas aménagea en réserve après l’avoir couverte. Comme souvent, l’étage était dans un état de délabrement proche de l’insalubrité et le jeune homme mit des mois pour y aménager un petit appartement agréable. Mais le résultat fut à la hauteur de l’énergie dépensée.
Lorsqu’il fit la connaissance de Martine à Lille, Stanislas venait de fêter le huitième anniversaire de sa librairie. Sa Malle aux livres s’était taillé une jolie réputation dans le monde ouaté des vieux livres et des vieux papiers. Au fil du temps, Stanislas Barberian avait développé en France et en Belgique un réseau qui réunissait à la fois une clientèle avisée, des collectionneurs parfois désireux de se débarrasser de belles pièces, et des dizaines de bouquinistes ou d’amateurs qui l’alimentaient à longueur d’année. Ses «rabatteurs», comme il les appelait, appréciaient son sérieux et sa correction en matière de prix. Parallèlement, Stanislas s’était fait remarquer dans le milieu en publiant un ouvrage fort joliment documenté sur les premiers imprimeurs en Europe. Depuis lors, des salles de vente renommées faisaient de plus en plus souvent appel à ses lumières pour la rédaction d’éléments de catalogues.
Pour dénicher des pièces rares ou recherchées, Stanislas parcourait Paris, la France et les pays limitrophes à longueur d’année, ce qui le tenait éloigné de la librairie deux jours par semaine, parfois davantage. Lors de ses absences, il pouvait compter sur l’aide efficace d’une ancienne employée de son oncle prénommée Clotilde, une sorte de gardienne du temple qui régnait alors en maîtresse absolue parmi les rayons surchargés de La Malle aux livres. Véritable puits de science livresque, Clotilde connaissait tout, avait réponse à tout, et voyait tout. Rien ne lui échappait.
Quelques voleurs à la petite semaine en avaient fait la honteuse expérience et leurs visages étaient gravés dans la mémoire de la redoutable libraire aussi bien que dans les méandres électroniques d’un fichier de police. Du côté face, Clotilde était donc une auxiliaire précieuse. Du côté pile, son aide avait toutefois une contrepartie: un caractère épouvantable qui expliquait probablement pourquoi cette sexagénaire de choc n’avait jamais goûté aux fruits du mariage.
Stanislas était également célibataire, mais pas pour des raisons similaires. D’allure décontractée malgré une mise toujours impeccable, le cheveu noir et dru planté sur une tête plutôt bien faite, le quadragénaire plaisait aux femmes qui n’étaient pas insensibles à sa voix posée, à son mètre 88 et à des yeux brun-vert qui mentaient rarement. Passionné par son travail qu’il avait la coquetterie d’appeler son «hobby», il affichait un petit penchant pour la bonne chère, le whisky irlandais et les bières trappistes. Un tiercé gagnant sur le plateau d’une balance qui oscillait entre nonante et nonante-trois kilos.
Après avoir butiné durant des années et même frôlé le mariage, il avait donc rencontré Martine quatre ans plus tôt.
En fait, leur relation n’avait rien de classique dans la mesure où plus de trois cents kilomètres les séparaient. Martine était donc devenue une ardente usagère du Thalys vers la capitale française et Stanislas remontait fréquemment à Bruxelles en voiture le samedi en fin de journée. Il s’organisait pour programmer en début de semaine ses rendez-vous en Belgique et dans le nord de la France, ce qui permettait au couple de partager une vie commune durant quelques jours, plusieurs fois sur le mois. L’un et l’autre s’étaient habitués à ce rythme et, ce qui ne gâte rien, ils travaillaient désormais ensemble.
Cette fois, c’était d’ailleurs à la demande de Martine que Stanislas se trouvait au domicile d’Oscar Lambermont. Client occasionnel du Vieux lutrin, ce collectionneur de Jules Verne possédait une belle collection d’ouvrages parus chez Hetzel et il souhaitait se séparer de quelques-uns d’entre eux. Martine lui avait proposé de rencontrer Stanislas qui était, dans ce domaine, plus compétent qu’elle pour estimer les livres de valeur au sein de la prolifique collection. Après quelques entretiens téléphoniques qui avaient permis à Stanislas d’affiner son offre et d’étudier une possibilité d’échange pour certains ouvrages, rendez-vous avait été pris pour ce jour, sur le coup de midi trente. Le collectionneur avait ajouté que cela leur permettrait de manger un bout «à la bonne franquette» pour discuter de leur affaire dans d’agréables conditions. Il avait cru bon préciser que Madame Lambermont était une fine cuisinière et que lui-même prendrait congé l’après-midi…
Ce rendez-vous sentait le piège à plein nez et Stanislas se souvenait de quelques gueuletons mémorables, improvisés au plus profond de la province française avec des amateurs de livres passionnés. Mais il n’était pas homme à refuser l’obstacle. Peu après onze heures, après avoir bu une tasse de café en parlant de ses dernières acquisitions avec sa compagne, Stanislas avait quitté Bruxelles et repris la route pour Landelies, un petit village de la banlieue verte de Charleroi.
Procureur du Roi à Charleroi, Oscar Lambermont habitait une belle maison enfouie dans les arbres dominant le bief de la Sambre. N’était la voie de chemin de fer un peu trop proche, l’endroit était reposant et les levers de soleil devaient y être superbes. La maison avait du charme et de hautes baies vitrées s’ouvraient largement sur la vallée.
De petite taille, l’œil malin et le verbe précieux, Oscar Lambermont arrivait au terme d’une carrière bien remplie et il prenait désormais quelques libertés avec ses horaires habituels de travail. En invitant Stanislas à déjeuner, il se faisait plaisir tout en créant, du moins l’espérait-il, un climat propice à une discussion fructueuse concernant la vente de ses livres.
Durant le repas – au cours duquel ils avaient dégusté un faisan aux chicons digne des meilleures tables – les deux hommes avaient, bien sûr, parlé livres. Puis, au moment du dessert, la conversation avait dévié sur un fait divers survenu la veille à quelques centaines de mètres à peine, sur le chemin de halage.
C’est Madame Lambermont qui, au moment de servir un crumble aux pommes aux saveurs délicates, avait parlé de la mort du juge d’instruction Jean-Régis de Chassart, retrouvé noyé par un promeneur matinal. Visiblement marquée par l’accident, elle avait commencé à évoquer les circonstances du drame, mais son époux l’avait arrêtée d’un geste, estimant qu’elle ne devait pas importuner leur invité avec la mort d’un homme qu’il ne connaissait pas.
Par politesse, autant que pour faire plaisir à la cuisinière qui l’avait si talentueusement accueilli, Stanislas avait protesté et c’est ainsi que le procureur lui-même s’était lancé dans la relation des faits. Dans cette vallée calme, essentiellement traversée par des personnes se rendant à l’abbaye d’Aulne toute proche, les incidents étaient rares. Tout au plus quelques histoires de promeneurs attaqués par les oies particulièrement belliqueuses de l’endroit ou des chutes de vélo provoquées par des animaux laissés en liberté. Bref, pas de quoi alimenter la rubrique des faits divers des quotidiens de la place.
À l’issue du repas, jugeant sans doute le moment opportun, le procureur du Roi suggéra de «passer aux choses sérieuses». Les deux hommes s’assirent au salon et, après avoir servi deux cognacs, Oscar Lambermont se dirigea vers l’imposante bibliothèque qui recouvrait un mur entier de la pièce. Avec une petite clé noire, il ouvrit les portes d’une armoire imbriquée dans les rayonnages en vieux chêne et il en retira une douzaine de Hetzel qu’il déposa sur la table basse, face à Stanislas.
Le magistrat carolorégien n’avait pas menti. Les exemplaires qu’il proposait étaient dans un fort bel état et le prix demandé – quoique légèrement excessif – correspondait assez bien au marché. L’homme, assurément, connaissait son affaire.
Durant trois quarts d’heure, le vendeur et l’acheteur potentiel joutèrent comme des maquignons, ne boudant pas le plaisir d’un échange animé où chacun faisait mine de céder du terrain en observant son interlocuteur du coin de l’œil.
C’est un moment qu’appréciait Stanislas, qui ne dédaignait pas les affaires difficiles et trouvait dans ces négociations un sel supplémentaire à son métier. Rien ne l’agaçait autant que la bêtise d’un interlocuteur réclamant des sommes folles pour un lot qui n’en valait pas le quart. Par contre, il lui était arrivé de donner plus que le prix demandé à un vendeur ignorant la valeur réelle d’un ouvrage. S’il ne dédaignait pas, tant s’en faut, les «bonnes affaires», Stanislas aimait en effet que les choses se passent dans la correction. Les seules exceptions concernaient les ventes publiques où il luttait alors à armes égales avec ses collègues dans un contexte où tous les coups étaient permis.
Dans le cas présent, son interlocuteur était un homme déterminé, certes, mais capable d’adapter ses exigences en fonction des propositions qu’il lui présenta successivement. C’est ainsi que, peu après quinze heures, les deux hommes finalisèrent un accord équilibré, sur base d’un prix fixe agrémenté d’un lot de six livres de La Pléiade offert par Stanislas.
Il faisait très chaud dans la pièce – ce qui augmentait l’effet de l’alcool – et le libraire appréhendait de reprendre la route immédiatement pour Bruxelles. Au-dehors, le ciel d’hiver s’était un peu éclairci et, par les portes-fenêtres du salon, on pouvait voir quelques rayons de soleil jouer dans les branches squelettiques des grands arbres entourant la maison.
Lambermont proposa de faire quelques pas dehors et Stanislas lui répondit qu’il aimerait faire un brin de promenade le long du chemin de halage. De sa jeunesse passée à quelques kilomètres de là, le libraire avait conservé le souvenir de longues balades au bord de la Sambre et de tours en barque au pied des ruines de l’abbaye d’Aulne.
C’est ainsi qu’après s’être chaudement vêtus, Oscar Lambermont et Stanislas descendirent vers la rivière, traversèrent le bief puis une écluse, et s’engagèrent sur le chemin bordant la Sambre. Lancés dans une discussion sur les mérites comparés des bières trappistes, les deux hommes parcoururent ainsi une belle distance. Après une longue courbe, le procureur s’arrêta et, montrant la berge où des plants bruns et cassants de renouées du Japon avaient été piétinés sur plusieurs mètres, il annonça: «C’est ici que ça s’est passé.»
Plongé dans la description savoureuse d’une récente dégustation de Bush Beer maturée en fûts de Nuits-Saint-Georges, Stanislas mit quelques secondes pour faire le raccord avec la mort accidentelle de Jean-Régis de Chassart survenue la veille au matin.
Patiemment, il écouta pour la deuxième fois – in situ cette fois – le récit du tragique accident, puis les deux hommes revinrent sur leurs pas tandis que le procureur dressait du défunt un portrait qu’il voulait objectif. À l’en croire, Chassart était un personnage assez secret, parlant peu avec ses collègues, modérément apprécié par les policiers et moyennement coté au niveau professionnel. Ses résultats n’étaient pas vraiment en cause, mais il traînait derrière lui une vieille histoire qui lui collait aux basques comme une casserole à la ceinture d’un politicien véreux.
Des années plus tôt, un marchand de voitures de luxe notoirement connu pour des faits de recel l’avait «mouillé» dans une sombre affaire de trafic et de braquages, l’accusant d’avoir couvert des truands en échange de véhicules de prix.
Le juge d’instruction était connu pour aimer les belles automobiles et ce goût, trop affiché au gré de certains, cadrait mal avec des revenus certes confortables, mais insuffisants pour expliquer des changements réguliers de véhicules. L’affaire avait été loin. Grâce à une subtile interprétation des faits – le truand avait également porté des accusations envers un policier – le Comité P, l’organe chargé du contrôle des services de police, avait élargi discrètement ses investigations dans la sphère judiciaire. Rien n’avait permis d’établir la moindre trace de corruption dans le chef du magistrat, mais les enquêteurs du Comité P avaient relevé des liens avérés entre l’homme de loi et des individus douteux. Dont quelques pointures du banditisme régional. Mieux: interrogée sur les fréquentations du marchand de voitures, la serveuse d’un restaurant italien de Charleroi avait fait état d’une soirée arrosée au cours de laquelle le magistrat et le truand «accompagnés de jeunes femmes qui n’étaient certainement pas leurs épouses» s’étaient amusés comme larrons en foire. Et avaient fait preuve, après le repas, «d’un comportement déplacé», notamment envers elle. Elle s’en était plainte à son patron qui lui avait demandé de se montrer conciliante. La jeune femme était d’autant plus traumatisée qu’elle avait reconnu un des deux hommes: c’était le juge d’instruction vu la veille sur les écrans de Télésambre, la télévision locale, dans le cadre d’un procès en préparation.
Le Comité P n’étant pas compétent, l’affaire en était restée là. Quant au marchand de voitures un peu trop bavard, placé en détention préventive pour d’autres faits, il avait entre-temps succombé à une overdose en prison. Son autopsie n’avait pas permis de relever la moindre trace permettant de suspecter un homicide. Seuls éléments troublants: l’individu, qui bénéficiait d’une cellule individuelle, était mort juste après un passage à la douche où il avait croisé d’autres détenus et les analyses avaient démontré qu’il n’était pas toxicomane.
Pour le juge d’instruction, l’alerte avait été chaude et la réputation de Jean-Régis de Chassart était sérieusement écornée depuis les faits. Au palais, des éléments du rapport ayant filtré, nombreux étaient ceux qui avaient profité de l’aubaine pour «charger» un personnage qu’au fond d’eux-mêmes ils jalousaient. Le juge, il est vrai, était aussi connu pour ses succès féminins et la désinvolture avec laquelle il traitait ses conquêtes avant de s’en séparer lui avait valu quelques solides inimitiés auprès des représentantes du sexe dit faible.
Alors qu’ils atteignaient le bout du chemin de halage, Stanislas et le procureur Lambermont virent l’éclusier sortir de sa maison et se diriger vers l’écluse où un bateau hollandais arrivait à petite vitesse. Comme ils s’arrêtaient pour observer la manœuvre, Stanislas eut l’attention attirée par une petite tache orange se détachant d’un amas de saletés à l’angle des portes de l’ouvrage. À cet endroit préservé des remous, les déchets les plus variés venaient s’accumuler en une masse noirâtre, peu ragoûtante, où se mêlaient des branches, quelques cadavres de poisson, des bouteilles en plastique et des bidons d’huile. Intrigué, Stanislas s’approcha, observa la tache puis demanda à l’éclusier s’il disposait d’un outil pour récupérer des objets tombés à l’eau.
L’agent des Voies navigables lui montra du doigt une sorte de gaffe accrochée au mur extérieur de sa maison. Le long manche de bois était prolongé par un crochet et un fil de fer torsadé en boucle. Saisissant la perche, Stanislas la plongea dans le magma crasseux, fit quelques essais infructueux, puis réussit à remonter l’objet convoité. Comme il l’avait supposé, la tache orange était la partie émergée d’un couteau de plongeur muni d’un manche en plastique creux.
Le procureur du Roi et l’éclusier s’étaient approchés. Stanislas leur montra l’objet en expliquant qu’il en possédait un semblable. Les plongeurs amateurs portent souvent au mollet une gaine dans laquelle ils passent un tel couteau destiné à trancher les câbles, bouts de corde et autres morceaux de filets dérivants, selon qu’ils plongent en carrière ou en mer. Il existe une infinité de modèles dont beaucoup sont dotés d’un manche creux. «Lors d’une plongée, il arrive qu’un couteau sorte de son étui et qu’on le perde», expliqua Stanislas à ses interlocuteurs. «Grâce à cette poignée creuse, et donc à l’air qu’elle contient, il remonte automatiquement à la surface et peut être facilement récupéré par son propriétaire.»
À l’évidence, l’objet n’avait pas séjourné longtemps dans l’eau, car le léger film verdâtre qui le recouvrait disparut d’un simple frottement avec les doigts.
— Un plongeur à cette époque dans la rivière, c’est plausible?, demanda Stanislas à l’éclusier.
— Il y aura bientôt quinze ans que je travaille ici et les seuls plongeurs que j’ai vus au travail étaient ceux de la police, dans des affaires de disparition, ou ceux des Voies navigables pour des réparations aux ouvrages. Pour le reste, la plongée en amateur n’est pas autorisée dans ce secteur. Et forcément pas entre les écluses, répondit l’éclusier en commençant à manœuvrer les portes et le pont levant.