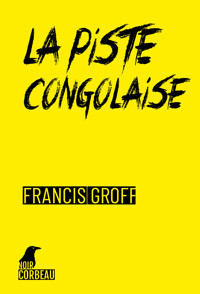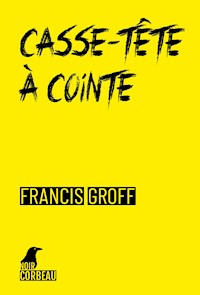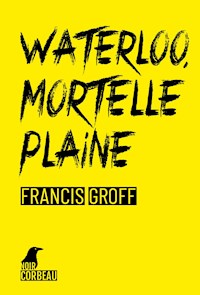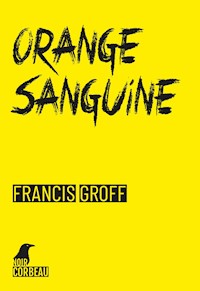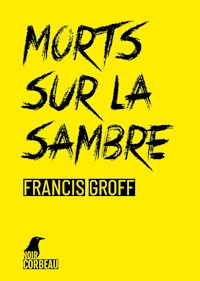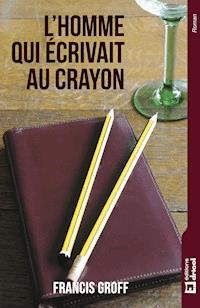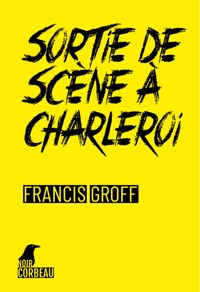
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Charleroi, fin 2023. Après de longs travaux, la ville renaît enfin. Au Palais des Beaux-Arts, la première d’un spectacle « engagé » tourne au drame. La victime est un comédien amateur à la personnalité double et méconnue. Chercheur au Biopark, il vouait une rare passion d’anthropologue aux chanteurs de rue d’antan. Et sa collection de « feuilles de chansons » a vite fait d’intriguer Stanislas Barberian. Des « vraies » reliques de l’authentique saint Valentin, le lumineux patron des amoureux, aux ombres mensongères des jalousies humaines, le cœur et la raison de Stanislas balanceront pas mal au Pays Noir…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste en presse écrite, radio et télévision, réalisateur de documentaires pour la télévision et scénariste,
Francis Groff a écrit une douzaine de livres à caractère journalistique avant de se lancer dans l’écriture de fictions, en créant le personnage de Stanislas Barberian, un bibliophile distingué qui a l’art de fourrer son nez là où les flics ne l’attendent pas. Dans "Vade retro Félicien!", le bouquiniste belgo-français va vivre une enquête haletante dans les coulisses d’une ville que peu de Namurois eux-mêmes connaissent. "Morts sur la Sambre" est son deuxième roman et y étrenne une série d’enquêtes menées au hasard de ses rencontres dans diverses régions de Belgique, suivi d'"Orange sanguine" et de "Waterloo, Mortelle plainte".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Descriptif
La collection de romans policiers Noir Corbeau bénéficie du regard averti de François Périlleux, Commissaire Divisionnaire (e. r.), ancien chef de la Crime à la Police Judiciaire Fédérale de Liège.
Prologue
Venant du boulevard Jacques Bertrand, de l’avenue de l’ Europe, du nouveau parking souterrain et de la place du Manège new-look inaugurée à la mi-septembre, des grappes humaines se dirigeaient vers les portes vitrées du Palais des Beaux-Arts de Charleroi qui brillait comme un phare culturel. Les uns marchaient vite en raison de la petite pluie fine mais froide qui mouillait des vestes parfois trop légères ; les autres n’en avaient cure et s’embrassaient sur l’esplanade, dans une joyeuse ambiance de retrouvailles amicales.
Réfugié sous l’auvent qui protégeait les sept grandes portes, Franco, le directeur technique du PBA – comme l’appellent familièrement les Carolos –, observait avec amusement cette foule qui grossissait à vue d’œil. En dégustant lentement le premier carré d’un chocolat qu’il venait de sortir de sa poche, il tentait de définir l’atmosphère particulière de ce soir. Certes, la fin des interminables travaux qui avaient étranglé le quartier pouvait expliquer cet engouement, mais il y avait autre chose. Une sorte de nervosité presque palpable qui faisait briller les yeux du public. Ou plutôt une excitation inhabituelle due aux nombreuses inconnues qui entouraient le spectacle dont c’était la première ce soir-là. Dans le genre minimaliste, la campagne de com’ orchestrée par la production avait été un modèle : un titre énigmatique – Vital Chaos –, une photo de décor vide de tout personnage et quelques mots annonçant une « comédie musicale comme vous n’en verrez plus jamais ». Tels étaient les seuls éléments qui avaient filtré durant quelques semaines, limitant à douze pour cent à peine les réservations. Inquiète, la direction des Beaux-Arts avait averti la production qu’elle allait se prendre un bide monumental, prévoyant d’ores et déjà l’annulation de la plupart des dates annoncées.
Mais ce n’était qu’un rideau de fumée : quinze jours avant la date critique, un grand journal de la capitale avait consacré une page entière à Vital Chaos, dont les représentations n’étaient pourtant prévues qu’à Charleroi. Selon un plan soigneusement préparé, l’article avait été résumé et diffusé sur tous les réseaux sociaux. Dans la métropole du Pays Noir, les chroniqueurs attitrés, les rédactions des quotidiens et la télévision régionale Télésambre avaient peu apprécié le procédé. Auprès de la production, toutes leurs demandes d’interview s’étaient heurtées à un refus poli mais définitif. Cette stratégie déclencha une vague de protestations dans les différents médias qui appelèrent au boycott de ce spectacle dont on ne savait rien ou presque, en soulignant au passage le mépris de la production pour « la province ». Il n’en fallait évidemment pas davantage pour faire monter la mayonnaise, d’autant que des complices spécialisés dans la « guerre de réputation » s’ingénièrent à relancer la balle sur le Net, déclenchant des échanges musclés. Faut-il le dire ? Le résultat de ce ramdam provoqua une vague d’intérêt qui se transforma en un petit tsunami au niveau des réservations. Tout le monde voulait en être…
Concrètement, l’article incriminé en disait pourtant très peu sur le spectacle. Celui-ci était l’œuvre d’un collectif éphémère, créé pour l’occasion par des micro-associations inconnues et d’autres artistes parmi lesquels figuraient quelques circassiens. Selon l’organisateur-producteur, un certain Bogdan Bukowski, la création finale était le résultat de confrontations organisées depuis plus de deux ans, en présentiel ou par vidéo, par l’ensemble des protagonistes, dans la plus parfaite tradition des groupes d’autogestion. À la question du journaliste qui lui demandait si cette forme de création n’avait pas abouti à une sorte de… chaos (suggéré par le titre), l’interviewé avait fini par admettre que la version finale avait été « légèrement retouchée par un professionnel de la mise en scène ». Ce remaniement avait été accepté par la grande majorité des acteurs/comédiens et seule une poignée d’entre eux s’était éloignée, soit trois sur une trentaine. « Mais la raison a prévalu et des remplaçants ont été immédiatement engagés ». Que dire du spectacle lui-même ? À en croire son producteur, il s’agissait d’un croisement entre « une opérette postindustrielle et une comédie musicale rock comme la célébrissime Hair. » Alors que le journaliste lui faisait remarquer que la guerre du Vietnam, les mouvements pacifistes, la révolution sexuelle et les hippies étaient passés aux oubliettes depuis longtemps, son interlocuteur ne s’était pas démonté : « À l’époque, le New York Times avait écrit que Hair était la première comédie musicale qui parlait enfin du temps présent. C’est en cela qu’elle a marqué les esprits et c’est ce choc que nous voulons reproduire avec Vital chaos. Le Vietnam, les hippies et tout ça, c’est bien fini, vous avez raison. Mais les problèmes de notre société sont bien plus vastes aujourd’hui, avec la résurgence de nouvelles formes d’esclavage, la disparition des abeilles, la montée des océans, la recherche effrénée du profit, le martyre des espèces animales, la surconsommation de viande, la malbouffe, l’obésité des enfants, la surexploitation des ressources, la persécution de la communauté LGBTQI+, la subsistance d’un patriarcat mortifère pour les femmes et la consommation dirigée. Vous saisissez les grands traits ? »
Devant une telle accumulation, l’intervieweur avait tenté d’en savoir davantage, mais Bukowski avait botté en touche. Il s’était néanmoins confié sur la personnalité de quelques artistes, de leurs performances vocales, mais aussi des « acrobaties » folles qui avaient nécessité des aménagements délicats de la scène. Comme unique illustration, en plus de son portrait travaillé en noir et blanc rehaussé de zones rouges, Bukowski avait remis au chroniqueur bruxellois une déclinaison de l’affiche de Vital Chaos. Dans un décor faiblement éclairé qui laissait deviner un chœur d’église dont l’autel à l’ancienne aurait été remplacé par un mur de photos, une statue de la Vierge façon drag-queen tenait dans la main une tirelire en forme de porcelet. À ses pieds, dans une cage en bois constituée de morceaux de palettes, on devinait une forme humaine nue, couchée en boule sur un lit de paille. Sur la gauche du décor, une télévision grand format montrant un ours blanc était plongée dans une bassine transparente remplie d’un liquide saumâtre. À l’avant-plan, une tête de mannequin féminin était posée sur le plancher, surmontée d’une perruque rousse décorée de préservatifs.
La guéguerre soigneusement entretenue entre réseaux sociaux, organes de presse régionaux et autres associations culturelles – parmi lesquelles étaient représentés le véganisme, la défense de l’environnement et le féminisme le plus militant –, avait créé un tel buzz que le résultat recherché par les organisateurs était atteint. En quelques jours, les réservations avaient explosé et le spectacle était déjà presque sold out pour la plupart des dates. La salle serait bondée ce premier soir et il y avait gros à parier que le spectacle ferait date. Quoique…
En mangeant le dernier morceau de son chocolat, Franco s’interrogeait sur la réaction du public qu’il voyait maintenant pénétrer dans la salle en rangs serrés. Celui-ci était constitué en majeure partie de couples âgés de quarante ans et plus, des spectateurs « sages » qui risquaient d’être sérieusement secoués par ce qu’ils allaient découvrir. Rentré la veille de Biarritz où il avait passé quelques jours en famille, le quinquagénaire avait été accueilli par une équipe survoltée, hilare, excitée à l’idée de lui décrire le spectacle. Comme il s’agissait d’une production indépendante du PBA, les équipes du Palais n’intervenaient pas, à l’exception de quelques régisseurs chargés d’aider le personnel engagé par le producteur. Ceux-ci n’étaient donc pas présents lors des répétitions, mais ils n’avaient pas pu résister à l’envie de jeter un œil discret depuis le premier balcon. Tandis que le directeur technique parcourait le plateau à la découverte des éléments de décor et d’une machinerie complexe, ses deux collègues lui expliquèrent quelques-uns des temps forts de la scénographie. Leur description ne laissait pas la place au doute : ou ça passait, ou ça cassait ! Pour l’un, il s’agissait d’une énorme farce qui allait faire un flop dès le premier soir. Le second, lui, ne contestait pas le caractère profondément dérangeant du spectacle, mais soulignait une prestation artistique particulièrement originale et surtout très exigeante sur le plan du jeu des comédiens et de la mise en scène. Pourtant blasés, les rares témoins avaient été bluffés par l’audace et l’inventivité des artistes venus d’horizons très différents. À l’exception des quelques circassiens et des artistes de rue, tous étaient débutants. Une vraie prouesse ! « Je n’ai plus jamais vu cela depuis Tintin, le temple du soleil », souffla un des hommes. Il faisait référence à une comédie musicale qui avait demandé cinq semaines de préparation en 2002. On y manipulait soixante-quatre décors et il avait fallu concevoir une véritable chute d’eau de plusieurs mètres de hauteur, celle dans laquelle le reporter à la houppe et son chien disparaissaient avant de retrouver le capitaine Haddock et Zorrino dans une caverne. À chaque représentation, des tonnes de liquide étaient déversées sur un côté de la scène et recueillies dans une cuve de six mètres cubes au sous-sol ! À l’époque, le spectacle avait drainé des milliers de personnes. Mais quel serait leur accueil ce soir ? Franco replia l’emballage de son chocolat et se hâta de regagner la salle. Dans quelques minutes, la sonnerie allait annoncer la fermeture des portes. Il alla s’installer à la régie centrale, placée au milieu de la corbeille.
Les lumières étaient à peine éteintes qu’un cri strident retentit dans la salle, une sorte de vagissement mêlé à des grognements d’animal, probablement un porc. Le rideau à l’italienne s’ouvrit lentement et tandis que les pleurs s’estompaient légèrement, un immense écran descendit à hauteur d’homme, montrant une succession rapide de berceaux, de cages à porcs, de couveuses néonatales, de bébés au visage crispé, de groins de cochon fouillant des excréments à la recherche de nourriture, etc. Puis l’écran se transforma en une sorte de théâtre d’ombres chinoises où des hommes et des femmes levaient les bras au ciel sur fond de lamentations. Depuis la régie, grâce à cet arrière-fond laiteux, légèrement éclairé, le directeur technique se rendit compte que le public s’agitait sur les fauteuils. Deux personnes s’étaient levées et semblaient se chamailler sur l’attitude à adopter, une autre regagnait la travée centrale pour quitter la salle. « Pas bon, ça ! » se dit Franco.
Sur la scène, le spectacle évoluait en puissance. Depuis quelques minutes, une trentaine de comédiens se croisaient en se déhanchant sur des danses tribales, vêtus pour la plupart de costumes improbables faits avec des tissus ou des objets de récupération. Seuls deux d’entre eux, plantés sur de courtes échasses, portaient un costume deux pièces-cravate impeccable et toisaient le peuple qui tentait vainement de les faire chuter. Sur divers écrans plus petits, dissimulés dans des éléments de décor inattendus, des vidéos se succédaient sur des thèmes parfois insoutenables comme l’abattage d’animaux d’élevage, la chasse aux baleines, le dépeçage d’ailerons de requins vivants, des forêts calcinées, des océans de plastique, des enfants fouillant des décharges à ciel ouvert. Entre ces tableaux horribles, des images superbes d’une nature en pleine vie marquaient des respirations au cours desquelles un homme et une femme à la voix sublime redonnaient un peu d’espoir dans ce monde apocalyptique. Soudain, les hommes en costume s’éloignèrent et les comédiens se couchèrent sur le sol en gémissant et en regardant le dessus de la scène. Tandis que les gémissements se transformaient en un chœur vocalisant subtilement sur Money des Pink Floyd, un personnage représentant Le grand Capital traversa la scène à plusieurs mètres de hauteur, glissant sur un câble invisible. Le bonhomme portait le chapeau claque des financiers d’autrefois, un costume à lignes et, tout en tirant de généreuses bouffées d’un énorme faux cigare, il jetait des dollars par poignées sur les humains étendus en dessous de lui. La performance était d’autant plus spectaculaire que, sans que l’on comprenne comment, il fit deux tours dans les airs, comme porté par l’obscurité soigneusement entretenue derrière lui. Puis la scène s’éteignit et le rideau se ferma. Le grand Capital réapparut au sol en écartant la lourde étoffe et s’installa à l’avant de la scène, se hissant sur un haut tabouret pour embrasser l’ensemble du plateau où d’étranges bruits témoignaient d’une activité fébrile.
Lorsque le rideau s’écarta, le décor avait changé du tout au tout, au point que le directeur technique en fut soufflé : là où, quelques minutes plus tôt, trente comédiens évoluaient dans un décor chaotique mais sophistiqué, il n’y avait plus qu’un amas de terre ocre. En son centre, un trou laissait apparaître un bout d’échelle en bois bricolée avec des morceaux de planche. L’illusion était parfaite et lorsqu’un enfant africain sortit la tête d’entre les pierres, poussant devant lui un sac sans doute rempli de terre à minerai, un murmure d’admiration parcourut le public. Juché sur son tabouret, le Capital était légèrement penché et observait la scène avec délectation. Un projecteur éclaira son visage et lorsqu’il le tourna vers la salle, les spectateurs distinguèrent deux incisives de vampire colorées de sang. Tout en s’extrayant péniblement de son trou, le gamin ouvrit son sac et répandit sur le sol terreux un lot de téléphones portables. Le temps était comme suspendu et, dans son casque d’interphonie qui reliait tous les techniciens entre eux, Franco eut encore le temps d’entendre un ordre bref lancé par la régie de plateau située côté cour, à droite en regardant la scène. À ce moment, dans un bruit sourd, un immense rideau de fer s’abattit sur l’avant-scène, écrasant le personnage du Capital et son tabouret. Le comédien poussa un cri et l’on vit encore un de ses bras bouger tandis que sa tête disparaissait en partie sous le poids du volet métallique.
Croyant à un effet supplémentaire, quelques spectateurs applaudirent, bientôt rejoints par d’autres, dont certains se mirent même debout. Cela ne dura que quelques secondes puis, après une sorte de flottement, on entendit des cris provenant de la scène, des coups portés sur le panneau métallique et même un appel au secours. Intrigués, des spectateurs du premier rang se levèrent et s’approchèrent du comédien. Une femme poussa alors un cri aigu qui déclencha un mouvement de panique. Derrière le banc de la régie centrale, Franco, lui, avait compris immédiatement. Pour une raison inconnue, le rideau métallique de trois tonnes servant de coupe-feu entre le plateau et la salle venait de s’abattre d’un coup sur le malheureux comédien. Le directeur technique se précipita vers la scène tout en téléphonant aux services de secours et avertit la police. Le commissariat principal se trouvait à quelques centaines de mètres.
Le cri poussé par la spectatrice avait provoqué un reflux massif du public des fauteuils d’orchestre vers le haut de la salle et les portes de côté. Franco eut fort à faire pour remonter le courant humain qui submergeait tout. Enchevêtrés dans les rangées étroites de sièges, certains escaladaient les fauteuils, d’autres poussaient frénétiquement leurs voisins en leur donnant des coups dans le dos. Au beau milieu du chaos, un spectateur hystérique tremblait de tout son corps, comme collé à la moquette, en hurlant des choses inintelligibles. Le directeur technique l’empoigna fermement par les épaules et le secoua en lui demandant de se calmer. Le malheureux s’arrêta instantanément et il l’abandonna avant de se retourner brièvement pour évaluer la situation. Il fut rassuré en constatant qu’au niveau de la corbeille, des loges et des deux balcons, les gens n’avaient pas cédé à la panique. La plupart étaient debout et tentaient de comprendre ce qui se passait ; les autres gagnaient calmement la sortie dans un brouhaha confus.
Arrivé à hauteur de la fosse d’orchestre, il gravit les quelques marches d’accès à la scène et il comprit immédiatement qu’il n’y avait plus rien à faire pour sauver le comédien. Son visage avait été en partie écrasé par le rideau de fer et sa nuque dessinait un angle incongru avec le haut du corps. Seul un bras était visible et le gros faux cigare avait roulé sous le pied droit du malheureux, comme un clin d’œil cynique au personnage du Grand Capital, pour une fois perdant. À l’arrière, les collègues de la victime s’acharnaient encore à tenter de relever le dispositif anti-feu avec divers outils, mais le directeur technique leur cria que c’était désormais inutile… Franco fut alors rejoint par un membre de son équipe à qui il demanda d’actionner mécaniquement le rideau. Pendant qu’il attendait, les secouristes du SMUR firent leur apparition, lui demandant de s’écarter pour les laisser travailler. Après un rapide examen, ils durent se rendre à l’évidence : le cœur de la victime ne battait plus, la nuque semblait brisée et la position du corps ne permettait pas de pratiquer un massage cardiaque. Ils remballaient leur matériel au moment où la police arriva à son tour. Lorsque le médecin eut brièvement fait rapport à l’inspecteur principal qui dirigeait l’équipe d’intervention, Franco entreprit de raconter au petit groupe les circonstances du drame. Autour d’eux, le calme était revenu, mais quelques dizaines de curieux s’étaient rapprochés de la scène, avides d’en savoir plus. Au moment où les policiers se préparaient à les prier de s’éloigner, le collègue du directeur technique accourut, essoufflé, le visage livide. Ignorant les intervenants, il posa sa main sur le bras de son chef et, d’une voix étonnamment basse, il lâcha :
— Franco, il y a un problème. Comme le mécanisme de relevage manuel ne fonctionnait pas, je suis d’abord monté au cintre1, puis jusqu’au gril2 pour inspecter la machinerie.
Il s’interrompit pour reprendre son souffle et avala péniblement sa salive.
— C’est un sabotage : le câble de retenue du rideau de fer a été coupé ! La disqueuse est encore là, tout près du moteur.
Le petit groupe se figea et resta silencieux quelques secondes. Puis l’inspecteur principal déclara avec une certaine solennité :
— Messieurs, il est évident que ceci n’est pas un accident. Nous nous trouvons face à un assassinat. Et cela change tout…
Chapitre 1
Lorsque Stanislas Barberian reposa le micro à côté de son assiette, des applaudissements nourris saluèrent l’exposé qu’il venait de faire devant les membres d’un service club connu de Charleroi. En face de lui, un public disparate occupait une dizaine de grandes tables où des septuagénaires portant beau côtoyaient des quadragénaires à l’allure plus décontractée, chemise colorée et veston de sport. Sous les chaises, les talons hauts et les sneakers de marque voisinaient avec les mocassins old style soigneusement cirés. À en croire son président qui avait réussi à débaucher Stanislas pour cette conférence, le club était un des plus huppés de la région et le restaurant dans lequel les membres se réunissaient bénéficiait d’une réputation flatteuse.
À dire vrai, Stan n’était pas un familier des services clubs. Certes, il avait été approché à plusieurs reprises, mais ses déplacements incessants dans le Nord de la France et la Belgique ne lui permettaient pas d’assumer un minimum de présence aux réunions. Originaire de Charleroi où il avait passé sa jeunesse avant de faire des études de Lettres à Liège et une année supplémentaire en littérature du Moyen Âge, Barberian avait émigré en France. Son oncle y tenait une librairie spécialisée dans la fourniture de cours et de livres aux étudiants de la quinzaine d’universités parisiennes. Très vite, en raison de son âge, Stanislas avait lié connaissance avec la plupart des clients. Se rendant compte que les jeunes dépensaient un argent fou pour leurs études, il avait eu l’idée de créer un coin « brocante ». On pouvait y acheter des romans à petit prix, avec la possibilité de les revendre ensuite pour quelques sous et se refaire une réserve de lecture. Il n’avait rien inventé, le système fonctionnait à Bruxelles depuis des lustres. À Paris, le succès fut tel qu’après deux ans, il avait quitté la librairie de son oncle pour s’installer à son compte dans une ancienne quincaillerie du quartier de Montparnasse. Au fil du temps, il s’était orienté vers l’achat et la vente d’éditions rares, de vieux documents ou de lettres de personnages connus. Depuis, sa réputation avait largement dépassé les frontières parisiennes et il était de plus en plus sollicité pour des publications diverses. Des sociétés renommées de vente aux enchères faisaient régulièrement appel à lui pour écrire des parties de catalogues réservées à des ventes de prestige.
Pour alimenter sa « boutique » comme il appelait sa Malle aux Livres, Stan avait développé en France et en Belgique un réseau de collectionneurs et de « rabatteurs ». Il traitait en direct avec les premiers et rétribuait les seconds lorsqu’il concrétisait une affaire signalée par l’un d’eux. C’est ainsi qu’une grande partie de l’année, le bouquiniste carolo-parisien sillonnait les routes du Nord de la France et de Belgique à la rencontre de clients fidèles ou potentiels. En son absence, sa fidèle assistante Clotilde gérait le magasin avec une telle compétence qu’elle faisait presque oublier son caractère de cochon. À soixante et quelques années – Stanislas n’avait jamais osé lui demander son âge –, Clotilde était son bras droit et ses connaissances en matière de littérature étaient remarquables.
Barberian avait sensiblement développé le marché belge où il disposait d’un réseau étoffé. La raison de ce choix était une charmante collègue bruxelloise dont il avait fait la connaissance au Marché aux Livres de la Vieille Bourse à Lille. Du même âge que lui, romaniste de formation, Martine avait longtemps travaillé comme bibliothécaire à la ville de Bruxelles avant d’ouvrir une bouquinerie à l’enseigne du Vieux Lutrin à Bruxelles, non loin du Sablon. Elle s’était notamment spécialisée dans les affiches anciennes, principalement des publicités vantant les voyages transatlantiques du début du XXe siècle, le thermalisme et le tourisme balnéaire. Sportive, passionnée par son métier, éternellement optimiste et résistante aux désagréments de la vie, la quadragénaire considérait que la plupart des aléas du quotidien ne valent pas la peine que l’on s’y attarde. Sa bonne humeur quasi permanente était une source d’apaisement pour Stanislas. D’un naturel plus stressé, il goûtait chaque minute passée avec sa « fiancée », comme il aimait la baptiser quand ils étaient entre amis. Deux ou trois fois par mois, il adaptait son calendrier pour passer quelques jours à Bruxelles, dans l’appartement qu’ils avaient aménagé ensemble au-dessus du Vieux Lutrin. Leurs retrouvailles étaient toujours l’occasion d’une sortie culturelle, d’une visite de musée et de repas en amoureux dont le couple raffolait. La bouquinerie du Sablon était en quelque sorte devenue sa base stratégique, d’où il rayonnait dans toute la Belgique.
Le couple avait réservé une chambre à Charleroi, conscient que la soirée risquait de se prolonger. Stanislas était venu dans sa ville de naissance à la demande de l’ancien PR, comprenez le procureur du Roi, Oscar Lambermont3. Bien qu’à la retraite, il avait conservé des relations avec Barberian. Fin lettré, l’homme était un collectionneur acharné qui passait la plupart de ses loisirs dans des salons spécialisés ou des brocantes aux vieux papiers. À l’occasion, il continuait à faire commerce ou à échanger avec le Carolo-parisien et ils avaient fini par tisser des liens amicaux. De son côté, Stan n’hésitait pas à faire un détour pour le saluer dans sa maison située en bord de Sambre, du côté de Thuin, à quelques kilomètres de l’abbaye d’ Aulne. Membre du service club devant lequel le bouquiniste venait de prendre la parole, il avait suggéré à son président d’inviter Stanislas à présenter une conférence. Pour l’occasion, celui-ci avait rédigé un texte fouillé sur les auteurs fantastiques belges comme Marcel Thiry, Thomas Owen, Franz Hellens, Michel de Ghelderode et l’incomparable Jean Ray. L’assistance avait apprécié et, à ses côtés, Martine rayonnait, très élégante dans une simple robe rouge qui soulignait sa silhouette sportive. Elle était installée à la droite de son « fiancé », à côté du président du club, Oscar Lambermont ayant pour sa part choisi la gauche de l’orateur.
Lorsque vint l’heure du café, les premiers convives s’en retournèrent, mais la plupart se regroupèrent autour de quelques tables rapidement rapprochées. Tout en répondant aux questions, Stanislas prit conscience qu’un petit groupe s’enflammait autour d’un sujet monopolisant la conversation. Lorsque enfin il réussit à se libérer, Oscar Lambermont vint le chercher avec des airs de complotiste, un sourire gourmand aux lèvres. Prenant son ami par le bras, il le conduisit au milieu du groupe où Martine avait déjà pris place, manifestement intéressée par la conversation. Lorsqu’elle vit Stan approcher, elle ne put s’empêcher de dire dans un sourire : « Si vous le branchez là-dessus, la nuit risque d’être longue. Je vous en supplie, pensez à moi. Je prends le train tôt, demain matin ».
Tout en faisant asseoir son invité, l’ancien PR fit tinter son verre d’un petit coup de cuillère et réclama le silence avant de prendre la parole.
— Mes amis, lorsque je vous ai présenté notre invité du jour, je vous ai expliqué que nous avions fait connaissance autour d’un lot de très belles éditions de Jules Verne parues chez Hetzel. Nous avons, ce jour-là, passé quelques heures agréables dans ma bibliothèque avant de profiter des talents culinaires de mon épouse. Comme il sied entre personnes de bonne compagnie, la négociation du prix est seulement intervenue à l’heure du calvados. J’avais une idée très précise du prix que je voulais obtenir, mais Stanislas est un fin négociateur. Bref, nous avons longuement débattu avant de tomber d’accord, non sans avoir dégusté deux autres pousse-cafés. Ce qui explique qu’à ce moment, nous avons tous deux ressenti l’envie de prendre l’air. Nous sommes descendus nous balader le long de la Sambre, là où, quelques jours plus tôt, on avait retrouvé le cadavre du juge d’instruction Jean-Régis de Chassart. Vous vous souvenez sans doute de cette délicate affaire.
Autour de l’ancien magistrat, une grande partie de l’assistance acquiesça.
— Ce que je ne vous ai pas révélé en présentant Stanislas tout à l’heure, c’est que la Justice aurait plus que probablement conclu à une simple noyade si notre ami n’avait pas remarqué un élément troublant dans l’eau de la Sambre. Moi-même, j’étais dubitatif, et il a fallu toute son insistance pour que je fasse revenir une équipe sur les lieux. Avec le résultat que l’on sait, l’arrestation des coupables qui purgent une longue peine de prison.
Lambermont se tourna vers le bouquiniste.
— Tout cela pour vous expliquer, mon cher Stanislas, que si vous nous voyez si agités en ce moment, c’est parce que Charleroi a vécu hier une soirée dantesque. On vous explique.
En quelques minutes, il résuma les faits dramatiques survenus la veille au Palais des Beaux-Arts, interrompu à quelques reprises par des convives avocats qui « avaient entendu dire que » et « qui croyaient savoir que » après avoir passé une partie de la journée dans les coulisses du palais de justice. Les échanges allaient bon train lorsque Oscar Lambermont se tourna vers une femme d’une cinquantaine d’années qui n’était pas intervenue jusque-là et observait cette agitation avec un léger sourire.
— Une personne parmi nous sait très précisément ce qui s’est passé. Je viens d’apprendre que c’est notre amie Karine qui est en charge du dossier. Peut-être pourrait-elle nous en dire un peu plus sans révéler quoi que ce soit sur l’enquête. Comme, hier soir, la presse a dû boucler ses éditions avec quelques lignes à peine en raison de l’heure tardive, nous restons tous sur notre faim.
Puis il fit un geste vers Stanislas.
— Mon cher Barberian, j’ai l’honneur de vous présenter la commissaire Karine Mortehan de la police judiciaire fédérale de Charleroi. Elle fait partie de la COP, la division qui s’occupe de la Criminalité contre les personnes et qui regroupe le terrorisme, les stupéfiants, les mœurs et la traite des êtres humains. Elle dirige pour sa part une des trois équipes chargées des homicides.
Le visage de la gradée se crispa et Stanislas comprit que, dans l’euphorie provoquée par les vins de qualité servis en abondance, le PR avait poussé… le bouchon un peu loin. Ce que la policière souligna immédiatement d’un ton courtois, mais ferme.
— Pour être franche, votre demande me met mal à l’aise, Monsieur le procureur. Vous êtes le mieux placé parmi nous pour savoir que je ne peux rien divulguer ici.
Elle s’interrompit un instant tandis que le procureur piquait un fard. Puis ses traits se détendirent et elle reprit.