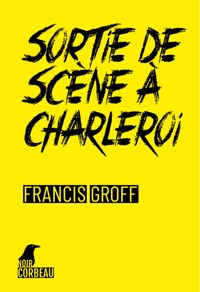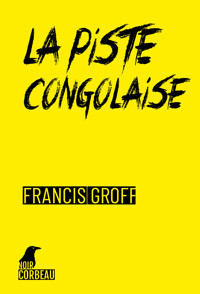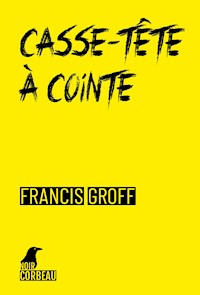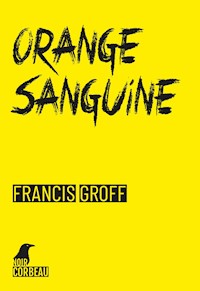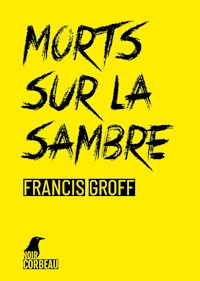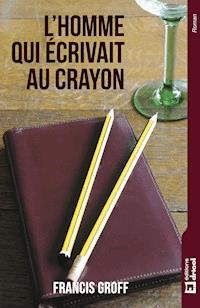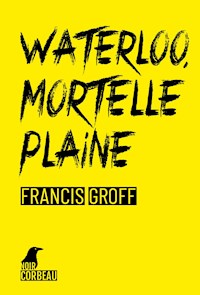
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Une enquête de Stanislas Barberian
- Sprache: Französisch
Braine-l’Alleud, juillet 2020. Profitant d’un déconfinement bienvenu, une trentaine de reconstituteurs napoléoniens se retrouvent sur les terres d’un gros propriétaire de l’endroit pour un bivouac de cinq jours. Au cours de la deuxième nuit, Charles-Damien Passereau – CHD pour les dames – est assassiné de façon particulièrement cruelle. Sollicité un mois plus tard par la maman de la victime qui déplore le statu quo de l’enquête, Stanislas accepte de mener ses propres investigations. Sans trop y croire, vu le délai écoulé. En fait, le bouquiniste belgo-parisien voit surtout dans cet appel au secours l’opportunité de fuir des travaux domestiques qui l’enferment dans l’appartement de sa fiancée Martine. Et pourtant, d’entrée de jeu, il va mettre le doigt – c’est l’expression exacte – sur un élément capital pour la relance du dossier d’instruction…
Après Morts sur la Sambre, Vade retro, Félicien ! et Orange sanguine , une nouvelle enquête de Stanislas Barberian
À PROPOS DE L'AUTEUR
Journaliste en presse écrite, radio et télévision, réalisateur de documentaires pour la télévision et scénariste,
Francis Groff signe ici la quatrième enquête de Stanislas Barberian, un bibliophile distingué qui a le don de se retrouver mêlé aux crimes les plus étranges. Et de se transformer en enquêteur tenace face à la police officielle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Descriptif
La collection de romans policiers Noir Corbeau bénéficie du regard averti de François Périlleux, Commissaire Divisionnaire (e. r.), ancien chef de la Crime à la Police Judiciaire Fédérale de Liège.
Mes remerciements à Marie-France Rosière, Françoise Ory et Laurent Hovine pour leur soutien attentif.
Un merci particulier au commissaire Pascal Vanbelle de la PJ de Nivelles et à Eddy Meylemans, fondateur de l’Ambulance 1809 de la Garde impériale, pour leurs précieux conseils.
PROLOGUE
Les voitures avaient fini par déserter la N5 toute proche et un silence impressionnant régnait sur le bivouac. Les touristes d’un jour s’en étaient retournés vers leur quotidien après avoir grignoté des bouts d’histoire napoléonienne dans différents sites de la région. Au loin, la Butte du Lion se découpait dans un ciel sans tache, comme un phare sur une mer d’huile. Une vache meugla, provoquant en écho l’aboiement peu convaincu d’un chien de ferme sans doute écrasé par la chaleur qui régnait toujours à cette heure pourtant avancée de la nuit. La journée du dimanche était encore dans les limbes d’une lune peu présente et dont l’ultime croissant se devinait à peine.
Un chat roux traversa prudemment le pré parsemé d’une vingtaine de tentes en toile blanchâtre. La veille en fin d’après-midi, des humains excités avaient envahi l’endroit en déployant un impressionnant matériel, dont ces curieuses petites maisons en coutil que les hommes avaient patiemment montées en s’encourageant mutuellement. Un petit groupe de femmes s’était occupé de placer des sièges, des tables et toute une quincaillerie destinée à la cuisine. Depuis son poste d’observation à l’étage de la grange voisine, le matou en avait déduit que les envahisseurs s’installaient pour plusieurs jours. Les heures suivantes avaient confirmé ses craintes : assis autour d’un feu de camp plus symbolique qu’autre chose en ces temps de sécheresse, femmes, hommes et enfants avaient partagé un repas copieusement arrosé qui s’était terminé par quelques airs de guitare, des chansons d’un autre temps et un peu d’accordéon. Le félidé était furieux car l’endroit où les humains avaient pris place était son terrain de chasse favori. Chaque nuit, il y pistait les petits rongeurs comme d’autres chassent le gibier. Avec les uns, il se contentait de jouer ; pour d’autres, le jeu finissait en carnage. Le calme étant enfin revenu, le chat roux décida de tenter sa chance malgré tout… Tandis qu’il s’élançait entre les tentes d’où sortait parfois un ronflement sonore, il ne vit pas une main ouvrir précautionneusement une des toiles. Une tête apparut dans l’ouverture, celle d’un homme d’une trentaine d’années, le cheveu hirsute et l’air inquiet.
Charles-Damien Passereau rongeait son frein depuis près de deux heures, attendant avec une nervosité croissante l’heure d’un rendez-vous qui revêtait à ses yeux une importance capitale. Par peur de réveiller les occupants des tentes voisines, il n’avait pas osé programmer l’alarme de son portable. Pas même sur le vibreur. La soirée des retrouvailles s’était prolongée plus longtemps que prévu car les reconstituteurs réunis ce vendredi 17 juillet 2020 dans la campagne brabançonne n’avaient pas caché leur joie de se retrouver après un confinement difficilement vécu par beaucoup d’entre eux. Désormais, les autorités autorisaient une « jauge » maximale de cinquante personnes, ce qui avait immédiatement vu fleurir les camps scouts dans les Ardennes.
Chaque année au mois de juin, des reconstituteurs venus parfois d’horizons très éloignés se retrouvent sur le champ de bataille de Waterloo pour célébrer l’ultime offensive de la Grande Armée. En 2015, le bicentenaire de cette confrontation historique avait rassemblé près de six mille participants ! Tous les cinq ans, une reconstitution moins grandiose réunissait quand même deux à trois mille soldats et officiers représentant les différentes armées. Tel aurait donc dû être le cas en cette année 2020, mais la pandémie de covid-19 en avait décidé autrement. Les manifestations du 18 juin avaient été annulées, au grand désespoir des habitués. Lorsque, quelques semaines plus tard, le gouvernement belge avait décidé de lâcher du lest en déconfinant progressivement, un gros propriétaire de la région, Henri de Poncelet-Bivort, avait lancé l’idée d’organiser un « bivouac de consolation ». Ce sont les termes qu’il avait utilisés en proposant l’idée à son ami Eddy Meuleman, un personnage plus connu dans le milieu sous le pseudonyme de Doc Percy, du nom du chirurgien en chef des troupes napoléoniennes. Un quart de siècle plus tôt, Eddy avait fondé l’Ambulance 1809 de la Garde impériale, un groupe de reconstitution particulièrement original puisqu’il n’en existe que deux en Europe, le second étant basé en Corse.
Sous Napoléon, le Corps de santé militaire avait théoriquement pour mission de recueillir les blessés, de les secourir, et de leur permettre de guérir dans les meilleures conditions possibles. Dans la réalité, les choses étaient tout autres : des soldats blessés, crevant de mal ou de soif, passaient parfois trente-six heures au milieu des morts et des agonisants avant d’être abandonnés dans des endroits souvent insalubres, réquisitionnés auprès d’une population hostile. Quant aux soins eux-mêmes, ils se résumaient la plupart du temps à des amputations à la chaîne. Ceux qui avaient un peu de chance étaient opérés par de vrais chirurgiens passés maîtres dans l’art de tailler les chairs ; les autres étaient livrés aux mains peu expertes d’étudiants en médecine, de barbiers et autres infirmiers autodésignés pour échapper aux combats. Les malheureux étaient amputés avec des instruments de fortune et sans anesthésie, évidemment. Sur certains champs de bataille, l’abattage était tel que des monceaux de membres s’accumulaient à l’écart des tentes servant de « salles d’opération ». À l’entrée de celles-ci, au plus fort des arrivées, il n’était pas rare d’entendre un infirmier régulateur crier : « Les bras à gauche, les jambes à droite ! » Certains médecins pratiquaient jusqu’à deux cents ablations en vingt-quatre heures, le record étant celui d’un chirurgien en chef – un vrai, celui-là – qui avait procédé à une amputation en neuf secondes ! Ceux qui survivaient devaient ensuite passer l’épreuve des contaminations, maladies ou épidémies diverses telles que le typhus, la gangrène, la gale et autres joyeusetés. À elles seules, les blessures et les maladies auraient occasionné deux fois plus de morts que le feu de l’ennemi…
Comme si cela ne suffisait pas, les « ambulances » mises en place pour tenter de sauver les soldats de l’Empereur étaient mal équipées et ne jouissaient pas de la considération que leur noble mission aurait dû légitimement susciter. Les charrettes mises à leur disposition étaient trop souvent rudimentaires, les chevaux trop vieux pour suivre l’avancée des troupes. Le matériel se résumait à une cinquantaine de kilos de linge à pansement, un peu de charpie, un matelas, des brancards démontables, une caisse pour les amputations et quelques béquilles. Pour suppléer au manque d’instruments, les chirurgiens se servaient d’outils de menuisier qu’ils achetaient dans les villages. Cerise sur le gâteau, il arrivait que des intendants sans scrupule pillent à leur profit les vivres destinés aux blessés.
Indépendamment de cela, ces postes médicaux avancés – sans doute les appellerait-on ainsi de nos jours – permettaient quand même de sauver des vies. C’est pour leur rendre hommage et montrer au grand public l’action de ces unités très spéciales qu’Eddy Meuleman, lui-même infirmier urgentiste, avait fondé son Ambulance 1809. Elle comptait dans ses rangs des médecins, des infirmiers et d’autres acteurs des services de santé. Dans l’univers très particulier des reconstituteurs, Eddy avait acquis une belle notoriété qui lui valait d’être écouté et respecté. Avec son groupe, Doc Percy était un élément actif des cérémonies de tout poil concernant l’époque napoléonienne. Lorsque son ami Henri de Poncelet-Bivort lui avait fait part de son idée d’organiser un bivouac sur ses terres en profitant des commodités de sa ferme, le Doc avait immédiatement accepté. En moins de deux semaines, il avait battu le rappel en contactant des amis sûrs et des groupes de qualité. Parmi ceux-ci, un destinataire enthousiaste avait relayé l’info sur Facebook et les demandes étaient arrivées en nombre tellement important que le président-fondateur de l’Ambulance 1809 avait dû se résoudre à stopper le mouvement et à opérer une sélection sévère. Pour des raisons pratiques et par mesure de précaution sanitaire, il s’était limité à trente-cinq inscriptions d’adultes et quelques enfants. Il avait alors rendu visite à son ami Poncelet-Bivort, dont la ferme était située entre Braine-l’Alleud et Genappe : un endroit idéal pour organiser un bivouac. Les premiers reconstituteurs étaient arrivés le vendredi et les derniers avaient planté leur tente quelques heures plus tard, dans l’après-midi du samedi. Tout ce beau monde avait dignement fêté les retrouvailles et les plus enjoués s’étaient couchés peu avant minuit.
Il était maintenant près de deux heures ce dimanche matin, et Charles-Damien avait rendez-vous dans quelques minutes dans une annexe de la ferme où des participants venus de la frontière allemande avaient remisé un canon à l’échelle un demi. Le jeune homme était en avance, mais sa nervosité était telle qu’il n’aurait pas pu rester une minute de plus dans sa tente. À courtes enjambées prudentes, il s’écarta du petit village de toile. La silhouette massive de la ferme n’était éloignée que d’une centaine de mètres, mais il fallait traverser une zone herbeuse vierge de toute construction et la pénombre relative ne permettait pas de se dissimuler. Or pour rien au monde le jeune homme ne devait être vu, pas davantage d’ailleurs que la personne avec laquelle il avait rendez-vous. En contournant une table placée à l’écart, il buta en jurant sur un objet métallique qui déclencha un horrible bruit de boîte de conserve : un fanal planté sur une pique en fer que les reconstituteurs placent généralement à côté de leur tente. Il se laissa tomber sur le sol, se couchant entre les touffes d’herbe jaunâtre en espérant que le bruit n’avait réveillé personne. Mais la chance était avec lui et il n’enregistra aucun mouvement suspect. Il redoubla de prudence pour traverser les quelques dizaines de mètres qui le séparaient encore de la ferme. Arrivé à hauteur de la grange dont les portes étaient grandes ouvertes, il se retrouva dans le noir, sous les hauts murs qui cachaient le ciel. Surpris, il tenta de s’orienter et s’immobilisa. Le silence n’était troublé que par les petits cris de quelque rapace chassant dans les environs, mais il lui sembla pourtant entendre un bruit discret, presque imperceptible. Une sorte de frôlement d’étoffe contre une surface dure. Peut-être un mur. Était-ce son interlocuteur ? Si c’était lui, il était également en avance. Inquiet, il siffla très légèrement et attendit une réponse, mais rien ne vint. Fausse alerte ! Rassuré, il reprit sa progression et longea un chariot dont il voyait à peine les lourds madriers en chêne. Pendant la journée, il était venu repérer les lieux et il savait que l’appentis dans lequel se trouvait le canon n’était plus bien loin. Il tâtonna un peu et se résolut à poursuivre sa progression en gardant les mains sur le mur de briques placé sur sa gauche. Bientôt, il sentit les planches rugueuses d’une porte et poussa celle-ci avec d’infinies précautions de sorte à ne pas faire geindre les vieilles charnières. Il pénétra dans l’appentis, heurta le fût du canon, le contourna, et alla se placer dos au mur du fond pour pouvoir observer à son aise l’entrée de la personne avec laquelle il avait rendez-vous.
Petit à petit, ses yeux s’acclimataient et il finit par distinguer la silhouette du canon avec, en avant-plan, une roue en bois cerclée de fer. Le peu de clarté qui pénétrait dans la pièce venait de l’encadrement de la porte. Aucune autre ouverture ne trouait le mur en face de lui. Il mourait d’envie d’allumer une cigarette, mais cela n’aurait pas été prudent et il ne tenait pas à attirer l’attention si d’aventure quelqu’un passait à proximité. Il respira profondément à trois reprises pour se calmer. Soudain, un nouveau bruit fit éclater la bulle de silence qui l’entourait. Une masse sombre se découpa dans l’encadrement de la porte et des pas prudents firent crisser la paille qui recouvrait le sol. Charles-Damien sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Il lança un prénom et demanda : « C’est toi ? Tu étais derrière moi ? Je ne m’en étais pas rendu compte. » Il se décolla du mur et s’avança vers son interlocuteur qui n’avait toujours pas prononcé un mot. Soudain, un éclair zébra la pénombre et le jeune homme vit une sorte de tige brillante se dresser devant lui. Il entendit un « han » de bûcheron, puis un bruit métallique qui s’acheva par un cri de douleur de l’intrus. Charles-Damien comprit brutalement que l’ombre qui se tenait en face de lui était décidée à lui faire mal, peut-être même à le tuer. La violence du coup auquel il venait d’échapper ne laissait aucun doute à ce sujet. Paniqué mais lucide, il réalisa qu’il avait peu de chance d’échapper à un second assaut. Alors, sans rien comprendre, il joua son va-tout et se jeta sur son adversaire en frappant aussi lourdement qu’il le pouvait. Avec les poings d’abord, puis, quand il eut cerné la position de son agresseur, il lui porta un violent coup de genou entre les jambes. Charles-Damien était vigoureux et il aurait sans doute pris le dessus s’il n’avait glissé sur la paille jonchant la terre battue de l’appentis. Il partit vers l’avant et son visage s’écrasa avec un bruit horrible sur la partie supérieure du canon. Il poussa un cri et s’écroula lourdement, la face tournée vers le plafond. L’ombre qui le dominait désormais se laissa tomber à califourchon sur son torse. D’une voix rendue presque inaudible par le sang qui coulait dans sa bouche depuis une large plaie ouverte à hauteur de son nez, Charles-Damien supplia son assaillant de le redresser car il étouffait. Insensible à ses suppliques, celui-ci mit ses mains autour de son cou et commença à serrer. Avec l’énergie du désespoir, sa victime tenta de se dégager, mais sans succès. Lorsque l’inconnu relâcha enfin son étreinte, l’homme avait cessé de respirer. Du moins le crut-il d’abord. Puis il vit un œil s’ouvrir au milieu du visage martyrisé et une bulle de sang commença à se former entre les lèvres du moribond qui se remit à gémir. L’adversaire lui-même était sans force, à bout de souffle. Il soupira profondément et chercha des yeux l’objet métallique avec lequel il avait frappé quelques instants plus tôt. Mais il ne le vit pas. C’est alors qu’il aperçut laservante, le coffret en bois dans lequel les canonniers placent les charges explosives appelées gargousses. À côté de la boîte se trouvait un sac rempli de poudre noire. L’ombre le saisit et l’ouvrit.
Charles-Damien Passereau était à l’agonie, mais il restait lucide et son œil valide le reliait encore à une certaine forme de réalité. Son agresseur approcha quelque chose de son visage, puis il sentit la poudre noire s’écouler dans sa bouche, formant un bouchon qui l’étouffa en quelques secondes. Pas suffisamment vite, toutefois, pour l’empêcher de voir une flamme jaillir dans la main droite de son bourreau. Le briquet enflamma la masse noirâtre. Il y eut un gargouillis écœurant, puis la petite pièce se remplit en un instant d’une odeur de viande grillée…
Chapitre 1
— Macho, moi ?
— Parfaitement ! Et j’ajouterais même : macho suranné !
Ils éclatèrent de rire en même temps tandis que Martine, perchée sur une échelle, faisait mine de lancer son gros pinceau plein de colle à la tête de Stanislas qui découpait de longues bandes de papier peint un mètre plus bas. Depuis le milieu de la matinée, le couple travaillait à recouvrir un pan de mur avec un papier intissé de dernière génération censé gommer les imperfections du plafonnage. C’était une idée de Martine et Stanislas n’avait pu s’empêcher, pour la énième fois en moins d’une heure, de lui répéter : « Du papier peint ! Au xxie siècle, à l’heure où on envoie des sondes sur Mars ! Non, mais je rêve ! C’est bien une idée de femme, ça ! »
Les deux amants travaillaient à l’étage du Vieux Lutrin, la bouquinerie de luxe que tenait Martine dans le quartier du Sablon, au cœur de Bruxelles. Les fenêtres du salon-salle à manger étaient largement ouvertes et les bruits de la rue témoignaient d’une agitation très relative. On approchait du 15 août et, depuis une semaine, une chaleur intense liquéfiait l’air ambiant. Les rares passants qui s’aventuraient dans les rues le faisaient de préférence de grand matin et là, le vieux carillon Westminster qui décorait la cheminée allait bientôt faire son Big Ben pour sonner midi. Stanislas était arrivé de Paris la veille après avoir fermé pour une quinzaine la porte de sa propre bouquinerie, La Malle aux Livres à Montparnasse. Chaque année à la même époque, la capitale française était envahie par des touristes qui, dans le domaine des « vieux » livres, se contentaient de dévaliser les coffres des vendeurs installés sur les bords de Seine. Une clientèle qu’il avait appris à éviter pour se concentrer sur de véritables collectionneurs avec qui conclure un achat ou une vente était un plaisir. En vingt-cinq ans, ce Carolo d’origine arrivé à Paris un peu par hasard s’était taillé une jolie réputation qui lui valait désormais de travailler comme expert pour de prestigieuses salles de ventes.
En début d’année, Martine et Stanislas étaient convenus de passer les deux semaines de vacances estivales en bord de Méditerranée. Au départ de Nice, ils pensaient gagner Menton puis Monte-Carlo avant de séjourner une semaine en Ligurie puis en Toscane. L’occasion pour Martine de chercher des vieilles affiches, des catalogues et des objets de l’époque où les touristes nantis s’offraient des croisières de luxe ou des séjours somptueux sur la Riviera. La bouquiniste quadragénaire en avait fait son fonds de commerce et toute occasion était belle pour nourrir la passion des clients du Vieux Lutrin. Les incertitudes liées à la pandémie de covid-19 en avaient finalement décidé autrement. Pris au piège des soubresauts capricieux d’un déconfinement en point d’interrogation, le couple avait décommandé les hôtels réservés quelques mois plus tôt. La Bruxelloise avait alors eu l’idée de consacrer les congés à quelques travaux de rafraîchissement dans les deux étages qu’elle habitait au-dessus de son magasin. Stan avait rechigné, cherchant des prétextes pour repousser cette proposition qui ne le motivait guère. Face à la détermination de sa compagne, il alla même jusqu’à proposer un séjour à ses frais aux îles Canaries, qui acceptaient encore des touristes à l’époque. Mais Martine tint bon et finit par lui rappeler d’un ton pincé qu’après tout, « il profitait largement de l’appartement, lui aussi ». Ce n’était pas faux : chaque semaine ou presque, Stanislas sillonnait la France et la Belgique à la rencontre de collectionneurs désireux de lui vendre ou de lui acheter des ouvrages. Deux à trois fois par mois, il s’arrangeait pour passer le week-end à Bruxelles chez Martine. Le samedi, comme elle ouvrait la bouquinerie, il réglait la paperasse ou visitait l’un ou l’autre confrère bruxellois. De temps à autre, sa compagne faisait appel à une amie pour tenir la boutique et ils s’offraient un court séjour en Ardenne, dans une ville flamande ou dans l’Ostbelgien. Devinant dans les yeux de Martine les prémices d’une dépression orageuse, Stanislas préféra battre en retraite et il accepta « de bon cœur » de participer au chantier de ravalement des étages. En contrepartie, il lui arracha néanmoins la promesse d’un week-end à la côte d’Opale en milieu de vacances. Finaude, Martine fit mine de réfléchir quelques secondes, puis acquiesça en lâchant « Faux-cul ! » dans un sourire. Il savait combien sa compagne appréciait les longues balades le long des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez.
Ce midi-là, ils déjeunèrent de pistolets1garnis de filet américain préparé2. Comme Stan débouchait une bouteille d’un vin d’Hérault découvert à Saint-Jean-du-Minervois lors d’une récente visite professionnelle, il vit une ombre passer sur le visage de Martine.
— Toi, tu me caches quelque chose. Je me trompe ?
La bouquiniste semblait hésitante.
— Non. Enfin si. C’est ennuyeux. Cela fait deux jours déjà que j’aurais dû te parler d’un petit souci, mais avec les travaux, ça m’est sorti de l’esprit. Mon amie doit s’impatienter…
— Mais de quoi parles-tu ? De qui s’agit-il ? Je la connais ?
Devant la volée de questions, la jeune femme sourit enfin. Elle se donna le temps de réfléchir en dégustant une gorgée de vin, puis elle s’expliqua.
— Il y a deux ans environ, au cours de yoga, j’ai fait la connaissance d’une femme prénommée Lilette. Elle s’est inscrite dans notre groupe sur les conseils de l’une d’entre nous avec qui elle est amie de longue date. Lilette habite le Brabant wallon et, chaque semaine, elle fait l’aller-retour entre Lasne et Uccle pour venir nous rejoindre. Elle prétend que, sans sa copine à ses côtés, elle ne serait pas assidue. Bref, l’ambiance lui plaît et, petit à petit, elle s’est intégrée au groupe avec qui je m’offre un gueuleton une fois par mois.
Stanislas connaissait. Le premier jeudi de chaque mois, Martine et une demi-douzaine de copines se réunissaient pour dîner dans un restaurant de la capitale sélectionné à tour de rôle par une des participantes. Cela se passait exclusivement entre filles et le Carolo-Parisien, qui avait vu l’une ou l’autre photo de ces soirées, ne put s’abstenir de lancer :
— Je vois très bien ! Et, comme j’ai déjà eu le plaisir de te le dire, je suis volontaire pour m’intégrer à ton petit groupe. Tes camarades seraient certainement ravies d’avoir un peu de compagnie masculine.
Il évita de peu la boulette de pain que Martine lui envoya d’un air faussement courroucé. Puis elle reprit le cours de son récit.
— Sois sérieux une minute, s’il te plaît. Ce que j’ai à t’expliquer n’a rien de rigolo, crois-moi.
De fait, les événements rapportés par Martine étaient du genre dramatique. Lors du dernier repas, la Brabançonne était absente. Son amie proche avait expliqué que son fils, Charles-Damien, avait été assassiné dans des circonstances horribles. Les faits s’étaient produits près de Waterloo, peu avant la fête nationale du 21 juillet, lors d’un bivouac organisé par des reconstituteurs napoléoniens. Depuis, la malheureuse avait sombré dans un état dépressif rendu plus sévère encore par le fait que l’enquête n’avait apporté aucun élément susceptible de mettre la main sur le coupable. À en croire la confidente de Lilette, la police judiciaire pataugeait : tous les participants au bivouac avaient été longuement entendus et le camp fouillé de long en large, mais sans résultat. Cela faisait trois semaines déjà et les chances de voir le crime élucidé s’éloignaient à la vitesse grand V. Si l’on considérait que les reconstituteurs étaient repartis chez eux depuis longtemps et qu’ils avaient repris leurs activités, rien ne permettait de penser qu’il subsistait des indices susceptibles de lever le mystère sur ce drame horrible.
— Après avoir appris cela, nous avons bien sûr discuté de la manière d’aider Lilette. Lui rendre visite ? Lui téléphoner ? Ce genre de choses. Mais son amie a rétorqué que le plus important à ses yeux était de coincer le ou la coupable. C’est alors que Christine – tu la connais, c’est celle qui travaille à la Bibliothèque nationale – m’a montrée du doigt en déclarant que je pouvais peut-être faire quelque chose. Elle a suggéré que… je t’en parle.
Devant l’air surpris de son amant, Martine reprit.
— Ne joue pas les modestes ! Toutes mes copines savent que tu as déjà résolu des enquêtes difficiles et je leur ai raconté en quelles circonstances tu as récemment frôlé la mort à Binche3. En fait, elles connaissent tout de tes exploits, mon Grand. Enfin, presque. J’ai préféré ne pas insister sur ton caractère de cochon et ton côté macho.
Stanislas tendit le cou et l’embrassa amoureusement. Il était touché.
— Bon, on en reste là, hein ? N’en profite pas pour gonfler du cou. Il est bien normal, après tout, que tu aies quelques menues qualités au milieu de tous tes défauts.
Reprenant son sérieux, la bouquiniste poursuivit :
— Cela se passait jeudi. Nous nous sommes quittées vers 23 heures et quand je suis revenue à l’appartement, j’ai reçu un coup de fil de ma copine. Enthousiasmée par ce qui s’était dit autour de la table, elle avait immédiatement sonné à Lilette et celle-ci souhaiterait te rencontrer au plus vite. Elle sait que tu es à Bruxelles pour une quinzaine de jours et elle aimerait que nous fassions un saut chez elle. Je lui ai téléphoné et j’ai essayé de relativiser les choses en expliquant que, lors de tes enquêtes précédentes, tu as toujours travaillé « à chaud », en disposant des éléments nécessaires pour mener tes propres recherches. Dans ce cas-ci, l’assassinat remonte à près d’un mois. Cela ne l’a nullement déstabilisée et elle se raccroche à l’idée que tu pourras peut-être découvrir quelque chose. Je suis sincèrement ennuyée. J’avais promis de t’en parler dès ton arrivée, hier, mais ça m’est sorti de la tête. Idéalement, ce serait bien que je lui réponde aujourd’hui encore. Que fait-on ? Je sais que c’est peine perdue, mais nous pourrions au moins la rencontrer. Ça aurait le mérite de lui permettre d’évacuer un peu de pression…
Stanislas ne savait trop que répondre. Il s’en tira avec une pirouette.
— Eh bien, merci pour ta confiance ! Cela fait chaud au cœur de savoir que tu ne crois pas en mes dons d’enquêteur.
— Stan, s’il te plaît, ne fais pas le gamin. Tu sais très bien ce que je veux dire. Les flics ont interrogé tous les acteurs du drame et n’ont rien trouvé. Reconnais que tes chances sont minimes de mettre la main sur un élément neuf.
Il était temps de reprendre le travail et ils convinrent de rendre quand même une visite à la mère éplorée. Jointe par Martine, Lilette Vanyperzele leur donna rendez-vous le lendemain en fin d’après-midi à Lasne.
Le moteur de la Facellia de 1963 ronronnait de bonheur tandis que la voiture enchaînait les tournants. Tout à la joie de reprendre le volant de l’ancêtre rendu célèbre par la série télévisée Les petits meurtres d’Agatha Christie, Stanislas Barberian avait opté pour le chemin des écoliers plutôt que pour les grands axes. Depuis quelques minutes, la voiture sillonnait les petites routes du Brabant wallon et, pour se donner l’illusion d’un peu de fraîcheur, ses occupants avaient baissé les vitres. De part et d’autre, la campagne était magnifique et l’été se déclinait en dizaines de palettes colorées sous un ciel de Méditerranée.
Malgré le décor bucolique, Stan se sentait un peu nerveux. À la réflexion, il prenait conscience qu’il avait peut-être accepté un peu vite la proposition de sa compagne. Certes, l’idée d’enquêter sur un meurtre aussi étrange que celui de Charles-Damien Passereau le séduisait mais, pour une fois, il doutait de ses capacités à assumer. Le fait de débouler dans l’affaire comme les carabiniers d’Offenbach n’augurait pas franchement d’une issue favorable. Il demanda à Martine de lui dire tout ce qu’elle savait sur la maman de la victime.
— Tout, c’est bien peu de choses, en fait. Au yoga, nous ne parlons souvent que de futilités et lors de nos « dîners de filles », Lilette n’est pas très causante, loin s’en faut. Elle est la plus âgée d’entre nous et, à soixante ans, elle est la seule à ne pas avoir d’occupation professionnelle, ce qui la démarque un peu plus encore. Cela dit, elle est enjouée et elle répond sans problème lorsqu’on la sollicite, mais toujours de façon brève, sans jamais se mettre en avant. Au début, je me souviens avoir pris cette attitude pour une forme de condescendance. Il est vrai que Lilette a tout d’une grande bourgeoise : elle semble être née avec une cuillère en argent dans la bouche et, même si elle a connu des moments difficiles, elle jouit manifestement d’une existence agréable.
Stanislas fit la moue.
— Agréable, c’est vite dit. Elle vient de perdre son fils, quand même.
— Bien sûr ! Mais je te parle d’aisance matérielle.
— Fortune personnelle ?
— Je ne pense pas. De ce que j’en sais, elle est bruxelloise et historienne de formation, mais elle n’a jamais enseigné. Elle s’est mariée très tôt avec un avocat nivellois qui s’est taillé une solide réputation dans le domaine de la stratégie juridique des entreprises pour gommer certains impôts. Un malin du nom de Jean-John Passereau qui a bossé comme un dingue durant des années pour monter son cabinet, puis qui a eu l’intelligence de s’entourer de collaborateurs pointus. Ce qui lui a permis de se détacher petit à petit des astreintes du travail quotidien pour se consacrer à des activités plus ludiques. Il a découvert le golf et s’est plongé dans ce sport comme d’autres dans l’œnologie ou la religion. Avec passion. À partir de ce moment, il a enchaîné les courts séjours à l’étranger pour des compétitions amicales comme il en existe des centaines de par le monde. Toujours dans des endroits féériques et en compagnie de gens friqués. D’après sa meilleure amie, Lilette a d’abord été conquise et elle s’est mise au golf avec son époux. Elle avait un swing plus qu’honorable et se défendait bien. Malheureusement, une hernie chronique, inopérable, l’a rapidement écartée des greens. À partir de ce moment, elle s’est retrouvée dans le camp des épouses qui ne jouent pas et qui s’occupent comme elles peuvent pendant que leurs maris enchaînent les dix-huit trous. Elle n’a pas trop aimé et elle s’est détachée progressivement de ce milieu tandis que son Jean-John multipliait les déplacements à l’étranger. Tu devines la suite ?
— L’avocat a mis un pied de côté ?
— C’est peu de le dire ! Loin des yeux, loin du cœur : il a eu une première liaison, puis une deuxième et ainsi de suite jusqu’au jour où Lilette a appris son infortune par une amie « bien intentionnée ». Le couple a rapidement battu de l’aile et, finalement, Passereau a pris l’avion pour la Floride en lâchant qu’il y resterait « sans doute un peu plus longtemps que d’habitude ». Tu parles ! Quand Lilette l’a revu six mois plus tard, il avait vendu son cabinet nivellois et il s’était recyclé dans la gestion d’un golf de luxe.
— Du côté de Palm Beach, chez Donald Trump ?
— Non. Du côté ouest, dans la région de Tampa. En guise decherry on the cake4, il lui a annoncé son intention de divorcer pour pouvoir refaire sa vie sur place. Elle l’a très mal pris. Alors, il lui a expliqué qu’à l’exception de leur maison, tout l’argent du ménage était en fait celui de sa société. Il l’a menacée de la mettre sur la paille.
— À moins qu’elle accepte un accord à l’amiable ?
Martine se tourna, interloquée, vers son compagnon.
— Exactement ! Serais-tu devin ?
La perche était trop belle…
— Non, mon amour, mais je suis un grand connaisseur de l’âme humaine et de ses turpitudes. Surtout de l’âme féminine, si prévisible, qui ne…
Il n’eut pas le loisir de terminer sa phrase : Martine lui pinça la joue et il ne put réprimer un cri de douleur.
— Oh ! Tu es dingue ? Pour un peu, j’envoyais ma Facellia dans le fossé !
— Ça t’apprendra à faire le macho, une fois de plus.
— Donc, elle a accepté une transaction financière et ils se sont séparés sans jugement ?
— C’est ainsi que cela s’est passé, en effet. Mets-toi à sa place. En perdant son mari, elle perdait tout et…
Stanislas soupira bruyamment.
— Et on dit que je suis macho !
Cette fois, ils rirent de concert et Stan fit un signe d’apaisement de la main. Puis il reprit :
— Et le gamin dans tout cela ? Il a suivi son père ?
— Dans un premier temps, oui. Il était encore adolescent, alors tu penses… Quand son paternel lui a parlé des plages de Floride, du soleil, du Walt Disney World, de Cap Kennedy et que sais-je encore, il n’a pas hésité. Mais le mirage n’a pas duré longtemps. Deux ou trois ans, je crois. En tout cas, il est revenu terminer ses études en Belgique. Entre-temps, il avait pris la mesure de l’affection que son père lui portait, c’est-à-dire peu de chose, en fait. L’ancien avocat préférait la compagnie des bimbos locales et il paraît que le malheureux Charles-Damien en a vu défiler ! Toujours est-il que quand il est rentré en Belgique, sa maman était aux anges et elle l’a littéralement couvé.
Ils venaient d’entrer dans Lasne et Martine, qui ne connaissait pas, comprit rapidement pourquoi la commune figurait parmi les mieux classées de Belgique en matière de revenu par habitant. La Facel Vega ne possédant évidemment pas de GPS, elle avait allumé son portable pour guider son « Grand » dans l’entrelacs des chemins boisés qui dissimulaient de luxueuses villas. Stan était venu une fois à Lasne une vingtaine d’années plus tôt. Dans le cadre de la réalisation d’un catalogue destiné à une importante vente d’animaux empaillés, une maison bruxelloise lui avait demandé de rencontrer Arlette Vincent. De son vrai nom Arlette van den Hende, celle-ci avait été durant de longues années la célébrissime animatrice du Jardin extraordinaire, l’émission-phare du dimanche soir sur la RTBF, la télévision publique belge. L’entretien s’était déroulé de façon très cordiale à Lasne, au domicile de l’animatrice. Stan avait même fait la connaissance de son mari. En pénétrant dans la maison blottie dans un cocon de verdure, il avait senti une savoureuse odeur de cuisine. Il s’était tout naturellement excusé d’avoir interrompu son hôtesse en plein travail, mais celle-ci l’avait rassuré en riant : ce n’était pas elle, mais son époux René qui se trouvait aux fourneaux au moment de son arrivée. Il s’était discrètement effacé au coup de sonnette pour retourner dans son potager. Devant l’air gourmand de Stanislas, Arlette Vincent était allée chercher son mari et les deux hommes avaient sympathisé devant un bol fumant et odorant.
Tout en essayant de ne pas se perdre dans le labyrinthe lasnois, Stan raconta l’anecdote à Martine qui crut discerner une certaine mélancolie dans la voix de son compagnon. Le souvenir du potage ou… le charme de l’élégante Arlette ? Elle préféra ne pas poser la question et, d’ailleurs,