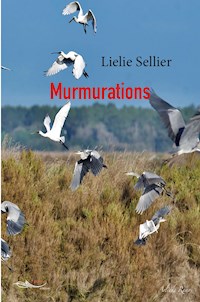
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand Charlotte, fille du nouveau médecin du village, entre dans sa classe un matin de novembre, la vie de Mathias rythmée par les coups de son père et le harcèlement de ses camarades de classe s’illumine. Il va trouver auprès d’elle et de ses parents, une nouvelle famille de cœur où il pourra se ressourcer, connaître des joies simples enfantines. Partagé entre son foyer chaotique et cette famille unie, il oscillera toute son enfance et adolescence, entre moments de terreur et de bonheur.
Inséparables, Charlotte et Mathias vont partager leur scolarité, leurs loisirs, leurs rêves jusqu’à la fin de l’adolescence. Après un baiser échangé, ils comprennent que la frontière entre amitié et amour est fragile. Charlotte entre à l’école des Beaux-Arts. Mathias respecte le souhait de son père et reste au village pour travailler sur l’exploitation agricole. Charlotte reviendra au village en pointillé jusqu’à l’annonce soudaine de ses fiançailles et son prochain départ pour vivre et se marier en Suède. Une correspondance s’établira pendant plus de quarante ans entre les deux amis, ponctuée de coups de téléphone. Charlotte et Mathias feront l’apprentissage de la vie, de ses désillusions, de ses espoirs, la quête de sens, d’identité, sans jamais interrompre le lien qui les unit grâce à leur correspondance. La vie les réunira-t-elle à nouveau ?
Ce roman gorgé d’émotions, parle de destins, d’accomplissement de soi, un hymne à la vie.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Lielie Sellier a écrit des romans, un recueil de nouvelles et des articles et nouvelles pour la presse féminine. Elle aborde des thèmes tels que la diversité, l’acceptation de la différence, les changements de choix de vies, les rapports entre humains et animaux, les liens entre le monde des vivants et des morts, la résilience. Elle anime des ateliers d’écriture et un club de lecture à Paris auprès de différents publics : enfants et adultes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lielie Sellier
Murmurations
À Nickie, Puce, Nino et Eden.
Partie I
Enfance
L’amour a un langage muet plus éloquent que l’éloquence.
Proverbe d’amour. Le livre de l’amour (1858)
Mathias appréciait d’être allongé au milieu de son lit, les jambes et les bras écartés. Cette position soulageait ses rhumatismes. Par temps sec, ses douleurs s’atténuaient. C’était un après-midi de pluie chargé d’humidité, tout semblait triste, endormi. Le ciel serait bientôt laiteux. Il était resté toute la nuit à l’étable pour veiller le vêlage de l’une de ses vaches. Le dimanche après-midi, Mathias s’octroyait une petite sieste d’une heure, il se perdait dans le dédale de ses souvenirs. Sa saison préférée était l’été, une légère brise faisait alors virevolter les rideaux de la chambre qu’il ne fermait jamais complètement. Il n’aimait pas l’obscurité, elle le ramenait à son enfance, à de mauvais souvenirs, au cagibi sous l’escalier où son père l’enfermait après lui avoir administré une raclée. L’été, avec l’éclat progressif du soleil, le ciel devenait lumineux. Dès l’aube, de son lit, il l’apercevait changer de couleur.
Cet après-midi-là, ne trouvant pas le sommeil, il se laissa bercer par des images le ramenant à un matin gris de novembre de son enfance, à l’école communale. La voix de son maître résonnait à ses oreilles, une leçon d’histoire en cours, la guerre 1914-1918, les tranchées, de nombreuses pertes humaines, beaucoup de soldats blessés. À leur retour, certains d’entre eux, défigurés, étaient devenus « les gueules cassées ». Les grands moments d’histoire se révélaient tristes et violents, pensait-il très intrigué par le destin de ces combattants. Mathias n’aimait pas la violence, il la connaissait trop bien, la vivant quotidiennement dans son foyer. Sous l’emprise de l’alcool et à l’évocation de certains souvenirs, son père Léon se transformait, son visage se fermait, ses yeux étincelaient de haine et de colère, ses propos devenaient grossiers, injurieux, les mains s’agitaient, distribuant torgnoles, coups de ceinture, de martinet, de corde. Il rendait son fils coupable de la mort de son épouse, Annabelle. Mathias devait disparaitre de sa vue. Essayant de trouver des positions qui lui permettaient d’atténuer la violence des frappes, l’enfant ne pleurait pas, ne protestait pas. Il s’était habitué avec le temps.
Malgré sa fureur, Léon prenait toujours soin de le frapper seulement sur le corps. Afin d’éviter tout soupçon, les marques étaient toujours contenues dans un certain périmètre, elles ne devaient pas dépasser des vêtements. Quand il le frappait, il revoyait toujours le visage de son épouse qui lui manquait terriblement. Après lui avoir administré une violente raclée, il le tirait par un bras, l’oreille, les cheveux et l’enfermait dans l’étroit cagibi sous l’escalier. Léon était prisonnier de ses émotions, il ne savait pas les gérer, il les extériorisait en battant son fils. Le corps de son Mathias gardait la trace d’hématomes à différents degrés de couleur. Léon cohabitait avec ses fantômes : Bérangère son premier amour et Annabelle sa défunte épouse. Le petit garçon vivait dans la perpétuelle attente des coups suivants.
Mathias restait enfermé dans le cagibi pour le reste de la journée, ou de la nuit. Sur le sol, il retrouvait sa vieille couverture effilochée. Il se contorsionnait afin de réussir à s’en envelopper. À tâtons, il déplaçait le seau placé à l’endroit où l’une des lattes du plancher du cagibi était disjointe, la soulevait et récupérait son petit trésor, une petite voiture en bois aux couleurs passées. Il la serrait très fort dans sa main qu’il ramenait sous la couverture qui sentait encore le parfum de sa mère, à base de figues et d’hibiscus, du cœur des jardins de l’Italie. Cette fragrance le tranquillisait. Il pensait à sa mère, au magasin de jouets en bois faits main, Le lutin bleu de Monsieur Aristide, un émerveillement renouvelé à chaque visite, la gentillesse du commerçant toujours accueillant qui lui offrait une guimauve.
Le mercredi c’était jour de contes, Madame Aristide les lisait aux enfants, les parents pouvaient terminer leurs courses tranquillement et venir les chercher plus tard. Ils les retrouvaient attentifs, les yeux écarquillés, les mines ravies, silencieux. Après la lecture, ils bénéficiaient d’un petit goûter concocté par la conteuse.
Ses rappels de mercredis après-midi heureux atténuaient sa souffrance. Il frottait les parties endolories de son corps, essuyait le sang. Le petit garçon fermait les yeux et se déplaçait en imagination parmi les rayons du Lutin bleu. Il s’endormait bercé par ces belles images. Depuis la mort de sa mère, il n’y était jamais retourné.
Léon continuait de l’envoyer à l’école, il se doutait qu’en son absence, il recevrait la visite du maitre d’école ou du directeur, Monsieur Delebarre, très à cheval sur l’enseignement républicain. Ils viendraient s’enquérir de Mathias.
Annabelle venait de la ville. Elle était belle, intelligente, élégante, raffinée, cultivée. Tout son contraire. Dès leur première rencontre, elle l’avait subjugué. En compagnie d’une amie, elle était venue pour participer aux vendanges. Léon les avait croisées sur les chemins autour du village, elles se promenaient ou lisaient sous le grand saule pleureur à côté de l’étang. Sa ferme jouxtait les vignes sans réelle limitation. Lucien n’avait pas osé les accoster. Il était maladroit en société. Il croisa un jour de marché son ami Lucien le viticulteur qui l’invita au repas de fin de vendanges, très réputé dans la région. Léon accepta l’invitation. La table était bonne et généreuse, de grands vins issus de la vigne de Lucien accompagnés de plats régionaux, les desserts fondaient en bouche, les produits provenaient du terroir local. L’ambiance était si joyeuse et bon enfant. Toute barrière de langue ou d’origine disparaissait. La veille du dîner, Léon fit un saut en ville pour s’offrir un nouveau pantalon, une belle chemise, des chaussures en cuir. Il se rendit chez le coiffeur et le barbier. Son image reflétée par l’un des miroirs lui plut. Issu d’une lignée de paysans, râblé et costaud, il ressemblait à ses aïeux.
Le soir du dîner, Léon arriva en retard, une génisse malade à soigner, le vétérinaire souffrant, il avait dû improviser avec les moyens du bord. Les villageois et les vendangeurs étaient réunis autour d’une grande table. Les conversations allaient bon train. À son arrivée, son ami Lucien lui assigna la place vide à côté de la belle inconnue croisée les jours précédents. Léon pensa que la chance lui souriait. Au moment où il prit place à ses côtés, elle fit tomber sa serviette qu’il s’empressa de ramasser. Léon engagea la conversation, il se sentait pousser des ailes.
– Bonjour, je m’appelle Léon, je gère la ferme d’à côté.
– Bonjour, moi c’est Annabelle, je suis bibliothécaire et sculptrice à mes heures perdues.
– Je dois avouer que je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture. Faute de temps, elle se limite aux revues agricoles, aux modes d’emploi des outils que je dois utiliser, à la composition des aliments pour mon bétail.
– C’est un bon début. Je peux vous retourner le compliment, gérer une exploitation doit être passionnant, j’adore les animaux et la campagne.
– C’est un métier de passion, très prenant. Il y a quelques années, j’ai repris l’exploitation familiale. J’y ai apporté de nombreux changements. Je dois avouer que je ne pourrai certainement pas vivre dans un autre endroit ni exercer un autre métier.
– Je comprends : respecter les vœux des anciens, conserver un héritage, le faire perdurer, le moderniser, doit être un challenge quotidien. J’aime à la fois la ville et la campagne. Vous vivez dans une belle région, verdoyante, et la mer n’est pas très loin.
– Avez-vous aimé participer aux vendanges ?
– Oui, j’ai apprécié, nous étions une dizaine de nationalités différentes. Je me suis fait de nouveaux amis, j’ai appris énormément sur le vin et la région.
Leur conversation avait été interrompue par leurs voisins qui les avaient enrôlés dans une danse collective, Léon et Annabelle s’étaient saisi la main en toute simplicité. La ronde des vendangeurs et des locaux entourait le grand feu. Les chansons, les rires, les éclats de voix se mêlaient au son des guitares. Annabelle était vêtue d’une robe toute simple en lin blanc, elle portait ses cheveux courts à la Jean Seberg. Elle ne ressemblait à aucune des femmes présentes, elle avait une allure décalée. Elle avait laissé ses sandales sous la table, et dansait pieds nus. Quand les guitares se turent, Léon ne lui lâcha pas la main, il l’emmena un peu à l’écart. En attrapant au passage sur une table deux coupes de champagne, il lui montra le crépuscule descendu au ras de la cime des arbres. Et leva sa coupe de champagne.
– À nous.
C’était un peu prématuré il en avait bien conscience, il passait souvent de la maladresse à l’impulsivité, d’un état passif à un état éruptif. Cette nuit-là, il avait décidé d’oser. Annabelle ne devait pas repartir dès le lendemain.
– Ne partez pas, prenez le temps de découvrir un peu plus notre belle région. Je peux mettre à votre disposition une longère attenante à mon corps de ferme plus que centenaire, elle a été bâtie par feu mon grand-père.
– Cette proposition est tentante et agréable. J’aime les vieilles pierres, les maisons imprégnées d’une histoire. Mon amie Claire m’accompagne. Nous prenons les décisions en commun pour ce voyage. Je dois lui demander si votre proposition la tente. Enfin, si elle peut s’appliquer à nous deux.
Léon n’avait pas eu l’intention d’inviter l’amie d’Annabelle. Il se reprit en se montrant enthousiaste.
– Bien entendu, ma proposition s’applique à vous deux. Je dois passer demain matin apporter du lait frais à Lucien, pour le petit déjeuner. Vous pourrez me répondre demain.
– D’accord, faisons ainsi.
Le repas se termina tardivement, Léon prit congé d’Annabelle en l’embrassant sur les joues. Il aurait aimé poser un baiser sur sa belle bouche. Il ne dormit pas cette nuit-là. Quand il rentra à la ferme, sa montre indiquait cinq heures, l’heure de la traite des vaches. Il devait labourer deux champs, nettoyer l’étable, rentrer du foin pour son bétail, remplir les bacs d’eau, réparer des clôtures côté route, nourrir tous les animaux. Il se changea tout en pensant à Annabelle qui ne devait plus jamais quitter ses pensées. Elle était devenue sa nouvelle obsession. Les cœurs solitaires, glacés, se réchauffent en croisant parfois un nouveau regard, une personne différente d’un précédent amour toujours présent et adulé, jamais trahi ou galvaudé par le temps, enfoui, intact sous des couches de glace. Annabelle venait de réveiller son cœur et son corps endormis. Elle représentait la main tendue à un marin en plein naufrage, épuisé par des années de solitude. Brune, mince, Annabelle était tout le contraire de son premier amour Bérangère, blonde, aux formes généreuses.
Avant sa rencontre avec Annabelle, Léon avait vécu un seul grand amour. Tout le village les voyait déjà fiancés puis mariés. Ils avaient partagé de longs mois un amour fougueux. Ils s’embrassaient sur les petits chemins de campagne. Certaines nuits, Léon enfourchait son vieux vélo pour apercevoir sa petite amie Bérangère une dernière fois avant le lendemain matin. Sur place, il lançait des cailloux contre les volets en bois, sa belle apparaissait dans sa sage chemise de nuit, laissant apercevoir un bout de sein en se penchant vers lui. Léon rentrait fou de désir, entièrement consumé par cet amour naissant. Dans sa chambre, il imaginait leurs corps enlacés, s’unissant au milieu de la nature champêtre, le bruissement du vent dans les feuilles, les rayons du soleil sur leurs peaux, leurs caresses, leurs bouches gourmandes de nouveaux plaisirs. Et s’endormait heureux.
Le bonheur lui paraissait immuable à cette époque, comme les saisons qui ponctuaient les années et transformaient les paysages environnants. L’innocence, la candeur les animaient. Un dimanche après-midi pendant que bétail et humains étaient repus et assommés par la chaleur, cachés par des meules de foin, les deux adolescents un peu timides, un peu embarrassés par leurs vêtements, fous de désir, se déshabillèrent, et firent l’amour. Leurs personnalités bien que différentes se complétaient. Ils auraient aimé passer l’été seuls, vivre nus dans la forêt au bord de la rivière. Enivrés par le goût de leurs peaux, du feu d’artifice de leurs sens après leur première union, par le plaisir les submergeant par vagues quand ils jouirent. Ils ne pensèrent plus qu’à recommencer à s’aimer, fous amoureux, traversant un premier amour pur et romantique. Léon, réservé et au caractère imprévisible, s’émancipa de la chape de plomb qui pesait sur ses épaules et verrouillait son âme depuis l’enfance.
Ses parents et le père Antoine répétaient inlassablement qu’il ne fallait pas commettre de péché de chair. Léon osa, expérimenta, s’ouvrit au monde, il supprima de ses pensées la litanie des transgressions à ne pas commettre. Il voulait s’échapper. Il n’y avait pas de faute, ils aimaient faire l’amour dans les endroits secrets où le voisinage et leurs parents ne pourraient pas les découvrir. Léon connaissait les moindres recoins et les cachettes des environs, il guidait sa jeune amie. Insouciants, l’avenir leur appartenait. C’était pour eux le temps des premiers émois, des mots doux prononcés au creux de l’oreille, de graver leurs deux prénoms entourés d’un cœur sur l’écorce des arbres centenaires. Au sein d’un été chaud, aride et sec que la région n’avait pas connu depuis une quarantaine d’années, les amoureux multipliaient les bains dans la rivière. Ils goûtaient les perles d’eau sur leurs lèvres. Ils se posaient sur le tapis de fougères et de mousse offert par les sous-bois qui les accueillaient.
La forêt semblait les protéger, ils avaient l’impression d’être le premier couple vivant dans un coin perdu. Cet été fut pour Léon l’été de tous les possibles, de l’affranchissement, de la rupture avec le modèle parental imposé. L’amour l’exaltait, le rendait invincible, maître de la forêt comme ses héros dans les bandes dessinées. Leurs corps, leurs bouches se cherchaient, découvrant chaque jour de nouvelles sources de plaisir. Léon, très habile de ses mains y avait construit un petit abri dissimulé, qui devint leur antre. L’été paraissait interminable.
Le matin, ils participaient aux divers travaux de la ferme de leurs parents. Les après-midi leur appartenaient. Ils purent passer deux longues et mémorables nuits ensemble. Leurs parents avaient été invités à un petit voyage paroissial. Ces deux nuits furent presque irréelles, sous les astres et entourés des bruits mystérieux de la forêt, ils s’endormirent enlacés.
Léon proposa à son amie de tout quitter, pourquoi ne pas partir à l’étranger, découvrir d’autres lieux, d’autres cultures, créer leur propre affaire. Bérangère accepta, elle avait un cousin en Australie. Dès le lendemain, elle lui écrivit et apporta un atlas dans leur cachette. Les deux amoureux avaient trouvé une destination. Ils décidèrent de se marier dans la forêt sans prêtre, sans famille. Ils confectionnèrent deux anneaux en liant des fleurs qu’ils glissèrent à leurs doigts. Ils étaient désormais mari et femme en secret devant l’éternité.
– À nous bientôt la belle vie en Australie. Ensemble, nous pourrons tout construire.
– Mon cousin nous aidera. Il a bien réussi, il tient une boulangerie à Sydney. La dernière fois quand il est venu pour les vacances, il nous a dit que tout était possible dans ce pays si on retroussait ses manches.
– Tu verras, nous nous dessinerons une belle vie pleine de surprises, d’inattendus, de voyages, de découvertes. Nos enfants seront libres. Nous leur ouvrirons en grand toutes les portes, il n’y aura jamais de secrets entre nous.
– J’avais soumis à mon cousin mon idée de refuge pour les koalas. Beaucoup de refuges existent déjà sur place. Mon projet sera un peu différent, il sera pédagogique.
– Je te fais confiance, les koalas t’adopteront.
– Oui comme tu m’as adoptée depuis notre classe de maternelle.
Ils s’embrassèrent à nouveau et restèrent nus à lézarder au soleil. La vie leur paraissait belle, vaste comme un océan, éclatante de couleurs. Ils rejetaient la vie qui les attendait s’ils restaient au village. L’Australie serait le premier pays où ils se poseraient, ensuite leurs pieds vagabonds pourraient les emmener ailleurs.
Un après-midi, alors que Léon l’attendait, Bérangère ne vint pas à l’heure convenue, peut-être avait-elle été retenue par sa mère ? Léon laissa passer deux heures. Puis, inquiet, ne tenant plus en place, il partit à vélo pour la ferme de Bérangère. Arrivé dans la cour, il vit tout de suite que quelque chose était arrivé, habituellement bien rangée et entretenue, elle semblait avoir été laissée subitement à l’abandon. Pierre, l’ouvrier agricole, traînait à côté du puits. Léon l’interrogea, ce dernier l’informa que Bérangère avait été transportée à l’hôpital de la ville voisine. En sortant de la ferme, elle avait été renversée par un chauffard qui avait pris la fuite. Léon lui demanda s’il pouvait le conduire à la ville. L’ouvrier devait garder la ferme, mais devant le désarroi du jeune homme il décida de passer outre et l’accompagna.
Le long du chemin, Léon qui avait rejeté tout l’été les prières se mit à prier. Bérangère devait vivre. Il faisait quarante degrés, mais il sentit un froid intense l’envahir. Ils étaient à plus d’une heure de l’hôpital, la route lui parut interminable. Pierre essaya d’engager la conversation en vain, Léon restait prostré sur le siège voisin, perdu dans ses pensées. Il répétait : Bérangère doit vivre. Il voulait la voir à nouveau plonger dans la rivière, courir, rire, sourire, grimper aux arbres, pédaler à côté de lui, libre, souriante, solaire. Elle était sa lumière. Elle faisait sortir le meilleur de chacun. À son contact, Léon allait de l’avant, il souriait à la vie en prenant tout à bras-le-corps. Leur projet de partir en Australie était un formidable défi. Non, il ne pouvait pas, il ne voulait pas la perdre. Pas maintenant. Ils devaient partir pour l’Australie comme ils l’avaient prévu.
Une fois à l’hôpital, Léon jaillit de la vieille voiture, il ne pouvait pas attendre une minute de plus. Dans le hall, il demanda à l’accueil l’étage et le numéro de la chambre et se précipita dans l’escalier. Dans le couloir, il croisa l’un des frères de Bérangère, dévasté. Il prit Léon dans ses bras et lui tapota le dos. Léon resta un moment devant la porte de la chambre, essayant de calmer sa peur. En inspirant plusieurs fois, il essaya de reprendre des forces et de la contenance. Il trouva enfin le courage d’entrer. Un bandage entourait la tête de Bérangère emprisonnant ses magnifiques cheveux blonds poissés de sang. Le côté droit de son beau visage était salement amoché, son regard dénué de vie, son teint livide. Son corps bandé, inanimé était relié à une grosse machine dont les signaux sonores rompaient le silence de la chambre.
Les parents de Bérangère l’embrassèrent et sortirent pour les laisser seuls. Léon s’approcha de son aimée. Il aurait souhaité l’emporter dans ses bras, l’emmener dans leur cachette dans la forêt, qu’elle revienne à elle. Il espérait un miracle. Elle, jadis si pleine de vie ressemblait à une Princesse de glace.
Léon s’assit dans le fauteuil à côté du lit, saisit l’une des mains inertes de Bérangère, et resta dans cette position à son chevet, indifférent au passage du corps médical. Il veilla son amoureuse jour et nuit. Il fit juste un saut à leur cachette pour récupérer leur atlas. Quand ils étaient seuls, il lui lisait des descriptions de villes ou de paysages australiens. Il avait découpé dans un magazine la photo d’un koala, qu’il déposa contre le vase de fleurs champêtres sur la table de chevet. Il souhaitait humaniser cette chambre impersonnelle.
– N’oublie pas ma douce, les koalas t’attendent. Tu manquais à Plume alors je l’ai emmené. Nous te veillons, nous attendons ton réveil.
Léon embrassa à nouveau ses lèvres glacées. Dans ses souvenirs de contes d’enfance, les princesses se réveillaient au contact d’un baiser. Là, dans cette chambre quelque part dans la ville, aucun miracle ne se produisait, la princesse ne se réveillait pas. Les ténèbres l’entouraient déjà.
Les ronronnements de Plume apaisaient Léon et brisaient la monotonie du bip de la machine. À l’aide d’un gant de toilette, Léon avait enlevé les traces de sang des cheveux de Bérangère et l’avait coiffée. Elle était toujours belle à ses yeux, son ange. Après leurs baignades dans le lac, il adorait lui brosser sa longue chevelure. Quand ils roulaient ensemble sur l’herbe, il aimait enfouir son visage dans ses boucles d’or. Il continua de déposer de doux baisers sur ses lèvres muettes, espérant toujours un réveil. Il lui lut à haute voix des poèmes, dont le préféré de Bérangère :
Air vif
J’ai regardé devant moi
Dans la foule je t’ai vue
Parmi les blés je t’ai vue
Sous un arbre je t’ai vue
Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments
Au tournant de tous les rires
Sortant de l’eau et du feu
L’été l’hiver je t’ai vue
Dans ma maison je t’ai vue
Entre mes bras je t’ai vue
Dans mes rêves je t’ai vue
Je ne te quitterai plus
Paul Eluard (1895-1952)
Le Phénix
Quelques jours passèrent sans aucune amélioration, les radios et les différents examens confirmèrent le diagnostic de mort cérébrale. Différents spécialistes de l’hôpital s’étaient réunis, la décision prise, la machine serait débranchée sous vingt-quatre heures. La famille de Bérangère, très croyante, avait d’abord été réticente à donner son accord. Il était mal de mettre fin à une vie, contraire à leur éthique. Suite aux explications médicales, ils s’étaient rendus à l’évidence.
Dans la solitude de la peur du départ proche de Bérangère, le passage du père Antoine dont Léon et elle avaient fréquenté les cours de catéchisme, le rendit plus serein. La présence du vieux prêtre le rassura, lui rappela des moments heureux de partage, des excursions dans la campagne à la découverte de la flore. Le père Antoine était un féru de la campagne et de ses ressources naturelles. En écoutant cette prière du père Antoine, Léon pensa que Bérangère ne partirait pas seule.
PRIÈRE
Dieu puissant et miséricordieux, voilà une âme qui quitte son enveloppe terrestre pour retourner vers le père des miséricordes, dans le Ciel sa véritable patrie ; puisse-elle y entrer en paix et votre miséricorde s’étendre sur elle.
Ange gardien qui l’avez accompagnée sur la Terre, ne l’abandonnez pas à ce moment suprême ; donnez-lui la force de supporter les dernières souffrances qu’elle doit endurer ici-bas pour son avancement futur ; inspirez-la pour qu’elle consacre au repentir de ses fautes les dernières lueurs d’intelligence qui lui restent, ou qui pourraient momentanément lui revenir.
Seigneur Jésus par votre Saint Sacrifice donnez-lui la vie éternelle !
Esprit-Saint donnez-lui la Paix !
Archange Saint-Michel protégez-la des attaques du démon.
Vierge Marie et Saint-Joseph patron de la bonne mort, priez pour elle.
Léon estima que la malédiction s’était abattue sur eux à travers elle, la foudroyant dans son éclatante jeunesse parce qu’ils voulaient quitter leur famille et leur terre natale. Ils se pensaient seuls dans la forêt, les esprits, les âmes blessés veillaient et les avaient certainement entendus. Il se sentait fautif, il était le premier à avoir évoqué leur départ. Les enfants ne devaient pas abandonner la terre ancestrale qui les avait vus naître. Ils lui appartenaient corps et âmes. Ils y naissaient, s’y mariaient, créaient une famille, y vivaient et y mouraient. Il en était ainsi depuis la nuit des temps. À leur mort, ils seraient enterrés dans le cimetière communal avec leurs secrets et pour certains, leurs rêves d’émancipation jamais réalisés.
Léon se souvint à cette époque des paroles de son grand-père Marcel, lui ordonnant de ne jamais s’approcher du puits de la ferme des parents de Bérangère. Au village, il se disait : si tu tombes un jour de beuverie dans le puits de Cyprien, tu peux dire adieu à la vie. Ce puits était le plus profond de la région. Dès qu’il passait à côté, il lui semblait entendre des chuchotements. Pierre, l’ouvrier agricole ne se tenait jamais très loin comme s’il en était le gardien. Les jours de grand vent, on pouvait entendre des voix gémir.
Les filles de la famille de Bérangère vivaient brièvement. Les garçons grandissaient forts et vigoureux. De son vivant, Bérangère s’était moquée de cette croyance, elle était en parfaite santé et souhaitait croquer la vie à pleines dents. La jeune femme s’efforçait de rester toujours positive et d’effacer la noirceur du quotidien dont les vieilles légendes familiales faisaient partie. Sa sœur jumelle était morte deux ans auparavant. C’était pour sa défunte sœur et sa mère qu’elle se montrait toujours heureuse et joyeuse. C’est le cœur léger qu’elle avait voulu rejoindre Léon cet après-midi-là. Les esprits malins et la terre l’avaient rappelée à eux. L’été chaud et sec brûlait l’herbe, les champs, tarissait les points d’eau. Les fantômes veillaient. Les croyances locales se diffusaient à travers la campagne.
Ses parents, ses frères et Léon assistèrent au débranchement de l’assistance respiratoire. Plus tard, après que l’infirmière l’ait recouverte d’un drap blanc immaculé, Léon sentit qu’il perdait pied. Il n’imaginait pas son quotidien sans elle. Il allait regagner les ténèbres, à nouveau happé par la chape de plomb dont il pensait s’être affranchi. La mort de Bérangère avait sonné le glas de jours heureux, insouciants, d’un rêve de départ.
Pour ses funérailles, le père Antoine avait laissé les portes de la vieille église ouvertes. Une enfant du pays partait, entourée des siens et de tout son village. Bérangère reposait, virginale, dans son cercueil blanc, les mains jointes, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages qu’elle adorait. Elle portait à son doigt l’anneau de leur mariage secret composé de fleurs désormais fanées. Plume veillait à côté du cercueil, fidèle à sa jeune maîtresse. Léon porta le cercueil, avec le père et les frères de Bérangère, de l’église au petit cimetière adjacent. Le cœur en hiver, ses vieux démons revenus faisaient déjà fléchir sa raison.
Bérangère prit place à côté de sa jumelle, dans le caveau familial. Leur mère pensa qu’elles allaient se retrouver. Elle se sentait fatiguée. Elle aurait aimé rejoindre ses filles, doucement, sur la pointe des pieds, bien que ce soit pêché de penser ainsi. Elle portait en elle une nouvelle vie. Elle espérait que ce nouvel enfant serait un garçon afin de le tenir éloigné de la malédiction. Cette nouvelle grossesse n’était pas désirée. Lors de sa dernière confession, le père Antoine lui avait dit que c’était un signe de Dieu. Quand une âme partait, un nouveau-né arrivait. Elle ne l’appréciait pas, elle ne lui faisait pas confiance. Elle s’interrogeait à son sujet, l’ayant vu sortir de leur grange rajustant ses habits tout en se dirigeant vers elle en train de suspendre une lessive dans le jardin. Elle avait alors remarqué des fétus de paille sur sa soutane et ses cheveux. Quelques minutes plus tard, Jeanine, l’une des saisonnières envoyées par un établissement de jeunes femmes déficientes mentales, était sortie du bâtiment en reboutonnant le haut de son corsage. Ses seins opulents débordaient de son décolleté trop ajusté. Curieux, avait-elle pensé tout en écoutant le père Antoine lui parler des bienfaits d’agrandir sa famille.
Dans ce coin de campagne, l’éducation passait par l’institution catholique. La morale chrétienne, la présence omniprésente du curé imprégnaient la vie de ses ouailles. À la mort de Bérangère, sa mère décida de ne plus jamais aller se confesser. Cela suffisait, elle déciderait elle-même de ce qui était bien ou mal. Elle savait faire la différence. Elle s’affranchit de l’église. Elle n’avait pas peur de la présence du diable souvent évoquée par les prêtres. Le diable était tapi partout, répétaient-ils ! Et les hommes de Dieu étaient-ils dénués de failles ? Elle se souvenait du père Antoine réajustant ses vêtements. Péché de chair ? Elle devait parler à Jeanine et lui conseiller de mettre des corsages plus amples et de ne plus rester seule en compagnie du curé.
Léon jeta une poignée de terre et une rose blanche sur le cercueil. Par ces gestes, il lui disait simplement au revoir, Bérangère serait toujours à ses côtés. Quand il sentit le grain lourd et gras de leur terre natale sous ses doigts, il comprit que le rêve de vivre ailleurs s’effaçait et qu’autour de lui tout reprendrait une place immuable, statique. Leur amour avait été une parenthèse magique. Il se sentit infiniment seul. Sans elle, le monde lui parut à nouveau hostile.
Plume se rendait chaque jour sur la tombe de sa jeune maîtresse, le cimetière n’était pas très loin de la ferme. Il y croisait Léon. Plume le regardait, et semblait lui dire : « Je partage ta peine, elle nous manque tellement. » Un après-midi, au lieu de rentrer à la ferme, Plume suivit Léon. Ce dernier le posa dans le panier accroché à son vélo. Le chat et lui devinrent inséparables. Plume serait l’ami, le confident, le compère de balades dans la campagne à vélo quand la noirceur des jours de deuil le torturerait de sa pointe acérée, empoisonnée, aliénant sa raison chancelante. Il allait l’accompagner durant dix-neuf années d’une belle amitié.
Quelques mois après l’enterrement de Bérangère, Léon, devenu mutique, fut interné deux ans en hôpital psychiatrique. Le monde ressemblait à un trou béant sans elle. Il devait être aidé pour continuer à vivre. Sa mère vint le voir deux fois par semaine en compagnie de Plume. La présence hebdomadaire de son ami à quatre pattes avait un effet bénéfique.
L’enquête de police piétinait. Le chauffard n’avait pas été retrouvé. Le voisinage n’avait remarqué aucun véhicule roulant à grande vitesse. Pierre, l’ouvrier agricole, semblait être le seul témoin. À cause de la terre sèche, les traces des pneus de la voiture étaient peu identifiables.
À son retour à la ferme, son père Marcel lui rappela que cette terre serait à lui, la nouvelle génération. Leurs aïeux l’avaient gagnée à la force des mains et du travail. Leurs racines étaient là. Le devoir de Léon serait de faire perdurer cet héritage. La terre ne devait pas être vendue aux étrangers. Elle les nourrissait depuis la nuit des temps. Aucun d’entre eux ne l’avait encore quittée. Entre les murs de l’exploitation, et la limitation des champs, Léon se sentit emprisonné à jamais.
*
Mathias changea de position et étira ses membres. Le ciel s’était éclairci. Ce matin-là de novembre, la leçon d’histoire avait été interrompue. Le directeur de l’école, Monsieur Delebarre, un homme de grande taille, au généreux embonpoint, avait ouvert la porte de la classe laissant s’engouffrer les feuilles mortes des peupliers de la cour. Il semblait occuper tout l’espace. À ses côtés se tenait une fillette aux cheveux blonds comme le blé d’été, des yeux en forme d’amande couleur d’océan, des pommettes hautes. Elle avait de beaux habits et un cartable en cuir tout neuf. En la regardant, Mathias crut à l’apparition d’un ange. La grisaille de la journée, les moqueries, les coups de son père la veille disparurent d’un coup de baguette magique. La place à côté de lui était libre. Mathias fit rapidement un vœu en espérant qu’il serait exaucé. Il n’était pas très populaire au sein de sa classe, les autres enfants le surnommaient « le bouseux », il n’avait pas de beaux habits. Né avec une malformation à la lèvre supérieure, son surnom était « bec-de-lièvre ». La petite fille ne voudrait certainement pas prendre place à ses côtés.
Monsieur Delabarre présenta la fillette au reste de la classe : « Bonjour les enfants, je vous présente Charlotte, elle rejoint votre classe. Son père est le nouveau médecin du village. » La fillette sourit. Il sembla à Mathias que son sourire lui était personnellement destiné. Son vœu se réalisa quand Monsieur Delabarre indiqua à Charlotte la place libre à côté de lui. La fillette s’assit, le salua. En un fragment de seconde, il n’était plus un bouseux, un bec-de-lièvre, il était beau, il existait. Il décida qu’il l’appellerait Charlotte devant les autres enfants, pour lui elle serait Luna. Luna sonnait bien, lui faisait penser à la beauté de la lune qu’il adorait regarder quand elle apparaissait. Luna était propre, les cheveux blonds bien coiffés, rassemblés par un beau ruban en velours bleu assorti à sa jolie blouse. Ses vêtements sentaient la lavande. Ce parfum rappela à Mathias des souvenirs enfouis au plus profond de sa mémoire. Sa blouse d’un gris terne, ses cheveux ébouriffés et mal coupés, ses vêtements portés plusieurs jours de suite sans être lavés et repassés, ne le mettaient pas à son avantage. Le directeur sortit de la classe. Des effluves de café stagnèrent dans l’air, de nouvelles feuilles s’engouffrèrent. Le maître d’école, songeur, en ramassa quelques-unes et annonça qu’ils iraient se promener en forêt le mercredi suivant pour identifier différentes espèces d’arbres. Mathias devint attentif. Les arbres le passionnaient plus que la guerre. Il aimait aller se promener dans la forêt avec ses chiens Milou et Patty. C’étaient ses seuls véritables amis avec la vache Marguerite. Les deux chiens le suivaient partout, l’accompagnant le matin et revenant le chercher le soir à la sortie des classes. Ce qui évitait à Mathias bien des raclées et des guets-apens tendus par les autres élèves. Dans la forêt, Mathias et ses deux compères se transformaient en aventuriers découvrant une terre inconnue. Mathias s’y sentait protégé. Il s’y cachait parfois de la vue de Léon, il savait qu’il ne viendrait pas le trouver là.
Mathias avait compris très tôt qu’en le regardant, son père pensait à la mort de sa mère Annabelle. Il se sentait coupable. Cette culpabilité pesait lourd sur ses frêles épaules. Dans la forêt, il pouvait être insouciant, jouer avec ses deux amis. Il aimait son odeur, l’humidité des sous-bois, les clairières ensoleillées, le lac, les animaux rencontrés, les bruits, grimper aux arbres.
La voix haute perchée du maître d’école sortit Mathias de ses rêveries, les images de batailles gagnées ou perdues, le bruit fracassant des obus envahirent à nouveau la salle de classe. Mathias espérait que Charlotte et lui deviendraient amis. Il savait déjà quelle surprise il lui ferait. La cloche sonna la fin des cours. Derrière le portail de la cour, Milou et Patty l’attendaient sagement assis, quand ils le virent, ils se levèrent. Mathias les caressa entre les deux oreilles. Charlotte aimait les animaux, elle s’agenouilla à côté d’eux. Ils lui tendirent chacun une patte.
– Bonjour les chiens.
Mathias les présenta :
– Milou et Patty.
La mère de Charlotte était venue la chercher, elle avait le même sourire que sa fille :
– Je m’appelle Louise, je suis la maman de Charlotte. Tu peux venir goûter chez nous, si tu le souhaites. Tes deux amis sont les bienvenus.
Aucun des parents des autres enfants ne l’avait jamais invité. Mathias accepta, son père devait être aux champs à cette heure-là. L’imposante maison de trois étages se dressait dans la rue principale, agrémentée de jolis volets blancs, dotée d’un très beau jardin et à l’arrière d’une véranda regorgeant de plantes exotiques. Louise avait la main verte. Mathias avait honte de ses vieux vêtements, il pensa qu’il ne devait pas sentir très bon. Louise et Charlotte semblaient s’en moquer.
– Allez vous laver les mains les enfants.
Les bulles de savon sentaient la vanille. Il essaya de faire discrètement disparaitre la crasse de dessous de ses ongles. Il avait conscience de son aspect négligé. La maîtresse de maison semblait indifférente à son apparence. Louise avait préparé une pâte à crêpes qui attendait sagement sur la table de la cuisine blanche, immaculée.
– Ne reste pas debout Mathias, assieds-toi. Venez Patty et Milou, installez-vous sur ces plaids près du radiateur. Vous serez comme des rois.
Ils s’installèrent, ravis d’être bien au chaud. À la ferme, Léon ne les laissait pas rentrer, leur place était à la grange. Mathias s’installa sur l’une des confortables chaises, Louise chantait tout en faisant virevolter les crêpes dans les airs avant de les poser dans leurs assiettes. Louise l’interrogea sur sa famille, Mathias lui répondit que son père était fermier.
– Est-ce qu’il vend du lait ?
– Oui, à la coopérative ainsi que des pommes, des poires du verger et des bons œufs. Si vous voulez, je peux demander à mon papa de vous en mettre de côté.
– Oui je veux bien, j’aime cuisiner avec de bons produits locaux. En rentrant, tu diras à ton papa que je passerai demain dans la matinée.
– D’accord.
Louise lui confectionna sa première crêpe « Coquelicot », une crêpe nappée de confiture de framboise issue du jardin, mélangée à du miel des montagnes et des zestes de citron. Mathias la regarda longuement, ravissement des yeux et saveur à venir aux papilles, il en coupa un premier petit morceau et le savoura religieusement. Il aimait la cuisine blanche et ses ustensiles étincelants de propreté. Les bouquets de fleurs et les pots de confiture, de miel sur la table étaient les seules touches de couleurs. Milou et Patty n’avaient pas été oubliés par la maîtresse de maison, ils venaient de manger les restes du déjeuner. Les deux compères étaient repus et allaient faire la sieste.
Charlotte et Mathias firent plus ample connaissance. Ce goûter fut un agréable moment, hors du temps pour le garçonnet, qui espérait secrètement qu’il pourrait revenir et que d’autres goûters suivraient. Il se sentait si bien dans cette maison accueillante. Louise appelait ce moment l’heure du thé. Il savait que c’était prématuré de penser qu’il avait trouvé une deuxième famille. Avant de partir, Louise enveloppa des crêpes :
– Tiens, elles sont pour ton père. Demain après-midi, je vous préparerai pour votre goûter une bonne tarte aux pommes.
Elles l’embrassèrent. Tout joyeux, il marcha d’un bon pas vers la ferme accompagné de ses deux chiens. Il venait d’être invité pour le lendemain. Il était trop tard pour aller se balader en forêt. Il venait de découvrir que lui aussi pouvait avoir des amis et être invité.
En rentrant dans la cour, il vit que la cuisine était éclairée, son père était rentré. Mathias espérait que son humeur ne serait pas trop maussade. Léon n’appréciait pas que son fils traine sur le chemin de retour de l’école. Il avait de nombreuses tâches à accomplir en rentrant le soir. Avec l’aide des chiens, il devait rentrer le troupeau de vaches à l’étable. Mathias savait qu’il était en retard. Quand il ouvrit la porte de la cuisine, il comprit de suite que l’atmosphère était tendue. La mine de son père était sévère, une bouteille de vin rouge bien entamée était posée sur la table de la cuisine.
– Fils, d’où viens-tu ? Le troupeau n’est pas rentré. Je ne peux pas compter sur toi ?
– La mère de Charlotte m’a invité à un goûter chez eux. Tiens, elle t’a enveloppé des crêpes. Elles sont délicieuses.
Léon regarda son fils poser les crêpes sur la table, ses doigts commençaient à le chatouiller.
– Qui sont cette Charlotte et sa mère ?
– Charlotte est arrivée dans notre classe aujourd’hui. Elle est la fille du nouveau médecin. Sa mère est venue la chercher à la sortie de l’école. Comme Charlotte lui a dit que j’étais son nouvel ami, elle m’a invité avec les chiens pour le goûter. Elle appelle ce moment l’heure du thé. Elle m’a demandé de te dire qu’elle passera demain pour t’acheter du lait, des œufs et des fruits.
De toute la conversation, Léon avait retenu les mots : nouveau médecin, il devait faire attention. Les médecins et leurs bonnes femmes, souvent des grenouilles de bénitier, fourraient toujours leur nez partout, cherchant à percer à jour l’âme humaine.
– Ok d’accord. Disparais, file chercher le troupeau avec les chiens, ouste !
Mathias sortit, siffla les chiens. Ils cheminèrent côte à côte, enveloppés par l’air froid et sec. Il commençait à geler. Les vaches ne se firent pas trop prier pour regagner l’étable. La tâche fut aisée, tout ce petit monde avait envie de rentrer bien au chaud. Marguerite, la doyenne du troupeau, imposante Holstein, menait le troupeau. Elle était la préférée de Mathias. Elle possédait un regard doux, tranquillisant. Les jours où Léon buvait jusqu’à plus soif, le petit garçon dormait parfois contre son flanc sachant qu’il était préférable de ne pas se montrer. Il restait à l’étable, entouré de ses animaux, trouvant auprès d’eux affection et réconfort.
Dans le grenier au-dessus de l’étable, il avait aménagé une petite cachette où il avait réuni ses rares trésors : une photo de sa maman Annabelle et lui bébé, un petit chat en bois sculpté par elle, un canif, un harmonica et des belles images qui le faisaient rêver, une très vieille peluche ayant appartenu à sa mère. Le soir, il aimait regarder ses maigres trésors, si chers à son cœur, si importants pour maintenir un lien avec sa maman qu’il avait peu connue. Quand il dormait à l’étable, il s’endormait en serrant la vieille peluche, présence rassurante et familière. Les garçons de l’école se seraient encore plus moqués de lui s’ils avaient eu connaissance de cette relique. Ils l’auraient traité de débile, de bébé à sa maman. Mathias la cachait, son père pourrait la détruire.
La nuit fut courte. À cinq heures du matin, Léon ouvrit brutalement la porte de l’étable. Mathias était déjà prêt et avait pris soin de cacher ses maigres possessions. Avant d’aller à l’école, il devait aider son père à différentes tâches, week-end compris. Mathias participait à la traite, nettoyait l’étable, mettait du foin propre, préparait les biberons pour les veaux. Il aimait leur donner à téter, ils buvaient goulûment. Il rentrait seul à la maison et préparait son petit déjeuner avec ce qu’il restait, parfois il n’y avait rien à manger. Il partait à l’école le ventre vide. Léon ne pensait pas toujours à faire des courses. Ce matin-là, il y avait du beurre, de la confiture et du pain. Chaque matin, Mathias préparait deux gamelles à ses chiens qu’il leur portait à l’étable. Il faisait un brin de toilette, essayait de discipliner ses cheveux hirsutes. Le dimanche, Léon lui permettait d’emprunter son eau toilette Menen.
Il chercha une tenue propre et pas trop usagée. Il trouva enfin un pantalon en velours côtelé convenable. Il avait grandi depuis la dernière fois où il l’avait porté. Le pantalon était trop court mettant ses vieilles galoches en lumière. Il se regarda une dernière fois, il n’était pas beau avec sa bouche abimée. Il s’en fichait. Il s’était habitué au fil du temps à sa différence. Il n’y pensait plus jusqu’au moment où les autres lui rappelaient.
Mathias partait toujours angoissé pour l’école. Il quittait un endroit hostile pour en rejoindre un autre. Ce jour-là, pour la première fois, il se sentait heureux. Quand il sortit du sentier de la forêt, le village était nimbé d’une lumière dorée. En distinguant le clocher de l’église, il remercia le petit Jésus qui s’y trouvait dans les bras de sa mère Marie. Son cœur ne battait pas la chamade, il se sentait délesté du poids de son angoisse matinale habituelle à l’approche du bâtiment. Il serait invincible. Indifférent au froid hivernal, aux moqueries, à la longueur de son trajet à pied, il se nommait Mathias, le chevalier. Les chevaliers avançaient toujours courageux, droits et fiers. L’arrivée dans sa vie de Luna et Louise marqua chez lui le temps de l’espérance. Ne plus être seul, pouvoir parler à des semblables autres que ses amis les animaux symbolisaient un grand pas en avant.
Milou et Patty l’accompagnèrent jusqu’à la cour de récréation. Mathias les caressa entre les deux oreilles, signe qu’ils devaient repartir à la ferme. Ils reviendraient l’attendre tout à l’heure. Ils avaient été recueillis par Annabelle. Depuis sa mort, ils semblaient veiller sur lui à sa place, fidèles anges gardiens. Dans la cour, un groupe de garçons jouait aux billes. Dès son arrivée, ils se moquèrent de son apparence.
– Voilà bec-de-lièvre. Tu pues la bouse de vache, bouche tordue, abruti, mocheté !
Mathias ne répondit pas, et s’assit sous un arbre à côté du préau, un coin abrité du vent et de la pluie, qu’il affectionnait. Il n’avait pas envie de se battre avec eux. Il se contentait de paraitre invisible lors des récréations. Dès le début, il avait compris que devenir amis serait impossible, ils le rejetaient de tout leur être. Il était le vilain petit canard, leur cible, il les irritait. L’aspect miteux de ses vêtements, ses pull-overs boulochés, son bec-de-lièvre les répugnaient. Un jour, il avait pensé que peut-être dans chaque école, il y avait d’autres petits garçons pas très beaux, pas très propres, vêtus de vieux vêtements comme lui, toujours assis seuls en attendant de rentrer en classe. Il attendait en dessinant dans son carnet de croquis, cela lui permettait de s’évader de son quotidien, d’inventer d’autres mondes, de nouvelles créatures, de trouver la paix, d’accéder à un monde imaginaire dont lui seul avait les clefs. Il aimait croquer ce qui l’entourait. Il avait hérité du don d’Annabelle pour le dessin. Sur le chemin de l’école, il avait décidé qu’il serait le chevalier servant de Charlotte, croix de bois, croix de fer. Quelques minutes avant l’entrée en classe, la fillette arriva accompagnée par Louise. Sa mère partie, quelques garçons se tournèrent vers elle et crièrent :
– Charlotte aux fraises, pimbêche, nunuche ! Vous faites une belle paire, le bouseux et la princesse.
Mathias bondit en entendant les moqueries, et s’interposa entre eux et son amie. Non, ils ne pourraient pas s’attaquer à elle, jamais ! Ils pouvaient le traiter de tous les noms, mais pas elle. Les garçons rirent et le prirent à nouveau pour cible :
– Le bouseux s’énerve. Vous avez vu les gars sa bouche tordue et son nez plein de morve. T’es le plus moche de la terre. Tes parents t’ont raté. Sale clodo !
Ils furent interrompus par la cloche et la détermination qu’ils virent pour la première fois dans le regard de Mathias qui les toisait les bras croisés, animé par une nouvelle force, une volonté de protéger son amie. Charlotte se tenait à ses côtés, indifférente à leurs propos. Elle s’en fichait qu’ils l’appellent Charlotte aux fraises. Depuis la veille, Mathias était devenu son ami. Louise le trouvait gentil et était ravie que sa fille ait déjà un camarade dans sa nouvelle école. Les enfants rentrèrent en classe. Mathias laissa passer Charlotte. Comme la veille, il était en sa présence sur un petit nuage de bonheur. Le maitre commença la leçon de mathématiques, Mathias aimait beaucoup les chiffres qu’il maniait avec une grande aisance. Sa position de premier de la classe dans cette matière lui permettait de compléter aisément sa collection de belles images. Charlotte semblait à la traîne. Il remarqua qu’elle venait de gommer plusieurs fois le résultat d’une soustraction. Il lui fit signe et lui montra discrètement le bon résultat. Elle recopia le nombre indiqué. Ce dernier s’assura que personne n’avait remarqué leur échange. Il ne souhaitait pas qu’elle s’attirât les foudres du maître d’école.
Après avoir déposé sa fille à l’école, Louise prit le chemin de la ferme. Elle pensait à Mathias. Il lui avait fait une très bonne impression. Il avait l’air bien solitaire et abandonné, sa maman ne semblait pas prendre grand soin de l’apparence de son fils, peut-être était-elle trop occupée ? Durant le trajet en voiture, elle nota que Mathias devait faire une très longue marche avant d’arriver à l’école. Quand elle arriva, la cour était déserte. Elle remarqua autour d’elle que le corps du bâtiment principal, les dépendances, les granges et l’étable auraient besoin d’un sérieux coup de peinture. Quelques instants plus tard, Milou et Patty vinrent à sa rencontre et la reconnurent. Comme la veille, ils lui tendirent chacun une patte en signe d’amitié qu’elle serra avec chaleur. Les deux chiens s’éloignèrent vers un bâtiment jouxtant l’étable, Louise les suivit. À l’intérieur, ils aboyèrent à maintes reprises. Personne ne vint. Après un long moment de silence, Louise entendit au loin une voix d’homme et un bruit de métal heurtant le sol. Elle se dirigea vers la source du bruit, et découvrit le propriétaire des lieux penché sur le moteur d’un tracteur, en train de jurer :
– Maudit tracteur ! Toujours en panne quand on a besoin de lui, saleté de machine !
Elle toussa pour attirer son attention. Quand il se retourna, son regard froid et distant la transperça. Elle se présenta, et remarqua qu’il faisait un effort pour se montrer sympathique. Elle nota son regard vitreux, son grain de peau abîmé, certainement par l’alcool. Quand il s’approcha d’elle, son haleine ne laissait aucun doute, cet homme était alcoolique. Dans le passé, il avait dû être séduisant.
C’était donc elle la fameuse Louise aux crêpes dont lui avait parlé son fils la veille. Léon pensa qu’il devait faire très attention. Il avait remarqué le long regard qu’elle venait de poser sur lui tout en lui serrant la main. À sa poignée de main ferme, il avait compris à quel type de femme il avait affaire. Louise était de cette nouvelle génération de femmes émancipées qui ne craignent rien. Si elle avait connaissance des coups qu’il portait à Mathias, elle remuerait ciel et terre afin que cette situation cesse. Il se retrouverait derrière des barreaux pour maltraitance. Léon devait se conduire intelligemment. Il la remercia pour ses savoureuses crêpes. Il lui indiqua que pour elle le lait, les fruits et les œufs seraient toujours gratuits.
– Allez, chère Madame, cela me fait plaisir.
– C’est très gentil à vous, mais j’insiste pour payer.
– Non vraiment c’est cadeau au nom de l’amitié entre Mathias et votre fille. Je peux vous offrir un café ?
Louise accepta impatiente de faire la connaissance de la maman de Mathias.
À l’école, Mathias obtint la meilleure note au contrôle de mathématiques et pour récompense une nouvelle belle image. Elle représentait un océan sur lequel voguait un superbe voilier. En la contemplant, Mathias rêva quelques instants qu’il était à bord et qu’il partait à la découverte du monde en compagnie de ses amis : Charlotte, Patty, Milou et Marguerite. Il fut interrompu dans sa rêverie par Charlotte qui le tirait par sa manche de blouse. Une nouvelle leçon venait de commencer.
Louise nota l’atmosphère d’abandon qui régnait dans la cuisine, la vaisselle accumulée pas lavée dans l’évier, les traces de gras sur la cuisinière, le sol non balayé, la couleur des murs défraichie, la décoration désuète. Un ruban torsadé pendait du plafond, enduit de papier glu, piège à mouches, figées, attrapées en plein envol, comme le temps qui semblait suspendu autour d’eux. La toile cirée semblait avoir été vaguement nettoyée. Au centre de la table, quelqu’un avait placé des marguerites dans un simple verre d’eau. Une fragrance d’eau de toilette bon marché stagnait dans l’air ambiant. Sur le dos d’une des chaises dépareillées, elle reconnut le pull troué porté la veille par Mathias. Léon l’invita à s’asseoir. Afin d’alimenter la conversation, il évoqua la météo du jour tout en faisant réchauffer du café dans une vieille cafetière tachée.
– La maman de Mathias est-elle là ?
Louise vit les traits de Léon se crisper et ses mains se nouer si serrées que les jointures devinrent blanches.
Il se reprit afin de lui répondre.
– Elle est au cimetière du village.





























