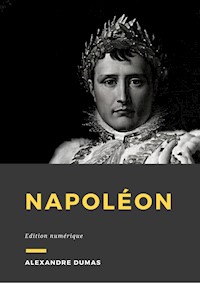
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le 15 août 1769, naquit à Ajaccio un enfant qui reçut de ses parents le nom de Buonaparte, et du ciel celui de Napoléon. Les premiers jours de sa jeunesse s’écoulèrent au milieu de cette agitation fiévreuse qui suit les révolutions ; la Corse, qui depuis un demi-siècle rêvait l’indépendance, venait d’être moitié conquise, moitié vendue, et n’était sortie de l’esclavage de Gênes que pour tomber au pouvoir de la France. Paoli, vaincu à Ponte-Nuovo, allait chercher avec son frère et ses neveux un asile en Angleterre, où Alfieri lui dédiait son Timoléon. L’air que respira le nouveau-né était chaud des haines civiles, et la cloche qui sonna son baptême, toute frémissante encore du tocsin.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys. Proche des romantiques et tourné vers le théâtre, Alexandre Dumas écrit d'abord un vaudeville à succès et des drames historiques comme
Henri III et sa cour (1829),
La Tour de Nesle (1832),
Kean (1836). Auteur prolifique, il s'oriente ensuite vers le roman historique tel que la trilogie
Les Trois Mousquetaires (1844),
Vingt Ans après (1845) et
Le Vicomte de Bragelonne (1847), ou encore Le Comte de Monte-Cristo (1844-1846), La Reine Margot (1845) et La Dame de Monsoreau (1846). L'œuvre d'Alexandre Dumas est universelle ; selon l’Index Translationum, avec un total de 2 540 traductions, il vient au treizième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAPOLÉON
ALEXANDREDUMAS
– 1840 –
Paris
AU PLUTARQUE FRANÇAIS, 17, RUE DUPHOT.
DELLOYE, ÉDITEUR.
13, PLACE DE LA BOURSE.
NAPOLÉON DE BUONAPARTE
Le 15 août 1769, naquit à Ajaccio un enfant qui reçut de ses parents le nom de Buonaparte, et du ciel celui de Napoléon.
Les premiers jours de sa jeunesse s’écoulèrent au milieu de cette agitation fiévreuse qui suit les révolutions ; la Corse, qui depuis un demi-siècle rêvait l’indépendance, venait d’être moitié conquise, moitié vendue, et n’était sortie de l’esclavage de Gênes que pour tomber au pouvoir de la France. Paoli, vaincu à Ponte-Nuovo, allait chercher avec son frère et ses neveux un asile en Angleterre, où Alfieri lui dédiait son Timoléon. L’air que respira le nouveau-né était chaud des haines civiles, et la cloche qui sonna son baptême, toute frémissante encore du tocsin.
Charles de Buonaparte, son père, et Laetitia Ramolino, sa mère, tous deux de race patricienne et originaires de ce charmant village de San-Miniato, qui domine Florence, après avoir été les amis de Paoli, avaient abandonné son parti, et s’étaient ralliés à l’influence française. Il leur fut donc facile d’obtenir de M. de Marbœuf, qui revenait comme gouverneur dans l’île où dix ans auparavant il avait abordé comme général, sa protection pour faire entrer le jeune Napoléon à l’école militaire de Brienne. La demande fut accordée, et, quelque temps après, M. Berton, sous-principal du collège, inscrivait sur ses registres la note suivante :
« Aujourd’hui, 23 avril 1779, Napoléon de Buonaparte est entré à l’École royale militaire de Brienne-le-Château, à l’âge de neuf ans, huit mois et cinq jours. »
Le nouveau venu était Corse, c’est-à-dire d’un pays qui, de nos jours encore, lutte contre la civilisation avec une force d’inertie telle, qu’il a conservé son caractère à défaut de son indépendance : il ne parlait que l’idiome de son île maternelle ; il avait le teint brûlé du méridional, l’œil sombre et perçant du montagnard. C’était plus qu’il n’en fallait pour exciter la curiosité de ses camarades et augmenter sa sauvagerie naturelle, car la curiosité de l’enfance est railleuse et manque de pitié. Un professeur, nommé Dupuis, prit en compassion le pauvre isolé, et se chargea de lui donner des leçons particulières de langue française : trois mois après il était déjà assez avancé dans celte étude pour recevoir les premiers éléments de latinité. Mais dès l’abord se manifesta chez lui la répugnance qu’il conserva toujours pour les langues mortes, tandis qu’au contraire son aptitude pour les mathématiques se développa dès les premières leçons ; il en résulta que, par une de ces conventions si fréquentes au collège, il trouvait la solution des problèmes que ses camarades avaient à résoudre, et ceux-ci, en échange, lui faisaient ses thèmes et ses versions, dont il ne voulait pas entendre parler.
L’espèce d’isolement dans lequel se trouva pendant quelque temps le jeune Buonaparte, et qui tenait à l’impossibilité de communiquer ses idées, éleva entre lui et ses compagnons une espèce de barrière qui ne disparut jamais complètement.
Cette première impression, en laissant dans son esprit un souvenir pénible qui ressemblait à une rancune, donna naissance à cette misanthropie précoce qui lui faisait chercher des amusements solitaires, et dans laquelle quelques-uns ont voulu voir les rêves prophétiques du génie naissant. Au reste, plusieurs circonstances, qui dans la vie de tout autre seraient restées inaperçues, donnent quelque fondement aux récits de ceux-là qui ont essayé de faire une enfance exceptionnelle à cette merveilleuse virilité. Nous en citerons deux.
Un des amusements les plus habituels du jeune Buonaparte était la culture d’un petit parterre entouré de palissades, dans lequel il se retirait habituellement aux heures des récréations. Un jour, un de ses jeunes camarades, qui était curieux de savoir ce qu’il pouvait faire ainsi seul dans son jardin, escalada la barricade, et le vit occupé à ranger dans des dispositions militaires une foule de cailloux dont la grosseur indiquait les grades. Au bruit que lit l’indiscret, Buonaparte se retourna, et, se voyant surpris, ordonna à l’écolier de descendre ; mais celui-ci, au lieu d’obéir, se moqua du jeune stratégiste, qui, peu disposé à la plaisanterie, ramassa le plus gros de ses cailloux, et l’envoya au beau milieu du front du railleur, qui tomba aussitôt assez dangereusement blessé.
Vingt-cinq ans après, c’est-à-dire au moment de sa plus haute fortune, on annonça à Napoléon qu’un individu qui se disait son camarade de collège demandait à lui parler. Comme plus d’une fois des intrigants s’étaient servis de ce prétexte pour arriver jusqu’à lui, l’ex-écolier de Brienne ordonna à l’aide-de-camp de service d’aller demander le nom de cet ancien condisciple ; mais ce nom n’ayant éveillé aucun souvenir dans l’esprit de Napoléon : « Retournez, dit-il, et demandez à cet homme s’il ne pourrait pas me citer quelque circonstance qui me remît sur sa voie. » L’aide-de-camp accomplit son message et revint en disant que le solliciteur, pour toute réponse, lui avait montré une cicatrice qu’il avait au front. « Ah ! cette fois je me le rappelle, dit l’Empereur ; c’est un général en chef que je lui ai jeté à la tête !.... »
Pendant l’hiver de 1783 à 1784, il tomba une si grande quantité de neige que toutes les récréations extérieures furent interrompues. Buonaparte, forcé malgré lui de passer les heures qu’il donnait ordinairement à la culture de son jardin, au milieu des amusements bruyants et inaccoutumés de ses camarades, proposa de faire une sortie, et, à l’aide de pelles et de pioches, de tailler dans la neige les fortifications d’une ville, qui serait ensuite attaquée par les uns et défendue par les autres : la proposition était trop sympathique pour être refusée. L’auteur du projet fut naturellement choisi pour commander un des deux partis. La ville, assiégée par lui, fut prise après une héroïque résistance de la part de ses adversaires. Le lendemain la neige fondit ; mais cette récréation nouvelle laissa une trace profonde dans la mémoire des écoliers. Devenus hommes, ils se souvinrent de ce jeu d’enfant, et ils se rappelèrent les remparts de neige que battit en brèche Buonaparte, en voyant les murailles de tant de villes tomber devant Napoléon.
A mesure que Buonaparte grandit, les idées primitives qu’il avait en quelque sorte apportées en germe se développèrent, et indiquèrent les fruits qu’un jour elles devaient porter. La soumission de la Corse à la France, qui lui donnait à lui, son seul représentant, l’apparence d’un vaincu au milieu de ses vainqueurs, lui était odieuse. Un jour qu’il dînait à la table du père Berton, les professeurs, qui avaient déjà plusieurs fois remarqué la susceptibilité nationale de leur élève, affectèrent de mal parler de Paoli. Le rouge monta aussitôt au front du jeune homme, qui ne put se contenir.— « Paoli, dit-il, était un grand homme, qui aimait son pays comme un vieux Romain ; et jamais je ne pardonnerai à mon père, qui a été son aide-de-camp, d’avoir concouru à la réunion de la Corse à la France : il aurait dû suivre la fortune de son général et tomber avec lui. »
Cependant, au bout de cinq ans, le jeune Buonaparte était en quatrième et avait appris de mathématiques tout ce que le père Patrault avait pu lui en montrer. Son âge était l’âge désigné pour passer de l’école de Brienne à celle de Paris : ses notes étaient bonnes, et ce compte-rendu fut envoyé au roi Louis XVI par M. de Keralio, inspecteur des écoles militaires :
«M. de Buonaparte (Napoléon), né le 15 août 1769, taille de quatre pieds dix pouces dix lignes, a fait sa quatrième : de bonne constitution, santé excellente ; caractère soumis, honnête, reconnaissant ; conduite très régulière ; s’est toujours distingué par son application aux mathématiques. Il sait très-passablement son histoire et sa géographie ; il est assez faible pour les exercices d’agrément et pour le latin, où il n’a fait que sa quatrième. Ce sera un excellent marin. Il mérite de passer à l’École militaire de Paris. »
En conséquence de cette note, le jeune Buonaparte obtint son entrée à l’École militaire de Paris ; et le jour de son départ cette mention fut inscrite sur les registres :
« Le 17 octobre 1784, est sorti de l’École royale de Brienne M. Napoléon de Buonaparte, écuyer, né en la ville d’Ajaccio, en l’île de Corse, le 15 août 1769, fils de noble Charles-Marie de Buonaparte, député de la noblesse de Corse, demeurant en ladite ville d’Ajaccio, et de dame Laetitia Ramolino, suivant l’acte porté au registre, folio 31, et reçu dans cet établissement le 23 avril 1779. »
On a accusé Buonaparte de s’être vanté d’une noblesse imaginaire et d’avoir faussé son âge ; les pièces que nous venons de citer répondent à ces deux accusations.
Buonaparte arriva dans la capitale par le coche de Nogent-sur-Seine.
Aucun fait particulier ne signale le" séjour de Buonaparte à l’École militaire de Paris, si ce n’est un Mémoire qu’il envoya à son ancien sous-principal, le père Berton. Le jeune législateur avait trouvé, dans l’organisation de cette école, des vices que son aptitude naissante à l’administration ne pouvait passer sous silence. Un de ces vices, et le plus dangereux de tous, était le luxe dont les élèves étaient entourés. Aussi Buonaparte s’élevait-il surtout contre ce luxe : (C Au lieu, disait-il, d’entretenir un nombreux domestique autour des élèves, de leur donner journellement des repas à deux services, de faire parade d’un manège très-coûteux, tant pour les chevaux que pour les écuyers, ne vaudrait-il pas mieux, sans toutefois interrompre le cours de leurs études, les astreindre à se servir eux-mêmes, moins leur petite cuisine, qu’ils ne feraient pas ; leur faire manger du pain de munition, ou d’un autre qui en approcherait ; les habituer à battre leurs habits et à nettoyer leurs souliers et leurs bottes ? Puisqu’ils sont pauvres et destinés au service militaire, n’est-ce pas la seule éducation qu’il faudrait leur donner ? Assujettis à. une vie sobre, à soigner leur tenue, ils en deviendraient plus robustes, sauraient-braver les intempéries des saisons, supporter avec courage les fatigues de la guerre, et inspirer un respect et un dévouement aveugles aux soldats-qui seraient sous leurs ordres. » Buonaparte avait quinze ans et demi lorsqu’il proposait ce projet de réforme : vingt ans après il fondait l’École militaire de Fontainebleau.
En 1785, après des examens brillants ; Buonaparte fut nommé sous-lieutenant en second au régiment de La Fère, alors en garnison dans le Dauphiné. Après être resté quelque temps à Grenoble, où son passage n’a laissé d’autre trace qu’un mot apocryphe sur Turenne, il vint habiter Valence : là, quelques lueurs du soleil de l’avenir commencent à se glisser dans le crépuscule du jeune homme ignoré. Buonaparte, on le sait, était pauvre ; mais si pauvre qu’il fût, il pensa qu’il pouvait venir en aide à sa famille, et appela en France son frère Louis, qui était de neuf ans plus jeune que lui. Tous deux logeaient chez mademoiselle Bou, Grande-Rue, n° 4. Buonaparte avait une chambre à coucher, et au-dessus de cette chambre le petit Louis habitait une mansarde. Chaque matin, fidèle à ses habitudes de collège, dont il devait se faire plus tard une vertu des camps, Buonaparte éveillait son frère en frappant le plancher d’un bâton, et lui donnait sa leçon de mathématiques. Un jour le jeune Louis, qui avait grand-peine à se faire à ce régime, descendit avec plus de regret et de lenteur que de coutume ; aussi Buonaparte allait-il frapper le plancher une seconde fois, lorsque l’écolier tardif entra enfin.
« Eh bien ! qu’y a-t-il donc ce matin, il me semble que nous sommes bien paresseux ? dit Buonaparte.
— Oh ! frère, répondit l’entant, je faisais un si beau rêve.
— Et que rêvais tu donc ?
— Je rêvais que j’étais roi.
— Et qu’étais-je donc alors, moi ?.. empereur ? dit en haussant les épaules le jeune sous-lieutenant. Allons ! à la besogne. »)
Et la leçon journalière fut, comme d’habitude, prise par le futur roi et donnée par le futur empereur1.
Buonaparte était logé en face du magasin d’un riche libraire nommé Marc-Aurèle7 dont la maison, qui porte j je crois, la date de 1530, est un bijou de renaissance. C’est là qu’il passait à peu près toutes les heures dont son service militaire et ses leçons fraternelles le laissaient maître. Ces heures n’étaient point perdues, comme on va le voir.
Le 7 octobre 1808, Napoléon donnait à dîner à. Erfurth ; ses convives étaient l’empereur Alexandre, la reine de Westphalie, le roi de Bavière, le roi de Wurtemberg, le roi de Saxe, le grand-duc Constantin, le Prince-Primat, le prince Guillaume de Prusse, le duc : d’Oldenbourg, le prince de Mecklenibourg-Schwerin, le duc de Weymar et le prince de Talleyrand. La conversation tomba sur la bulle d’or, qui, jusqu’à rétablissement de la confédération du Rhin, avait servi de constitution et de règlement pour l’élection des empereurs, et le nombre et la qualité des électeurs. Le Prince-Primat entra dans quelques détails sur cette bulle, et en fixa la date à 1409.
«Je crois que vous vous trompez, dit en souriant Napoléon ; la bulle dont vous parlez a été proclamée en 1336, sous le règne de l’empereur Charles IV.
— C’est vrai, Sire, répondit le Prince-Primat, et je me le rappelle maintenant ; mais comment se fait-il que Votre Majesté sache si bien ces choses-là ?
— Quand j’étais simple lieutenant en second dans l’artillerie, » dit Napoléon...
A ce début, un mouvement d’étonnement si vif se manifesta parmi les nobles convives, que le narrateur fut forcé de s’interrompre ; mais au bout d’un instant :
« Quand j’avais l’honneur d’être simple lieutenant en second d’artillerie, reprit-il en souriant, je restai trois années en garnison à Valence. J’aimais peu le monde et vivais très-retiré. Un hasard heureux m’avait logé près d’un libraire instruit et des plus complaisants. J’ai lu et relu sa bibliothèque pendant ces trois années de garnison, et je n’ai rien oublié, même des matières qui n’avaient aucun rapport avec mon état. La nature, d’ailleurs, m’a doué de la mémoire des chiffres ; il m’arrive très-souvent, avec mes ministres, de leur citer le détail et l’ensemble numérique de leurs comptes les plus anciens. »
Ce n’était pas le seul souvenir que Napoléon eut conservé de Valence.
Parmi le peu de personnes que voyait Buonaparte à Valence était M. de Tardiva, abbé de Saint-Ruf, dont l’ordre avait été détruit quelque temps auparavant. Il rencontra chez lui mademoiselle Grégoire du Colombier, et en devint amoureux. La famille de cette jeune personne habitait une campagne située à une demi-lieue de Valence et appelée Bassiau ; le jeune lieutenant obtint d’être reçu dans la maison et y fit plusieurs visites. Sur ces entrefaites se présenta de son côté un gentilhomme dauphinois, nommé M. de Bressieux. Buonaparte vit qu’il était temps de se déclarer, s’il ne voulait pas être gagné de vitesse ; il écrivit en conséquence à mademoiselle Grégoire une longue lettre, dans laquelle il lui exprimait tous ses sentiments pour elle, et qu’il l’invitait à communiquer à ses parents. Ceux-ci, placés dans l’alternative de donner leur fille à un militaire sans avenir, ou bien à un gentilhomme possédant quelque fortune, optèrent pour le gentilhomme : Buonaparte fut éconduit, et sa lettre remise aux mains d’une tierce personne, qui voulut la rendre, ainsi qu’elle en avait été chargée, à celui qui l’avait écrite. Mais Buonaparte ne voulut pas la reprendre. « Gardez la, dit-il à la personne, elle sera un jour un témoignage à la fois et de mon amour et de la pureté de mes sentiments envers mademoiselle Grégoire.) La personne garda la lettre et la famille la conserve encore.
Trois mois après mademoiselle Grégoire épousa M. de Bressieux.
En 1806, madame de Bressieux fut appelée à la cour avec le titre de dame d’honneur de l’impératrice, son frère envoyé à Turin en qualité de préfet, et son mari nommé baron et administrateur des forêts de l’état.
Les autres personnes avec lesquelles Buonaparte se lia pendant son séjour à Valence furent MM. de Montalivet et Bachasson, lesquels devinrent, l’un ministre de l’intérieur, et l’autre inspecteur des approvisionnements de Paris. Le dimanche, ces trois jeunes gens se promenaient presque toujours ensemble hors de la ville, et là s’arrêtaient quelquefois à regarder un bal en plein air que donnait, moyennant deux sous par cavalier et par contredanse, un épicier de la ville, qui, dans ses moments perdus, exerçait l’état de ménétrier. Ce ménétrier était un ancien militaire qui, retiré en congé à Valence, s’y était marié et y exerçait en paix sa double industrie : mais comme elle était encore insuffisante, il sollicita et obtint, lors de la création des départements, une place de commis expéditionnaire dans les bureaux de l’administration centrale. Ce fut là que les premiers bataillons de volontaires le prirent, en 1790, et l’entraînèrent avec eux.
Cet ancien soldat, épicier, ménétrier et commis expéditionnaire, fut depuis le maréchal Victor, duc de Bellune.
Buonaparte quitta Valence, laissant trois francs dix sous de dettes chez son pâtissier, nommé Coriol.
Que nos lecteurs ne s’étonnent point de nous voir rechercher de pareilles anecdotes : lorsqu’on écrit la biographie d’un Jules-César, d’un Charlemagne ou d’un Napoléon, la lanterne de Diogène ne sert plus à chercher l’homme ; l’homme est trouvé par la postérité, et apparaît aux yeux du monde, radieux et sublime : c’est donc le chemin qu’il a parcouru avant d’arriver à son piédestal qu’il faut suivre, et plus les traces qu’il a laissées en certains endroits de sa route sont légères, plus elles sont inconnues et par conséquent plus elles offrent de curiosité.
Buonaparte arrivait à Paris en même temps que Paoli. L’Assemblée constituante venait d’associer la Corse au bénéfice des lois françaises ; Mirabeau avait déclaré à la tribune qu’il était temps de rappeler les patriotes fugitifs qui avaient défendu l’indépendance de l’île, et Paoli était revenu. Buonaparte fut accueilli en fils par l’ancien ami de son père : le jeune enthousiaste se trouva en face de son héros : celui-ci venait d’être nommé lieutenant général et commandant militaire de la Corse.
Buonaparte obtint un congé, et en profita pour suivre Paoli et revoir sa famille, qu’il avait quittée depuis six ans. Le général patriote fut reçu avec délire par tous les partisans de l’indépendance, et le jeune lieutenant assista au triomphe du célèbre exilé : l’enthousiasme fut tel que le vœu unanime de ses concitoyens porta en même temps Paoli à la tète de la garde nationale et à la présidence de l’administration départementale. Il y demeura quelque temps en parfaite intelligence avec la Constituante ; mais une motion de l’abbé Charrier, qui proposait de céder la Corse au duc de Parme en échange du Plaisantin, dont la possession était destinée à indemniser le pape de la perte d’Avignon, devint pour Paoli une preuve du peu d’importance qu’attachait la métropole à la conservation de son pays. Ce fut sur ces entrefaites que le gouvernement anglais, qui avait accueilli Paoli dans son exil, ouvrit des communications avec le nouveau président ; Paoli, au reste, ne cachait pas la préférence qu’il accordait à la constitution britannique sur celle que préparait la législature française. De cette époque date la dissidence entre le jeune lieutenant et le vieux général ; Buonaparte resta citoyen français, Paoli redevint général corse.
Buonaparte fut rappelé à Paris au commencement de 1792. Il y retrouva Bourrienne, son ancien ami de collège, lequel arrivait de Vienne, après avoir parcouru là Prusse et la Pologne. Ni l’un ni l’autre des deux écoliers de Brienne n’étaient heureux ; ils associèrent leur misère pour la rendre moins lourde : l’un sollicitait du service à la guerre, l’autre aux affaires étrangères ; on ne répondait à aucun des deux, et alors ils rêvaient des spéculations commerciales, que leur défaut de fonds.les empêchait presque toujours de réaliser. Un jour ils eurent l’idée de louer plusieurs maisons en construction dans la rue Montholon, pour les sous-louer ensuite 1 mais les prétentions des propriétaires leur parurent si exagérées qu’ils furent forcés d’abandonner cette spéculation par le même motif qui leur en avait fait abandonner tant d’autres. En sortant de. chez le constructeur, les deux spéculateurs s’aperçurent non-seulement qu’ils n’avaient point dîné, mais encore qu’ils n’avaient point de quoi dîner. Buonaparte remédia à cet inconvénient en mettant sa montre en gage.
Sombre prélude du 10 août, le 20 juin arriva. Les deux jeunes gens s’étaient donné rendez-vous pour déjeuner chez un restaurateur de la rue Saint-Honoré : ils achevaient leur repas, lorsqu’ils furent attires à la fenêtre par un grand tumulte et les cris de ça ira,, vive la nation, vive les sans-culottes, à bas le veto ! C’était une troupe de six à huit mille hommes, conduite par Santerre et le marquis de Saint-Hurugues, descendant des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, et se rendant à l’assemblée. « Suivons cette canaille, » dit Buonaparte, et les deux jeunes gens se dirigèrent aussitôt vers les Tuileries, et s’arrêtèrent sur la terrasse du bord de l’eau : Buonaparte s’appuya contre un arbre et Bourrienne s’assit sur un parapet.
De là ils ne virent point ce qui se passait ; mais ils devinèrent facilement ce qui s’était passé, lorsqu’une fenêtre donnant sur le jardin s’ouvrit, et que Louis XVI parut coiffé du bonnet rouge qu’un homme du peuple venait de lui présenter au bout d’une pique.
« Coglione ! Coglione ! » murmura en haussant les épaules, et dans son idiome corse, le jeune lieutenant, qui jusque-là était resté muet et immobile.
« Que voulais-tu qu’il fît ? dit Bourrienne. Il fallait en balayer quatre ou cinq cents avec du canon, répondit Buonaparte, et le reste courrait encore.
Pendant toute la journée il ne parla que de cette scène qui avait fait sur lui une des plus fortes impressions qu’il ait jamais ressenties.
Buonaparte vit ainsi se dérouler sous ses yeux les premiers événements de la révolution française. Il assista en simple spectateur à la fusillade du 10 août et aux massacres du2 septembre ; puis, voyant qu’il ne pouvait obtenir de service, il résolut de faire un nouveau voyage en Corse.
Les intrigues de Paoli avec le cabinet anglais avaient pris, en l’absence de Buonaparte, un tel développement, qu’il n’y avait plus à se tromper sur ses projets. Une entrevue, que le jeune lieutenant et le vieux général eurent ensemble chez le gouverneur de Corte, se termina par une rupture : les deux anciens amis se séparèrent pour ne plus se revoir que sur le champ de bataille. Le même soir, un flatteur de Paoli voulut dire devant lui du mal de Buonaparte : « Chut ! lui dit le général, en portant le doigt à ses lèvres, c’est un jeune homme taillé sur l’antique ! »
Bientôt Paon leva ouvertement l’étendard de la révolte. Nommé, le 26 juin 1793, parles partisans de l’Angleterre, généralissime et président d’une consulte à Corte, il fut, le 17 juillet suivant, mis hors la loi par la Convention nationale. Buonaparte était absent : il avait enfin obtenu sa mise en activité tant de fois demandée. Nommé commandant de la garde nationale soldée, il se trouvait à bord de la flotte de l’amiral Truguet, et s’emparait, pendant ce temps, du fort Saint-Étienne, que les vainqueurs furent bientôt forcés d’évacuer. Buonaparte, en rentrant en Corse, trouva l’île soulevée. Salicetti et Lacombe Saint-Michel, membres ’de la Convention, chargés de mettre à exécution le décret rendu contre le rebelle, avaient été obligés de se retirer à Calvi : Buonaparte alla les y rejoindre et tenta avec eux sur Ajaccio une attaque qui fut repoussée. Le même jour un incendie se manifesta dans la ville ; les Buonaparte virent leur maison brûlée ; quelque temps après, un décret les condamna à un bannissement perpétuel. Le feu les avait faits sans asile, la proscription les faisait sans patrie : ils tournèrent les yeux vers Buonaparte, et Buonaparte vers la France. Toute cette pauvre famille proscrite s’embarqua sur un frêle bâtiment, et le futur César mil à la voile, protégeant de sa fortune ses quatre frères, dont trois devaient être rois, et ses trois sœurs, dont l’une devait être reine.
Toute la famille s’arrêta à Marseille, réclamant la protection de cette France pour laquelle elle était proscrite. Le gouvernement entendit ses plaintes : Joseph et Lucien obtinrent de l’emploi dans l’administration de l’armée, Louis fut nommé sous-officier et Buonaparte passa comme lieutenant en premier, c’est-à-dire avec avancement, dans le 4e régiment d’infanterie : peu de temps après il monta, par droit d’ancienneté, au grade de capitaine dans la deuxième compagnie du même corps, alors en garnison à Nice.
L’année au chiffre sanglant, 93, était arrivée ; la moitié de la France luttait contre l’autre ; l’Ouest et le Midi étaient en feu ; Lyon venait d’être pris, après un siège de quatre mois ; Marseille avait ouvert ses portes à la Convention ; Toulon avait livré son port aux Anglais. Une armée de trente mille hommes, composée des troupes qui, sous le commandement de Kellermann, avaient assiégé Lyon, de quelques régiments tirés de l’armée des Alpes et de l’armée d’Italie, et de tous les réquisitionnaires levés dans les départements voisins, s’avança contre la ville vendue. La lutte commença aux gorges d’Ollioules. Le général Butheil, qui devait diriger l’artillerie, était absent ; le général Dommartin, son lieutenant, fut mis hors de combat dans cette première rencontre ; le premier officier de. l’armée le remplaça de droit : ce premier officier était Buonaparte. Cette fois le hasard était d’accord avec le génie, en supposant que pour le génie le hasard ne s’appelle point la Providence.
Buonaparte reçoit sa nomination, se présente à l’état-major et est introduit devant.le général Cartaux, homme superbe et doré des pieds jusqu’à la tête, qui lui demande ce qu’il y a pour son service : le jeune officier lui présente le brevet qui le charge de venir, sous ses ordres diriger les opérations de l’artillerie : « L’artillerie, répond le brave général, nous n’en avons pas besoin ; nous prendrons ce soir Toulon à la baïonnette et nous le brûlerons demain. »
Cependant, quelle que fût l’assurance du général en chef, il ne pouvait pas s’emparer de Toulon sans le reconnaître ; aussi eut-il patience jusqu’au lendemain : mais au point du jour, il prit son aide-de-camp, Dupas, et le chef de bataillon Buonaparte, dans son cabriolet, afin d’inspecter les premières dispositions offensives. Sur les observations de Buonaparte, il avait, quoique avec peine, renoncé à la baïonnette et en était revenu à l’artillerie ; en conséquence, des ordres avaient été donnés directement par le général en chef, et c’était ces ordres dont il venait vérifier l’exécution et hâter l’effet.
Les hauteurs desquelles on découvre Toulon, couché au milieu de son jardin demi oriental et baignant ses pieds à la mer, à peine dépassées, le général descend de cabriolet avec les deux jeunes gens, et s’enfonce dans une vigne au milieu de laquelle il aperçoit quelques pièces de canon rangées derrière une espèce d’épaulement. Buonaparte regarde autour de lui, et ne devine rien à ce qui se passe : le général jouit un instant de l’étonnement de son chef de bataillon, puis se retournant avec le sourire de la satisfaction vers son aide-de-camp :
« Dupas, lui dit-il, sont-ce là nos. batteries ? — Oui, général, répond celui-ci.
— Et notre parc ?
— Il est à quatre pas.
— Et nos boulets rouges ?
— On les chauffe dans les bastides voisines. » Buonaparte n’avait pu en croire ses yeux, mais il est obligé. d’en croire ses oreilles. Il mesure l’espace avec l’œil exercé du stratégiste, et il y a une lieue et demie au moins de la batterie à la ville. D’abord il croit que le général a voulu ce qu’on appelle, en ter mes de collège et de guerre, tâter son jeune chef de bataillon ; mais la gravité avec laquelle Cartaux continue ses dispositions ne lui laisse aucun douté. Alors il hasarde une observation sur la distance et manifeste la crainte que les boulets rouges n’arrivent pas jusqu’à la ville.
« Crois-tu ? dit Cartaux.
,- J’en ai peur général, répond Buonaparte : au reste on pourrait, avant de s’embarrasser de boulets rouges, essayer à froid pour bien s’assurer de la portée. »
Cartaux trouve l’idée ingénieuse, fait charger et tirer une pièce, et tandis qu’il regarde sur les murailles de la ville l’effet que produira le. coup, Buonaparte lui montre, à mille pas à peu près devant lui, le boulet qui brise les oliviers, sillonne la terre, ricoche, et s’en va mourir, en bondissant, au tiers à peine de la distance que le général en chef comptait lui voir parcourir.
La preuve était concluante ; mais Cartaux ne voulut pas se rendre et prétendit que c’étaient « ces aristocrates de Marseillais qui avaient gâté la poudre. »
Cependant, comme, gâtée ou non, la poudre ne porte pas plus loin, il faut recourir à d’autres mesures : on revient au quartier-général ; Buonaparte demande un plan de Toulon, le déplie sur une table, et, après avoir étudié un instant la situation de la ville et des différents ouvrages qui la défendent, depuis la redoute bâtie au sommet du Mont-Faron, qui la domine, jusqu’aux forts Larnalgue et Malbousquet, qui protègent sa droite et sa gauche, le jeune chef de bataillon pose le doigt sur une redoute nouvelle, élevée par les Anglais, et dit avec la rapidité et la concision du génie :
« C’est là qu’est Toulon. »
C’est Cartaux à son tour qui n’y comprend plus rien : il a pris à la lettre les paroles de Buonaparte, et se retournant vers Dupas, son fidèle :
« Il paraît, lui dit-il, que le capitaine Canon n’est pas fort en géographie. »
Ce fut le premier surnom de Buonaparte ; nous verrons comment lui est venu depuis celui de petit caporal.
En ce moment, le représentant du peuple Gasparin entra : Buonaparte en avait entendu parler, non-seulement comme d’un vrai, loyal et brave patriote, mais encore comme d’un homme d’un sens juste et d’un esprit rapide. Le chef de bataillon va droit à lui :
« Citoyen représentant, lui dit-il, je suis chef de bataillon d’artillerie. Par l’absence du général Dutheil et par la blessure du général Dommartin, cette arme se trouve sous ma direction. Je demande que nul ne s’en mêle que moi, ou je ne réponds de rien.
— Eh ! qui es-tu pour répondre de quelque chose ? demande le représentant du peuple, étonné en voyant un jeune homme de vingt-trois ans lui parler d’un pareil ton et avec une semblable assurance.
— Qui je suis, reprend Buonaparte, en le tirant dans un coin et en lui parlant à voix basse ; je suis un homme qui sais mon métier, jeté au milieu de gens qui ignorent le leur. Demandez au général en chef son plan de bataille, et vous verrez si j’ai tort ou raison. »
Le jeune officier parlait avec une telle conviction que Gasparin n’hésita pas un instant : « Général, dit-il en s’approchant de Cartaux, les représentants du peuple désirent que dans trois jours tu leur aies soumis ton plan de bataille.
— Tu n’as qu’à attendre trois minutes, répondit Cartaux, et je vais te le donner. »
Effectivement le général s’assit, prit une plume et écrivit sur une feuille volante ce fameux plan de campagne qui est devenu un modèle du genre. Le voici :
« Le général d’artillerie foudroiera Toulon pendant trois jours, au bout desquels je l’attaque« rai sur trois colonnes et l’enlèverai. »
« CARTAUX. »
Le plan fut envoyé à Paris, et remis aux mains du comité du génie. Le comité le trouva beaucoup plus gai que savant : Cartaux fut rappelé, et Dugommier envoyé à sa place.
Le nouveau général trouva en arrivant toutes les dispositions prises par son jeune chef de bataillon : c’était un de ces sièges où la force et le courage ne peuvent rien d’abord, et où le canon et : la stratégie doivent tout préparer. Pas un coin de la côte. où l’artillerie n’eût affaire à l’artillerie. Elle tonnait de tous côtés comme un immense orage dont se croisent les éclairs ; elle tonnait du haut des montagnes et du haut des murailles ; elle tonnait de la plaine et de la mer : on eût dit à la fois une tempête et un volcan.
Ce fut au milieu de ce réseau de flammes que les représentants du peuple voulurent faire changer. quelque chose à une batterie établie par Buonaparte : le mouvement était déjà commencé lorsque le. jeune chef de bataillon arriva et fit tout remettre en place ; les représentants du peuple voulurent faire quelques observations : « Mêlez-vous de votre métier de député, leur répondit Buonaparte, et laissez-moi faire mon métier d’artilleur. Cette batterie est bien là, et je réponds d’elle sur ma tête. «
L’attaque générale commença le 16. Dès-lors le siège ne fut plus qu’un long assaut. Le 17 au matin les assiégeants s’emparaient du Pas-de-Leidet et de la Croix-Faron ; à midi ils débusquaient les alliés de la redoute Saint-André, des forts des Pomets et des deux Saint-Antoine ; enfin, vers le soir, éclairés à la fois par l’orage et par le canon, les républicains entraient dans la redoute anglaise, et là, parvenu à son but, se regardant comme maître de la ville, Buonaparte, blessé d’un coup de baïonnette à la cuisse, dit au général Dugommier, blessé de deux coups de feu, l’un au genou, l’autre au bras, et tombant à la fois d’épuisement et de fatigue : « Allez vous reposer, général, nous venons de prendre Toulon, et vous pourrez y coucher après-demain. »
Le 18, les forts de l’Éguillette et de Balagnier sont pris, et des batteries dirigées sur Toulon : à la vue de plusieurs maisons qui prennent feu, au sifflement des boulets qui sillonnent les rues, la mésintelligence éclate parmi les troupes alliées. Alors les assiégeants, dont les regards plongent dans la ville et sur la rade, voient l’incendie se déclarer sur plusieurs points qu’ils n’ont pas attaqués : ce sont les Anglais qui, décidés à partir, ont mis le feu à l’arsenal, aux magasins de la marine et aux vaisseaux français qu’ils ne peuvent emmener. A la vue des flammes, un cri général s’élève : toute l’armée demande l’assaut ; mais il est trop tard, les Anglais commencent à s’embarquer sous le feu de nos batteries, abandonnant ceux qui avaient trahi la France pour eux, et qu’ils trahissaient à leur tour. La nuit vient sur ces entrefaites. Les flammes qui se sont élevées sur plusieurs points s’éteignent au milieu de grandes rumeurs ; ce sont les forçats qui ont brisé leurs chaînes, et qui étouffent l’incendie allumé par les Anglais.
Le lendemain 19, l’armée républicaine entra dans la ville, et le soir, comme l’avait prédit Buonaparte, le général en chef couchait à Toulon.
Dugommier n’oublia pas les services du jeune chef de bataillon, qui, douze jours après la prise de la ville, reçut le grade de général de brigade.
C’est ici que l’histoire le prend pour ne plus le quitter.
Nous allons maintenant, d’un pas précis et rapide, accompagner Buonaparte dans la carrière qu’il a parcourue comme général en chef, : consul, empereur et. proscrit : puis, après ravoir vu, rapide météore, reparaître et briller un instant sur le trône, nous le suivrons sur cette île où il est allé mourir, ainsi que nous avons été le prendre dans cette île où il était né.
1Cette scène se passa devant M. Parmentier, médecin du régiment où Buonaparte était lieutenant en second.
LE GÉNÉRAL BONAPARTE
Bonaparte avait été, comme nous venons de le dire, nommé général d’artillerie à l’armée de Nice, en récompense des services rendus à la république devant Toulon : ce fut là qu’il se lia avec Robespierre le jeune, qui était représentant du peuple à cette armée. Rappelé à Paris, quelque temps avant le 9 thermidor, ce dernier fit tout ce qu’il put pour décider le jeune général à le suivre, lui promettant la protection directe de son frère ; mais Buonaparte s’y refusa constamment : le temps n’était pas encore venu où il devait prendre parti.
Puis, peut-être aussi un autre motif le retenait il, et cette fois encore était-ce le hasard-qui protégeait le génie ? S’il en était ainsi, le hasard s’était fait visible, et avait pris la forme d’une jeune et jolie représentante du peuple, qui partageait à l’armée de Nice la mission de son mari. Bonaparte avait pour elle une affection sérieuse, qu’il manifestait par des preuves d’une galanterie toute guerrière. Un jour qu’il se. promenait avec elle dans les environs du col de Tende, il vint à l’idée du jeune général de donner à sa belle compagne le spectacle d’une petite guerre, et il ordonna une attaque d’avant-poste : une douzaine d’hommes furent victimes de ce divertissement ; et Napoléon a plus d’une fois avoué à Sainte-Hélène que ces douze hommes, tués sans motif réel et par pure fantaisie, lui étaient un remords plus grand que la mort des six cent mille soldats qu’il avait semés dans les steppes neigeuses de la Russie.
Ce fut sur ces entrefaites que les représentants du peuple près l’armée Italie prirent l’arrêté suivant :
« Le général Bonaparte se rendra, à Gênes pour, conjointement avec le chargé d’affaires de la république française, conférer avec le gouvernement de Gênes sur les objets portés dans ses instructions.
« Le chargé d’affaires près la république de Gênes le reconnaîtra et fera reconnaître par le gouvernement de Gênes.
« Loano, le 25 messidor an II de la république. »
Le véritable but de cette mission était de faire voir au jeune général, de ses propres yeux, les forteresses de Savone et de Gênes, de lui offrir les moyens de prendre sur l’artillerie et les autres objets militaires tous les renseignements possibles, enfin de le mettre à même de recueillir tous les faits qui pouvaient déceler les intentions du gouvernement génois relativement à la coalition.
Pendant que Bonaparte accomplissait cette mission, Robespierre marchait à l’échafaud, et les députés terroristes étaient remplacés par Albitte et Salicetti. Leur arrivée à Barcelonnette fut signalée par l’arrêté suivant : c’était la récompense qui attendait Bonaparte à son retour :
« Les représentants du peuple près l’armée des Alpes et d’Italie ;
« Considérant que le gênerai Bonaparte, commandant en chef l’artillerie de l’armée d’Italie, a totalement perdu leur confiance par la conduite la plus suspecte et surtout par le voyage qu’il a dernièrement fait à Gênes, arrêtent ce qui suit :
« Le général de brigade Bonaparte, commandant en chef l’artillerie de l’armée d’Italie, est provisoirement suspendu de ses fonctions ; il sera, par les soins et sous la responsabilité du général en chef de ladite armée, mis en état d’arrestation et traduit au comité de salut public de Paris sous bonne et sûre escorte : les scellés seront apposés sur tous ses papiers et effets, dont il sera fait inventaire par des commissaires qui seront nommés sur les lieux par les représentait du peuple Salicetti et Albitte, et tous ceux desdits, papiers qui seront trouvés suspects seront envoyés au comité du salut public.
« Fait à Barcelonnette, le 19 thermidor an n de la république française, une, indivisible et démocratique.
« Signé ALBITTE, SALICETTI, LAPORTE. Pour copie conforme, le général en chef de l’armée d’Italie, « Signé DUMERBION. »
L’arrêté fut mis à exécution : Bonaparte, conduit à la prison de Nice, y resta quatorze jours, après lesquels, par un second arrêté signé des mêmes hommes, il fut remis provisoirement en liberté.
. Cependant Bonaparte ne sortit d’un danger que pour tomber dans un dégoût. Les événements de thermidor avaient amené un remaniement dans les comités de la Convention : un ancien capitaine, nommé Aubry, se trouva diriger celui de la guerre, et fit un nouveau tableau de l’armée,, où il se porta comme général d’artillerie. Quant à Buonaparte, en échange de son grade qu’on lui prenait, on lui donnait celui de général d’infanterie dans la Vendée. Bonaparte, qui trouvait trop étroit le théâtre d’une guerre civile dans un coin de la France, refusa de se rendre à son poste, et fut, par un arrêté du comité du salut public, rayé de la liste des officiers généraux employés.
Bonaparte se croyait déjà trop nécessaire à la France pour n’être point profondément frappé d’une pareille injustice : cependant, comme il n’était pas encore arrivé à l’un de ces sommets de la vie d’où l’on voit tout l’horizon qui reste à parcourir, il avait déjà des espérances, il est vrai, mais point encore de certitudes. Ces espérances furent brisées : il se crut, lui, plein d’avenir et de génie, condamné une inaction longue, sinon éternelle ; et cela dans une époque où chacun arrivait en. courant. Il loua provisoirement une chambre dans un hôtel de la rue du Mail, vendit pour six mille francs ses chevaux et sa voiture, réunit le peu d’argent qu’il se trouvait posséder, et résolut de se retirer à la campagne. Les imaginations exaltées bondissent toujours d’extrêmes en extrêmes : exilé des camps, Bonaparte ne voyait plus rien que la vie rurale ; ne pouvant être César, il se faisait Cincinnatus.
Ce fut alors qu’il se souvint de Valence, où il avait passé trois ans, si obscur et si heureux ; ce fut de ce côté qu’il dirigea ses recherches, accompagné de son frère Joseph, qui retournait à-Marseille. En passant à Montélimart, les deux voyageurs s’arrêtent : Bonaparte trouve le site et le climat de la ville à sa convenance, et demande s’il n’y a pas dans les environs quelque bien de peu de valeur, à acheter. On le renvoie à M. Grasson, défenseur officieux, avec. lequel il prend jour pour le lendemain : il s’agissait de visiter une petite campagne appelée Beauserret, et dont le seul nom, qui dans le patois du pays signifie Beauséjour, indique l’agréable situation. En effet, Bonaparte et Joseph visitent cette campagne ; elle est en tout point à leur convenance : ils craignent seulement, en voyant son étendue et son bon état de conservation, que le prix n’en soit trop élevé ; ils hasardent la question, — trente mille francs, — c’est pour rien.
Bonaparte et Joseph reviennent à Montélimart en se consultant : leur petite fortune réunie leur permet de consacrer cette somme à l’acquisition de leur futur ermitage : ils prennent rendez-vous pour le surlendemain. C’est sur les lieux mêmes qu’ils veulent terminer, tant Beauserret leur convient : M. Grasson les y accompagne de nouveau ; ils visitent la propriété plus en détail encore que la première fois : enfin Bonaparte, étonné que l’on donne pour une somme si minime une si charmante campagne, demande s’il n’y a pas quelque cause cachée qui en ait fait baisser le prix.
« Oui, répond M. Grasson, mais sans importance pour vous.
— N’importe, répond Bonaparte, je voudrais la connaître.
— Il y a eu un assassinat de commis.
— Et par qui ? :
— Par un fils sur son père.
— Un parricide !, s’écria Bonaparte en devenant plus pâle encore que d’habitude : partons, Joseph. ».
Et saisissant son frère par le bras, il s’élança hors des appartements, remonta en cabriolet, et, arrivé à Montélimart, demanda des chevaux de poste et repartit à l’instant même pour Paris, tandis que Joseph continuait sa route vers Marseille.
Il y allait pour épouser la fille d’un riche négociant, nommé Clary, qui devint aussi depuis le beau-père de Bernadotte.
Quant à Bonaparte, repoussé encore une fois par le destin vers Paris, ce grand centre des grands événements, il y reprit cette vie obscure et cachée qui lui pesait tant : ce fut alors que, ne pouvant supporter son inaction j il adressa une note au gouvernement, dans laquelle il exposait qu’il était de l’intérêt de la France, au moment où l’impératrice de Russie venait de resserrer son alliance avec l’Autriche, de faire tout ce qui dépendait d’elle pour accroître les moyens militaires de la Turquie : en conséquence, il s’offrait au gouvernement pour passer à Constantinople, avec six ou sept officiers de différentes armes, qui pussent former aux sciences militaires les milices nombreuses et braves, mais peu aguerries, du sultan.
Le gouvernement ne daigna pas même répondre à cette note, et Bonaparte resta à Paris. Que lut-il arrivé du monde si un commis du ministère eût mis au bas de cette demande le mot « accordé » ? — Dieu seul le sait.
Cependant, le 22 août 1795, la constitution de l’an m avait été adoptée : les législateurs qui l’avaient rédigée y avaient stipulé que les deux tiers des membres qui composaient la Convention nationale feraient partie du nouveau corps législatif : c’était la chute des espérances du parti opposé, qui espérait, par le renouvellement total des, élections, l’introduction d’une majorité nouvelle représentant son opinion. Ce parti opposé était surtout soutenu par les sections de Paris, qui déclarèrent qu’elles n’accepteraient la constitution qu’au tant que la réélection des deux tiers serait annulée.
La Convention maintint le décret dans son intégrité : les sections commencèrent à murmurer ; le 25 septembre quelques troubles précurseurs se manifestèrent ; enfin, dans la journée du i octobre (12 vendémiaire) le danger devint si pressant que la Convention pensa qu’il était temps de se mettre sérieusement en mesure : en conséquence, elle adressa au général Alexandre Dunlas, commandant en chef de l’armée des Alpes, et alors en congé, la lettre suivante, dont la brièveté même démontrait l’urgence :
« Le général Alexandre Dumas se rendra à l’instant même à Paris pour y prendre le commande ment de la force armée. »
L’ordre de la Convention fut porté à l’hôtel Mirabeau ; mais le général Dumas était parti trois jours auparavant pour Villers-Coterets, où il reçut la lettre le 13 au matin.
Pendant ce temps, le danger croissait d’heure en heure ; il n’y avait pas moyen d’attendre l’arrivée de celui qui était mandé : en conséquence, pendant la nuit, le représentant du peuple Barras fut nommé commandant en chef de l’armée do l’intérieur : il lui fallait un second ; il jeta les yeux sur Bonaparte.
Le destin, comme on le voit, avait déblayé sa route : cette heure d’avenir, qui doit sonner, dit-on, une fois, dans la vie de tout homme, était venue pour lui : le canon du 13 vendémiaire retentit dans la capitale.
Les sections, qu’il venait, de détruire, lui donnèrent le nom de Mitrailleur ; et la Convention, qu’il venait de sauver le titre de général en chef de l’armée d’Italie.
Mais cette grande journée n’allait pas influer seulement sur la vie politique de Bonaparte. : sa vie privée devait en dépendre et en ressortir. Le désarmement des sections venait d’être opéré avec une rigueur que nécessitaient les circonstances, lorsqu’un jour, un enfant de dix ou douze ans se présenta, à l’état-major :, suppliant le général Bonaparte de lui faire rendre l’épée de son père, qui avait été général de la république. Bonaparte y touché de la demande et de la grâce juvénile avec laquelle elle lui était faite, fît chercher l’épée y et, l’ayant retrouvée, la lui rendit. L’enfant, à la vue de cette arme sainte qu’il croyait perdue ? baisa en pleurant la poignée qu’avait touchée si souvent la main paternelle’ : le général fut touché de cet amour filial, et témoigna tant de bienveillance à l’enfant que sa mère se crut obligée de venir le lendemain lui faire une visite de remerciements.
L’entant était Eugène, et la mère, Joséphine.
Le 21 mars 1796, Bonaparte partit pour l’armée d’Italie, emportant dans sa voiture deux mille louis : c’était tout ce qu’il avait pu réunir, en joignant à sa propre fortune ’et à celle de ses amis les subsides du Directoire ; c’est avec cette somme qu’il part pour aller conquérir l’Italie : c’était sept fois moins que n’emportait. Alexandre allant conquérir l’Inde.
En arrivant à. Nice ? il trouva une armée sans discipline, sans munitions, sans vivres, sans vêtements. Dès qu’il est au quartier-général, il fait distribuer aux généraux, pour les aider à entrer en campagne, la somme de quatre louis ; puis aux soldais, en leur montrant l’Italie : « Camarades, dit-il, vous manquez de tout au milieu de ces rochers : jetez les yeux sur les riches plaines qui se déroulent à vos pieds, elles nous appartiennent : allons les prendre. »
C’était à peu près le discours qu’Annibal avait tenu à ses soldats il y avait dix-neuf cents ans : et depuis dix-neuf cents ans, il n’avait passé entre ces deux hommes qu’un seul homme digne de leur être comparé : — c’était César !





























