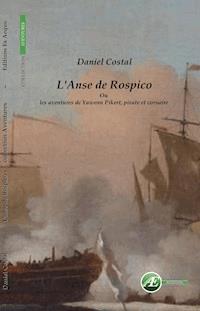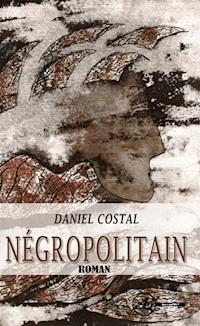
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Blanche
- Sprache: Französisch
Roman d'initiation, de conquête de soi, malgré les déterminismes et les écueils de départ.
Négropolitain, roman sur l’outre-mère, mais aussi adieu au père. Roman d'initiation, de conquête de soi, malgré les déterminismes et les écueils de départ, ou, plutôt, grâce à eux ? Une trajectoire qui contraint le héros à résoudre un délicat problème : pas celui de devoir choisir entre être noir ou blanc (question posée dans sa cité), ni même de vivre en noir et blanc (question posée par ses parents), mais d’arriver à se construire juste métis, au prix d'innombrables contradictions et contre-indications à dépasser. En toile de fond, autant qu’en personnages secondaires, la Martinique, l’Irlande, l’Ile de France : triangulation culturelle et sentimentale qui met en perspective les îles matrices et forme un imaginaire géographique, où s'apprirent la diversité et la mobilité. Ne sommes-nous pas les uns et les autres, des îles perdues dans l’océan de l’incertitude qui cherchent à tisser des liens avec d’autres îles, en quête d’autres rivages ? L’histoire. C’est son dernier voyage en Irlande et celui-ci tourne au désastre: ses meilleurs amis, Liam et Tricia sont en pleine crise conjugale.
La solitude et la déshérence qui en découlent permettent à Joseph, la quarantaine, professeur en sciences sociales et ancienne gloire de la Boxe Française, de nouer avec Sabine, la belle interprète, une relation pleine de promesses… Ces quelques jours vont lui offrir l’occasion de revenir, par petites touches, sur son parcours singulier de métis d’origine antillaise, né et élevé en banlieue parisienne. De se réapproprier les tribulations d’une émigration inscrite dans la geste tumultueuse et brutale de la Martinique. Jusqu’à clarifier l’embrouillamini de sa famille et la clé de son origine. Jusqu’à comprendre, enfin, comment il n’est jamais devenu champion du monde. Pour en tirer une illustration réaliste - mais pas désespérée - de ce que l’on pourrait appeler, en référence respectueuse à Philip Roth… « le complexe du négropolitain »
Découvrez la trajectoire d'un homme confronté à un délicat problème : se construire métis, au prix d'innombrables contradictions et contre-indications à dépasser.
EXTRAIT
— Je suis désolé Joseph.
— Laisse tomber cousin, ça n’en vaut pas le coup.
— Je pensais que ton statut de champion t’aurait mis à l’abri de ce genre de connerie. Tu es connu et aimé ici, franchement je suis sur le cul.
Champion ou pas, ça avait pourtant fusé. Soudain, les mots railleurs avaient été criés. Ressentant leur cruauté, Bruno, hors de lui, allait répondre, quand je lui fis signe de se taire. En un rien de temps les grincheux agressifs avaient été discrètement évacués et la cérémonie avait repris son cours. Dans des moments comme celui-ci, ces moments où tout le monde se sent gêné : les organisateurs parce qu’ils se croient responsables, la majorité de l’assistance, car elle endosse la honte mal placée des offenseurs issus de son sein, en de tels moments, il arrive qu’on parvienne à noyer le poisson, en faisant mine de ne rien avoir entendu.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Daniel Costal est né en 1962 à Paris. Il débute sa vie professionnelle comme organisateur d évènements de jazz, éducateur en Maison d'Enfants et animateur de prévention. DESS en Sciences de l'Education en poche, il est tour à tour Directeur pédagogique et Formateur-Consultant en pratiques sociales. Depuis les années quatre-vingt-dix il réside en Haute-Normandie où il est aujourd'hui Responsable de Projets dans un grand organisme de formation. Négropolitain est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Tartane. Février 2003
Dublin. Mai 2001
Tricia
Murphy
Loup Noir
Djamel
Bruno
Xavier
Max
Félicien
Liam
Maddy
Lucien
Aimé
Nate
Richard
Sabine
Marie-Ca
Katheleen
Bruno (2)
Dorothy
L’Américaine
Max (2)
Joseph
Tartane. Février 2003
Iémanja
Négropolitain
Daniel Costal
roman
Dépôt légal novembre 2012
ISBN : 978-2-35962-333-8
Collection Ultramarine
ISSN : 2108-8539
©Couverture Pierre Cousin
Négropolitain
roman
Collection Ultramarine
Daniel Costal
Éditions Ex Aequo
6 rue des Sybilles
88 370 Plombières les bains
Aujourd'hui je suis ce que je suis
Nous sommes qui nous sommes
Et tout ça, c'est la somme
Du pollen dont on s'est nourri
PierreBAROUH
Tartane. Février 2003
— Je suis désolé Joseph.
— Laisse tomber cousin, ça n’en vaut pas le coup.
— Je pensais que ton statut de champion t’aurait mis à l’abri de ce genre de connerie. Tu es connu et aimé ici, franchement je suis sur le cul.
Champion ou pas, ça avait pourtant fusé. Soudain, les mots railleurs avaient été criés. Ressentant leur cruauté, Bruno, hors de lui, allait répondre, quand je lui fis signe de se taire. En un rien de temps les grincheux agressifs avaient été discrètement évacués et la cérémonie avait repris son cours. Dans des moments comme celui-ci, ces moments où tout le monde se sent gêné : les organisateurs parce qu’ils se croient responsables, la majorité de l’assistance, car elle endosse la honte mal placée des offenseurs issus de son sein, en de tels moments, il arrive qu’on parvienne à noyer le poisson, en faisant mine de ne rien avoir entendu. Dans le cas présent, il n’y avait aucun doute, seuls les sourds et les distraits avaient pu manquer les quelques noms d’oiseaux, insultes par destination, qui avaient su profiter d’un bref silence, d’une respiration dans le brouhaha ambiant pour s’imposer et glacer l’atmosphère. La musique venait de s’arrêter, l’adjoint au maire était déjà en place devant le micro, mais il prenait son temps, il relisait les notes du discours qu’il allait prononcer dans dix secondes, il envoyait des clins d’œil et des petits saluts de la tête à la cantonade. J’avais l’habitude de ce genre de cérémonies. Il fallait se tenir debout sur une petite estrade décorée par trois banderoles, deux calicots, et sourire comme un cake à une petite foule de personnalités locales, d’enfants, de fans, de curieux et, parfois, à une poignée de cons qui se sont sentis obligés d’imposer leur présence. Comme le disait le directeur des sports, sur un ton emprunt de fatalisme :
— Ça leur fait plus plaisir à eux qu’à toi, c’est sûr, mais faut penser au public, faut encourager les vocations, montrer les valeurs positives du sport.
Tu parles ! Une volée d’insultes. Et elles m’étaient nettement destinées, elles me visaient expressément. Pourtant, j’aurais été de mauvaise foi si je m’étais prétendu blessé. Touché sans doute un peu, mais j’en avais vu d’autres, et au fond, ça m’amusait. Ça n’avait duré qu’un instant, personne n’avait relevé. Le murmure de désapprobation du public avait suffi à dissuader les importuns d’aller plus loin. Pour donner le change, l’édile besogneux avait dû forcer sa nature et enchaîner précipitamment, il avait fini par lire son compliment, qu’il prévoyait de déclamer. Puis, sous un tonnerre d’applaudissements, j’avais remis leurs récompenses aux « sportifs martiniquais de l’année ». Cela s’était bien terminé. Toutefois, étant donné que c’était lui qui m’avait mis sur le coup — sans me demander mon avis — Bruno, se sentait mal à l’aise. Réactif et entreprenant comme toujours, mon cousin avait saisi la balle au bond : les festivités coïncidaient avec mon arrivée sur l’île, il avait dû s’engager à me convaincre d’y participer. Je pense aussi qu’il n’avait pas pu s’empêcher de frimer en plaçant ostensiblement qu’il avait dans sa famille un boxeur. Un tireur de boxe française, fraîchement retiré, qui jouissait encore de quelque notoriété.
— Quels cons ! J’m’en veux. J’ai honte pour les mecs qui t’ont crié ça, j’ai les nerfs, c’est pas normal. Putain ! Au lieu d’être tous derrière toi, ça me gonfle ! Avec ton palmarès…. c’est énorme.
— Ça te touche parce qu’on est comme des frères, pas vrai ? Donc tu en prends un peu pour toi. Mais je peux te dire que moi, ça ne me surprend pas. J’ai déjà eu l’occasion d’en parler avec d’autres sportifs antillais vivant en métropole, ça leur arrive aussi de se faire méchamment chambrer, comme s’ils avaient renié quelque chose. On fait un jour la une d’un journal, alors là c’est la fierté au village, « je le connais, il est né à Paris, d’accord, mais son grand-père il est du Vauclin ou son oncle il est de Schœlcher ». Une fois passé le quart d’heure de gloire, on se rend compte qu’on est juste utilisé, notre image est utilisée. Pour faire passer des messages aux jeunes. Ou pour faire mousser un politicien du coin qui saura en récupérer les bienfaits. Mais, au fond, pour être vraiment respecté, faut être natif d’outre-mer et habitant de l’île. Là, tu ne risques pas de te prendre des insultes.
— Je ne sais pas. Si tu le dis. Tu crois que vous êtes victimes d’une défiance ? Ça me paraît exagéré, surtout qu’en général, les sportifs sont populaires, au-delà des origines, d’ici, de là-bas ou d’ailleurs. Ceux qui viennent d’outre-mer et qui réussissent à un niveau international sont respectés. Et, même s’ils sont nés en métropole…
—… faut croire que ça en dérange certains. Mais te bile pas, j’suis pas vexé.
— Franchement, t’as pas eu envie de choper les mecs ?
— Bah ! D’abord je les ai pas bien vus, puis surtout, pour faire quoi ? Leur casser la gueule ? Et après ?
— Ça t’aurait défoulé, merde !
— J’ai pas besoin de ça. Faut rester zen. Si j’avais accordé de l’importance à ce genre d’incidents, ça m’aurait pompé mon énergie, j’aurais jamais fait ce parcours. J’ai rien à prouver, je suis ma voie, j’avance sans me laisser arrêter par l’imbécillité. Je l’ai rencontrée tant de fois et depuis si longtemps.
— Si Max avait été là, il n’aurait pas pu garder son calme comme toi. T’imagines ? Max et trois demeurés qui insultent son fils, j’les plains les mecs !
— Tu as raison, mais de toute façon ça ne serait jamais arrivé en présence de Max, tu ne crois pas ?
— C’est vrai, il les aurait juste regardés comme ça, d’un regard… qui te fait comprendre où est ton intérêt.
— D’un regard, genre « vas-y, dis-la ta connerie, j’t’entreprends juste après ! »
Installés en terrasse de cette arrière-cour du café Séverin où nous avons trouvé refuge et où le reste de notre petite bande antillo-métro-irlandaise doit nous rejoindre, c’est en savourant une Caribe bien fraîche que nous revenons sur l’incident et évoquons l’art de la dissuasion selon mon père. Il a fallu manœuvrer le fauteuil roulant de mon cousin pour franchir le perron, mais nous avons fini par trouver une table qui ne soit pas dans le passage. Bruno est encore sous le coup de la stupeur. Je lui répète qu’il n’y a pas de quoi se mortifier, quoique ça demeure contrariant. Il y a toujours de mauvais coucheurs, mécontents de tout, et on se demande pourquoi ils prennent encore la peine de se déplacer pour une manifestation qu’ils critiqueront, de toute façon. Un évènement modeste et bon enfant qui, pour une fois, ne se déroulait pas à Fort-de-France. Il serait intéressant de lire, le lendemain, comment les gazettes auraient relaté les faits. Mon cousin réfléchit toujours longuement avant de relancer, il parle lentement et cherche ses mots. Il ne veut pas me gêner, ce qu’il craint à revenir ainsi sur l’anecdote que nous venons de vivre. Mais, vu les circonstances, il aimerait bien qu’on aille au fond des choses, quant à moi, je ne suis pas contre. Il tire sur sa cigarette en fixant le mur, juste au-dessus de ma tête. Il expire la fumée en faisant une grimace sonore.
— Alors c’est sérieux ? Ça ne te vexe pas quand on te traite comme ça ?
— Oui, très sérieux. Par contre, parfois, comme aujourd’hui justement, ça me fait un peu de peine. Parce que ça vient d’antillais des Antilles. Ce n’est pas humiliant, mais c’est dur. Ça traduit comme un rejet de ceux qui sont nés en métropole, tu vois, un reproche. Comme si, dans les îles, on n’acceptait pas que des natifs aient pu émigrer à Paris et y faire naître des enfants. L’insulte est autant pour les enfants que pour les parents. C’est injuste. Moi, ce que je ressens c’est principalement ce regard d’accusation quand je suis en Martinique. Pas en permanence, bien sûr, mais souvent quand même. C’est comme si on me disait « tu n’es pas un vrai antillais ».
— Mais c’est vrai pourtant : comparé à moi tu n’es pas un « vrai antillais » !
— Ça commence où être un vrai Antillais ? C’est des conneries. Max n’est pas né à la Trinité ? Moi je n’ai pas la couleur locale ? Je suis quoi ? Trop clair ? Pas assez « black » ?
— Je comprends. Mais regarde, t’as beau être métis, comme moi, quand tu séjournes ici, tu parles pas créole, t’as ton accent parisien, t’es pas sapé pareil, je sais pas… ça se voit que t’es pas de là. Ça se sent. Même quand tu danses… C’est pas que tu danses mal, tu bouges mieux qu’un blanc, c’est clair, surtout que t’as le physique. Je sais pas, t’es dans la retenue, c’est pas tout à fait pareil.
— Et alors ? Je ne prétends pas réagir et parler, zouker ou couper-décaler comme les gens qui vivent dans l’île, qui ne l’ont jamais quittée. C’est le fait d’être accepté ou pas comme Antillais qui m’intéresse. Qu’on me fasse ressentir par plein de signes plus ou moins explicites, que non, vraiment je n’en suis pas et n’en serai jamais. Alors que mes grands-parents et mon père y ont vécu si longtemps. Ce qu’il faut savoir Bruno, tu t’en es d'ailleurs sans doute rendu compte, c’est que, en France, à cause de cette couleur, à cause de nos généalogies, nous ne sommes pas toujours vus comme de vrais Français. Or chez nous, à Tartane, parce que je suis né à St Denis et parce je vis en métropole, on me renvoie que je ne suis pas martiniquais !
— Donc, le mot ne te touche pas en lui-même, c’est ce qu’il révèle qui te gêne ?
— Oui, tu y es. Tu veux que je te dise, sans parano mal placée, je trouve que vous êtes parfois plus durs dans votre comportement, avec nous les métis, les chabins, les mulâtres de métropole, qu’avec les blancs. Un blanc de métropole, pour vous, c’est soit un type qui vous pique votre taf et alors vous êtes clairement hostiles, soit un touriste, et lui on l’accueille, au pire on lui fout la paix et on profite de son fric. Nous, c’est entre les deux. Faut toujours qu’on nous vanne, qu’on cherche à nous piéger – en nous parlant en créole, facile — qu’on nous critique Paris, la banlieue. Moi, la banlieue, je ne l’ai pas faite. Et si j’adore Paris, c’est qu’il y a le monde entier à Paris, c’est ça que vous ne voyez pas.
— Attends, ne dis pas « vous » ! Moi, j’ai jamais été comme ça avec toi.
— Avec moi non, mais t’es sûr que t’es toujours ce qu’il y a de plus sympa avec, je ne sais pas, les Lorphelin par exemple, je sais qu’ils n’aiment plus revenir ici, il y a sans doute des raisons ?
Il n’était pas dans mes intentions de régler des comptes, ni avec Bruno, ni avec qui que ce soit. Cependant, je devais reconnaître que ça faisait du bien de sortir un peu ce vécu, de le partager, de le confronter. Je ne m’étais jamais vraiment rendu compte que j’en avais gros sur la patate douce !
— Voilà le truc, mec. Je vais être direct : à force de propos méprisants, de vannes à la con, on finit par dénier à des cousins, des frères, des voisins, tous les sacrifices, le travail, l’endurance qu’il leur a fallu pour percer en France. Se faire une place, peut-être pas au soleil, puisque le soleil ils l’avaient laissé dans leur île natale, mais une place respectable, et si possible respectée. Ils n’ont trahi personne. Ils ont tout conquis par obstination. Entre nous, tu crois que ça se fait tout seul de s’adapter au climat, au racisme, à la vie urbaine ? Pour qu’au final, on leur fasse bien sentir qu’ils ne sont plus chez eux en Martinique. Cela dit, personne ne se plaint quand ils se font construire une maison, sans compter l’argent envoyé à la famille, les cadeaux – même si tout le monde ne l’a pas fait.
— Non, je sais tout ça, Jo, ça fait partie de presque toutes les familles. J’admire Lucien et Max. Et Maddy. Je suis conscient de ce qu’ils ont fait. C’est très fort. Pareil pour Irénée Lorphelin et sa famille : respect.
— Je te crois, et je crois que beaucoup de martiniquais pensent comme toi. Mais vous avez du mal à le montrer, non ? Entre nous, est-ce qu’il n’y aurait pas un soupçon de jalousie ?
Bruno se soulève un peu en s’appuyant sur les roues de son fauteuil, allume une autre cigarette, prend une nouvelle fois le temps de réfléchir, joue avec la petite Martinique plaquée argent qu’il porte en sautoir depuis des années — « mon talisman » — comme à chaque fois qu’il redevient sérieux. Sa perplexité est palpable. Je suis sûr qu’il va dire « non ». Qu’il n’y a nulle jalousie de ceux de l’île envers les émigrés.
— Peut-être qu’il y a de ça… Ouais, je crois qu’on peut dire qu’il y a une sorte de jalousie. Mais y’a pas que ça. Quand vous revenez en vacances ou à la retraite, vous avez votre argent. Vos manières pas d’ici. Vous avez une façon de speeder, comme si vous aviez été déformés ! Toi, tu dis que tu ressens du rejet. Moi je ressens parfois de la condescendance. Je ne parle pas pour toi, tu le sais bien.
— En fait, on s’envoie les uns les autres des messages qui reflètent des habitudes de vie qui ont forcément divergé, du coup on crée malgré nous de l’exclusion. L’exclusion de l’autre qui n’est pas comme nous, ou pas comme on voudrait qu’il soit. Parce qu’on n’a pas les mêmes réflexes culturels.
— C’est comme ça qu’on entretient les caricatures. En plus, ça rassure… l’antillais indolent, jamais pressé, toujours en retard, et le métro fonceur, qui ne prend pas le temps de vivre. Bon, y’a du vrai là-dedans, hein ? Mais faisons gaffe aux stéréotypes assassins.
— Je sais que, en effet, les antillais des Antilles n’aiment pas qu’on les brusque, ils ont alors l’impression qu’on veut leur donner des leçons. Cela dit, ils ne sont pas toujours si cool.
— Pour toi, qu’est-ce qu’il faudrait en fin de compte pour que ça se passe mieux ?
— La question qui tue ! J’en sais rien, mais ça me semblerait au moins utile de réinterroger les concepts de négritude et de créolité, souvent opposés, mais complémentaires, en les appliquant aussi à la métropole. Tiens, tu as essayé de piger pourquoi je suis nul en créole ? Je vais te le dire, ce n’est pas que je ne m’y sois pas intéressé. C’est, d’une part, parce que la famille m’en a écarté ; Lucien ne voulait pas que Max le parle, Max s’en foutait et ne m’a rien transmis, toi et Mawika, pendant toutes les vacances qu’on a passées aupeyi, chez vous avec Nate, vous n’avez jamais jugé bon de nous l’apprendre. D’autre part, tu peux ajouter à cela que, mes timides tentatives pour dialoguer avec des locaux — parce que je savais pas mal de mots et d’expressions appris tout seul — se sont soldées par des moqueries. Du coup, j’ai vite remis mes velléités dans ma poche !
— Oui, mais regarde comment tu parles, « velléités », on dit jamais ça ici !
— Pour être franc, c’est bien un manque de considération qu’on subit. On ne prétend pas être comme vous, ce serait débile, ce qu’on veut c’est que vous nous considériez comme des antillais. Des antillais émigrés en France ou nés en France, mais des antillais. C’est tout. Parce qu’en France, y’a pas de problème, eux ils nous calculent bien comme des nègres, t’as beau être que café au lait !
— Tu dis « nègre » comme les gens d’ici !
— Ben ouais, comme toi, ce mot ne me gêne pas. Dans ma bouche ou celle d’un martiniquais ou d’un gwada, pas de problème du tout. Mais y’a des nuances, par exemple, dans la bouche d’un gaulois réac…
— Question de contexte !
— C’est vrai. En tout cas, cousin, quand Nate et moi parlons de Madinina, dans notre famille d’émigrés, nous disons « mon île ». Alors, cette île, qu’elle nous accepte comme ses enfants, même si nous n’avons pas eu l’honneur de naître sur son sol. Après, qu’on se traite de blacks, de nègres, de négropolitains, quelle importance ? « Négropolitain » aujourd’hui est plutôt péjoratif, tout-à-l’heure c’était bien une insulte, mais il s’en faudrait de peu qu’il perde un jour cette connotation.
— C’est « négro » qui pose problème, non ? « politain » c’est pas méchant, à priori.
— Au final, je vais te dire : chabin, mulâtre, métis, quarteron, t’appelles ça comme tu veux, moi quand j’étais môme, mon problème c’était comment arriver à vivre en n’étant ni noir, ni blanc, juste métis. Aujourd’hui c’est réussir à être à la fois noir et blanc.
— Juste métis !
— Tiens, regarde, les voilà qui arrivent, comme ils sont beaux !
Ils étaient tous là, nous étions au complet. On allait changer de sujet. Nous en avions mis du temps à avoir cette discussion. Pour un mot. Un mot qui, par sa sonorité, son nombre de syllabes, est facile à utiliser pour désigner les personnes d’origine antillaise, vivant ou ayant vécu en France métropolitaine. Un mot qui est un jeu de mots. Un mot de mots mêlés, de sangs-mêlés. Un mot qui ne se veut pas injure, mais un mot qui réduit et qui enferme. Mot schizophrène qui se réfère à des vies dédoublées, comprenant un là-bas et un ici. Mot qui jette un pont fragile au-dessus de l’océan. Mot contenant des cultures entrecroisées, des contradictions identitaires. Mot qui interdit d’oublier jamais qu’il y eut un commerce triangulaire, un Code Noir, mot violent qui exploite, qui rejette. Mot-copain qui interpelle. Mot universel où se reconnaissent le cantalou de Montparnasse, le catalan de Tourcoing, le corse de Vénissieux, et tant d’autres déracinés qui pourraient ensemble proclamer « nous sommes tous des négropolitains ». Mot dialectique et paradigmatique. Mot qui signe toutes les acculturations, mot qui n’est qu’un mot et qui provoque tant de remous. Mot sédiment, avatar du colonialisme, du centralisme, du paternalisme. Mot bâtard, comme un projet malhabile pour qu’advienne la diversité. Un mot enfin, cosmopolite, pour alerter. Pour dire que ce n’est pas gagné.
Dublin. Mai 2001
— Non Liam, tu ne peux pas me faire ça. Ça fait deux ans qu’on ne s’est pas vu et voilà comment tu m’accueilles. C’est… je ne sais pas quoi te dire… Non, non, voilà. C’est tout. N’insiste pas. Je ne peux pas faire ça. Tu me demandes quelque chose que je ne peux pas faire.
Mais Liam insista tant, et je l’aimais tant que je finis par rendre les armes. Évidemment. Liam, mon ami irlandais, mon complice, depuis tant d’années. Liam, ce colosse si doux, cette montagne que l’on imagine pleine de force et de ressources. Il avait la stature d’un deuxième ligne, sauf qu’il avait toujours été un peu gras, placide, bonhomme. Cependant, il dégageait une puissance qui vous faisait vous sentir en sécurité lorsqu’après avoir écumé les pubs de Mullingar ou de Cork il fallait rentrer par les rues sombres et mal famées où une mauvaise rencontre était toujours possible. Généreux, il était également toujours disponible pour ses amis et en particulier pour moi, à l’époque où je me rendais régulièrement en son pays pour évaluer des programmes d’échanges transnationaux financés par l’Europe. Je l’avais rencontré dix ans plus tôt alors que je réalisai ma première mission à Mullingar, dans le Westmeath. Jeune consultant du réseau Racine, un organisme chargé de financer des voyages éducatifs pour des adolescents relevant de la Protection judiciaire de la Jeunesse, je l’avais remarqué au sein du groupe d’éducateurs qui encadraient l’échange. On trouvait parmi eux des Français, des Italiens et des Irlandais. Mon travail consistait à rencontrer et interviewer les jeunes dans leur milieu d’accueil, familles et entreprises, ainsi qu’à animer des séminaires entre encadrants. Je disposais d’une méthodologie conçue à Paris et validée par Bruxelles, l’objectif étant autant de mesurer l’efficacité éducative du dispositif que de justifier l’utilisation des fonds mis à disposition par les états et l’Union Européenne. Pour accomplir cette tâche, les moyens alloués étaient considérables : une logistique impressionnante, des interprètes à demeure, une enveloppe en liquide pour mes frais. Il me fallait dans un premier temps encourager l’expression des principaux acteurs, puis en effectuer la synthèse en suivant les critères d’un document d’évaluation que je livrais à mon retour. Liam était un bonheur de participant. Il intervenait spontanément, n’hésitait pas à mettre son vécu à la disposition du groupe. Posé, serein, passionné, il parlait des jeunes avec humour et sensibilité. Il avait une sérieuse expérience pédagogique et pour cela, était respecté par les représentants de tous les pays. Mais il avait aussi, sans en avoir l’air — sans doute à cause de sa voix de basse et de son ton toujours très calme — un don pour la controverse et un goût certain pour la provocation. Dès nos premiers échanges, il avait cherché à m’asticoter en se situant résolument comme homme de terrain, pour mieux souligner que mon approche était théorique et, partant, un peu éloignée de la réalité quotidienne. Pour tout arranger, dans la plaquette du séminaire, une courte bio disait que j’avais une maîtrise en Sciences de l’Éducation : je ne pouvais donc être qu’un intellectuel donneur de leçons, mâtiné de technocrate européen, jargonnant et sûr de son arbitrage ! Nos joutes courtoises eurent tôt fait d’établir entre nous du respect et de l’écoute, car si je pus lui montrer que j’avais, à maintes reprises et dans des contextes très variés, encadré des groupes de jeunes « difficiles », je découvris qu’il avait une connaissance assez complète de la pensée éducative contemporaine. Je perçus également que nous partagions cette idée que l’éducation et la prévention étaient autant les résultantes de nos différents systèmes politiques que des leviers de transformation de la société. Parfois, il m’accaparait au point que je devais lui demander de laisser les autres s’exprimer. Il fallait alors que quelque vieux briscard de l’Education Spécialisée à Rome, pionnier des échanges européens, nous mette à l’aise en nous affirmant que nos débats étaient ce qu’il avait entendu de plus intéressant depuis qu’il participait à ces rencontres. Le soir, après des journées bien remplies, Liam et moi poursuivions la discussion chez Fat Daddy, le pub où se retrouvaient les profs de fac et les joueurs de l’équipe de rugby. Dans ce décor, il faisait montre de beaucoup moins de retenue, cédait volontiers à un certain emportement, voire devenait un peu hâbleur. Nous nous écharpions avec passion tout en faisant le chaser : une bière, un whiskey, une bière, un whiskey, etc. La mousse des pintes s’accrochait à sa barbe blond roux. Ses cheveux hirsutes, déjà un peu clairsemés sur le front, son regard clair et son grand rire d’ogre me le rendaient attachant. De Guinness en Blackbush, nos propos glissaient doucement sur nos vies et, peu à peu, nous laissions entrevoir des facettes de nos personnalités et de nos existences. Il était intarissable sur son enfance à Dublin, mais me demandait avec curiosité que je lui raconte la Martinique. Quand vint la fin de cette première session, il fallut se promettre d’écrire, de téléphoner et de se revoir pour supporter l’interruption de cette relation féconde et gratifiante. Liam me jura que j’avais désormais une base en Irlande. Contrairement à ce qui se produit souvent dans ce genre de situation, non seulement ces démonstrations affectueuses eurent une suite, mais elles nous permirent de savoir ce que voulait dire le mot amitié : voici dix ans que ça dure et dix de plus qui s’annoncent.
Sauf que là, pour la première fois, nos retrouvailles étaient vraiment gâchées.
Tricia
Quelques heures plus tôt, j’avais embarqué à l’aéroport de Beauvais, plein d’enthousiasme à la pensée de revoir mon cher Liam. Comme à chacun de mes séjours irlandais depuis que j’avais fait sa connaissance, c’est chez lui que je prenais mes quartiers, même après que j’eus cessé d’animer les stages de formateurs européens. J’avais ainsi suivi son évolution personnelle. Les premiers temps, il m’accueillit dans son grand studio de Mullingar. Une situation et une organisation impeccables pour deux célibataires aimant se coucher tard. Puis, le barbu colossal prit du galon au sein de l’institut qui l’embauchait depuis l’obtention de son diplôme de travailleur social. À son corps défendant il s’embourgeoisa et se trouva une maisonnette confortable à Carrick On Shannon. J’y avais alors ma chambre, enfin c’était la chambre d’ami, mais Liam y avait placardé un panonceau « Joe’s » qui me situait, au choix : comme seul ami, comme ami propriétaire ou comme invité permanent. C’est à cette époque qu’il rencontra Tricia, la jolie rousse de Newry qui après un parcours amoureux pittoresque et compliqué allait devenir sa femme, et par conséquent, une de mes meilleures copines. Elle m’avait surnommé quelques fois « the Judge », car Liam nous avait fait comprendre que mon avis sur la poursuite de leur relation serait décisif. Quoiqu’on en ait ri depuis, ce fut la première et la plus grave engueulade que nous eûmes : je ne voulais à aucun prix de cette responsabilité et lui, il voulait être assuré que le choix de son épouse ne le couperait pas de son frangin antillais, selon un scénario assez fréquent — il fallut bien le lui concéder — et qui aurait été ici aggravé par la distance. Tout à mes pensées, je survolais les nuages de la mer Celtique en me répétant le planning frénétique qui m’attendait dès que j’aurais posé le pied sur le sol dublinois. J’en avais fini avec les programmes européens, mon dernier séminaire remontait à trois ans. Désormais mon activité se partageait entre un poste de professeur à l’IUT de Bobigny et de Chargé de Mission pour le compte de la Fédération Internationale de Boxe Française. C’était la deuxième fois que je voyageais pour cette instance : après l’Espagne, je retrouvais l’Irlande. Comme à Barcelone au printemps précédent, l’objectif était de repérer des boxeurs issus d’autres disciplines — full contact, muay thaï, kick boxing – afin de les inviter à l’Open de Paris, la seule compétition officielle de Boxe Française qui permît à des combattants appartenant à d’autres fédérations de tenter leur chance et de se faire connaître. Tous les sélectionnés pourraient participer aux phases finales du Championnat d’Europe. Je devais visiter deux clubs de kick boxing, l’un à Dublin, l’autre à Galway. Cinq boxeurs m’étaient proposés, je pouvais sélectionner les cinq ou aucun. Mes rendez-vous avaient été préparés avec beaucoup de soin par Jean-Marc Ollier, Champion de France Espoir, Brevet d’Etat deuxième degré, professeur d’Education Physique et Sportive à St Kilian, le Lycée Français d’Irlande. Gant d’Argent, c’était un technicien de grande valeur qui venait de gagner une place méritée dans le championnat élite, où il avait de sérieuses chances de devenir le prochain numéro un national chez les moins de soixante-quatorze kilos. Il avait développé à St Kilian une section de Boxe Française Savate dont il faisait profiter ses élèves ainsi que des boxeurs venus de tout le pays et même d’Angleterre, à l’occasion de stages de découverte dont il avait eu l’initiative. Ils connaissaient un succès constant depuis qu’il avait eu la possibilité d’inviter des tireurs issus des nations aux palmarès les plus prestigieux, français et hollandais en tête. Il attirait ainsi la curiosité de nombreux amateurs, dont quelques-uns, séduits par les règles et la technique de la Boxe française, lui restaient fidèles. Malgré tous ses efforts, Jean-Marc n’avait jamais obtenu la création d’une Fédération irlandaise, mais il servait la cause de son sport avec abnégation. C’est ainsi que j’avais fait sa connaissance quatre ans plus tôt : je venais de gagner mon premier titre européen des mi-moyens, il m’avait contacté par téléphone et proposé d’encadrer un stage « compétition » à Dublin. Toujours prêt à m’envoler pour la verte Eirin, j’avais accepté et, depuis, nous avons une relation suivie. J’ai obtenu de la Fédération qu’elle lui délègue un supplément de budget, j’ai mobilisé plusieurs fois mes partenaires de l’équipe de France pour ses stages. Grâce à notre directeur sportif, il put participer à un regroupement en Haute-Savoie dont il garda un souvenir émerveillé. De son côté, il avait pris l’habitude d’organiser chacune de mes visites. Entre lui pour la logistique et Liam pour l’accueil, j’étais aux petits oignons. À ma demande, il avait procédé à une sélection drastique des candidats : quelle que soit leur boxe d’origine, je voulais qu’ils aient au moins dix combats à leur actif avec un solde positif de victoires. Ce jeudi-là, il était convenu que Liam me récupèrerait à l’aéroport de Dublin et que je dormirais chez lui et Tricia durant tout mon séjour, soit une semaine et demi. Il m’avait annoncé avec enthousiasme qu’ils avaient acheté un immense appartement dans une bâtisse de Montjoy Square et qu’ils étaient impatients de m’y inviter. Liam et moi devions passer l’après-midi ensemble puis retrouver en soirée Jean-Marc et sa compagne sur Temple Bar. Le lendemain serait consacré à la visite de l’IKA — Irish Kick (Boxing) Academy : tests physiques, entretiens avec les boxeurs, séances technico-tactiques, travail sur sac, vidéos de leurs combats. Puis, les gants avec moi pour trois ou quatre reprises d’opposition.
Après nous être embrassés et avoir échangé des phrases convenues : « — Qu’est-ce que je suis content de te voir, ça te va bien cette veste, t’as raccourci ta barbe, t’aurais pas un peu grossi ? Et Tricia, ça marche toujours sa boutique ? Nate te transmet plein de baisers ! Je rêve ou il ne pleut pas ? », alors que je m’attendais à ce que nous filions dans le centre-ville, Liam me proposa de boire d’abord un coup dans l’aéroport. Je n’avais pas particulièrement soif, mais comme cela semblait lui faire plaisir, nous nous installâmes dans un bar avec vue sur les pistes. Café. Liam est troublé, il hésite à commencer une phrase, s’y reprend à deux fois. Intrigué, je n’interviens pas. Il se racle la gorge, et le voilà qui me jure qu’il m’aime et essuie une larme.
— Tu ne dis rien Joe ?
— Que veux-tu que je dise ? J’attends.
— Aide-moi s’il te plaît.
— D’accord. Qu’est-ce qui ne va pas Liam, que n’arrives-tu pas à me dire ?
— Je ne peux pas rester avec toi cet après-midi.
Si ce n’était que ça. Il devait avoir une obligation, pas de problème, on se verrait ce soir. Sauf que ce soir non plus on ne se verrait pas.
— Ah... Est-ce qu’au moins je dors toujours chez vous ?
— Oui, on ne change rien. On se retrouvera sur O’Connell Street et on rentrera ensemble.
— Pourquoi on ne se retrouve pas directement chez toi ? Jean-Marc me ramènera.
— Non, nous devons rentrer ensemble. Et raconter à Tricia quelle bonne soirée on aura passée avec ton copain français.
— Liam, j’ai peur de trop bien comprendre.
De fait. Il trompait sa femme depuis dix mois et n’arrêtait pas de monter des plans pour se donner du bon temps sans se faire pincer. Je fus d’abord vexé qu’il cherche ainsi à utiliser ma venue, non pour flâner avec moi, mais pour sauter et bécoter une jeune pintade papiste. C’était une étudiante assistante sociale qu’il avait accueillie dans son service comme stagiaire. Elle était si jolie, si sensible, si… amoureuse de lui, qu’il n’avait pas pu résister.
— Je suis dingue d’elle.
— Et Tricia ?
— Je l’aime encore, mais c’est différent.
— Tu t’envoies une fille de vingt ans et, pour te donner bonne conscience, tu te persuades que tu l’aimes. Tu as beau ne pas être croyant, ton formatage catholique t’empêche d’assumer cette relation comme sexuelle. Tu devrais réfléchir à ça Liam.
— Écoute Joe, écoute,
— Oui ?
— Je ne sais pas quoi te dire.
— Tu m’en as dit pas mal déjà : tu te fous de Tricia et tu te fous de moi.
— Non ! Ne dis pas ça, vous êtes tous les deux si importants pour moi.
— Ben tu vois, ça ne saute pas aux yeux.
Et j’ai piqué ma crise. Il s’est d’abord défendu, puis il s’est effondré en larmes. Et il m’a serré contre lui. Quel étau ! Et tout mouillé en plus. Cognac. Nous avons tout repris depuis le début. Si je voyais Katheleen je comprendrais. Il devait la rejoindre et passer avec elle tout le reste de la journée ; c’était parfaitement au point puisque Tricia savait qu’il était censé être avec moi et nous attendait pour minuit au plus tard. Une étudiante ! Stagiaire !
— Tu te rends compte de ce que tu me demandes ?
— C’est parce que j’ai tellement confiance en toi que je te livre ce secret, je suis entre tes mains. Je ne pourrais pas t’empêcher de tout révéler à Tricia.
— C’est ça. Bien sûr que je vais me charger de dénoncer tes enfantillages. Je peux accepter que tu vives ta vie à ta façon, et je crois que c’est une passade, quand tu auras limé et limé et limé ta Katheleen, tu ne ressentiras plus rien et tu te demanderas comment tu as pu faire ça. Peut-être même que tu auras besoin d’en parler à ta femme. Mais tu te démerdes sans moi, je ne vais pas chez vous dans ces conditions. Tu imagines quelle sera ma situation vis-à-vis de Tricia ? Je dormirai chez Jean-Marc ou je me prendrai un B and B près de la salle de boxe.
— Non !
Livide, désespéré, il s’affala en sanglotant sur la table. Un spectacle pathétique. Comme je me retenais de rire, il tapa plusieurs fois de son poing énorme sur la table, les serveurs commençaient à s’affoler ; s’il fallait vider ce géant triste, il faudrait appeler la sécurité. Nos regards se croisent et nous éclatons de rire. Il prend mes mains dans les siennes et s’apaise comme un enfant après un chagrin. Liam, putain !
— OK je dors chez toi, mais seulement ce soir et je ne veux pas tomber sur Tricia, tu te démerdes ! Demain je me trouve une chambre.
— Merci mon ami, merci.
— Arrête de m’appeler ton ami, ce n’est pas du tout amical ce que tu me fais faire.
— Tu as raison. Bon, je dois y aller, elle m’attend.
— C’est ça, tu me déposes quand même à Dublin ou faut-il que je prenne un taxi ?
— Bien sûr que je t’emmène.
— Alors je laisse mes bagages dans ta voiture.
Je passai donc l’après-midi en compagnie de ma solitude et du soleil timide du mois de mai. Les courts immeubles en briques, leurs grilles de fer forgé, les fenêtres à petits carreaux, les fleurs le long des murs, débordant sur les trottoirs. Mes yeux s’emplissaient de souvenirs. En passant devant Trinity College, je me revis attendant cette interprète qui devait me seconder durant l’une de mes toutes premières sessions Racine. Le temps était pluvieux, il faisait sombre à cause d’une brume précoce. Elle ne venait pas. Nous n’avions pas alors de téléphones cellulaires, ne sachant comment la joindre, j’attendis, j’attendis. Je m’occupai en regardant passer les filles. L’une d’elles était époustouflante ; grande, athlétique, des cheveux — une crinière — noirs et bouclés qui se répandaient comme une cascade. Et des yeux ! Ce bleu. Ce bleu-là qui me fascina. Par deux fois elle passa devant moi. Puis, après une brève hésitation, elle m’adressa la parole, c’était Sabine, mon interprète. Près d’une heure de retard, mais je ne regrettais pas ma peine. Elle m’accompagna ensuite à chacune de mes visites d’évaluation. Sabine, ma complice. Et plus, car affinités. Cela faisait longtemps que j’étais sans nouvelles. Vivait-elle toujours ici, à deux pas de Trinity College ou était-elle retournée à Toulouse, sa chère patrie garonnaise ? À dix-huit heures, je retrouvai Jean-Marc comme convenu. Il avait réservé une table pour quatre chez un thaï qui tirait dans sa salle à St Killian. Comme j’étais en train de lui expliquer ma déconvenue avec Liam, il m’informa que son amie nous rejoindrait au cours du repas. Nous voilà donc confortablement installés dans des fauteuils de rotin, il me parle des clubs de Galway et de Dublin.
— Ici, à l’IKA, ce sont de vrais kickers. Ils ont des types qui montent. Des légers, des welters. Leur entraîneur est un copain. Il vient du karaté, il s’est formé au Kick Boxing, a gagné des combats et a repris cette salle avec l’intention d’avoir beaucoup de pratiquants et des résultats. Et ça marche. Il est emballé de te recevoir.
— Comment il s’appelle ?
— David Johnson, ça te dit quelque chose ?
— Non. Il a tiré en France ?
— Je ne crois pas.
— Mais avec un nom comme ça, c’est vraiment un irlandais ?
Il rit de ma remarque.
— Non, c’est un Jamaïcain, à côté de lui tu vas avoir l’air d’un blanc !
À Galway, il s’agissait en fait d’un club réputé de boxe anglaise, d’où étaient sortis au cours de la décennie précédente plusieurs champions, dont quelques internationaux. Jean-Marc connaissait l’équipe dirigeante et certains de ses poulains. Il avait organisé plusieurs stages de Boxe française à leur demande. Et nombreux furent ceux qui en redemandèrent. Il voulait que je m’y rende pour voir un certain Declan Townshend, un jeune très doué qui avait tout compris du réglage permanent des distances, nécessaire aux enchaînements et aux liaisons entre coups de pieds et coups de poing. D’instinct, il réussissait à faire ce que l’on mettait des mois à inculquer à d’autres. C’était en effet un très bon point, car sans cette capacité à avancer, se décaler et rompre, un tireur n’a aucune chance de remporter un combat en Boxe Française : s’il ne trouve pas la bonne distance, soit ses bras seront trop courts, soit il portera des coups avec la jambe au lieu du pied, ce qui lui vaudra des avertissements et des pénalités. C’est entre autres raisons pour cela qu’il est plus aisé pour les Boxeurs français de réussir dans les autres disciplines pieds-poings que pour des boxeurs allogènes de s’imposer en Boxe française. Je lui fis remarquer que ce jeune type ne serait pas prêt pour boxer à l’Open sans technique de jambes. Jean-Marc soutint qu’il était souple, tonique et plein de courage. Et très méchant, un pitbull. Qu’il ferait tous les efforts pour apprendre. Devant mes doutes persistants il esquiva d’un « — tu verras par toi-même de toute façon ».
Après de copieux et épicés masaman de boeuf et de poulet, il n’y a qu’une chose à faire : marcher dans les rues. Il y a beaucoup de monde dehors, effet du printemps et de l’absence de pluie, dont les gens, ici, savent profiter. Au pas lent de la plupart des personnes croisées — étudiants, couples, personnes âgées, touristes — on sent que l’heure est au vagabondage. Comme eux, nous vaquons sans trop décider où nos pas nous mèneront. L’amie de Jean-Marc se nomme Maureen. C’est une brunette boulotte, assez mignonne, vêtue comme une lycéenne baba. Elle est timide et n’est sortie de sa réserve que lorsque j’ai évoqué Sabine. Elle la connaissait bien pour avoir vécu pendant deux ans sur le même palier qu’elle, à la Résidence Universitaire. Elles avaient d'ailleurs été assez proches en raison d’amis communs, un groupe d’étudiants français inscrits en littérature irlandaise. L’interprétariat était pour Sabine un moyen de financer ses études et son logement, plus qu’une ambition professionnelle. D’après les dernières nouvelles reçues par Maureen, elle avait passé un concours à la Direction des musées du ministère de la Culture. L’air est doux et devient frais, car ici jamais la mer ne se fait oublier. Jean-Marc me propose de découvrir Padraig’s, un pub appartenant depuis des générations à une famille de boxeurs et fréquenté aujourd’hui par des journalistes et des artistes. Le lieu est à la fois désuet par son décor et branché par sa clientèle. Boiseries vertes et rouges délavées, peintes d’antiques réclames, miroirs monumentaux au tain écaillé, chaises cloutées, zinc couvert de cicatrices, cuivre des leviers à pression. Nous avons du mal à entrer, il faut jouer des coudes pour accéder au bar et y déguster une première bière en surveillant qu’un coin de table se libère. Les plateaux chargés de pintes passent au-dessus des têtes, à chaque mouvement on bouscule quelqu’un et l’on en récolte un sourire. C’est un endroit chaleureux, bouillonnant, populaire, bruyant. Sur les innombrables cadres de photos jaunies, parfois dédicacées, sur les affiches délavées il n’est question que de boxeurs et de combats fabuleux : Jimmy Carson, Wayne Mac Cullough, Kevin Mac Bride. C’est pour cette Irlande-là que je reviens toujours. Mes meilleurs souvenirs sont attachés à des pubs. C’est indissociable. Ce sont des rencontres, des conversations animées. La curiosité pour son voisin de comptoir. C’est aussi boire sur la tournée d’un inconnu et à son tour régaler la cantonade. Ce sont des rires, des éclats de voix, parfois des sanglots. Et bien sûr, des chansons. Chansons en solitaire écoutées avec respect et applaudies avec enthousiasme, chansons à deux ou trois entonnées discrètement puis s’imposant crescendo. Chansons reprises par toute la salle : Chieftains, Bothy Band, Clancy Brothers, Pogues. Ou, comme ce soir-là, la plus belle des constest songs, « We shall over come », un frisson, une communion. Jean-Marc n’est plus parisien, je ne suis plus martiniquais, nous sommes irlandais et « fiers de l’être » ! Grâce à quelques textos, Liam nous retrouve. Comme il a une descente en proportion de ses cent vingt kilos, il rattrape sans difficulté notre score de Guinness. Il affiche la mine ravie de celui qui vient de connaître la langueur de câlins illicites. Les présentations sont rapides, nous nous jetons sur une table alors que ses occupants ne sont pas encore tous levés. Le malaise entre Liam et moi est perceptible ; il est péteux et moi je lui fais la gueule ! Je m’adresse à Jean-Marc et Maureen, je m’intéresse à eux. Mon vieux copain est malheureux comme un chien. Je fais le tour de la table, me campe derrière lui et pose mes mains sur ses épaules que je malaxe plus que je ne les masse, de plus en plus fort, j’essaye de lui faire mal.
— Liam, Liam … Tu me gonfles!
— Excuse-moi, répond-il toute honte bue.
— Tu t’es bien éclaté au moins ? Je continue mon massage.
— C’est plus que ça, c’est une relation sublime, c’est…
— Arrête, reconnais que tu as tiré un bon coup et ne nous emmerde pas avec ton sentimentalisme de supermarché.
Il essaie de me donner un coup de coude, je lui tords l’oreille. Il pousse un cri disproportionné. Ça fait rire les clients. Maureen est intriguée par cette amitié sadique. Je retourne à ma place et quand je suis revenu face à lui, il avoue « c’est mérité ». Et la salle qui avait suivi notre petite exhibition repart de rires abondants. Quand il n’était pas pétri de culpabilité, Liam était le type idéal avec qui sortir au pub. Je m’efforçais de passer sur notre querelle afin de ne pas gâcher la soirée, de ne pas inhiber sa faconde. De plus, j’étais un peu fatigué, l’alcool aidant, je relâchai la pression et Liam se décontracta. Il connaissait tout le monde, toutes les cinq minutes quelqu’un venait lui taper dans le dos. C’était un Dubliner pur jus, truculent, volubile, à la tristesse paradoxale, la larme facile, une mélancolie chronique cachée derrière les braillements de sa grande gueule, ses rodomontades. Le participant posé et réfléchi du séminaire libérait alors un tempérament extraverti qu’il cachait bien, sauf dans les pubs. Il avait travaillé aux docks du grand canal à l’époque où le virus du travail social couvait en lui, mais ne s’était pas encore déclaré. Entré sur dossier à l’Institut des Sciences Sociales de Rathmines House, écumeur des lieux nocturnes chics de Dublin 2 autant que des boîtes mal fréquentées de Kildare Street. Expatrié dans le Westmeath il avait fini par retrouver son centre du monde, là où son cœur battait au rythme de son île, de toutes les rébellions. Il se met en tête de raconter à Maureen et Jean-Marc comment nous nous sommes rencontrés. Puis, ayant trouvé un auditoire captivé, il offre une version légendaire de mon combat contre Sofiane Ben Charifi à Amsterdam. Huit ans déjà. Il avait fait le déplacement pour me voir, car je lui avais dit au téléphone que j’avais peur. Mon adversaire était expérimenté, numéro un néerlandais, champion d’Europe en titre et moi je sortais du Championnat de France Elite. Je n’avais que seize combats (une défaite, quinze victoires, onze par KO), et la presse spécialisée me promettait un calvaire. Dire que sa venue m’avait donné du courage serait excessif, mais à tout le moins, il m’apporta une motivation supplémentaire à tenir les six reprises de deux minutes trente que devait durer ma punition… Liam est un conteur talentueux, il pose le cadre, les enjeux. L’ambiance, la tension, il les revit, il les partage.
— L’Arena d’Amsterdam, c’est plus qu’une salle, c’est un cirque, les gens veulent du sang, c’est terrible. J’ai failli partir à peine arrivé ! Bon, je suis resté, mais vraiment je me demandais ce que je faisais là. Cette violence annoncée, les hurlements des spectateurs. Le cinéma de certains tireurs pour impressionner leurs adversaires et le public. Tu te souviens Joseph, dans ton vestiaire, je t’ai dit « — je viens de comprendre ce que tu fais comme sport, je veux que tu arrêtes tout de suite ! »
— Tu étais déjà fin psychologue, à quinze minutes du gong, tu m’encourageais en me décrivant une foule sanguinaire et survoltée, des combattants transformés en gladiateurs…
— C’était pour te stimuler au contraire ! Bref, ton coach a voulu me virer, c’est toi qui as insisté pour que je reste. Vous savez quoi ? J’ai pu aller dans son coin, mais fallait que je la ferme et ça, c’est pas facile pour un irlandais, émotifs comme nous sommes.
— Moi aussi il m’est arrivé de pouvoir être dans le coin de JM, faut reconnaître que c’est une sacrée expérience, intervint Maureen.
— Le Sofiane là, tout le monde disait qu’il était affûté, bon moi je l’ai trouvé gras pour un super-légers, mais j’ai rien dit ; à l’époque j’y connaissais rien. Joe était mieux proportionné.
— N’empêche qu’il avait des grands bras et des grandes jambes et qu’il était ainsi maître de la distance et du centre du ring.
— Oui, mais on s’en fout ! Car ce qui arriva c’est que Joe, ici présent, l’a envoyé au tapis juste à la fin du premier round : une liaison gauche droite gauche dans le buffet, suivie d’un fouetté jambe avant en pleine gueule. Je le connais par cœur, car j’ai vu et revu la vidéo.
— Moi aussi je l’ai vue, dit Jean-Marc, c’était fort. Et je sais que tu as placé cette combinaison à d’autres mecs. En fait, tu décales et tu reviens avec la jambe avant ?