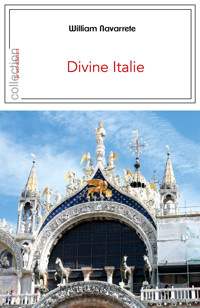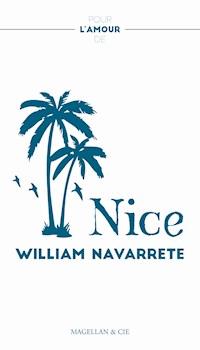
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une ode à la ville de Nice par l'un de ses enfants adoptifs.
William Navarrete, écrivain cubain exilé en France, auteur de deux romans remarqués publiés chez Stock, exprime sa gratitude à Nice qui l’a « recueilli » au soir de l’exil, quand la douleur était forte. Au point de faire sienne la devise de Romain Gary : « Ma chère ville de Nice, presque natale. » Il en décrit avec sensibilité les qualités, les beautés, les humeurs, et quelques travers !
Laissez l'auteur vous guider par-delà les charmes de la baie des Anges pour en découvrir tous les secrets.
EXTRAIT
J’ai toujours voulu rendre à Nice ce que Nice m’avait donné : la sensation de me sentir un peu comme chez-moi. Conscient de mon départ sans retour, j’avais quitté Cuba pour Paris peu de temps auparavant. Décidé à ne pas faire marche arrière, j’avais pris pour tout bagage ma jeunesse et la ferme intention de reprendre ma vie, coûte que coûte, ailleurs. Là où personne n’essaierait de m’empêcher d’être libre…
À PROPOS DE L'AUTEUR
William Navarrete est un écrivain, traducteur et critique d'art né à Cuba en 1968 et naturalisé français. Il est établi en France depuis 1991 et diplômé en histoire de l'art, littérature et civilisation hispano-américaine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Odette Balducci et à Pierre Bignami, tous deux Niçois.
Je leur dois mes premiers pas dans la ville.
« Ma chère ville de Nice presque natale. »
Romain Gary, Chien Blanc
« Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre. »
Charles Baudelaire, La beauté
« Chaque matin, pieds nus sur ma terrasse,
le parfum des jasmins m’étreint
et m’offre la gratitude de remercier
pour la grâce d’aimer. »
Olympia Alberti, Divines empreintes
AVANT-PROPOS
J’ai toujours voulu rendre à Nice ce que Nice m’avait donné : la sensation de me sentir un peu comme chez moi.
Je garde encore le souvenir de mon premier séjour au début de l’hiver 1992. Au départ d’Orly, l’avion d’Air Inter avait survolé les Alpes couronnées de neige avant de se poser en frôlant avec ses grosses roues les crêtes des vagues. La vue, avec d’un côté la mer et de l’autre les sommets recouverts d’un manteau blanc, était époustouflante.
Conscient de mon départ sans retour, j’avais quitté Cuba pour Paris peu de temps auparavant. Décidé à ne pas faire marche arrière, j’avais pris pour tout bagage ma jeunesse et la ferme intention de reprendre ma vie, coûte que coûte, ailleurs. Là où personne n’essaierait de m’empêcher d’être libre. La nostalgie n’était donc pour moi que l’affaire de quelques bons moments du passé, peut‐être l’odeur d’un fruit introuvable en Europe ou la voix envoûtante d’une chanteuse à la mode me parvenant, que je le veuille ou non, depuis un poste de radio quand je marchais dans les rues de La Havane. La nostalgie ne peut se nourrir que de bonnes choses. Mais ces « choses » s’éclipsaient tout de suite dans la mesure où ma seule envie était de quitter le prétendu paradis qu’on voulait me léguer dans l’île.
En peu de temps, j’avais déjà oublié la mer. Elle m’avait encerclé, coupé les ailes depuis ma naissance. Ses eaux bleues avaient été notre meilleur gardien, celui qui, spontanément, sans que personne ne le lui demandât, se prêtait à nous surveiller, à nous enfermer, à nous contrôler avec le zèle d’un chien de garde. La mer était un tyran qui nous caressait parfois la peau, comblait nos pores de sel, peut‐être dans le but de se faire pardonner. Je l’aimais tout en la dédaignant. Je la craignais surtout et, en bon insulaire, la respectais. Scruter l’horizon. Imaginer qu’au‐delà de cette ligne parfaite existait un monde interdit, le seul et unique paradis vrai car défendu. Cracher sur ce mur d’eau infranchissable me libérait de mon dégoût, de ma claustration, de mon impuissance. La mer avait réglé ma vie. Elle m’étouffait. Et j’ignorais que je l’aimais.
Soudain elle apparut devant mes yeux. La voiture m’emmenant au centre de Nice entama, depuis le petit port de Carras, cette Promenade mythique que je n’appelais pas encore « la Prom’ », comme les Niçois. Devant mes yeux, étalé sur mon passage, les mille et un éclats argentés des flots, le contour sensuellement délicat du rivage, en communion parfaite avec l’azur de la baie.
Au cas où le doute persisterait, je cherche mes premières impressions de Nice dans mon journal de cette époque. Les mots s’empilent, deviennent recurrents. Mon langage est admiratif. Je ne parvenais pas à exprimer tout mon bonheur : apabullante (impressionnant), regio (royal), mortal (top), sublime (id.)… Que de mots en castillan et en argot cubain, une litanie pour essayer d’apprivoiser la beauté que m’offrait mon premier séjour sur la Côte !
J’ai souvent entendu dans mon entourage parisien cette phrase : « Nice, j’aime pas. C’est une ville de vieux. »
Claquemurés dans des idées préfabriquées, les détracteurs de la ville répètent quelque chose qu’ils ont probablement entendu sans y avoir jamais mis les pieds. Nice suscite autant d’admiration que de clichés. Comme toutes les villes touristiques, elle s’invente des masques pour se vendre. Mais, quand on s’y promène pour la première fois, elle se dérobe aussitôt aux a priori. La ville apparaît lumineuse, colorée, joyeuse dans la splendeur de ses vieux murs aux tons chauds et clairs. Les bleus ravissants, les rouges vifs, les jaunes éclatants sont liés au sentiment d’épanouissement. Les rayons de soleil font luire les dorures et l’or des ornementations. Le climat semble épicer le bonheur de ses habitants.
« Je m’en tiendrai à Nice comme à un fragment de fatalité », écrivait Nietzsche à son ami Peter Gast.
Moi aussi !
TOUCA PAS LOU CASTEU
C’est le meilleur belvédère de Nice. Par beau temps, le panorama s’étend du massif du Mercantour à l’Estérel. C’est aussi l’endroit qui porte un nom plus trompeur : « Château. » Les visiteurs le cherchent en vain. Certains s’en vont même déçus de ne l’avoir jamais vu. D’autres, au bout de quelque temps de recherche infructueuse, finissent par comprendre. Pourtant – on les entend se plaindre –, il est bel et bien indiqué un peu partout ! Les signalétiques sont sans équivoque : « Colline du Château », « Parc du Château », « Montée du Château ». On soupçonne les Niçois de croire qu’il continue à être le gardien de la ville, qu’il joue encore à la protéger des intrus et des envahisseurs. Certains affirment même que sa masse, autrefois imposante, empêcherait le soleil de taper trop fort sur les étalages des marchands du cours Saleya. Moi aussi, je le crois.
On dit qu’au‐delà de la mort l’âme abandonne la matière à laquelle elle a été liée pour traîner, virevolter, survoler les lieux que, de leur vivant, les corps habitaient. Ce château était bien le corps d’un géant. Démesuré, il fut la sentinelle qui veillait sur la ville, celui qui ne somnolait jamais. Du haut des quatre‐vingt‐trois mètres d’un promontoire en roche calcaire, il surplombait la baie des Anges et fut assiégé à plusieurs reprises. Sa mission était de sauvegarder, d’abord le castrum confiné à la superficie de la plate‐forme, plus tard la ville basse à ses pieds, sur la rive est du Paillon. Une fois, il y a bien longtemps, on a voulu le raser. Les hommes se sont acharnés en le démantelant pierre par pierre, mais il n’a jamais laissé son âme s’éloigner.
Né sous les Ligures au XIe siècle, avant de devenir une possession du comté de Provence, puis une forteresse aux confins de l’État savoyard en 1388, le château eut une histoire mouvementée. Après quelques va‐et‐vient entre les mains des Grimaldi et des Capètes d’Anjou‐Sicile, l’aigle rouge symbolisant l’emprise d’Amédée II, dit « le Rouge », sur Niçe, flotta pendant plus de trois siècles sur ses bastions et ses tours crénelées. François 1er et son allié turc Soliman le Magnifique l’assiégèrent en 1543. Louis XIV l’occupa en 1691, puis, craignant son rôle de position stratégique sur le seul débouché méditerranéen de la Savoie, ordonna de le détruire à l’explosif. Murs et tenailles, bastions et cornes ont sauté peu de temps après la capitulation de la citadelle en 1705.
Les indications données par Paul‐François de Lauzières d’Astier, directeur des fortifications et responsable des travaux, notées dans le cahier des charges, ne laissaient aucun espoir : « L’entrepreneur devra ouvrir les trous de mine au niveau du rocher ou terrain sur lesquels les murs sont assis, c’est‐à‐dire qu’il commencera par la première pierre de fondation afin que rien ne reste. Les murs seront renversés jusqu’aux fondations, ainsi que le revêtement des fossés. Les souterrains seront démolis et les terres du château, de la citadelle et du glacis seront brouettées jusqu’à cinq relais de distance… Il sera pratiqué de même pour le rasement du corps de la place et des bastions de la ville. »
La ville redevenue italienne huit ans plus tard, son colosse de pierre n’y était plus. Ce fut l’un des ouvrages militaires les plus admirables de l’arc alpin. Un amas de pierres demeura à l’endroit où se trouvaient jadis le premier temple, les remparts, les tours de guet et des bastions considérés comme inexpugnables.
Le lieu entra pour toujours dans l’imaginaire populaire. Alors que les touristes doutent de son existence, tout en cherchant ses traces dans les fouillis de pierres autour des soubassements de l’ancienne cathédrale médiévale Sainte‐Marie, les locaux, eux, continuent de l’évoquer par son nom : « le château », comme s’il dressait sa fière allure en haut de la colline au‐delà de sa mort.
Il faut dire que les gravures d’antan le représentent en superbe forteresse, si imposante qu’on a du mal à la replacer mentalement dans l’espace occupé de nos jours par le jardin paysager dessiné en 1828, aux temps du roi de Sardaigne Charles‐Félix, lorsqu’il céda le terrain à la Ville à condition qu’elle y conçût un espace réservé aux flâneries des habitants. Parmi ces illustrations, la plus ancienne date de 1543. On la doit à Eneas Vico et elle s’intitule Siège de Nice par les Français et l’escadre turque commandée par Khaïr-ed-Din, « Barberousse ». Du château, elle ne laisse pas apparaître grand‐chose car la perspective est dessinée depuis la mer et met plutôt en valeur les deux flottes alliées et les murailles de la citadelle.
Une autre gravure, celle d’I. Laurus (1625), révèle en détail la configuration du site. On comprend alors que la place d’armes – l’endroit où l’artiste plaça cinq canons en direction de la mer – correspondait à peu près au plateau actuel, l’espace central le plus dégagé de la grande pelouse du jardin.
Les vestiges du château sont nombreux. Toutefois, il faut se donner la peine de les chercher. Le plus visible n’est qu’une reconstitution de 1825 de l’une de ses tours, celle de Saint‐Elme (par la suite Clerissi, puis Bellanda en 1844), s’avançant sur le versant sud‐ouest de l’éperon rocheux et donnant sur la plage de Castel et le début du quai de Rauba-Capeù (« vole chapeau », en nissart). Plus au sud, la tour de l’ancienne place d’armes, reconstruite elle aussi, constitue l’un des plus beaux miradors de l’arrondi majestueux de la baie des Anges. Côté nord du parc, dissimulés par les arbustes, quelques lambeaux des remparts sont encore là. Finalement, en gravissant la colline par n’importe laquelle des montées, on pourra observer des pans de murs, un passage voûté en chicane et même l’impact d’un boulet sur le parement de l’une des courtines.
Aux contestations des incrédules vint s’ajouter le doute sur l’existence de l’un des personnages clés de son histoire, l’héroïne niçoise par excellence, Catherine Ségurane, celle qui redonna courage aux assiégés lors de la fâcheuse attaque des troupes franco‐turques en 1543. On prétend qu’en arrachant le drapeau à l’ennemi, elle s’essuya avec le tissu et, en dévoilant ses seins, provoqua le départ des musulmans de la coalition. C’est la raison pour laquelle Menica Rondelly, défenseur de la langue nissarde et des lieux historiques de la ville, exaspéré par tant de malentendus, voulut la faire entrer une fois pour toutes dans les pages de l’histoire. Le bas‐relief inauguré en 1923 en contrebas de la colline, rue Sincaïre (en face de l’église Saint‐Augustin), est le résultat de cette démarche. Sur le dessin, l’héroïne brandit l’étendard ottoman arraché. Elle porte dans sa main droite le battoir à linge, outil essentiel à son métier. La stèle perpétue ainsi la mémoire de cette héroïne, bugadiera (lavandière) de son état, et fait fi de deux témoins oculaires des événements – l’historien Jean Badat et Pierre Lambert, président de la Chambre des comptes au service de la Maison de Savoie – qui ne la mentionnent pas dans leurs récits. Elle est un palimpseste tendu entre le mythe et l’histoire officielle.
Cet endroit au charme désuet est resté intact depuis plus d’un siècle. Depuis le boisement du site – tel qu’il a été prévu par le naturaliste Antoine Risso et ses successeurs, François Bottieri et le baron Louis Milonis de Touet –, de nombreuses espèces exotiques ont survécu. Des générations entières de Niçois sont montées au château pour se reposer sur le gazon, pique‐niquer sous les oliviers ou simplement se balader entre les ormes et les frênes à fleurs. Les amoureux dissimulent leurs ardeurs dans les recoins les plus reculés. Joueurs de pétanque, apprentis acrobates, adeptes du yoga, se donnent rendez‐vous sous les pins parasol et les chênes verts de la colline. Les étrangers profitent du spectacle qui s’ouvre à leurs yeux, avant de poser devant la cascade artificielle achevée en 1887 et alimentée en eau de la Vésubie. Les plus fainéants se rendent à la buvette du sommet – le meilleur point de vue sur les toits de la vieille ville – à bord du petit train touristique.
Mais, début avril 2016, le journal Nice-Matin se fit l’écho d’un projet de réaménagement du château, annoncé par la municipalité. On évoqua l’installation d’un ascenseur panoramique en verre, une autre conception de la grande esplanade et la construction d’une passerelle autour du site archéologique pour faciliter la compréhension des vestiges de l’ancienne citadelle.