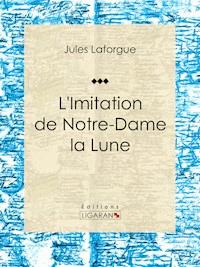Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Mes livres. Oeuvre de littérature et oeuvre de prophète des temps nouveaux. Un volume de vers que j'appelle philosophiques. Sans prétention. Naïvement. Je croyais. Puis, brusque déchirement. Deux ans de solitude dans les bibliothèques, sans amour, sans amis, la peur de la mort. Des nuits à méditer dans un atmosphère de Sinaï."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je voudrais trouver des pensées belles comme des regards. Malheureusement ma nature répugne au mensonge, qu’il doive être bleu ou noir.
J.L.
MES LIVRES.– Œuvre de littérature et œuvre de prophète des temps nouveaux.
Un volume de vers que j’appelle philosophiques. Sans prétention. Naïvement. Je croyais. Puis, brusque déchirement. Deux ans de solitude dans les bibliothèques, sans amour, sans amis, la peur de la mort. Des nuits à méditer dans une atmosphère de Sinaï. Alors je m’étonne que les philosophes qui exécutent quotidiennement l’idée de la justice, les idoles religieuses, et métaphysiques, et morales soient si peu émus, à croire qu’ils ne sont pas persuadés de l’existence de ces choses. Puis, étonnement qu’il y ait dans notre génération de poètes si peu qui aient fait ce livre. Leconte de Lisle pas assez humain, trop élevé au sens bourgeois, Cazalis trop dilettante, Mme Ackermann pas assez artiste, pas assez fouillée, Sully-Prudhomme trop froid, trop technique, et les autres l’accidentel, seulement. Et alors je fais naïvement ce livre – cinq parties – Lamma sabachtani, Angoisses, Les poèmes de la mort, Les poèmes du spleen, Résignations : l’histoire, le journal d’un parisien de 1880, qui souffre, doute et arrive au néant et cela dans le décor parisien, les couchants, la Seine, les averses, les pavés gras, les Jablochkoff, et cela dans une langue d’artiste, fouillée et moderne, sans souci des codes du goût, sans crainte du cru, du forcené, des dévergondages cosmologiques, du grotesque, etc.
Ce livre sera intitulé : Le Sanglot de la terre. Première partie : ce seront les sanglots de la pensée, du cerveau, de la conscience de la terre. Un second volume où je concentrerai toute la misère, toute l’ordure de la planète dans l’innocence des cieux, les bacchanales de l’histoire, les splendeurs de l’Asie, les orgues de barbarie de Paris, le carnaval des Olympes, la Morgue, le Musée Dupuytren, l’hôpital, l’amour, l’alcool, le spleen, les massacres, les Thébaïdes, la folie, la Salpêtrière.
Puis un roman, tout d’analyses et de notules psychologiques. Un personnage et quelques comparses. C’est une autobiographie de mon organisme, de ma pensée, transportée à un peintre, à une vie, à des ambitions de peintre, mais un peintre penseur, Chenavard pessimiste et macabre. Un raté de génie. Et vierge, qui rêve quatre grandes fresques : l’épopée de l’humanité, la danse macabre des derniers temps de la planète, les trois stades de l’Illusion. Vie malheureuse, pauvre, sans amour, spleen, tristesse incurable de la vie et de ses saletés, s’analyse pour se trouver des symptômes de folie et finit par le suicide.
Et alors mon grand livre de prophétie, la Bible nouvelle qui va faire déserter les cités. La vanité de tout, le déchirement de l’Illusion, l’Angoisse des temps, le renoncement, l’Inutilité de l’Univers, la misère et l’ordure de la terre perdue dans les vertiges d’apothéoses éternelles de soleils.
On désertera les cités, les hommes s’embrasseront, on ira sur les promontoires vivre dans la cendre, tout à la contemplation des cieux infinis, tout au renoncement. On organisera des Concerts infinis d’orgues vastes comme des montagnes qui souffleront des ouragans de lamentations avec leurs tuyaux montants, énormes comme des tours, dans les nuées qui courront, bousculées par ces lamentations. Et la planète en deuil laissera dans l’azur comme un sillage de lamentations.
LE SAGE DE L’HUMANITÉ NOUVELLE. CATÉCHISME PESSIMISTE.– Absurdité des remèdes. Deux solutions proposées : Bouddha, l’Inde vénérable – Schopenhauer, Hartmann.
Pas de remède absolu, universel, qui supprime le mal universel. Rêves de dilettantes : l’atrophie du vouloir, l’insaisissable présent partout sous les mille variétés de l’illusion, désir, appétit sexuel, etc.
Jamais on n’atteindra l’essence même de la Volonté, le principe mystérieux, insaisissable qui circule partout. Il faut se contenter du suicide matériel et du renoncement.
Tuez votre existence individuelle, matériellement ou intellectuellement mais ne songez pas à tuer le Vouloir universel. Travaillez à l’art et à la science, multiplication des moyens d’extase, de contemplation, la seule trêve au supplice de l’Être.
Le grand bienfait des religions est d’avoir bercé la douleur et les effrois de l’homme d’un au-delà d’éternelle douceur. Aujourd’hui, qu’on y fasse attention, cet espoir s’en va, on ne croit plus. Cela peut amener la révolte des malheureux, tous les bouleversements. Il faut se hâter de multiplier le remède du renoncement, entretenir l’homme de l’éternel pour qu’il ne fasse pas attention à sa misère éphémère.
Par la contemplation sereine, esthétique, scientifique ou philosophique (ces deux dernières sont les plus sûres de quiétude) on échappe à soi, on est affranchi pour un instant du Temps, de l’Espace et des Nombres, on meurt à la conscience de son individualité, on monte, on atteint à la grande Liberté : – sortir de l’Illusoire.
Le vouloir objectivé et vivant par chaque individu : une chaîne. On tue pour un moment le vouloir individualisé qui est en nous. On meurt au vouloir. Le vouloir est souffrance ; trêve à la souffrance, non-être, Dieu.
Il n’y a pas de pauvre ni de riche, de phtisique, ni d’hypertrophique, de soucis, d’estomac, ni d’esclave du génie de l’Espèce, de cerveaux en mal d’absolu, d’extase, de Dieu.
Ce remède, je ne le sais que trop, ne peut être, du moins encore, qu’à la portée d’une élite. Pour les autres, la charité, l’amour, l’instruction, l’émancipation, maintenir doucement dans l’illusion, ne provoquer le déchirement que lorsqu’on sait que l’individu peut être mûr pour cet état et peut arriver au renoncement « η ιερα νοσος ».
Avant d’arriver au renoncement, il faut souffrir au moins deux ans : jeûner, souffrir de la continence, saigner de pitié et d’amour universel, visiter les hôpitaux, toutes les maladies hideuses ou tristes, toutes les saletés, se pénétrer de l’histoire générale et minutieuse, en se disant que cela est réel, que ces milliards d’individus avaient des cœurs, des sens, des aspirations au bonheur ; la lire avec sympathie (le premier don du sage) comme Carlyle ou Michelet.
Voir toute la douleur de la planète, éphémère et perdue dans l’universel des cieux éternels, inutile, sans but et sans témoin, se pénétrer de l’inutilité du Mal et de la vanité de tout, de la Réalité universelle. Désirer l’Illusion. Arrivés là, les uns jouissent, hommes par excellence, ou ont recours au suicide matériel ; les autres, sages, philosophes, artistes, curieux, vivront et arriveront au renoncement. Nous laissons les indifférents de côté comme des cailloux, les félicitant de leur grâce d’état, en passant. Pitié, sans oublier que le plus haut degré de souffrance est au plus haut degré de sensibilité.
Arrivé au renoncement, le sage devra éviter le grand écueil : se cristalliser dans son égoïsme d’émancipé de l’Univers. Il devra jeûner, observer une rigoureuse continence, travailler, partager son cœur, saigner pour toute l’Humanité. À certaines heures, méditation : se représenter vivement par l’imagination toutes les souffrances qui crient en ce moment sur la terre.
Résignons-nous à ne rien savoir, à ne rien pouvoir sur l’essence universelle, sur la nécessité résignons-nous à nos misères, soulageons-les comme nous pourrons, et arrivons au renoncement par la conscience de la vanité éphémère de notre planète et la contemplation de l’affolement solennel, universel, éternel et sans cœur des torrents d’étoiles.
LE BONHEUR.– Le bonheur – tous nous le voyons réellement dans l’avenir et nous en rappelons réellement des échappées dans le passé, on n’a jamais entendu personne, nul n’a jamais pu se dire : « le voici, j’en ai, en ce moment dans le présent ». C’est le contraire de la sensation de vivre. Et en fin de compte nous n’aurons pas été heureux ; nous n’aurons pas vécu.
LE POINT CULMINANT. Nous n’avons pas, même malades, c’est-à-dire par définition en voie de mourir, la moindre idée du temps qui nous reste à vivre. Et cependant, il est certain que notre fond inconscient en a le sentiment, et cela depuis notre premier jour, puisque tout est fixé d’avance, et pour cette conscience qui veille et sait, notre existence se divise en deux moitiés : celle où elle voit l’avenir, celle où elle a une moitié de passé. – Oh ! le jour, l’heure summum de cette moitié !
Que chacun de nous songe aux êtres chers et connus près, et fasse le calcul et cherche ce qui se passa le jour où il eut sa moitié, le sommet – il verra !
LE CHOIX DE LA VIE (nirvanâh ou amour). – En fait de religion, de vie organisée, systématique, il n’y a de choix qu’entre deux : ou bien vous voulez le néant, le repos – ou la vie. Le Repos – ou la bataille aveugle, substratum du Progrès indéfini sans but ni sanction, par la vertu de la Sélection naturelle. Si votre religion est le néant, la voie est toute tracée, – nirvana – opium de la marmotte – suicide – Platon Karataïeff. – Si votre religion veut la vie, elle doit avant tout prendre son centre, sa clef, sa lumière dans ce qui est l’essence de la vie, de sa continuation – etc. : l’amour des sexes.
Or l’amour est chose inconsciente, universellement imprévue et inenregistrable en tragique, seconde-vue, etc… Donc laissez le faire, laissez le passer ; l’Amour inconscient souffle où il veut. « Aimez et laissez faire le reste. »
PEUR ET RESPECT DE LA MORT.– Cette frousse réflexe, devant la Mort – qui fait que nous sanglotons, secoués de pardons, devant un ennemi agonisant, que nous trouvons génial un artiste qui vient de trépasser, et notre mère une sainte, etc. – Quand est-ce que nous nous montrerons adéquats à la valeur des phénomènes, et vivrons-nous justes de ton ?
LA PENSÉE DE LA MORT ET LA VIE COURANTE.– Je cesserai de vivre :
aussi carrément que ce moustique qui vient de se brûler à ma lampe,
Je cesserai de vivre aussi carrément que vient de commencer à vivre ma nièce Juliette née la nuit dernière.
– C’est étonnant comme ça me laisse froid.
Cent cinquante francs pour payer mon terme demain me toucheraient davantage.
Ce qui prouve que la créature humaine a beau se monter le coup, elle est organisée pour le bonheur, d’autres disent l’Illusion.
L’ENNUI.– L’action est le débouché naturel de l’être. – Le rêve, même non teinté d’espérance, est encore de l’action. – Mais quand tout vous répugne excepté vous pelotonner en vous-même un dimanche, en écoutant le bruit de la rue (gens revenant de vêpres !) et que pelotonnés en vous-mêmes, vous n’avez plus de vie que pour ne pas voir le seul hôte que vous y trouvez c’est-à-dire la Mort… alors c’est l’ennui. Nous n’avons pas de goût à vivre – et nous ne pouvons pas vivre de l’idée de la mort, bavarder avec cette idée, la considérer comme l’égale universelle de la vie en intérêt et distractions et même indigestions.
Ô Ennui ! cinquième saison ! steppes désertes comme le temps (la durée). – Horloge dans une gare désertée… Célibat irrémissible !
Le temps ! le temps ! et le reste est sillages…
Ô donjons de l’ennui, tout un monde dans la mousse des créneaux.
Ennui, célibat de la Terre.
À LA DÉRIVE.– S’abandonner à cette force unique, toujours veillante, à la grande vertu curative, inconsciente, maternelle, présente partout ! (voilà l’ange gardien détaché pour chacun de nous du grand ange de l’Histoire et délégué de l’évolution terrestre détaché lui-même de celui de l’omnivers) qui fait tout sans bruit, qui m’a fait croître selon un certain type élu au moral et en forme, qui me guide, me suggère des instincts inconnus et précieux qui nous sauvent, raccommode ma chair quand je me suis blessé, qui présida aux unions bien trouvées de tous mes ascendants en vue de moi, qui donna le divin amour maternel à maman, qui me poussa à la puberté vers la jeune fille adorable, élue, me donna le sens esthétique, la moralité, l’harmonie préétablie, me garde mélancolique et attendri le long de la vie parmi les loups, et enfin qui m’a en si spéciale dilection, moi pourtant si jeune, qu’elle m’a permis de la contempler, qu’elle a soulevé un peu son voile et s’est distraite de son Œuvre éternel et infini pour se donner SPONTANÉMENT ! à moi, atome et minute et dans ce baiser de la bonne Loi m’a ravi du monde de la réflexion, du raisonnement, du calcul, des préméditations pour l’en aller à la dérive sur les jourdains de l’Inconscient où fleurissent les lotus de la Vraie moralité.
l’Univers, la historia farà da se.
FATALISME.– Comme on est bien, quel état délicieux d’existence, quand on s’est bien pénétré de la nécessité de la Fatalité universelle et minutieuse, inexorable, sans entrailles, torrent souverain des soleils, des choses, des idées, des êtres, des sentiments, des effets et des causes, étouffant sans les entendre, sans conscience sous sa clameur unique et souveraine, les plaintes de l’individu éphémère. – Berce-moi, roule-moi, vaste fatalité ! – On se laisse aller. – Votre mère meurt, vous perdez au jeu, un ami vous lâche, une femme vous accable de son indifférence, etc., vous tombez malade, la mort, est là peut-être. Tout est écrit, – à quoi bon se remuer ? – Toutes vos joies, toutes vos peines, toutes vos actions, votre santé, vos chances, tout cela sera déterminé par des causes, des circonstances. L’armée des circonstances est en marche à travers la vie ; me heurterai-je à des circonstances défavorables, saurai-je m’emboîter aux circonstances favorables ? – Rien ne dépend de moi, tout est écrit, je me laisse aller. – Je suis un brin d’herbe dans un torrent qui roule des quartiers de rocs, des arbres, des troupeaux, des toitures, etc… Je suis l’atome dans l’infini, l’atome dans l’éternel, le soupir dans l’ouragan déchaîné, une force équivalente à un souffle dans les puissances formidablement brutales du mécanisme universel. – Je ne suis rien. – Je me laisse porter, – rien ne m’étonne.
INCERTITUDE.– C’était un caractère cousu d’incertitudes. Il ne se décidait jamais. Ira, ira pas. L’aimera, l’aimera pas. Ceci est sans doute la marque d’une organisation supérieure, d’un être qui, dédomestiqué des ambiances, n’est influencé en aucun sens, ne se décide à rien et est, par conséquent, un être sur le seuil du libre arbitre.
LE MAL, DESTINÉE DU MONDE.– Une preuve que le Mal est, plutôt que le Bien, la destinée de notre monde, c’est que le bien ne se montre que par l’effort (la douleur) vers le bien, tandis que le mal arrive tout seul et le plus souvent malgré les efforts pour le prévenir. Et quand le mal et le bien se sont produits, le bien s’en va si l’on cesse un moment de l’activer, tandis que le mal est indéracinable, s’accroît si on ne le combat pas (pour l’atténuer, l’enrayer) et submerge tout – Ce monde est destiné au mal et il régnerait absolument sans la lutte incessante de l’homme, il se développerait suivant sa fatalité éternelle. Le bien est un accident produit à grand-peine par l’homme et il est si peu fait pour vivre, pour régner, qu’il disparaît aussitôt, dès qu’on ne l’entretient pas. – Un mot d’une femme célèbre ( ?) : Que de peine pour avoir un peu de plaisir ! – Réflexion : Dès qu’un homme cesse d’emplir son estomac il ne peut plus penser, être vertueux, avoir de grandes conceptions, s’élever à l’idéal – Et il n’a pas besoin de penser pour manger. Si l’on ne mangeait pas, on ne penserait pas, mais l’on peut manger sans qu’il soit nécessaire pour cela de penser. – Cela ne prouve-t-il pas quelque chose ? Que la raison ne gouverne pas le monde ?
SOLITUDE DE LA VIE.– Aux Indifférents. Un homme pendant son sommeil est transporté rapidement dans une île au milieu de la mer vaste, sous le grand ciel, seul. Le lendemain il se réveille, il se voit seul, sous le ciel au milieu de la mer bleue… Il se demande avec angoisse : où suis-je ? il court, il cherche, il réfléchit, il n’a pas de repos qu’il ne sache où il est.
Eh bien, l’homme naît, grandit ; il regarde, il se trouve sur un îlot isolé dans l’azur et emporté : cependant, il vit, mange, se reproduit, etc., et meurt, sans se demander : où suis-je ? sans s’étonner de rien.
Je vais souvent dans le monde – J’ai observé des dizaines de jeunes filles en toilette, en beauté, en leur mieux – J’en compte bien cinq, six, qui m’ont paru idéales, uniques, inaccessibles. Eh bien ! ceci va paraître un pavé d’une naïveté colossale – mais j’avais un critérium infaillible, une pierre de touche divine pour savoir si tout cela n’était que faux dehors dont elles n’étaient ni dignes ni responsables. – Je ne suis point un jeune homme beau, ni remarquable d’aspect sous aucun rapport, je ne m’étale pas ni comme manières ni comme conversation, je suis même un peu ours, et je ne m’amuse pas à rencontrer et à intriguer des regards de jeunes filles. En somme je ne suis pas remarquable ni ne fais quoi que ce soit pour être remarqué – pour qu’on me distingue il faut avoir la vue profonde, s’ennuyer des majorités, et me chercher… Eh bien ! si la jeune fille en question après avoir vu mon air et entendu ma voix ne devine pas que je suis moi, c’est que c’était une fausse alerte et qu’elle n’est pas elle. Si on ne saisit pas, tant pis.
MÉLANCOLIE ATAVIQUE AU CRÉPUSCULE.– Ce sentiment de mélancolie qui nous prend au crépuscule, – surtout en pleins champs c’est-à-dire avec pas sous les yeux et à nos côtés les bruits rassurants de la ville, de la tribu sociale.
L’atavisme de ce sentiment qui fut le plus fort, de l’homme primitif notre ancêtre – le sentiment de faiblesse devant le jour qui s’en va, de l’être nu qui a traqué et a été traqué tout le jour, et que l’obscurité épeure et envisionne.
Aujourd’hui c’est l’antique sentiment d’effroi, de faiblesse, de créature dépendante de quelque chose de plus fort là-haut : la lumière, la nuit – et la nuit est le frère (alléchant, transitionnel) de la mort – ce mystère. – C’est l’effroi qui, mêlé à l’autre sentiment de la sécurité sociale et du savoir du fond de ces choses, se change en douce mélancolie.
LE LIT.– Heureux ceux qui jouissent du lit, qui peuvent abandonner leur corps éreinté dans la fraîcheur des draps, qui dorment, qui rêvent éveillés des rêves d’amour, de gloire, de fortune, de vengeance. – Mais celui qui est seul, qui souffre, qui songe à la mort, bourrelé d’angoisse ! – et qui se lève à deux heures, qui s’en va par les rues aux maisons endormies, sur les quais, sur les ponts, qui pleure dans la Seine et qui fait se retourner les débauchés aux blêmes paupières lourdes ! Heureux qui peut jouir de son lit !
ROUTE ABANDONNÉE.– Tu n’es plus là. Et je suis comme une route désertée depuis l’inauguration du grand chemin à côté plus coupant court et plus propre, et qui n’a plus dans ses ennuis que le bonheur des ornières laissées dans sa peau tendre, mais que les averses et le temps auront bientôt effacées. – Ah ! puisque nul ne veut plus rouler sur moi, que les ronces et les haies de mes marges m’envahissent, luxurient et s’inextriquent et que je vive des petits bonheurs des feuilles, des sarments, des fourmis et des larves.
RÊVE D’ÉCRITURE.– Écrire une prose très claire, très simple (mais gardant toutes ses richesses), contournée non péniblement mais naïvement, du français d’Africaine géniale, du français de Christ. Et y ajouter par des images hors de notre répertoire français, tout en restant directement humaines. Des images d’un Gaspard Hauser qui n’a pas fait ses classes mais a été au fond de la mort, a fait de la botanique naturelle, est familier avec les ciels et les astres, et les animaux, et les couleurs, et les rues, et les choses bonnes comme les gâteaux, le tabac, les baisers, l’amour.
PAYSAGE D’ÉTÉ. – Le Soleil torride à son apogée pleure des lingots ! comme des battants de cloche, et assoiffé de brises de prairies, de parfums de cresson, il aspire les sources invisiblement, les sources des paysages ;… elles se tordaient de malaise cherchant leur destinée dans cette atroce journée ; il voit monter ces troupeaux aériens de globules et s’y rafraîchit avec un soupir, de loin, et soulagé, cesse d’aspirer et l’eau plane alors en nappes noires bouillantes de ce baptême spasmodique. En nappes noires pleines d’orage, fécondées de foudres latentes, se tordant comme un malade sur son matelas, voyageant, s’étirant, se flairant amoureuses les unes des autres, se désirant, se repoussant par peur des catastrophes finales… Les feuilles tournent comme un œil agonisant sur leurs pédoncules, les branches battent comme des artères bouchées par des chaleurs inconnues, les prairies s’assombrissent comme la roue d’un paon en courroux, comme la crête d’un coq aveuglé, comme la face des aéronautes perdus, désorbités de la planète, les vents se cherchent en inventant des prétextes inépuisablement lamentables, la créature se sent en détresse. L’eucharistie du Soleil défaillant d’un air tout somnambule a disparu. Le simoun d’amour fait sa tournée. Les pupilles s’agrandissent, les tempes sont moites et battent aux champs, des supplications s’étranglent dans les gosiers en feu, les mains s’égarent pleines de Foi, les lèvres altérées affolées de soif cherchent et vont s’abattre sur des lèvres plus altérées, plus affolées encore, plus flétries. – Ô rosée des fraîcheurs corrosives, où te délivrer ? où la bonde que battent tes flots à la faire sauter ? Pauvres mineurs ensevelis, éperdus, sans lampes, creusant le tunnel, on entend les coups de pics des pionniers de l’autre côté, plus qu’une cloison. – Deux éclairs ont sifflé, s’entrelaçant en fulgurantes vipères, la foudre a déchiré le voile du temple et l’éventail de l’averse d’amour s’abat sur les prairies haletantes comme l’épervier aux mille mailles sur l’océan calé de lingots de fidélité avec un bruit argentin d’averse sur un lac autour d’une barque perdue. Les feuilles et les yeux ruissellent, délayant l’amer des sueurs, noyant les yeux.
SOIR D’AUTOMNE AU LUXEMBOURG.– Un crépuscule frileux – les feuilles irrémédiablement brûlées de rouille semblaient s’être ramassées en tas pour se tenir au chaud. – les fines découpures des futaies squelettées par les brises noires et les averses éternelles.
Le ciel au ras était or pâle, sanguinolences dans des plaques de lilas morne et de violet sourd – vaste ceinture où se découpaient les lignes calmes des toitures à cheminées puis des deux tours St-Sulpice. – Plus haut le ciel était jonquille anémique qui montait se fondre dans du laiteux voilé qui devenait le ciel bleu pâle, et çà et là des fouettages de nuages violâtres, lie de vin, aubergine. Tout était calme, sauf, derrière des troncs entre deux basses échancrures de toits, une place rose laissée par l’agonie du soleil vaincu.
Le bassin moiré d’or tendre, avec des futaies réfléchies brisées, était plein de mille frissons en marche toujours renouvelés, – au milieu, dans la vasque soutenue de trois angelots, le jet d’eau était mort.
Et l’espace était presque imperceptiblement rempli des rumeurs confuses des rues, voitures, un clic-clac de fouet, une trompe de tramway, un aboiement de chien, impression de vie de cité lointaine.
L’heure sonna à l’horloge du Luxembourg.
Oh ! le ciel en quelques minutes était devenu très curieux là-bas à gauche – c’était de l’or comme un grand champ de blé où pleuvaient comme une averse, les hachures des nuages à ras d’horizon qu’un coup de bise égarée avait déchiquetés.
Un tuyau d’usine fumassait mollement des paquets violâtres qui montaient, s’étiraient et se fondaient.
En face c’étaient donc là les dernières curiosités, les derniers jeux du couchant royal, mais derrière c’était la nuit qui tombait, pleuvait, estompant tout, les pâleurs des statues. –
Et le gaz crépita.
Bon ! voilà que le vent assez aigre ma foi se levait…
CLAIR DE LUNE DE NOVEMBRE.– Voyez un clair de lune de novembre dans le plein enchantement d’une brume fine immobile au-dessus du fleuve large qu’on devine aux feux réfléchis et sa berge effacée d’une igné de plusieurs lieues de collines avec leurs feux mobiles.
Et là-haut la lune comme la clef énigmatique de cet enchantement immobile et qu’un souffle, semble-t-il, ferait redevenir réel et cru.
UN PARC.– Novembre, malgré les ingénieux travaux et mosaïques et rafistolements de fleurs des jardiniers dans les plates-bandes, que ce jardin était dépouillé, hérissé, carcasse, automnal vu de la grande fenêtre du salon !
Tout le long du fond du berceau, fait de poutres à jour sur colonnes espacées, aux poutres rampaient, s’accrochaient les sarments comme des ramifications de gros nerfs noirs, avec çà et là persistant encore une touffe maladive de feuilles d’un jaune serin anémique. – Deux merles sautaient, peu gais, c’était visible.
Le sol était mal balayé des tas de petites folioles jaunes des acacias.
Les marches de pierre étaient un brin verdies pour monter à la terrasse sablée où une table de fer avec sa chaise gelait sous un groupe mythologique en grès des plus poreux.
Le jet d’eau du bassin rond n’avait jamais, oh ! jamais joué aux soleils irisants, et le rond d’eau morte et glacée mirait avec une précision d’eau-forte le ciel craie sale et les futaies fines et sèches des grands arbres qui séparaient le parc de la rivière s’en allant comme en été.
PROMENADE DANS UNE RUE.– Et ma liberté d’allures et d’âme ! Mais hélas, le dilettantisme n’a son prix qu’en nostalgie. – En fait il est vide, équivoque ou débordant.
Oui, errer dans une capitale, par un fin matin de lendemain de pluie. Aller – regarder les visages de femmes, y déchiffrer la quotidienneté de leur existence et de leur destinée. – Un pensionnat distingué passe, je le regarde passer, ô délices, orgies de berquinades bizarres, mélancolie dont les objets sont tirés à tant d’exemplaires, qu’elle devient monotonie et débonnaire fatalisme.
Quelle est cette rue de province aisée ? À une fenêtre, des rideaux, un piano travaille réglé d’un métronome cette éternelle valse de Chopin usée comme l’amour – ô délices poignantes, ô bon fatalisme ! et l’on allume un cigare – Des platanes – Une bonne lavant des vitres, le tramway qui passe, – gare ! d’une porte-cochère sort une calèche découverte avec deux dames en noir se gantant. Une petite fille qui boite et tient une orange.
Et toutes ces fenêtres comme des yeux condamnées. Et l’on imagine l’ennui de la salle à manger à suspension en cuivre poli, la mesquinerie laborieuse du salon, l’immuable atmosphère de la chambre à coucher.
À une fenêtre là-haut une cage à serins.
À une autre de mansarde aussi, accoudé, un jeune homme regardant avec la conscience du terme payé.
Deux bonnes se rencontrent et causent, les bébés regardent par-dessus l’épaule, pendant cet arrêt forcé, un chien sans but.
La surprise de trouver son nom fixé à une enseigne de boutique et de bâtir des romans antédiluviens là-dessus.
À CHEVREUSE.– Le soir par la fenêtre un ciel de violet assez grand deuil, piqué de deux brillants d’argent clignotant sur la même ligne dans l’écartement de deux yeux, juste en face ; et faisant tapisserie la faction, le corps de garde des sept peupliers hauts qui massés par la nuit étaient plus des cyprès noirs que des peupliers. Le bruit était une traînée là-bas, bruit de feuilles continu si égrené, détaché parfois qu’il semblait être plutôt le bruissement métallique mais éteint des grillons, puis redevenant si feuillu qu’on opinait décidément pour le frisement perpétuel des futaies sous le lancinement des brises diverses ; oui, à preuve que ça devenait parfois presque les rumeurs des sources lointaines – cet accompagnement seul etc. En bas les piaulements très doux méconnaissables des canards semblant ou rêver ou se bécoter.
SOIR DE PRINTEMPS SUR LES BOULEVARDS.– Un soir de printemps sur un banc, grands boulevards, près des Variétés. Un café ruisselant de gaz. Une cocotte toute en rouge allant de bock en bock. Au premier, tout sombre, recueilli, des lampes, des tables, des crânes penchés, un cabinet de lecture. Au second, éblouissement du gaz, toutes les fenêtres ouvertes, des fleurs, des parfums, un bal. On n’entend pas la musique dans le grand bruit qui monte de la chaussée grouillante de piétons et de fiacres avec les passages qui dévorent et vomissent sans cesse du monde et la criée du programme devant le péristyle des Variétés. – Mais on voit danser, le long de ces dix fenêtres, des hommes en frac noir, devant blanc, tournant en cadence, tenant une femme bleue, rose, lilas, blanche, la tenant à peine embrassée, très correctement, on les voit passer, repasser, sérieux, sans rire (on n’entend pas la musique qui les fait danser). Un groupe de souteneurs passe ; l’un dit : « Mon cher, elle a fait dix francs. » – Aux Variétés, une cohue sort pour l’entracte ; et toujours l’enfer du boulevard, les fiacres, les cafés, le gaz, les vitrines, toujours des passants. Ces cocottes qui passent sous les clartés crues des cafés. – Près de moi un kiosque de journaux – deux femmes causent ; l’une dit : « Pour sûr, elle ne passera pas la nuit, et son môme qui a donné la gale au mien. » Les omnibus chargés des deux sexes tous ayant leur cœur, leurs soucis, leurs fanges.
En haut les étoiles douces et éternelles.
PAYSAGE PARISIEN.– Boulevard Bourdon – le long du canal aboutissant par un étranglement noir souterrain à la Seine fourmillante – venant par un boyau sombre aussi au-dessous là-bas de la place de la Bastille ; – des maisons se dressant isolées avec leurs cinq étages et leurs rangs de six fenêtres – au bas marchand de vin traiteur et une boutique poussiéreuse volets clos, sans indication – à vendre ? Sur le flanc droit de la maison vers le vide de l’horizon avec les éternels chantiers de bûches empilées et rangées – une vaste fresque-réclame sur fond bleu des lavoirs : un énorme et farouche hébété mousquetaire embrasse du bras droit un flacon d’insecticide Vicat et de l’autre d’un soufflet au jet palpable occit des poux, des punaises, des puces énormes vues au microscope.
En face, de l’autre côté du canal, aussi des maisons se dressant en détresse isolées cerclées de balcons avec sur un flanc du haut en bas comme montré dans une figure section verticale reliée de deux ponts vénitiens le boyau de la cour avec les fenêtres grises des cuisines couleur torchon.
Et des fabriques, des fumées lentes et noires ou fusées par jets blancs – Et le grand ciel houleux sur lequel était plus tragique une femme là-bas à un sixième venant secouer un tapis à l’angle d’un balcon.
Et la vie du canal – sur le chemin du halage, des casemates de douaniers, des tas de barriques et tonneaux – des camions qui attendent – d’autres qui arrivent, d’autres qui partent, un fouet claque.
Puis à gauche une enfilade comme une série d’accents circonflexes de dix hangars à jour continus, et dessous, dans l’eau-forte enchevêtrée des charpentes, la vie des tonneaux, des débardeurs un sac gris en capuchon, des gens qui chargent des péniches amarrées.
Il ne passait sur ce boulevard que des camions, des camions pas encombrement mais la sensation de l’encombrement car ils allaient, allaient au pas et le pavé sonnait creux à donner des coups dans l’estomac.
À L’AQUARIUM DE BERLIN.– Devant le regard atone, gavé, sage, bouddhique des crocodiles, des pythons (les ophites) etc. Comme je comprends ces vieilles races d’Orient qui avaient épuisé tous les sens, tous les tempéraments, toutes les métaphysiques – et qui finissaient par adorer, béatifier comme symbole du Nirvâna promis ces regards nuls dont on ne peut dire s’ils sont plus infinis qu’immuables.
Mais l’idéal c’est ces éponges, ces astéries, ces plasmas dans le silence opaque et frais, tout au rêve, de l’eau.
CRÉPUSCULE DE MI-JUILLET, HUIT HEURES.– Après un temps d’averse pas trop épaisse, l’eau d’un boueux verdâtre laisse aller du même train ses rides et ses moires.
Il y a trois notes uniques et monotones dans l’espace, les sifflets de la gare, les flûtis éveillés d’un merle, dans les bas feuillages de la terrasse, et des clochettes de vaches qui passent.
Tout le reste est masse immobile de coteaux, espace et ciel blafard.
FIN DE JOURNÉE EN PROVINCE.– Passé une fin de journée en province.
Ville grisâtre, soigneusement pavée, paisible.
La fenêtre d’hôtel donne sur la grande place. Je regardais une lune bête monter là-bas, éclairant spécialement cette ville comme pour me jurer que cette ville existait vraiment, dans son insignifiance.
Un allumeur de réverbère portant un bébé dans ses bras et suivi d’un chien qui avait l’air habitué à tout, et flairait les pavés comme de très vieilles connaissances.
Le réverbère ne voulait pas s’allumer.
Aussitôt, deux, cinq, six personnes s’attroupent et conjecturent ; le réverbère s’allume, les gens constatent qu’il est allumé et s’en vont à pas lents. Un seul reste. Il contemple une minute le réverbère, puis s’en va.
Oh ! vivre dans un de ces bancs de mollusques !
Mourir !… mourir.
Et la lune est ici la même qu’à Paris, que sur le Mississippi, qu’à Bombay.
DIMANCHE DE FÉVRIER EN PROVINCE.– Ces dimanches de février en province qu’aucun soleil de demain ne rachètera pour nos cœurs pleins de rancune. Ciel de cendre opaque distillant une pluie monotone grisâtre, qui moitié retombe et enflaque le sol, moitié imprègne la grosse atmosphère comme un invisible buvard qui vous pénètre.
6 heures. – On allume le gaz dans les maisons, pas encore les réverbères, les deux ou trois cafés sont pleins, étouffants de cigares économiques, on s’y arrache les journaux illustrés.
À 6 heures 1/2 les gens vont au théâtre. Les monuments découpant à leurs terrasses des statues trophéïques, prennent dans le crépuscule crotté, le ciel définitivement gâché (dimanche raté), prennent des tristesses de cheminées. Voilà qu’on entend quelques cloches d’après les vêpres disant la province bloquée sans espoir et les dimanches de vieilles filles. On a froid aux pieds. Puis la cloche impertinente d’un tramway. – La pluie devient de l’averse, l’atmosphère étant trop saturée. Les amateurs de dimanche quand même vont patauger en famille toute la nuit et rentrer n’osant supputer les avaries de leurs toilettes, et demain repeupler leurs bureaux, leurs comptoirs, leurs ateliers.
Un lundi matin blafard. Le livide sec (après la ventée furibonde de la nuit) ricane blanc au ciel où courent des nuées noires et monotones comme des huissiers. Des gens recommençant la semaine – hélant un fiacre – portant des paquets que fatigué on remonte sous le bras. – Des parapluies en réserve – Un bébé qui court contre la grille du square ballottant son petit manchon bleu sur son ventre comme une breloque maternelle.
Un couple se racontant quelque chose. – Des solitaires qui ruminent ce qu’ils viennent de vivre ou l’affaire où ils vont, les uns avec des faces optimistes, les autres ennuyées, dures, giflées. Toutes les femmes ont l’air battues à la maison, ou uniquement heureuses pour le quart d’heure de leur mise, de leur chapeau, d’une plume, d’une tournure, de leurs gants. Les cochers de fiacre ont encore les têtes les plus sages, adéquates au piétrisme de l’existence (à la situation). Tous sont non pas gifleurs ou giflés, mais les deux comme causes et effets.
APRÈS-DÎNER TORRIDE ET STAGNANTE.– Les pieds cuisent, on sent battre ses artères aux chevilles, sous le menton, au cœur, aux poignets, on doit tenir en l’air à des embrasses ses mains déjà trop gonflées et moites, le moindre dîner vous pèse, il faut défaire sa cravate, on souffle si profondément, la cigarette qui ne quitte pas le coin de votre bouche est consumée en douze bouffées, la peau trempe.
– Que je serais malheureux si j’avais des seins, et étais nourrice ! Ou si, un de ces musiciens militaires, je devais, sanglé dans un uniforme, souffler dans un trombone des Danaïdes, au jardin public. Ah ! être une mouche dans une cuisine au carrelage arrosé, en province ! Ou plutôt une éponge passive, un corail au fond de la mer, incrusté à la même place, voir le défilé de la nature sous-marine ; ou un bluet bleu, sur une faïence de Delft au-dessus d’un empilement d’étoles, dans la fraîche et toujours obscure arrière-boutique d’un bric-à-brac sur les bords de la Séquane ! ou une fleur de rideau dans le salon propret et nu d’une vieille fille à Quimper – ou un héron…
MATINS VANNÉS.– Les matins d’éreintement, de vanné de partout.
On essaie en vain de fermer énergiquement les poings, une volupté coulant dans le pouls s’en rit. – On ne sent ses jambes que dans un confus bain de lassitude, jambes s’évaporant, muscles assassinés et somnolents, on respire pesamment, comme dormant encore, les yeux clignant dans le vide.
Tout mort, tout mort et s’évaporant ; sauf le cœur qui cogne, cogne. Comme un oiseau encore tout palpitant de la mêlée sauvage. La main se refuse à tenir la plume qui festonne comme un homme ivre le long des phrases, sur les plates-bandes des marges. On va chercher ses estampes et on s’abêtit là-dessus, tout le long, le long de dix cigarettes.
MUFLES DES GENS.– Les yeux souffrent derrière des lorgnons, des yeux criblés de dettes – à tous les points de vue ; des moustaches cavalières ou blasées trempées des soupes quotidiennes.