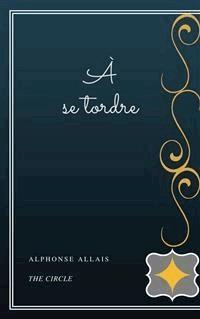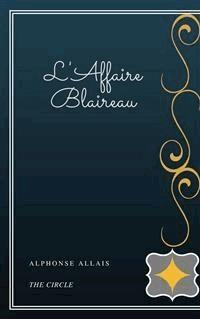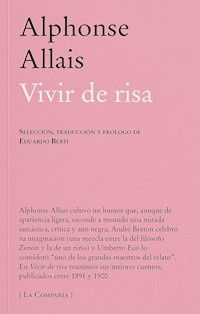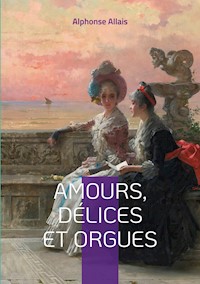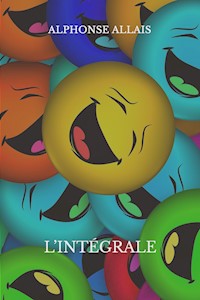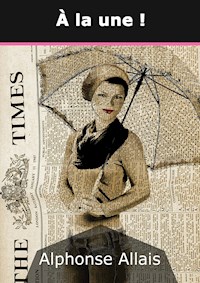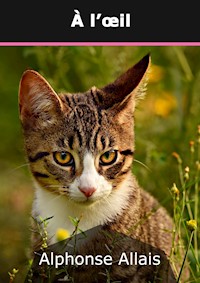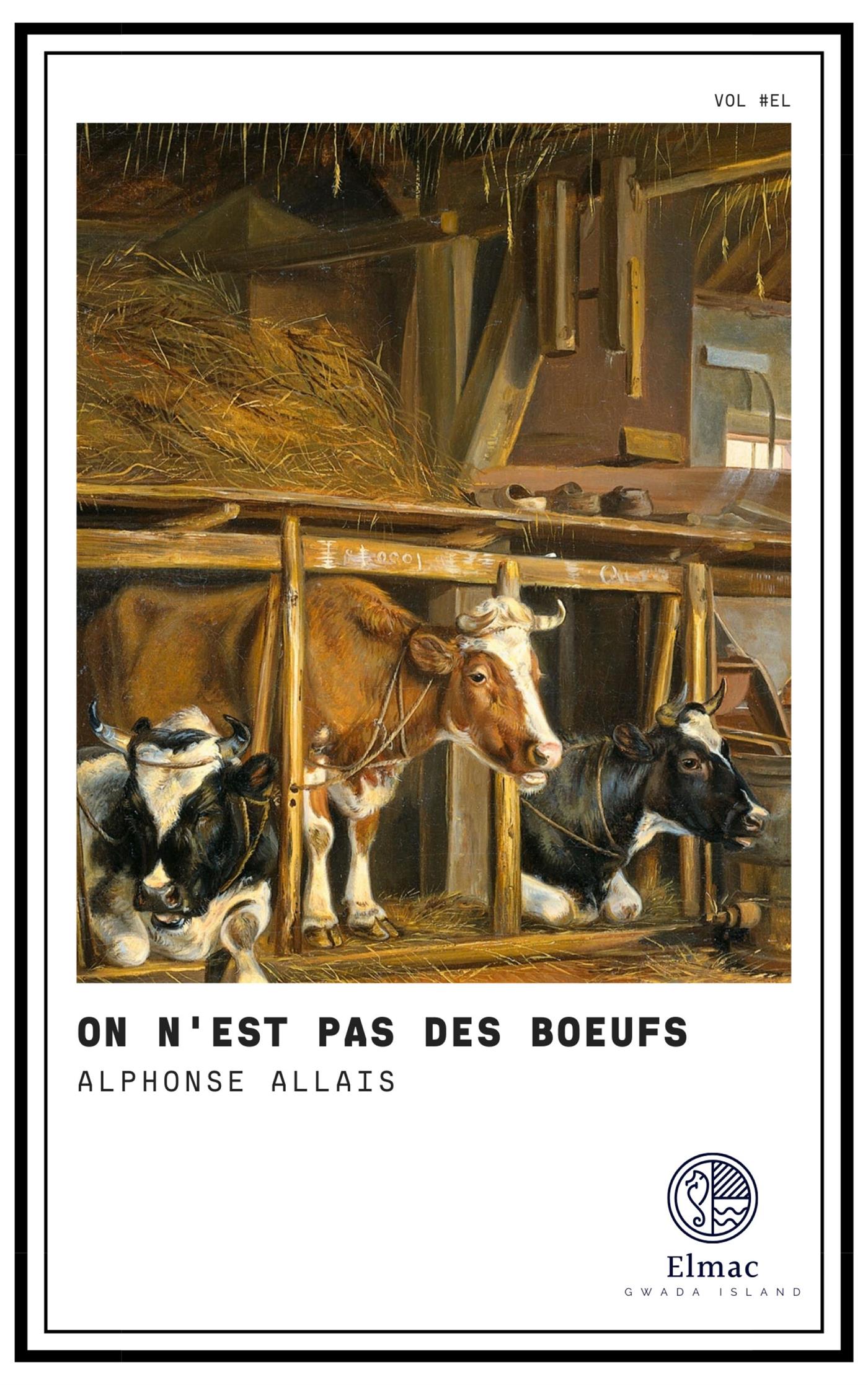
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alphonse Allais est reconnu comme le premier humoriste français et son style journalistique, associé à son bagou facétieux, me fait vraiment marrer, il n'y a pas d'autre terme. Maîtrise brillante de l'ironie et du second degré, imagination sans frein, ingéniosité littéralement géniale et éloquence provocante comptent parmi ses meilleurs atouts. Derrière ses phrases aux allures...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alphonse Allais
table des matières
Un excellent truc
Utilité à Paris du Bottin des départements
Le bouchon
Ingéniosité d’un jeune peintre de talent
Divertissement de table d’hôte
La Côte Ouest d’Afrique
Tonton dans le monde
Chromopathie
OU L’ARC-EN-CIEL HUMAIN
Les ballons horo-captifs
Jugement sévère
DE MON JEUNE AMI PIERRE SUR LA FONTAINE EN PARTICULIER ET SUR LE GRAND SIÈCLE EN GÉNÉRAL
Les culs-de-jatte militaires
Véritable révolution dans la mousqueterie française
Une nouvelle décoration
L’aventure de l’homme-orchestre
La barbe
Décentralisation
Automobilofumisme
Dressage
Le premier parapluie de M. Francisque Sarcey
« MON PREMIER PARAPLUIE
Les misères de la vie conjugale
PREMIER TABLEAU
DEUXIÈME TABLEAU
SUITE ET FIN
Faste influence du système décimal sur la question ouvrière
Un homme modeste
VICTOR BONCHRÉTIEN
Jardinier-pépiniériste
Membre de l’Académie Française
Comme le prince
OU UN MONSIEUR CHIC
Trois étranges types
L’inattendue fortune
Patriotisme
Une infâme calomnie du Petit Journal
Irrévérence
L’or mussif
Une curieuse industrie physiologique
Une maison prolifique
ÉTAT CIVIL DE DIJON
Du 29 octobre 1895
NAISSANCES
Un saint clou pour l’Exposition de 1900
Un miracle indiscutable
Un pèlerinage
à Notre-Dame-de-Grâce
le 29 août 1895
MATIN
AVE MARIA
(Air de Lourdes.)
En quittant Pont-l’Évêque, on chantera le cantique suivant :
LOUANGE À MARIE
PROCESSION
Sancte Léonarde, ora pro nobis.
Sancta Catharina, ora pro nobis.
À NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Anecdote inédite sur M. Jules Lemaître
Supériorité de la vie américaine sur la nôtre
L’engraisseur
Le pauvre rémouleur rendu à la santé
La langue et l’armée françaises
Essai sur la vie de l’abbé Chamel
À PROPOS DE LA STATUE
QU’ON SE PROPOSE D’ÉRIGER EN SOUVENIR
DE CE DIGNE PRÉLAT
Où l’ivrognerie mène les lapins
Une affaire de tout premier ordre
SOCIÉTÉ FRANCO-LAPONE
pour le tirage,
au moyen de rennes,
des cyclistes aux montées.
Le méticuleux vieillard
Légitime revendication
Ce livre
Notes
Un excellent truc
Ce fut moins de la stupeur que du vertige qui s’empara de mes sens quand l’hôtelier me remit ma petite note.
Puis, le sang-froid me revint :
– Cet imbécile, pensai-je, se trompe de facture et me donne celle d’une nombreuse famille installée chez lui depuis fort longtemps.
Mais, non ! pas du tout, c’était bien ma petite note.
Comment diable, en deux jours, dans cet hôtel de troisième ordre, en pleine morte-saison, sans avoir fait l’ombre d’une petite fête, avions-nous pu, à deux, dépenser plus de cent francs.
Alors, j’épluchai mon compte, et, de nouveau, le vertige étreignit mon crâne.
– Pardon, monsieur l’hôtelier, commençai-je, vous nous comptez quatre jours de présence en votre établissement, alors que nous n’y demeurâmes même pas trois jours, puisque, arrivés lundi soir, à l’heure du coucher, nous filons aujourd’hui jeudi dès le matin.
– Lundi, mardi, mercredi et jeudi, ça fait quatre jours.
– Vous n’avez pas, pourtant, la prétention de nous compter la journée de lundi, où nous passâmes vingt minutes chez vous, ni celle d’aujourd’hui jeudi, que nous inaugurons à peine.
– C’est une habitude de la maison, monsieur, toute journée commencée est due intégralement.
– Alors, c’est différent… Mais, m’expliquerez-vous pourquoi vous nous comptez deux francs d’éclairage électrique par jour ?
– Nous comptons un franc de lumière électrique par personne et par jour !
– Mais, nom d’un chien, nous n’avons même pas aperçu le bout de la queue de votre électricité !
– L’électricité ne marche pas en ce moment, mais je vous ferai remarquer que vous n’en avez aucunement souffert, puisqu’on vous a donné la bougie à la place.
– On nous a donné… on nous a donné… vous en parlez à votre aise, car vous nous la comptez fichtre bien sur mon mémoire, votre bougie !
– Bien sûr que je vous la compte ! Si vous croyez qu’on m’en fait cadeau à moi, de la bougie !
– Alors, si vous nous comptez la bougie, ne nous comptez pas l’électricité !
– Impossible, monsieur, l’électricité c’est dans la dépense ordinaire, la bougie c’est de l’extra.
– Et cette fourniture de papeterie, 1 fr. ? Nous n’avons rien écrit chez vous.
– Vous, non. Mais on a écrit pour vous chaque jour.
– Qui ça ?
– Nous, à l’hôtel. Le soir que vous êtes arrivés, on vous a remis du papier, une plume, de l’encre, pour écrire votre état-civil. Chaque jour, à chaque repas on vous a donné un menu. C’est de la papeterie, ça !… Et encore maintenant, cette note que je vous remets, c’est encore de la papeterie !
Qu’auriez-vous répondu à cet homme ?
Je renonçai à poursuivre une discussion où j’étais battu d’avance.
Cependant, je crus devoir m’en tirer par l’ironie ; mais mon ironie glissa sur l’âme de cet industriel, sans plus l’incommoder que le ferait un bouchon de liège jeté par une petite fille sur la peau de l’hippopotame du Jardin zoologique d’Anvers.
J’arborai mon air le plus sardonique.
– Il n’y a qu’une chose que vous avez oublié de compter sur votre note : ce sont les punaises !
– Ah ! vraiment ! Vous avez eu des punaises ?
– Des tas !
– C’est très curieux, ce que vous me dites là !… Nous essayons souvent de les chasser ; quelquefois nous réussissons, mais toujours elles reviennent, les satanées petites bêtes !
– Ah ! elles reviennent ?
– Infailliblement !
– Eh bien ! voulez-vous que je vous donne un truc pour qu’elles ne reviennent pas ?
– Très volontiers !
– Voici : la prochaine fois que vous les apercevrez, montrez-leur une note dans le genre de celle-là, et je vous f… mon billet qu’elles ne reficheront jamais les pieds chez vous.
Je sortis le cœur un peu soulagé.
Utilité à Paris du Bottin des départements
Vraiment, j’avais beau chercher au plus creux de mes souvenirs, il m’était impossible de me rappeler le monsieur qui me tendait si cordialement la main.
Ou plutôt, je me le rappelais vaguement, comme un monsieur qu’on peut avoir vu quelque part, mais où ? mais quand ? mais dans quelles circonstances ?
– Chacun son tour, alors, fit-il d’un ton enjoué. Il y a quelques années, c’est vous qui m’avez reconnu ; aujourd’hui, c’est moi !
– Monsieur Ernest Duval-Housset, de Tréville-sur-Meuse.
Je jouai la confusion, la honte d’un tel oubli ! Comment avais-je pu ne point me rappeler la physionomie de M. Ernest Duval-Housset que j’avais connu à Tréville-sur-Meuse, puis revu dans la suite à Paris ?…
Notez que, de ma vie, je n’ai mis les pieds à Tréville !
Cette histoire-là est toute une histoire !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il y a quelques années, mon ami George Auriol et moi, nous arrêtâmes un jour à la terrasse du café d’Harcourt, et nous installâmes à une table voisine de celle où un monsieur buvait un bock.
Comme il faisait très chaud, le monsieur avait déposé, sur une chaise, son chapeau, au fond duquel mon ami George Auriol put apercevoir le nom et l’adresse du chapelier : P.Savigny, rue de la Halle, à Tréville-sur-Meuse.
Avec ce sérieux qu’il réserve exclusivement pour les entreprises de ce genre, Auriol fixa notre voisin ; puis, très poliment :
– Pardon, monsieur, est-ce que vous ne seriez pas de Tréville-sur-Meuse ?
– Parfaitement ! répondit le monsieur, cherchant lui-même à se remémorer le souvenir d’Auriol.
– Ah ! reprit ce dernier, j’étais bien sûr de ne pas me tromper. Je vais souvent à Tréville… J’y ai même un de mes bons amis que vous connaissez peut-être, un nommé Savigny, chapelier dans la rue de la Halle.
– Si je connais Savigny ! Mais je ne connais que lui !… Tenez, c’est lui qui m’a vendu ce chapeau-là.
– Ah ! vraiment ?
– Si je connais Savigny !… Nous nous sommes connus tout gosses, nous avons été à la même école ensemble. Je l’appelle Paul, lui m’appelle Ernest.
Et voilà Auriol parti avec l’autre dans des conversations sans fin, sur Tréville-sur-Meuse, localité dont mon ami George Auriol ignorait jusqu’au nom, il y a cinq minutes.
Mais moi, un peu jaloux des lauriers de mon camarade, je résolus de corser sa petite blague et de le faire pâlir d’envie.
Un rapide coup d’œil au fond du fameux chapeau me révéla les initiales : E.D.-H.
Deux minutes passées vers le Bottin du d’Harcourt me suffirent à connaître le nom complet du sieur E.D.-H.
Entrepositaires : Duval-Housset (Ernest), etc.
D’un air très calme, je revins m’asseoir et fixant à mon tour l’homme de Tréville :
– Excusez-moi si je me trompe, monsieur, mais ne seriez-vous pas M. Duval-Housset, entrepositaire ?
– Parfaitement, monsieur, Ernest Duval-Housset, pour vous servir.
Certes, M. Duval-Housset était épaté de se voir reconnu par deux lascars qu’il n’avait jamais rencontrés de son existence, mais c’est surtout la stupeur d’Auriol qui tenait de la frénésie :
Par quel sortilège avais-je pu deviner le nom et la profession de ce négociant en spiritueux ?
J’ajoutai :
– C’est toujours le père Roux qui est maire de Tréville ? (J’avais à la hâte lu dans le Bottin cette mention : – Maire : M. le docteur Roux père.)
– Hélas ! non. Nous avons enterré le pauvre cher homme, il y a trois mois.
– Tiens, tiens, tiens ! C’était un bien brave homme, et, par-dessus le marché, un excellent médecin. Quand je tombai si gravement malade à Tréville, il me soigna et me remit sur pied en moins de quinze jours.
– On ne le remplacera pas de sitôt, cet homme-là !
Auriol avait fini, tout de même, par éventer mon stratagème.
Lui aussi s’absenta, revint bientôt, et notre conversation continua à rouler sur Tréville-sur-Meuse et ses habitants.
Duval-Housset n’en croyait plus ses oreilles.
– Nom d’un chien ! s’écria-t-il. Vous connaissez les gens de Tréville mieux que moi qui y suis né et qui l’habite depuis quarante-cinq ans !
Et nous continuions :
– Et Jobert, le coutelier, comment va-t-il ? Et Durandeau, est-il toujours vétérinaire ? Et la veuve Lebedel ? Est-ce toujours elle qui tient l’hôtel de la Poste ? etc., etc.
Bref, les deux feuilles du Bottin concernant Tréville y passèrent. (Auriol, moderne vandale, les avait obtenues d’un délicat coup de canif et, très généreusement, m’en avait passé une.)
Duval-Housset, enchanté, nous payait des bocks – oh ! bien vite absorbés ! – car il faisait chaud (l’ai-je dit plus haut ?) et rien n’altère comme de parler d’un pays qu’on n’a jamais vu.
La petite fête se termina par un excellent dîner que Duval-Housset tint absolument à nous offrir.
On porta la santé de tous les compatriotes de notre nouvel ami, et, le soir, vers minuit, si quelqu’un avait voulu nous prétendre, à Auriol et à moi, que nous n’étions pas au mieux avec toute la population de Tréville-sur-Meuse, ce quidam aurait passé un mauvais quart d’heure.
Le bouchon
Parmi toutes les désopilantes aventures survenues à mon ami Léon Dumachin, au cours de son voyage de noces, voici celle que je préfère :
– Après deux ou trois jours passés à Munich – c’est mon ami Léon Dumachin qui parle – après deux ou trois, dis-je, jours passés à Munich, nous annonçâmes notre départ pour ce petit délicieux pays de Kleinberg.
Un excellent homme, devant qui j’avais émis cette détermination, me regarda, regarda ma jeune femme, et, tout à coup, se mit à ressentir une allégresse muette, mais énorme, une allégresse qui secouait son bon gros ventre de Bavarois choucroutard.
– Quoi ? m’informai-je, qu’y a-t-il donc de si comique à ce que nous partions, ma femme et moi, pour Kleinberg ?
– Vous allez à Kleinberg, répondit le voleur de pendules (style patriote), et vous descendez sans doute à l’auberge des Trois-Rois ?
– C’est, en effet, celle qu’on nous a indiquée.
– Et à l’auberge des Trois-Rois, on vous donnera certainement la belle grande chambre du premier ?
– Je ne sais pas.
– Moi, je sais… C’est la chambre qu’on réserve toujours aux jeunes ménages, en évident voyage de noces.
– Ah !
– Parfaitement !… Eh bien ! méfiez-vous du bouchon.
– Le bouchon !… Quel bouchon ?
– Comment, vous ne connaissez pas la petite plaisanterie du bouchon ?
– Je vous avoue…
Ce vieux excellent bourgeois de Munich – car il était excellent – me raconta le coup du bouchon.
La chambre en question, celle qu’à l’auberge des Trois-Rois on réserve aux jeunes ménages, est garnie d’un lit qui est précisément situé juste au-dessus d’une petite salle du rez-de-chaussée, laquelle sert d’estaminet privé où, le soir, viennent s’abreuver, toujours les mêmes, quelques braves commerçants de Kleinberg.
Au sommier du lit est attachée une ficelle qui, passant à travers un trou pratiqué dans le parquet, pend dans la petite salle du dessous.
Au bout de la ficelle, un bouchon.
Vous devinez la suite, n’est-ce pas ?
Le moindre mouvement du sommier agite la ficelle et se traduit, en bas, par une saltation plus ou moins désordonnée du bouchon.
Voyez-vous d’ici la tête des calmes bourgeois de Kleinberg, buvant et fumant toute la soirée, sans quitter des yeux le folâtre morceau de liège !
D’abord, petit mouvement, quand la dame se couche.
Et puis, plus gros mouvement, quand c’est le monsieur.
Et puis… le reste.
Des fois, paraît-il, le spectacle de ce bouchon gambilleur est tellement passionnant que les buveurs de bière des Trois-Rois ne s’en détachent qu’au petit jour.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je remerciai vivement mon obligeant vainqueur de sa révélation, et me promis d’échapper aux indiscrets constats des Kleinbergeois.
D’autre part, je ne me sentais pas le droit de priver ces braves gens d’une innocente distraction qui, en somme, ne fait de tort à personne.
Et j’imaginai un truc, un véritable truc d’azur, dont, à l’heure qu’il est, je me sens encore tout fier.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les choses se passèrent comme il était prévu.
Arrivé à l’auberge des Trois-Rois, le soir, je m’aperçus, d’un rapide coup d’œil, que la chambre à nous donnée était bien la chambre au-dessus de la petite salle.
Un autre coup d’œil plus rapide encore me révéla la présence de la ficelle transmetteuse.
Je pensai au bouchon momentanément immobile, mais prêt aux plus fous chahuts.
Je vis, dans mon imagination, les bonnes têtes des gens de Kleinberg doublement réjouis à l’idée que c’étaient des Français qui allaient leur donner la comédie, ce soir.
À la grande stupeur d’Amélie, qui ne savait rien, je me mis à plat ventre, muni d’une paire de ciseaux et de notre réveille-matin de voyage.
Usant de mille précautions pour éviter tout mouvement intempestif à la ficelle, je la coupai, cette ficelle, et en attachai le bout à l’extrémité de l’aiguille des minutes de ma petite horloge, que je plaçai au bord du trou.
Et voilà !
Comprenez-vous ?
Et voyez-vous d’ici la tête de ces braves gens, en bas, avec leurs pots de grès et leurs pipes de porcelaine, assistant froidement à la montée et à la descente de leur bouchon !
Que se passa-t-il en l’âme de ces Allemands ? je l’ignore.
À six heures du matin, paraît-il, tout Kleinberg, les yeux démesurément fixés sur le bouchon, était encore dans l’estaminet.
Peut-être, ajouta mon ami Léon Dumachin, conclurent-ils que la fameuse furia francese n’était plus qu’un vain mot.
Ingéniosité d’un jeune peintre de talent
Nous avons eu, la semaine dernière, des chaleurs de près de quarante degrés, ce qui est excessif pour un aussi petit pays que celui où je vis en ce moment.
Dès le matin, le soleil liquéfiait nos crânes, et la nuit n’apportait même pas le rafraîchissement sur lequel on aurait été en droit de compter.
Cette chaleur, due évidemment à une élévation de température, incommodait bêtes et gens.
Les messieurs et dames qui me font l’honneur de me lire ont dû constater, dans mes récentes petites productions, une dépression intellectuelle plus marquée encore que de coutume.
Tout en le regrettant vivement, je ne compte pas rentrer en forme avant la fin d’octobre, d’autant plus que, le 15 du mois prochain, je vais avoir mon déménagement, opération peu idoine à conférer du génie au pauvre monde.
Pour en revenir à la chaleur, je la considère comme un fléau plus difficile à combattre que le froid.
On peut endosser autant de pardessus qu’on le désire ; mais il est impossible, si peu de respect qu’on ait des convenances sociales et mondaines, de se présenter élégamment affublé d’un simple complet en mousseline légère.
On fait du feu dans les appartements, on ne peut y faire du frais (pratiquement).
Encore la banqueroute de la science ! n’est-ce pas, mon vieux Brunetière ?
Et pourtant, j’ai vu, cet été, un jeune homme qui luttait contre le soleil et la chaleur avec une ingéniosité vraiment stupéfiante.
C’est un peintre.
Un peintre de beaucoup de talent et qui a choisi comme spécialité les effets de soleil fulgurants, aveuglants, ophtalmisants !
Il est en quelque sort le chef de l’École Éblouiste, chef d’autant plus incontesté qu’il ne compte pas encore d’élèves.
Tellement lumineuses, ses toiles, qu’auprès d’elles les becs Auer clignotent, tels de fuligineux lampions !
Ce peintre m’a donné, ces jours-ci, un magistral Tas de fumier à midi et demi (il précise), que j’ai immédiatement placé dans ma chambre à coucher.
Chaque soir, au moment de me mettre au lit, j’ai grand soin de couvrir mon tableau d’une toile opaque, sans quoi le sommeil, chassé par tant de clarté, déserterait ma couche.
Or, ce jeune artiste travaille sans jamais s’abriter du grand parasol cher à ses congénères.
Le matin, en le voyant partir sans ombrelle, je ne manquais jamais de le blâmer :
– Vous verrez que vous attraperez un bon coup de soleil ! Mais, lui, de me répondre sommairement :
– N’ayez pas peur, j’ai un truc.
Un jour, la curiosité me prit de connaître son fameux truc.
Je le suivis jusque dans un champ, où il s’installa en plein soleil.
Son chevalet et son tabouret bien établis, il sortit d’une boîte une douzaine de chauves-souris qu’il embrassa sur le museau en leur disant, à chacune, de mignardes paroles d’amitié.
Il leur attacha à la patte un fil, dont l’autre extrémité était retenue au bout d’un long bâton fiché en terre.
Il se mit à travailler.
Aussitôt, les chauves-souris déployèrent leurs grandes ailes et voletèrent, s’interposant entre sa tête et le soleil.
C’était du même coup le parasol et le ventilateur.
Les chauves-souris, admirablement entraînées à cet exercice, semblaient y puiser plutôt du divertissement que de la fatigue.
Véritablement émerveillé de ce spectacle, je serrai la main du jeune peintre et pris congé de lui, non sans lui avoir fait mille compliments de son extrême ingéniosité.