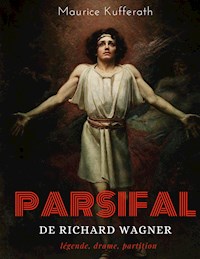1,79 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
IL est au loin, dans une contrée inaccessible, un burg sacré du nom de Montsalvat. Un temple lumineux, auquel la terre n’a rien de comparable, s’y dresse dans sa gloire et son éclat. Dans son enceinte, au fond du sanctuaire, des cœurs pieux adorent, nuit et jour, le saint calice où Dieu versa son sang divin ; pour être confié à la garde des hommes d’un cœur simple et pur, ce vase fut apporté à la terre par les anges. Chaque année, descend du ciel une colombe blanche pour rendre à sa vertu miraculeuse une force nouvelle. C’est le Saint-Graal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Table of Contents
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Parsifal, de Richard Wagner :
légende, drame, partition..
Maurice Kufferath
1890
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383836834
A LÉON HUSSON,
En mémoire d’une ferme amitié, En espérance d’un art identique.
M. K.
LA LÉGENDE
IL est au loin, dans une contrée inaccessible, un burg sacré du nom de Montsalvat. Un temple lumineux, auquel la terre n’a rien de comparable, s’y dresse dans sa gloire et son éclat. Dans son enceinte, au fond du sanctuaire, des cœurs pieux adorent, nuit et jour, le saint calice où Dieu versa son sang divin ; pour être confié à la garde des hommes d’un cœur simple et pur, ce vase fut apporté à la terre par les anges. Chaque année, descend du ciel une colombe blanche pour rendre à sa vertu miraculeuse une force nouvelle. C’est le Saint-Graal. Quiconque l’adore et le sert est assuré d’un pouvoir surhumain. En quelque lieu que son destin le mène, le Graal le soutient quand il combat pour le droit et la vertu. Mais tel est le pouvoir du Graal qu’aussitôt dévoilé, il s’évanouit ; une loi sévère ordonne à ses chevaliers de rester inconnus ; s’ils révèlent leur qualité, ils perdent leur puissance, ils doivent aussitôt s’éloigner et regagner la montagne sainte. C’est pourquoi je vais vous quitter. Je vous ai été envoyé par le Graal ; mon père Parsifal est roi du Graal, et Lohengrin, son chevalier, c’est moi. „
Ainsi dit le chevalier au cygne au moment où il va s’éloigner pour jamais d’Elsa.
Ce récit, qui amène le dénouement de Lohengrin, pourrait en quelque sorte servir d’avant-propos à Parsifal. Il définit le caractère et le lieu de l’action. Seulement, dans Parsifal, c’est un adolescent, simple de cœur et d’esprit, que nous voyons lutter pour atteindre aux plus hautes destinées et devenir roi de l’ordre du Graal, tandis que dans Lohengrin, c’est un chevalier, déjà en possession du pouvoir surhumain et accomplissant une mission divine, dont les exploits chevaleresques nous sont contés.
Le sujet de Parsifal, comme ceux de Lohengrin, de Tristan et Yseult, du Tannhœuser, a été emprunté par Wagner aux romans d’aventures et aux poèmes épiques du moyen âge. Par un procédé analogue à celui des trouvères puisant la matière de leurs légendaires récits dans des chants nationaux et des traditions antérieures arrivés jusqu’à eux soit par. la transmission orale, soit par la transmission littéraire, le maître de Bayreuth a réuni et condensé dans son drame les traits principaux de toute une série de poèmes du moyen âge relatifs à Parsifal.
Ces poèmes sont nombreux. La légende sur laquelle ils sont fondés a fait l’objet de quantité d’adaptations littéraires en vers et en prose, non seulement en Allemagne, mais aussi en Angleterre et en France. C’est en français, toutefois, qu’elle paraît avoir revêtu pour la première fois la forme du poème épique au commencement du XIIe siècle, et c’est de là qu’elle a passé dans presque toutes les littératures.
Pour le fond, les fables qui ont donné naissance au Perceval français sont de beaucoup antérieures au XIIe siècle ; leur origine se perd dans la nuit des temps. D’ailleurs, la plupart des poèmes chrétiens du moyen âge ne sont, en réalité, que des transformations d’anciens mythes païens, les uns venus de l’Orient, de la Grèce et de l’Italie ; les autres, et ce sont les plus nombreux, nés sur le sol même de la Gaule et de la Germanie, ou importés du Nord par l’invasion des races germaniques. Les romans relatifs au Graal ont leur source dans les anciens chants gaéliques ou celtiques, hymnes religieuses, chants de guerre, chansons mythologiques, ballades redisant les exploits des héros nationaux, invocations mystiques aux divinités de l’ancienne Gaule, de l’Armorique païenne, du pays de Galles, de l’Ecosse.
Certains de ces chants sont arrivés jusqu’à nous, mais très altérés, probablememt par des versions et des interpolations successives. On y démêle, à travers des allusions mythologiques et historiques, le ressouvenir des mythes communs à toutes les races indo-aryennes. Les contes du Graal, par exemple, se rattachent à l’histoire d’un bassin merveilleux rempli d’herbes magiques et doué d’une vertu particulière, celle de conférer le don de sagesse et de prophétie.
La coupe d’Hermès chez les Egyptiens et les corbeilles des Dyonisiaques 1 dans l’ancienne Grèce jouent un rôle à peu près analogue ; de même encore la pierre sacrée des Arabes que l’on conserve à la Kaaba (2) de la Mecque. Il y a là différentes manifestations d’une même croyance, se rattachant à l’idée d’une rédemption après la chute ; et cette idée, dans le cours des siècles, subit naturellement l’influence des milieux et du temps, elle se transforme à l’infini.
Le bassin dont parlent les anciens chants gaéliques, et qui donne à celui qui le possède pouvoir surhumain et satisfaction de tous ses désirs, a été remis de temps immémorial à un guerrier fameux au moment où il se promenait au bord d’un lac d’Ecosse. Un nain et un géant sortent des eaux et lui font ce don précieux. Dès lors, il est tout puissant, il remporte la victoire partout : ce bassin magique, toutefois, ne tarde pas à être l’objet des convoitises de tous, et il devient ainsi la cause de luttes sanglantes et de combats meurtriers. Les mêmes passions véhémentes s’allument dans les Eddas scandinaves autour du fameux trésor des Nibelungen, le Nibelungenhort.
Ce bassin celtique est, très probablement, l’écuelle où les prêtresses druidiques recueillaient le sang des victimes offertes aux dieux et d’où elles tiraient des présages.
L’emblème religieux devient bientôt un objet symbolique ; il découvrait à ses adorateurs la science de l’avenir, le mystère du monde, le trésor des connaissances humaines ; il donnait l’inspiration poétique. Comme les objets du culte chez tous les peuples, il joue un grand rôle dans l’histoire de la nation celtique, ainsi que plus tard, dans l’histoire des peuples christianisés, l’hostie et le calice où se célèbre le “sacrifice” de la messe. On peut même se demander si cet emblème ne dérive pas de l’autre. Il est avéré qu’un grand nombre de pratiques de l’Eglise catholique dérivent directement d’anciennes croyances païennes et de traditions du culte druidique.
Lorsqu’après les premières conversions, dans les Gaules et en Angleterre, la lutte s’établit entre les sectes religieuses rivales, le prêtre chrétien et l’ancien barde celtique, prêtre et poète tout à la fois, un autre emblème s’ajoute au bassin ensanglanté : la lance sanglante, l’arme qui symbolise d’abord la résistance aux conquérants étrangers et qui devient ensuite l’emblème sacré de la foi persécutée. C’est sur la lance que les Celtes jurent haine et mort aux oppresseurs et aux persécuteurs de leur religion. „ Le pays des Logriens (3) périra par la lance sanglante„ , chante le barde Taliésin (VIe siècle), et Chrétien de Troies répète cette prophétie dans son Perceval :
Si est escrit qu’il est une eure Que tous les roiaumes de Logres, Dont jadis fu li tière al Ogres, Ert détruite par cele lance.
Il est écrit qu’il est une heure Où le royaume de Logres, Qui jadis fut la terre aux Ogres, Sera détruit par cette lance.
A mesure que le christianisme se répand, ces symboles changent de caractère et de signification. L’Eglise transforme habilement à son profit toutes les traditions des peuples qu’elle conquiert aux nouvelles croyances. Le bassin druidique devient tantôt le bassin où fut placée la tête de saint Jean après sa décollation, tantôt le bassin où Joseph d’Arimathie recueillit, selon la légende, le sang qui coula des plaies du Christ. La lance druidique devient
. .... la lance Dont Longis (4) ferit el costé Du Roi de sainte majesté.
L’épée brisée de Wotan, que Siegfried parvient seul à reforger, la bonne épée qui donne la victoire à qui sait la manier, cette arme devient “ l’espée de quoi S. Fehanz fu décolez „.
Tous les symboles de l’ancienne religion passent de la sorte au service du culte nouveau. C’est ainsi encore que les luttes qui, dans les anciens chants, s’engagent entre les guerriers pour la possession du bassin merveilleux, de la lance sacrée et de l’épée qui donne la victoire, se transforment peu à peu, au souvenir des croisades, en luttes héroïques pour la possession des reliques du Sauveur.
Parmi ces reliques, il en est une qui, pendant près de deux siècles, a hanté l’imagination de trois ou quatre générations successives, inspiré tous les poètes, préoccupé les princes et les rois, fait l’envie de tous les déshérités : c’est le Saint-Graal.
Les linguistes se sont perdus en conjectures sur le sens et l’origine de ce mot : Graal, qui ne se trouve clairement expliqué dans aucun des poèmes qui s’en occupent. Le Graal est, pour les poètes et les lecteurs du XIIe siècle, un objet connu, qui n’a pas besoin de définition.
Au moyen âge, on donnait le Saint-Graal ou Saingral, comme une corruption de sang réal, sang royal, par allusion à la légende d’après laquelle Joseph d’Arimathie aurait recueilli le sang du Christ (du Roi), dans le calice même où Jésus avait consacré le pain et le vin. Il désigne ce calice même, transmis aux descendants de Joseph et apporté par eux en Occident, où il devient la source d’innombrables bienfaits pour ceux qui le possèdent.
D’autres le font dériver du mot corail (Korrallion en grec, Corallium en latin). C’est la thèse de M. Gustave Oppert. Elle a ceci de plausible qu’elle explique pourquoi, dans le Parzival de Wolfram d’Eschenbach, le Graal est une pierre précieuse apportée jadis sur la terre par des anges et confiée par eux à la garde d’une confrérie religieuse qui s’intitule “ les chevaliers du Graal „. Dans le poème allemand sur le Combat des chanteurs à la Wartburg, il est fait allusion à une pierre lumineuse tombée de la couronne que les anges rebelles avaient fait faire pour Lucifer et que l’archange Michel lui arrache du front. “ Cette pierre est le Graal ”, dit le vieux poème. Elle a exactement les mêmes vertus que le bassin druidique, et le plat ou le calice de Joseph d’Arimathie.
Une troisième version fait dériver le mot Graal du provençal grazal, grazau ou grial, grasale en bas latin, qui signifie littéralement plat, bassin, vase. M. Fauriel, l’historien de la poésie provençale, retrouve aussi le mot avec cette signification dans la langue basque. C’est l’interprétation qui nous paraît la plus rationnelle, car non seulement elle s’accorde avec les données historiques et légendaires, mais elle est étymologiquement la moins compliquée. Aussi est-elle aujourd’hui le plus généralement adoptée.
Au demeurant, que le mot soit d’origine orientale, gaélique ou provençale, il est certain, qu’il apparaît pour la première fois dans les poèmes français du XIIe siècle, et qu’il y désigne tantôt un vase merveilleux, tantôt une pierre précieuse, ou le calice dans lequel Jésus consacra le pain et le vin, ou le bassin dans lequel Joseph d’Arimathie, d’Abarimacie, disent les vieilles chroniques, recueillit le sang du Sauveur. A côté du Graal, figurent tantôt l’épée de saint Jean et la lance saignante, quelquefois, mais plus rarement, des fragments de la croix et les clous qui transpercèrent les membres du Christ.
Ce n’est pas tout. S’étant assimilé les symboles de l’ancienne religion des Gallo-Germains, l’Eglise s’empara parallèlement des types légendaires des héros nationaux pour en faire des défenseurs de la foi, quelquefois des martyrs et des saints. C’est ainsi que Perceval, le type accompli du chevalier chrétien, au service de l’Eglise et de la foi, est tout uniment un dérivé de Morvan, le héros de la Bretagne, qui, peu de temps après la mort de Charlemagne, souleva les Bretons contre Louis le Pieux, et prit le titre de roi. La légende profane en avait fait le type accompli du roi patriote et dévoué à son peuple. Les ballades bretonnes relatives à ce personnage racontent comment Morvan naquit d’une mère restée veuve et fut élevé dans les bois, comment il rencontra, un jour, un chevalier bardé de fer, qu’il prit pour saint Michel, comment s’éveilla en lui le goût des aventures. Pendant dix ans, il parcourt victorieux les pays les plus éloignés ; finalement, lorsqu’il revient au pays, il apprend que sa mère est morte de douleur en le voyant s’éloigner d’elle.
C’est l’histoire même, au nom près, de Perceval le Gallois. Comment les légendes relatives à Morvan se transformèrent et devinrent le roman de Perceval le Gallois, c’est ce que l’histoire littéraire n’a pu jusqu’ici clairement expliquer. L’Angleterre possède une très vieille légende, qui met en scène un enfant élevé, comme Morvan, par sa mère, restée veuve, arrivant à l’adolescence ignorant du métier des armes, qui bientôt y excelle, accomplit toutes sortes de prodiges, met en fuite les sorcières de Glocester et reconquiert un bassin dans lequel se trouvent une tête sanglante et une lance saignante. Il a accompli ainsi une prophétie qui subordonne la délivrance du pays et la fin d’une longue série de crimes et d’actes de vengeance à la rentrée de ces symboles en son pouvoir. Le héros de ce roman s’appelle Peredur, qui signifie chercheur de bassin.
Ce Peredur serait le prototype du Perceval français. Il présente, en effet, de grandes analogies avec lui. On retrouve dans les premiers poèmes français une foule d’aventures absolument identiques à celles du roman gallois. Seulement, il n’existe de celui-ci qu’une copie manuscrite du XIVe siècle, de beaucoup postérieure, par conséquent, aux manuscrits français de Perceval. De là, parmi les historiens et les philologues, d’interminables discussions. Pour les uns, Perceval n’est qu’une version française amendée du Peredur gallois ; pour les autres, c’est, au contraire, le Peredur qui est une adaptation britannique du poème français, auquel on aurait mêlé des traditions locales, afin de le rendre plus sympathique aux lecteurs anglais. C’est l’opinion du savant éditeur du Parzival allemand, M. Simmrock (5). MM. de la Villemarqué et San-Marte tiennent pour la priorité de Peredur, sinon dans la forme où il est parvenu jusqu’à nous, du moins pour le fond de l’histoire. Il y a une probabilité en faveur de cette opinion ; l’aveu de Chrétien de Troies qu’il a composé son poème d’après un livre que lui avait prêté Philippe d’Alsace, comte de Flandre. Or, on sait que ce prince passa quelques mois en Angleterre en 1172, c’est-à-dire peu de temps avant l’époque où l’on place généralement la composition du Perceval de Chrétien.
Il est à remarquer, en outre, que dans le Peredur, il n’est pas question du Graal, mais que le bassin sanglant et la lance druidique, évidemment plus anciens que le Graal chrétien, sont le but et la conclusion de l’aventure.
Reste à expliquer la transcription de Peredur en Perceval. M. de la Villemarqué admet que Perceval est une traduction française de Peredur. Mais on ne voit pas bien la filiation des deux mots. Peredur, nous l’avons dit, signifie : chercheur de bassin. Le nom français n’a aucun rapport, ni par l’étymologie, ni par le sens, avec le nom gallois. Que signifie au juste Perceval ?
Les poètes et prosateurs du moyen âge ont des opinions très variables à ce sujet. Pour les uns, Perceval veut dire : qui passe à travers tout, de perce, percer, et val, vallée ; d’où le nom de Perceforêt donné plus tard à Perceval ; d’autres l’appellent Perlesvaux (par les vallées), et même Parluifet, “ pour ce qu’il s’estait fait par lui-même ”, dit l’auteur du Perceval en prose dont l’unique manuscrit a été publié par M. Ch. Potvin. Celui-ci pense que Parluifet serait la traduction du latin : per se valens, d’où Perseval, qui vaut par soi-même. Cette interprétation a le mérite de s’accorder avec le caractère du héros, qui ne doit rien qu’à sa bonne nature : Car il tenoit de nature, dit Chrétien de Troies. En Allemagne, une explication plus compliquée encore a été donnée. Le philologue Gœrres, rattachant toute la légende du Graal à des origines orientales, fait dériver le nom de Perceval, Parzival en allemand, de l’arabe : parséh, pur, et fal, niais, simple. Parzival voudrait donc dire : le Pur simple, l’ingénu sans tache. Wagner a adopté cette origine et cette signification du nom. Mais il y a un double inconvénient à cette étymologie : la première, c’est que le nom allemand de Parzival est incontestablement entré dans la poésie germanique par l’intermédiaire du français Perceval, où les deux mots parséh et fal ne peuvent trouver leur application ; la seconde, et elle est décisive, c’est que, d’après les arabisants, le mot fal n’existe pas dans l’arabe. Ainsi s’écroulerait tout l’édifice philologique laborieusement élevé par Gœrres et adopté, on ne sait pourquoi, par Wagner. Cette querelle, toutefois, offre pour nous un certain intérêt, en ce qu’elle explique l’orthographe Parsifal, adoptée par le maître de Bayreuth.
Quoi qu’il en soit de la priorité de Peredur ou de Perceval, ce qui est intéressant pour la filiation et les transformations successives de la légende primitive de Morvan, c’est que, dans le Peredur, elle est déjà mêlée à un autre cycle de lais ou contes bretons ; je veux parler des chants relatifs au noble et chevaleresque roi Artus.
Artus ou Arthur, lui aussi, est un héros légendaire. Dans les chants les plus anciens, il personnifie avec son conseiller, le barde Merlin, la résistance aux envahisseurs, aux Pictes et aux Saxons, oppresseurs des Kymris. Artus n’est pas un personnage absolument historique. Il est une sorte de résumé des traditions nationales relatives aux anciens rois ou chefs bretons.
Quant à Merlin, c’est un personnage mi-réel, mi-légendaire. Il est certain qu’il a existé un barde de ce nom, et l’on a, de lui et d’autres bardes, ses contemporains : Anieurin, Taliésin, Lywarch (VIe siècle), des poèmes narratifs, lyriques ou didactiques, remplis d’allusions douloureuses à la patrie, à la famille, à la religion druidique menacées, et de regrets pathétiques et touchants donnés aux héros tombés pour la défense de la patrie.
Merlin paraît avoir été un défenseur ardent de la religion druidique ; ses poèmes sont pleins d’invectives contre les prêtres chrétiens ; il traite les moines d’imposteurs, de libertins et de méchants ; il leur prête toutes sortes de vices, jusqu’à la gloutonnerie (6).
Par la suite, l’imagination populaire a fait de Merlin un nécromancien ; il est devenu l’Enchanteur Merlin ; et, dans cette nouvelle tradition, on devine encore une fois l’influence de l’Eglise. Pour déraciner les anciennes croyances, elle jette la suspicion sur ceux qui les exaltent. Merlin a des accointances avec le diable, avec l’ennemi ; c’est un faux prophète, un sorcier (7). Même la cour du roi Artus, après avoir été longtemps, avec ses chevaliers de vertu parfaite et de courtoisie si délicate, l’idéal des rois et des princes, finit par n’être plus qu’une cour où règnent la volupté et le dévergondage.
En passant d’Angleterre en France, ces deux ordres de légendes se confondent avec un troisième cycle : celui de la confrérie du Graal chrétien.
Cette légende est probablement d’origine provençale ; elle l’est certainement dans sa forme chrétienne. C’est dans les Pyrénées, sur les confins de l’Espagne, pays du merveilleux et des ennemis du christianisme (les Maures), que le moyen âge place la montagne où s’élève le temple du Graal : Montsalvat, corruption du latin mons salvationis, montagne du salut, ou du provençal mont saltvage, c’est-à-dire sauvage.
Le plus ancien poème connu où ces trois cycles se trouvent réunis, est le Perceval de Chrétien de Troies.
On n’a que peu de renseignements sur ce remarquable poète, dont l’influence sur ses contemporains et sur toute la littérature du moyen âge fut extraordinaire. Il était d’origine champenoise et il vécut dans différentes cours, celles de Hainaut, de Flandre et de Champagne ; il fut protégé par la comtesse Marie de Champagne, fille de Louis VII et de la reine Aliénor ; plus tard, il fut aussi très choyé par Philippe d’Alsace, comte de Flandre. C’est à peu près tout ce que l’on sait de sa vie. La date de sa mort n’est pas même connue, mais l’on estime généralement qu’elle tombe avant la fin du XIIesiècle, entre 1191 et 1195.
Sur ses œuvres, en revanche, on a des renseignements plus précis. Avant de mettre en vers français ce que l’on appelle la “ matière de Bretagne„ , c’est-à-dire les contes bretons qui ont inspiré tant de poèmes épiques et de romans d’aventures du XIe au XIIIe siècle, il avait imité les Métamorphoses d’Ovide, ce qui tendrait à prouver qu’il était clerc, c’est-à-dire membre de quelque communauté religieuse. Il nous apprend lui-même qu’il avait mis en français les épisodes de Pélops et de Philomèle. De ces deux poèmes, le premier est perdu ; le second vient d’être retrouvé. Chrétien de Troies avait ensuite composé, vers 1160, un Tristan qui est perdu, puis Erec, légende bretonne ; Cligès, dont le sujet est emprunté à une ancienne légende orientale sur la femme de Salomon, enlevée à son mari par une ruse dont elle est complice ; le poète champenois y mêle toutes sortes de fictions empruntées aux contes bretons ; vers 1170, il écrivit ensuite le Conte de la Charrette ou Lancelot du Lac (inachevé), dont la comtesse Marie de Champagne lui avait fourni le sujet, et, un peu après, Ivain ou le Chevalier au lion ; ces deux poèmes sont tirés des contes bretons ; enfin, vers 1175, il composa son dernier et son plus important ouvrage, Perceval li Galois ou le Conte del Graal, d’après un “ livre ”, comme il dit lui-même, sans doute un poème anglo-normand, que lui avait prêté Philippe d’Alsace, lequel, en 1772, avait passé quelques mois en Angleterre à guerroyer contre Henri II (8).
Chrétien passa sans conteste, aux yeux des écrivains de son époque et du siècle suivant, pour le meilleur poète français, et son école dura presque jusqu’à la fin du XIVe siècle. L’Histoire littéraire de France, ce grand monument élevé par les Bénédictins à la gloire des lettres françaises, dit qu’il méritait sa réputation “ par l’invention, la conduite et particulièrement par le style qui l’élève par dessus tous les poètes de son temps ”. Le grand mérite de Chrétien de Troies est plutôt, cependant, dans la forme. “Il prenait, dit un auteur du XIIIe siècle, le beau français à pleines mains et n’a laissé après lui qu’à glaner. ” Il a créé, en quelque sorte, la poésie chevaleresque et la poésie de l’amour ;
Chrétien de Troies dit mieux Du cœur navré, du dard des yeux, Que l’on ne pourrait vous en dire,
répète encore, un demi-siècle plus tard, Huon de Méri. Ce fut, à tous égards, un vrai poète et un grand écrivain. Ses œuvres sont faciles à lire, pour peu qu’on veuille se familiariser avec les mots et les formes grammaticales tombées en désuétude. C’est une initiation qui ne demande ni beaucoup de travail, ni un grand effort, grâce aux grammaires et aux excellents glossaires de la langue du moyen âge. On sera, d’ailleurs, bientôt récompensé de ses peines par l’intérêt et le charme que dégage ce vieux poème.
L’aveu de Chrétien qu’il a composé son poème de Perceval d’après “ un livre ” prouve qu’avant lui, il existait en Angleterre une histoire de ce personnage, conte, roman ou poème rédigé probablement en latin. Mais c’est son œuvre qui popularisa cette légende et qui, devenue rapidement célèbre, fut prise aussitôt pour modèle et inspira un nombre considérable de récits analogues. Il trouva des imitateurs non seulement en France, mais partout au dehors : en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, jusqu’en Norwège et au Portugal. L’un des monuments de la vieille langue portugaise est un poème de Perceval, imité du français. Le chef-d’œuvre de la littérature germanique au moyen âge, c’est le Parzival de Wolfram d’Eschenbach, qui cite expressément Chrétien de Troies parmi les auteurs dont il s’est inspiré.
Grâce à cet immense succès, le poème de Chrétien fut continué en France de diverses façons. Une première suite semble avoir été composée sur des notes laissées par le poète champenois ; deux autres continuations, l’une du poète Menessier, qui fut au service de Jeanne de Flandre, petite-nièce du comte Philippe, sous les auspices duquel le poème avait été commencé ; l’autre, de Gerbert de Montreuil, à qui l’on doit un joli conte, le Roman de la Violette, racontent les aventures de Gauvain, le neveu d’Artus, le plus célèbre des chevaliers de la Table Ronde, qui, dans le roman de Chrétien, est fréquemment le compagnon d’aventures de Perceval. Seulement, l’histoire de Gauvain n’a plus que de vagues rapports avec le Graal.
Il y a d’autres grands poèmes sur le Graal et Perceval. Le poète franc-comtois Robert de Boron en composa un vers le commencement du XIIIe siècle (9). Robert de Boron rattache plus directement encore que Chrétien de Troies la légende du vase sacré au cycle breton. Il composa, à cet effet, une sorte de trilogie : Joseph d’Arimathie ou le Petit Saint-Graal, — Merlin, — Perceval, dans laquelle le barde et enchanteur breton, engendré par le diable pour combattre le Christ, mais rattaché à la bonne cause par sa connaissance du passé et de l’avenir, forme un lien naturel entre l’histoire des premiers prodiges du Saint-Graal et le poème qui nous montre ce Graal finalement conquis par Perceval et transporté au ciel après sa mort. Mal<heureusement, nous ne possédons de l’œuvre de Robert de Boron que le premier poème (10) et un fragment du deuxième ; le troisième est perdu, et il ne nous en reste que des imitations en prose. Le Joseph d’Arimathie fait connaître ce que c’est que le Graal et annonce qu’il sera porté en Occident et plus tard trouvé par un chevalier de la race de Joseph d’Arimathie ; — le Perceval raconte comment ce chevalier trouva le Graal et mit ainsi fin aux“ merveilles” de Bretagne ; le Merlin sert de transition entre ces deux poèmes en transportant la scène en Bretagne, en introduisant Arthur ou Artus, et en faisant, par Merlin, rappeler le sujet du premier poème et prédire celui du second (11).
C’est par ce Merlin que nous apprenons ce qu’était la Table Ronde. Au fond, cette institution se rattache à l’antique tradition des assemblées de chefs de clans bretons. Ces assemblées se tenaient sous la présidence d’un chef suprême élu, appelé Guortiguern ou Roi ; elles avaient lieu régulièrement aux principales fêtes de l’année et, exceptionnellement, dans toutes les circonstances importantes. On y discutait les questions de législation et les intérêts du pays. Le moyen âge en fit une sorte d’assemblée de l’élite du pays.
Un jour que le roi Artus tient sa cour à Carlion, Merlin lui rappelle la Sainte Cène et l’épisode de la trahison de Judas. Après la mort du Christ, Joseph d’Arimathie se retire avec son “ lignage ”, c’est-à-dire sa famille, et quelques disciples dans le désert, où ils souffrent la faim. Jésus alors apparaît à Joseph et lui ordonne de faire une table à l’image de celle qui servit pour la Sainte Cène et de placer sur cette table le “vaissiel ”, c’est-à-dire le plat ou le vase, qu’il avait conservé et qui était celui où Jésus et les Apôtres avaient mangé. Quand Joseph a accompli ce que le Seigneur lui a ordonné, et que toutes les personnes de sa suite se sont assises à la table, celle-ci se couvre de mets. “ Qui à cele table povait seoir, il avait l’accomplissement de son cœur ”, dit la vieille chronique. A la table, une place reste vide. C’est celle qu’occupait Judas à la Sainte Cène, le jour où Jésus annonça qu’il serait trahi par un de ses disciples. Les auteurs du moyen âge, amplifiant le récit de l’Evangéliste, ajoutent que Judas fut chassé de la table par Jésus ; Jésus lui signifie même qu’il est exclu “ de la compaignie de Dieu ”. C’est à ces paroles que se rattache l’idée morale de la Table Ronde. Ceux qui restèrent avec Jésus, c’étaient les purs, les vrais disciples, les “ chevaliers "de loyauté parfaite, les fidèles. De là, l’indignité qui frappe ceux qui sont exclus. Lorsque Joseph d’Arimathie fonde la deuxième table, il n’a autour de lui que des fidèles qui, tous, participent au festin miraculeux servi par le Christ en personne ; l’infidèle n’y aurait pas été admis. De même la Table Ronde n’admettra que les chevaliers de vertu accomplie. Le Graal, qui renouvelle incessamment le miracle de la table de Joseph d’Arimathie dans le désert, ne dispensera pas ses grâces à ceux qui ne sont pas dignes en tout point de le contempler.
Voilà, tout entier, le symbole de la Table Ronde. S’asseoir à la table du roi Artus, cela équivaut, en quelque sorte, à un brevet de noblesse, c’est la reconnaissance officielle de la valeur, de la courtoisie, de l’honneur d’un chevalier. Sans aller chercher bien loin, on pourrait retrouver, dans nos clubs aristocratiques modernes d’Angleterre et de France, le dérivé de l’institution chevaleresque du moyen âge.
Seulement, à cette époque, à l’idée de chevalerie se joint l’idée religieuse. La chevalerie était la réunion des deux choses qui occupaient le moyen âge : la religion et la guerre. Aussi, lorsque sur les conseils de Merlin l’Enchanteur, le roi Artus fonde la Table Ronde, c’est au nom de la Très Sainte Trinité qu’il l’institue (12). De militaire qu’elle semble avoir été au début, la Table Ronde finit par être militaire à la fois et théocratique. Être de la Table Ronde, c’est être un preux chevalier et un bon chrétien.
La Table Ronde et le Graal sont désormais indissolublement liés l’un à l’autre. Jusqu’au XIVe siècle, on ne parle plus de l’une sans faire allusion à l’autre. Les fictions primitives de la légende, interprétation poétique et généralisation de faits réels, d’événements historiques, s’altèrent de plus en plus par l’adjonction d’éléments empruntés aux Evangiles et aux mystères de la religion nouvellement implantée. L’absorption par l’Eglise de toutes les traditions nationales est complète.
Non moins curieuse est la transformation des mêmes mythes en passant d’un peuple à l’autre. Ils se chargent d’allusions nombreuses aux traditions locales, aux mœurs particulières, aux anciennes croyances religieuses de leur nouveau milieu ; l’idée est comme un fleuve dont les flots s’enflent des eaux secondaires des contrées qu’ils traversent. L’Allemagne emprunte à la France, comme la France avait emprunté à l’Angleterre, qui elle-même doit beaucoup aux Scandinaves. Ces échanges sont d’ailleurs réciproques. La Chanson de Roland, qui est par excellence l’épopée française, est sortie de traditions essentiellement germaniques. Les deux plus beaux monuments poétiques du moyen âge germanique, la chanson des Nibelungen et le Parzival, sont l’un d’origine Scandinave, l’autre d’origine celtique et française. Le Dante, l’Arioste, même le Tasse ne peuvent s’expliquer si l’on ne tient compte des influences du Nord sur l’imagination méridionale. C’est une erreur profonde, et malheureusement trop longtemps enseignée, que tout nous vienne des Grecs et des Romains. Les grandes migrations de peuples au ve siècle ont amené dans toute l’Europe, du Nord au Midi, un choc prodigieux des idées, des souvenirs, des mœurs propres à chacune des races qui ont pris part à ce mouvement extraordinaire. Il en est résulté une sorte de libre-échange de la pensée et la constitution d’un capital poétique commun auquel toutes les nations ont fait successivement des emprunts (13).
Le même fond poétique donne ainsi naissance à des productions très diverses de caractère et d’esprit, selon le moment de leur éclosion et la nationalité des auteurs de leurs adaptations successives. Il y a là un mouvement intellectuel et artistique très curieux à étudier, où se marquent déjà nettement les caractères particuliers qu’auront les différentes littératures de l’Europe centrale à leur période d’entier épanouissement. Il suffit, ici, d’indiquer d’une façon sommaire ces principes.
On en conclura que le protectionnisme poétique et l’ostracisme prononcé par un peuple à l’égard des productions artistiques d’un autre constituent le phénomène le plus attristant et le plus inexplicable qui soit.
HISTOIRE ET POÉSIE
LE caractère commun à la plupart des poèmes chevaleresques du moyen âge est de mettre en scène des ingénus, des innocents, des ignorants. On nous les montre aux prises avec toutes les difficultés de la vie, les ruses de la nature, qu’ils surmontent ou écartent par la fermeté du vouloir, par la persévérance, par le courage, par l’abnégation en toutes circonstances.
Il y a un sens profond et éminemment poétique dans ce spectacle de l’homme privé de tout appui, né hors de la société, élevé en dehors des règles ordinaires de la vie, luttant avec énergie, sans défaillance, contre tous les obstacles qui se présentent à lui, et arrivant finalement à dominer ses contemporains par la force acquise dans les épreuves subies. En retraçant les impulsions désordonnées d’une âme qui s’agite sous l’action des seules inspirations naturelles, du remords de la faute commise, de la douleur physique ou morale, elles retracent l’histoire éternelle du genre humain. L’idée qui est au fond est toujours celle de la fatalité insurmontable : l’oracle prédit, l’homme veut détourner la menace, et tout arrive pour démontrer combien est aveugle l’esprit des faibles mortels et par quels chemins l’inexorable destinée sait ressaisir sa proie. Ces histoires sont émouvantes comme des souvenirs de la première jeunesse ; il s’en dégage comme un parfum d’avril ; elles évoquent en chacun de nous des images de notre propre passé ; et si elles laissent comme un regret de cet autrefois, elles y ajoutent toute l’ampleur des sentiments, toute la grandeur des choses qui séparent la courte et humble histoire de l’individu de l’histoire infinie et rayonnante de l’humanité.
C’est cette grandeur et cette profondeur du sentiment qui ont attiré Wagner et qui l’ont retenu prisonnier, depuis le moment où, renonçant au drame historique après Rienzi, il est entré dans le domaine du drame légendaire avec le Vaisseau-Fantôme.
Tannhæuser, Lohengrin, Tristan et Yseult, l’Anneau du Nibelung, enfin Parsifal ; tous ces sujets, qui sont en dehors de l’histoire, l’ont captivé par leur caractère profondément humain. En quoi son intuition de philosophe et de grand poète a merveilleusement servi le musicien.
La poésie et la musique, en effet, sont une simplification, une sublimisation, pour nous servir d’un mot hardi de Liszt. Elles sont condamnées à généraliser si elles veulent s’élever. Elles s’abaissent, au contraire, dès qu’elles cherchent à spécialiser. De tout temps, les plus grands poètes ont été ceux qui ont exprimé les idées les plus simples, les vérités les plus générales. Parce que l’être humain n’a qu’une façon de sentir et de penser, en dépit de toutes les variétés que les circonstances de temps et de lieu, la différence des races et des tempéraments, le milieu social même apportent à l’expression du sentiment et de la pensée, le fond de l’une et de l’autre reste universellement le même. Qu’importe, au bout d’un certain temps, la manière dont se sont manifestées dans l’individu les crises du cœur et de l’esprit, si l’on n’y retrouve les lois générales du développement des passions humaines ? Les particularités finissent toujours par s’effacer et se noyer dans les ensembles.
C’est ce qui fait que l’histoire proprement dite est impropre à la poésie. Elle n’étudie les évolutions et les révolutions de la politique qu’au point de vue de la part plus ou moins large qu’y ont prise le caprice ou les erreurs de quelques personnages, c’est-à-dire qu’elle s’occupe plus spécialement d’accidents trop personnels pour nous révéler des lois générales. La vie réelle des peuples, c’est-à-dire de l’humanité, elle la soupçonne à peine ; ce qu’il y a de sourd, de continu, de moral dans l’action anonyme des masses, échappe fatalement aux calculs et aux perspicacités de l’historien trop préoccupé des faits matériels et de l’exactitude des documents. Quand l’histoire veut comprendre et recueillir les témoignages de ces influences inexprimées, c’est à la poésie qu’elle doit s’adresser ; car c’est par la poésie seule qu’elle pourra expliquer tout ce que les aspirations des races, éléments impondérables, ajoutent de force aux idées, donnent de puissance et d’audace aux individus, d’impatience ou de faiblesse aux gouvernements.
La poésie est donc d’un intérêt plus constant et plus élevé que l’histoire, parce qu’elle est l’expression la plus complète, la plus pure de la vie d’un peuple. On n’a point à dégager ses enseignements des faits qui les cachent ou les travestissent ; ils sont clairs, positifs, universels. Aussi, les abstractions de la légende, histoire poétisée, ont-elles toujours été plus favorables au poème dramatique que les réalités sèches et insipides de l’histoire. Faites, si vous le voulez, le compte des tragédies historiques que le théâtre a vues depuis l’antiquité, et mettez en présence les drames fondés sur la légende purement imaginaire ou inspirée de traditions historiques ; je crois qu’il n’y a pas longtemps à hésiter. Pour dix chefs-d’œuvre nés de la légende, depuis les Erynnies, l’Œdipe-Roi et les Iphigénie, jusqu’ à Faust, en passant par Hamlet, Macbeth, le Roi Lear, le Cid, combien de drames historiques qui se soient vraiment emparés de la mémoire des hommes ? La fiction et la réalité se tiennent de plus près que ne l’admet généralement la critique moderne ; ainsi que l’a dit Victor Hugo, “elles surprennent quelquefois notre esprit par les parallélismes singuliers qu’il leur découvre (14) ”.