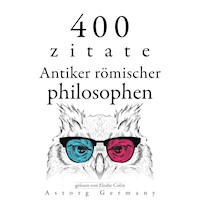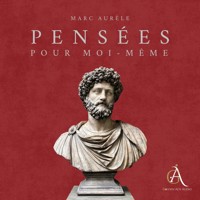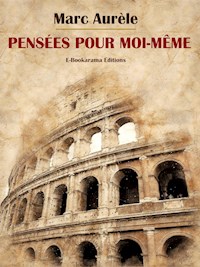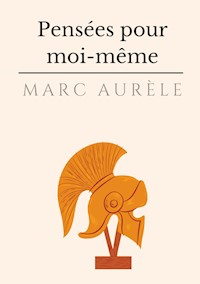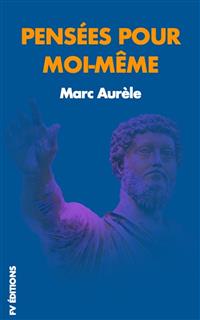
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
*** Cet ebook est optimisé pour la lecture numérique *** « Cesse de te laisser emporter par le tourbillon » Ouvrage majeur de la philosophie stoïcienne, les pensées de l'empereur Marc Aurèle furent rédigées entre 170 et 180 ap. JC. Ces pensées apparaissent aujourd’hui comme étant d'une modernité surprenante. Considérées comme une véritable méthode pour atteindre le bonheur, ce chef de guerre, en avance sur ce temps, y démontre que le coaching moderne et la tendance du développement personnel n’ont rien inventé. Nous apprenons ainsi que pour les stoïques, le bonheur implique la sérénité, une forme d'impassibilité face aux aléas du quotidien, mais aussi et surtout une attitude distanciée face aux question existentielles liées notamment à la mort. C'est dans une conception déterministe du monde que l'empereur philosophe nous invite donc à prendre du recul, à savoir rester sage face au choses qui ne peuvent être changées, et courageux face à celles que nous pouvons modifier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pensées pour moi-même
Marc Aurèle
Traduction parAuguste Couat
Table des matières
MARC AURÈLE
LIVRE PREMIER
LIVRE II
LIVRE III
LIVRE IV
LIVRE V
LIVRE VI
LIVRE VII
LIVRE VIII
LIVRE IX
LIVRE X
LIVRE XI
LIVRE XII
MARC AURÈLE
121 ap. JC - 180 ap. JC
"Cesse de te laisser emporter par le tourbillon"
Ouvrage majeur de la philosophie stoïcienne, les pensées de l'empereur Marc Aurèle furent rédigées entre 170 et 180 ap. JC. Ces pensées apparaissent aujourd’hui comme étant d'une modernité surprenante. Considérées comme une véritable méthode pour atteindre le bonheur, ce chef de guerre, en avance sur ce temps, y démontre que le coaching moderne et la tendance du développement personnel n’ont rien inventé. Nous apprenons ainsi que pour les stoïques, le bonheur implique la sérénité, une forme d'impassibilité face aux aléas du quotidien, mais aussi et surtout une attitude distanciée face aux question existentielles liées notamment à la mort. C'est dans une conception déterministe du monde que l'empereur philosophe nous invite donc à prendre du recul, à savoir rester sage face au choses qui ne peuvent être changées, et courageux face à celles que nous pouvons modifier.
FVE
LIVRE PREMIER
Mon grand-père Vérus m’a laissé l’exemple de l’honnêteté et de la patience.
2
Celui de qui je tiens la vie m’a laissé la réputation et le souvenir de sa modestie et de sa fermeté.
3
Ma mère m’a appris la piété et la libéralité, l’éloignement pour le mal, et même pour l’idée de faire du mal. Elle m’a appris, en outre, à être frugal et à m’abstenir d’un train de vie luxueux.
4
Mon bisaïeul m’a appris à ne pas fréquenter les écoles publiques, mais à suivre chez moi les leçons de bons maîtres et à comprendre qu’il ne faut épargner pour cela aucune dépense.
5
Mon gouverneur m’a appris à ne me passionner ni pour les Verts ni pour les Bleus, ni pour les Petits ni pour les Longs-Boucliers, mais à supporter la fatigue, à avoir peu de besoins, à travailler de mes mains, à ne pas multiplier les affaires, à fermer l’oreille aux délateurs.
6
Diognète m’a appris à ne pas m’empresser pour des choses frivoles, à me défier de ce que les charlatans et les imposteurs racontent sur les incantations magiques, les évocations de démons et autres choses du même genre ; à ne pas élever des cailles et à ne pas m’ébahir sur ce genre d’occupation ; à supporter la franchise, à apprendre la philosophie. Il m’a fait suivre les leçons d’abord de Bacchius, puis de Tandaside et de Marcien ; il m’a appris tout enfant à écrire des dialogues et à aimer le grabat, la couverture et toutes les prescriptions de la discipline hellénique.
7
Rusticus m’a fait comprendre que j’avais besoin de redresser et de former mon caractère ; il m’a appris à ne pas me laisser entraîner à l’imitation de la propagande des sophistes, à ne pas écrire sur les sciences, à ne pas composer des exhortations dialoguées, à ne pas essayer de frapper l’imagination en affectant une activité intempérante ; il m’a détourné de la rhétorique, de la composition poétique, du bel esprit ; il m’a enseigné à ne pas me promener dans ma maison vêtu d’une longue robe, et à dédaigner toute ostentation de ce genre ; à écrire des lettres simples, comme celle qu’il écrivit lui-même de Sinuessa à ma mère ; à me montrer facile et prêt à une réconciliation avec ceux qui, après m’avoir offensé, manifestaient l’intention de revenir à moi ; à lire de très près et à ne pas me contenter d’un examen sommaire ; à ne pas acquiescer trop vite à l’opinion de ceux qui parlent beaucoup ; c’est à lui, enfin, que je dois d’avoir eu dans les mains les Commentaires d’Épictète, qu’il avait dans sa bibliothèque, et qu’il m’a prêtés.
8
Apollonius m’a enseigné à avoir des opinions libres, nettes et réfléchies ; à ne regarder jamais, si peu que ce soit, autre chose que la raison ; à demeurer toujours le même au milieu des douleurs les plus vives, devant la perte d’un enfant, dans les grandes maladies ; j’ai vu en lui l’exemple vivant d’un homme à la fois très ferme et très doux, ne s’impatientant jamais lorsqu’il enseignait, et considérant à coup sûr comme le moindre de ses avantages son expérience professionnelle et l’habileté avec laquelle il savait transmettre sa science ; il m’a appris qu’il fallait accueillir les bienfaits que croient nous faire nos amis, sans engager notre liberté et sans nous montrer insensibles par nos refus.
9
De Sextus j’ai appris la bienveillance ; il m’a donné l’exemple d’une maison administrée paternellement et la notion d’une vie conforme à la nature ; il m’a montré la gravité sans fard, l’attention vigilante aux intérêts de ses amis, la patience à supporter les ignorants et ceux qui opinent sans examen. Son humeur était égale avec tous, au point qu’aucune flatterie n’avait la douceur de sa conversation, et que ceux qui en jouissaient n’avaient jamais plus de respect pour lui qu’à ce moment-là. Avec une intelligence compréhensive et méthodique, il découvrait et classait les principes nécessaires à la conduite de la vie ; il ne laissait jamais paraître ni colère ni aucune autre passion, étant à la fois très impassible et très tendre ; il aimait qu’on parlât bien de lui, mais sans faire de bruit ; il avait de l’érudition sans en faire étalage.
10
Alexandre le grammairien m’a donné l’exemple de la modération dans la correction des fautes ; il s’abstenait de reprendre avec dureté ceux qui laissaient échapper un barbarisme, un solécisme, un son vicieux ; il se bornait à leur montrer habilement ce qu’il fallait dire, en ayant l’air de répondre, [de confirmer, ] de discuter non sur le mot lui-même, mais sur l’objet en question, ou par toute autre adroite suggestion.
11
Fonton m’a appris tout ce que la tyrannie a de méchanceté, de duplicité et d’hypocrisie ; et combien peu de cœur, en somme, ont ces gens que nous appelons patriciens.
12
Alexandre le Platonicien m’a appris à ne pas dire souvent et sans nécessité, et à ne pas écrire dans une lettre : « Je n’ai pas le temps, » afin d’écarter sans cesse par ce moyen, et en alléguant des affaires pressantes, tous les devoirs que m’imposent mes relations vis-à-vis de ceux qui vivent autour de moi.
13
Je tiens de Catulus que, loin de dédaigner les reproches de ses amis, même mal fondés, il faut en faire son profit et reprendre l’ancienne intimité ; qu’il faut dire volontiers du bien de ses maîtres, comme le faisaient, dit-on, Domitius et Athénodote, et aimer ses enfants d’un amour sincère.
14
De mon frère Sévérus j’ai appris l’amour de mes proches, l’amour de la vérité, l’amour de la justice ; par lui j’ai connu Thraséas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus ; j’ai eu l’idée d’un gouvernement fondé sur la loi et sur l’égalité des droits de tous les citoyens, d’une royauté respectueuse avant tout de la liberté des sujets ; par lui encore j’ai appris comment on honore sans défaillance et toujours avec la même ardeur la philosophie, comment on est toujours généreux, libéral, plein d’espérance, confiant dans l’affection de ses amis, franc à l’égard de tous ceux à qui l’on a à faire des reproches, sans que nos amis aient à se demander : « Que veut-il ? que ne veut-il pas ? » mais de manière à le leur faire voir clairement.
15
Maximus m’a montré comment on est maître de soi-même, sans que rien puisse nous faire changer ; il m’a enseigné la fermeté dans toutes les circonstances pénibles et particulièrement dans les maladies ; la modération, la douceur et la dignité du caractère, la bonne humeur dans l’accomplissement du travail de chaque jour. Tout le monde était persuadé que sa parole exprimait toujours sa pensée, et que ce qu’il faisait était bien fait ; il ne s’étonnait de rien, [ne se troublait pas], n’avait jamais ni précipitation, ni indolence, ni embarras ; il ne se laissait pas abattre, ne montrait pas un visage tour à tour jovial, ou irrité et défiant ; il était bienfaisant, pitoyable et sincère ; on voyait en lui une droiture naturelle et non apprise. Jamais personne n’aurait craint d’être méprisé par lui ni n’aurait osé se supposer supérieur à lui ; il avait, enfin, de l’enjouement et de la grâce.
16
Voici les vertus dont mon père m’a légué l’exemple : la mansuétude, l’attachement inébranlable aux opinions réfléchies, le dédain de la vaine gloire et des vains honneurs, l’assiduité au travail ; il était prêt à écouter tous ceux qui avaient à lui dire quelque chose d’utile [à la communauté] ; rien ne pouvait le détourner de récompenser chacun selon son mérite ; il savait à quel moment il fallait tendre sa volonté ou lui donner du relâche ; il avait renoncé à l’amour des jeunes garçons ; bien qu’aimant la société, il permettait à ses amis de manquer un de ses repas et ne les obligeait pas à l’accompagner dans ses voyages. Ceux que des obligations quelconques avaient éloignés de lui le retrouvaient toujours le même ; dans les délibérations, il cherchait attentivement et avec persévérance le parti à prendre, au lieu d’éviter toute peine en se contentant de ses premières impressions. Il était fidèle à ses amis sans manifester ni lassitude ni engouement ; en toute occasion, il était maître de lui et d’humeur sereine. Il prévoyait et réglait d’avance les plus petites choses, sans faire d’embarras ; il arrêtait les acclamations et les flatteries dont il était l’objet. Économe des biens de l’empire, il réglait avec vigilance les dépenses des chorégies et ne craignait pas d’en être blâmé. Il n’avait aucune superstition à l’égard des Dieux, et, à l’égard des hommes, il ne cherchait point à plaire à la foule et à se rendre populaire ; en tout, il était sobre, ferme, sans affecter le manque de goût et sans se montrer avide de nouveautés. Il usait sans vanité et sans façon des biens qui contribuent à la douceur de la vie, et que la fortune prodigue en abondance. Il s’en servait [naturellement] quand ils se présentaient et n’en éprouvait pas le besoin quand il ne les avait pas. Nul n’aurait pu dire de lui qu’il fût un sophiste, un goujat, ou un pédant. On voyait en lui un homme mûr, complet, supérieur à la flatterie, capable de gouverner ses affaires et celles des autres. En outre, il honorait les vrais philosophes ; quant aux autres, il les traitait sans mépris, mais aussi sans se laisser entraîner par eux. Il était d’abord facile et aimable sans excès. Il avait assez de soin de sa personne, sans être trop attaché à la vie ni désireux de se faire beau, et sans se négliger pour autant. Grâce à cette vigilance, il n’eut recours que très rarement à la médecine, et s’abstint de remèdes et d’onguents. Avant tout, il s’effaçait sans envie devant ceux qui possédaient une faculté éminente, telle que la puissance de la parole, la connaissance des lois, des mœurs ou toute autre science ; il s’intéressait à eux et veillait à ce que chacun eût la renommée que lui méritait sa supériorité spéciale. Agissant toujours conformément à la tradition des ancêtres, il ne s’appliquait pas à en avoir l’air. Il n’aimait pas à changer de place et à s’agiter ; il séjournait volontiers dans les mêmes lieux et s’attachait aux mêmes objets. Après des crises de maux de tête, il revenait dispos, avec la même ardeur, à ses occupations accoutumées. Il avait fort peu de secrets, et ce n’était jamais qu’à propos des affaires publiques. Il était prudent et mesuré dans l’organisation des fêtes, la construction des édifices et les distributions faites au peuple et autres choses semblables. Il considérait le devoir à remplir, et non la gloire à retirer de ses actes. Il n’aimait pas à se baigner à une heure indue ; il n’était ni grand bâtisseur, ni curieux de mets rares, ni attentif au tissu et à la couleur de ses vêtements, ou à la beauté de ses esclaves. [Le plus souvent, même à Lanuvium, il portait le vêtement de Lorium, qu’il avait fait venir de sa maison d’en bas. A Tusculum, il empruntait son manteau ;] tout son train de vie était de la même simplicité. Il n’y avait dans ses manières rien de dur, d’inconvenant, ni de violent, rien dont on pût dire : « Il en sue ; » au contraire, il examinait chaque chose séparément, comme à loisir, sans précipitation, avec méthode, avec force, et de la façon la mieux appropriée. On aurait pu lui appliquer ce qu’on rapporte de Socrate, qu’il pouvait aussi bien s’abstenir que jouir de tout ce dont la plupart des hommes ont tant de peine à se priver, et dont ils jouissent avec si peu de retenue. Avoir la force de se contenir et de se priver dans les deux cas est la marque d’une âme bien équilibrée et invincible, telle que parut la sienne pendant la maladie de Maximus.
17
Voici, enfin, ce que je dois aux Dieux : j’ai eu de bons aïeuls, de bons parents, une bonne sœur, de bons maîtres ; mes familiers, mes parents, mes amis ont presque tous été bons. Je ne me suis jamais laissé aller à manquer de tact avec aucun d’entre eux, bien que je fusse d’un tempérament à le faire, à l’occasion ; la bonté des Dieux n’a pas permis le concours de circonstances où j’aurais commis cette faute. Grâce à eux, je n’ai pas été trop longtemps élevé par la concubine de mon grand-père, j’ai conservé la fleur de ma jeunesse ; loin de devenir homme avant le temps, j’ai même différé au delà. J’ai eu pour maître et pour père un homme qui devait me corriger de tout orgueil et me mettre dans l’esprit qu’il est possible de vivre dans une cour sans avoir besoin de gardes du corps, de vêtements éclatants, de torches, de statues et de tout cet appareil pompeux ; qu’on peut, au contraire, s’y réduire presque au train d’un simple particulier, sans être pour cela plus humble et plus lâche en face des devoirs qu’impose le gouvernement de l’État. J’ai eu un frère dont l’exemple pouvait m’exciter à me surveiller moi-même, et qui me charmait par sa déférence et sa tendresse. Mes enfants n’ont été ni dépourvus d’intelligence ni contrefaits. Je n’ai pas fait de trop rapides progrès dans la rhétorique, la composition poétique et d’autres exercices auxquels je me serais peut-être attaché, si j’avais senti que j’y réussissais bien. Je me suis hâté d’assurer à mes parents les honneurs qu’ils paraissaient désirer, et je ne les ai pas laissés languir dans l’espérance que, puisqu’ils étaient encore jeunes, je le ferais plus tard. C’est aussi grâce aux Dieux que j’ai connu Apollonius, Rusticus, Maximus. Je me suis fait, en les connaissant, une idée claire et répétée de ce que c’est que vivre conformément à la nature, et, autant que cela dépendait des Dieux, de leurs dons, des conceptions et des inspirations qui me venaient d’eux, rien ne m’a dès lors empêché de vivre conformément à la nature. Si j’y ai manqué en quelque chose, c’est par ma propre faute, c’est pour n’avoir pas observé les recommandations, et pour ainsi dire l’enseignement des Dieux. C’est grâce à eux que mon corps a résisté si longtemps à la vie que je mène, que je n’ai touché ni à Bénédicta ni à Theodotus, et que, saisi tard par les passions de l’amour, je m’en suis guéri. J’ai été parfois irrité contre Rusticus, mais je ne suis jamais allé jusqu’à des actes dont je me serais repenti. Ma mère, qui devait mourir jeune, a habité avec moi pendant ses dernières années. Toutes les fois que j’ai voulu venir en aide à un pauvre ou à un homme ayant quelque besoin, jamais je n’ai entendu objecter que je n’avais pas d’argent pour le secourir. Je n’ai jamais eu moi-même besoin de recourir à un autre pour le même objet. Je dois aussi aux Dieux d’avoir eu une femme si douce, si tendre, si simple ; d’avoir trouvé facilement pour mes enfants les meilleurs des maîtres. Des songes m’ont, comme un oracle, révélé des remèdes contre mes indispositions et particulièrement contre les crachements de sang et les vertiges, et cela à Gaète. Quand j’ai été séduit par la philosophie, je ne suis pas tombé dans les mains d’un sophiste, je ne me suis pas appesanti à déchiffrer les écrivains, à décomposer des syllogismes, à étudier les phénomènes célestes. Je n’aurais jamais eu tant de bonheurs sans l’assistance des Dieux et de la Bonne-Fortune.
Écrit chez les Quades, sur les bords du Granua.
LIVRE II
Se dire à soi-même, dès le matin : je vais me rencontrer avec un fâcheux, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Ils ont tous ces vices par suite de leur ignorance du bien et du mal. Mais moi, qui ai examiné la nature du bien, qui est d’être beau, et celle du mal, qui est d’être laid, et celle de l’homme vicieux lui-même, considérant qu’il a la même origine que moi, qu’il est issu non du même sang ni de la même semence, mais de la même intelligence, et qu’il est comme moi en possession d’une parcelle de la divinité, je ne puis recevoir aucun tort de ces hommes parce qu’aucun d’eux ne pourra me déshonorer ; je ne puis non plus ni m’irriter contre un frère ni m’éloigner de lui. Nous sommes nés pour l’action en commun, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées des dents d’en haut et d’en bas. Agir les uns contre les autres est contraire à la nature, et c’est agir les uns contre les autres que de s’indigner et de se détourner.
2
Qu’est-ce donc que ceci, qui constitue mon être ? De la chair, un souffle, le principe dirigeant. Laisse là tous les livres ; cesse de te disperser. Cela ne t’appartient plus. Mais, comme si tu étais sur le point de mourir, méprise la chair ; ce n’est que du sang, des os, un tissu fragile de nerfs, de veines et d’artères. Et vois ce qu’est ce souffle : du vent, qui n’est pas toujours le même, mais qu’à tout moment tu rejettes pour l’aspirer de nouveau. Reste donc le principe dirigeant. Eh bien, réfléchis : tu es vieux ; ne le laisse pas s’asservir, ne le laisse pas se mouvoir capricieusement et céder à des impulsions égoïstes, ne le laisse pas murmurer contre ton sort présent et redouter ton sort à venir.
3
Ce que font les Dieux est plein de leur providence. Ce que fait la Fortune ne se produit pas hors de la nature, hors de la trame et de l’enchaînement des choses que règle la Providence ; tout découle de là. Ajoutons-y la nécessité et l’utilité de l’ensemble de l’univers dont tu es une partie. Or, ce que comporte la nature du tout, et ce qui sert à la conserver, est bon pour chaque partie de cette nature. Les transformations des éléments aussi bien que celles des composés contribuent à conserver l’univers. Que ces dogmes te suffisent pour toujours. Repousse la soif des livres, pour mourir sans murmurer, mais avec tranquillité, en remerciant les Dieux du fond du cœur.
4
Rappelle-toi depuis combien de temps tu diffères, à combien d’échéances fixées par les Dieux tu n’as pas répondu. Il faut enfin que tu comprennes quel est cet univers dont tu fais partie ; quel est l’ordonnateur de l’univers dont tu es une émanation ; que ta durée est enfermée dans des limites déterminées. Si tu n’emploies pas ce temps à te procurer la sérénité, il disparaîtra, tu disparaîtras aussi, — et il ne reviendra plus.
5
À chaque heure du jour applique fortement ta réflexion, comme un Romain et comme un homme, à remplir tes fonctions exactement, avec sérieux et sincérité, avec charité, suivant la liberté et la justice ; débarrasse-toi de toute autre représentation. Tu y réussiras si tu accomplis chacune de tes actions comme la dernière de ta vie, te délivrant ainsi de toute légèreté, de toute répugnance passionnelle pour les commandements de la raison ; tu seras libre d’hypocrisie, de l’amour-propre, de la mauvaise humeur vis-à-vis de la destinée. Tu vois le peu d’obstacles qu’il suffit de vaincre pour vivre une vie au cours régulier et pareille à celle des Dieux ; les Dieux, en effet, ne demanderont pas autre chose à celui qui observera ces règles.
6
Tu t’es outragée, tu t’es outragée toi-même, ô mon âme, mais tu n’auras plus l’occasion de t’honorer toi-même, car notre vie à tous est courte. La tienne est presque achevée sans que tu te sois respectée, parce que tu as mis ton bonheur dans les âmes des autres.
7
Tu es distrait par les incidents extérieurs ; donne-toi le loisir de toujours ajouter quelque chose à ta connaissance du bien et cesse de t’étourdir en vain. Préserve-toi, en outre, d’une autre cause d’erreur. C’est folie que de se fatiguer à agir dans la vie, sans avoir un but où diriger toutes les tendances de notre âme et toutes nos idées sans exception.
8
On trouverait difficilement quelqu’un qui soit malheureux pour ne pas examiner ce qui se passe dans l’âme des autres, mais ceux qui ne suivent pas avec attention les mouvements de leur propre âme sont fatalement malheureux.
9
Se rappeler toujours ceci : quelle est la nature de l’univers et quelle est la mienne ? qu’est celle-ci par rapport à la première ? quelle partie de quel tout est-elle ? Et ceci : nul ne peut t’empêcher d’agir toujours et de parler conformément à la nature dont tu es une partie.
10
C’est en philosophe que Théophraste, comparant entre elles les fautes et les jugeant comme le ferait le sens communs, déclare les infractions de la concupiscence plus graves que celles de la colère. L’homme irrité agit sous l’effet d’une certaine douleur qui contracte secrètement son âme et le détourne de la raison ; celui qui pèche par concupiscence est esclave du plaisir ; il est évidemment plus déréglé et plus efféminé. Théophraste disait donc avec raison et en vrai philosophe que la faute accompagnée de plaisir mérite d’être plus sévèrement reprochée que celle qui vient de la douleur. Bref, dans un cas, le coupable est comme victime d’une injustice, et c’est la douleur qui le force à se mettre en colère; dans l’autre, il court de son plein gré à l’injustice et se hâte d’agir pour satisfaire sa concupiscence.
11