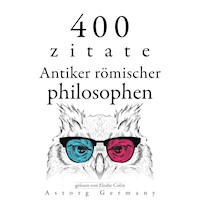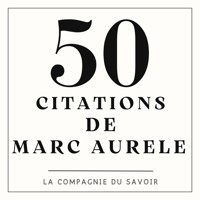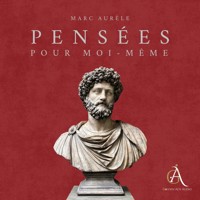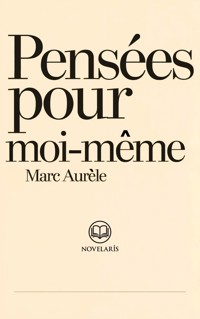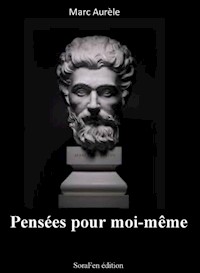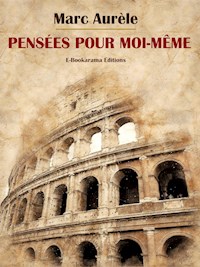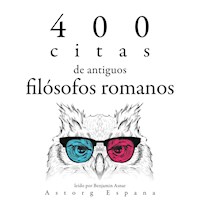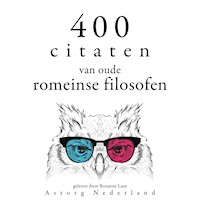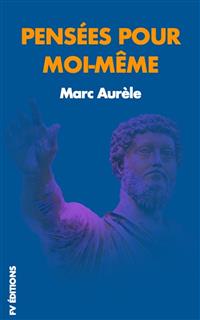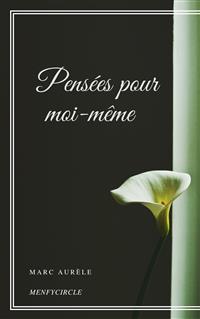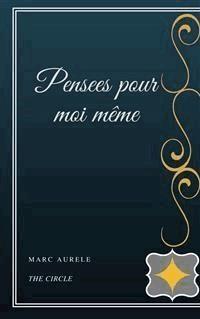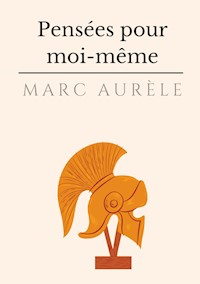
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Pensées pour moi-même" de Marc Aurèle est une oeuvre introspective qui plonge le lecteur dans les réflexions personnelles de l'empereur romain. Connu pour sa sagesse et son leadership, Marc Aurèle a consigné ses pensées et ses méditations, offrant un aperçu unique de sa philosophie stoïcienne. Ce texte, rédigé principalement pour lui-même, explore des thèmes universels tels que la vertu, la raison, la nature humaine et la mortalité. À travers ses écrits, Marc Aurèle encourage la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité et l'acceptation de l'ordre naturel des choses. Son approche stoïcienne prône une vie en accord avec la nature et l'importance de vivre dans le moment présent. Les "Pensées" sont non seulement une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à mener une vie vertueuse, mais elles offrent également une perspective historique précieuse sur la vie d'un des plus grands empereurs de Rome. Ce texte intemporel continue d'influencer les philosophes, les leaders et les individus en quête de sagesse et de tranquillité intérieure. Marc Aurèle, à travers ses écrits, nous rappelle l'importance de la réflexion personnelle et de la quête de la sagesse dans notre vie quotidienne. L'AUTEUR : Marc Aurèle, né en 121 après J.-C., est l'un des empereurs romains les plus respectés et un fervent adepte de la philosophie stoïcienne. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux, il devient empereur en 161 après J.-C. Son règne est marqué par des guerres, des réformes administratives et une gestion sage de l'Empire. Toutefois, ce qui distingue Marc Aurèle, c'est sa dévotion à la philosophie. Influencé par les stoïciens tels qu'Épictète, il consacre une grande partie de son temps à l'étude et à l'écriture de ses réflexions personnelles, qui seront plus tard publiées sous le titre "Pensées pour moi-même". Ces écrits, rédigés en grec, ne visaient pas la publication, mais servaient de guide personnel pour mener une vie vertueuse. Marc Aurèle est souvent décrit comme le "philosophe-roi", une figure idéale qui incarne la sagesse et la justice. Sa philosophie stoïcienne, centrée sur la rationalité, la maîtrise de soi et l'acceptation stoïque du destin, continue d'influencer de nombreux penseurs contemporains. Marc Aurèle décède en 180 après J.-C., laissant derrière lui un héritage philosophique et politique durable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
LIVRE I
LIVRE II
LIVRE III
LIVRE IV
LIVRE V
LIVRE VI
LIVRE VII
LIVRE VIII
LIVRE IX
LIVRE X
LIVRE XI
LIVRE XII
LIVRE I
I. — De 1 mon grand-père Vérus 2 : la bonté coutumière, le calme inaltérable.
II. — De la réputation et du souvenir que laissa mon père 3 : la réserve et la force virile.
III. — De ma mère 4 : la piété, la libéralité, l’habitude de s’abstenir non seulement de mal faire, mais de s’arrêter encore sur une pensée mauvaise. De plus : la simplicité du régime de vie, et l’aversion pour le train d’existence que mènent les riches.
IV. — De mon bisaïeul 5 : n’avoir point fréquenté les écoles publiques ; avoir, à domicile, bénéficié de bons maîtres, et avoir compris qu’il faut, pour de telles fins, largement dépenser.
V. — De mon précepteur : n’avoir point pris parti pour les Verts ni les Bleus, pour les Courts ni pour les Longs-Boucliers 6 ; supporter la fatigue et se contenter de peu ; faire soi-même sa besogne, et ne pas s’ingérer dans une foule d’affaires ; mal accueillir la calomnie.
VI. — De Diognète 7 : réprouver les futilités ; ne point ajouter foi à ce que racontent les charlatans et les magiciens sur les incantations, la conjuration des esprits et autres contes semblables ; ne pas nourrir des [32] cailles ni s’engouer pour des folies de ce genre ; avoir pris goût à la philosophie, et avoir eu pour maîtres d’abord Bacchius, puis Tandasis et Marcianos 8 ; m’être appliqué, dès l’enfance, à composer des dialogues ; avoir opté pour un lit dur et de simples peaux, et pour toutes les autres pratiques de la discipline hellénique.
VII. — De Rusticus 9 : avoir pris conscience que j’avais besoin de redresser et de surveiller mon caractère ; avoir évité de se passionner pour la sophistique, de rédiger des traités, de déclamer de piteux discours exhortatifs, et de frapper les imaginations pour se montrer un homme actif et bienfaisant ; m’être détaché de la rhétorique, de la poétique et de l’art de parler avec trop d’élégance ; m’être interdit de me promener en toge à la maison, et d’étaler quelque autre faste ; écrire mes lettres avec simplicité, comme était celle qu’il écrivit lui-même de Sinuesse 10 à ma mère ; envers ceux qui nous ont irrités et offensés, être disposé à l’indulgence et à la réconciliation, aussitôt qu’ils veulent revenir ; lire avec attention, et ne pas se contenter d’une intelligence globale ; ne pas accorder aux bavards un prompt assentiment ; avoir pu connaître les écrits conservant les leçons d’Epictète, écrits qu’il me communiqua de sa bibliothèque.
VIII. — D’Apollonius 11 : l’indépendance et la décision sans équivoque et sans recours aux dés ; ne se guider sur rien autre, même pour peu de temps, que sur la raison ; rester toujours le même, dans les vives souffrances, la perte d’un enfant, les longues maladies ; avoir vu clairement, sur un vivant modèle, que le même homme peut être très énergique en même temps que doux ; ne se pas s’impatienter au cours de ses explications ; avoir vu un homme qui visiblement estimait comme le moindre de ses mérites, l’expérience et l’habileté à transmettre les principes des sciences ; avoir appris comment il faut recevoir de nos amis ce qui passe pour être des services, sans se laisser diminuer par ces bons offices, sans grossièrement les refuser.
IX. — De Sextus 12 : la bienveillance ; l’exemple de ce qu’est une maison soumise aux volontés du père ; l’intelligence de ce que c’est que vivre conformément à la nature ; la gravité sans affectation ; la sollicitude attentive pour les amis ; la patience envers les ignorants et envers ceux qui décident sans avoir réfléchi ; l’art de s’accommoder à toutes espèces de gens, de telle sorte que son commerce était plus agréable que toute flatterie, et qu’il leur imposait, par la même occasion, le plus profond respect ; l’habileté à découvrir avec intelligence et méthode et à classer les préceptes nécessaires à la vie ; et ceci, qu’il ne montra jamais l’apparence de la colère ni d’aucune autre passion, mais qu’il était à la fois le moins passionné et le plus tendre des hommes ; l’art de savoir sans bruit adresser des louanges, de connaître beaucoup sans chercher à briller.
X. — D’Alexandre le grammairien 13 : s’abstenir de blâmer ; ne pas critiquer d’une façon blessante ceux qui ont commis un barbarisme, un solécisme, ou quelque autre faute choquante, mais amener adroitement le seul terme qu’il fallait proférer, sous couvert de réponse, de témoignage à l’appui, ou de commun débat sur le fond même du sujet, et non sur la forme, ou par quelque autre moyen d’avertissement occasionnel et discret.
XI. — De Fronton 14 : avoir observé à quel degré d’envie, de souplesse et de dissimulation les tyrans en arrivent, et que, pour la plupart, ceux que chez nous nous appelons patriciens sont, en quelque manière, des hommes sans cœur.
XII. — D’Alexandre le Platonicien 15 : ne pas, souvent et sans nécessité, dire à quelqu’un ou mander par lettre : « Je n’ai pas le temps. » Et, par ce moyen, constamment ajourner les obligations que commandent les relations sociales, en prétextant l’urgence des affaires.
XIII. — De Catulus 16 : ne jamais être indifférent [34] aux plaintes d’un ami, même s’il arrive que ce soit sans raison qu’il se plaigne, mais essayer même de rétablir nos relations familières ; souhaiter du fond du cœur du bien à ses maîtres, ainsi que faisaient, comme on le rapporte, Domitius et Athénodote 17 ; avoir pour ses enfants une véritable affection.
XIV. — De mon frère Sévérus 18 : l’amour du beau, du vrai, du bien ; avoir connu, grâce à lui, Thraséas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus 19 ; avoir conçu l’idée d’un état juridique fondé sur l’égalité des droits, donnant à tous un droit égal à la parole, et d’une royauté qui respecterait avant tout la liberté des sujets. Et de lui aussi : l’estime constante et soutenue pour la philosophie ; la bienfaisance, la libéralité assidue ; la confiance et la foi en l’amitié de ses amis ; ne pas déguiser ses reproches envers ceux qui se trouvaient les avoir mérités, et ne pas laisser ses amis se demander : « Que veut-il, ou que ne veut-il pas ? » mais être d’une évidence nette.
XV. — De Maximus 20 : être maître de soi et ne pas se laisser entraîner par rien ; la bonne humeur en toutes circonstances, même dans les maladies ; l’heureux mélange, dans le caractère, de douceur et de gravité ; l’accomplissement sans difficulté de toutes les tâches qui se présentaient ; la conviction où tous étaient qu’il parlait comme il pensait et qu’il agissait sans intention de mal faire ; ne point s’étonner ni se frapper ; ne jamais se hâter, ni tarder, ni se montrer irrésolu ou accablé ; ne pas rire à gorge déployée, pour redevenir irritable ou défiant ; être bienfaisant, magnanime et loyal ; donner l’idée d’un caractère droit plutôt que redressé. Et ceci encore : que personne n’a jamais pu se croire méprisé par lui, ni osé se prendre pour meilleur que lui ; la bonne grâce, enfin.
XVI. — De mon père 21 : la mansuétude, et l’inébranlable attachement aux décisions mûrement réfléchies ; l’indifférence pour la vaine gloire que donne ce [35] qui passe pour être des honneurs ; l’amour du travail et la persévérance ; prêter l’oreille à ceux qui peuvent apporter quelque conseil utile à la communauté ; inexorablement attribuer à chacun selon son mérite ; l’art de savoir quand il faut se raidir, quand se relâcher ; le moment où il faut mettre un terme aux amours pour les adolescents ; la sociabilité ; la faculté laissée à ses amis de ne pas toujours manger à sa table et de ne point partir obligatoirement en voyage avec lui, mais être retrouvé toujours le même par ceux qui avaient dû, pour certaines affaires, s’en éloigner ; le soin scrupuleux de tout peser dans les délibérations, de persister et de ne jamais abandonner une enquête, en se montrant satisfait des apparences faciles ; l’art de conserver ses amis, de ne jamais s’en dégoûter ni de s’en rendre éperdument épris ; la capacité de se suffire en tout par soi-même et d’être serein ; prévoir de loin et régler d’avance les plus petits détails sans outrance tragique ; réprimer les acclamations et toute flatterie à son adresse ; veiller sans cesse aux nécessités de l’Empire, ménager les ressources et supporter ceux qui le blâmaient d’une telle conduite ; envers les Dieux, point de superstition ; envers les hommes, nulle recherche de popularité, ni désir de plaire ou de gagner la faveur de la foule ; mais, modéré en tout, résolu, jamais mal élevé ni possédé par le besoin d’in-nover ; user à la fois, sans morgue et sans détour, des biens qui donnent de l’agrément à l’existence — et la Fortune les lui avait en abondance offerts — de sorte qu’il en usait sans orgueil comme sans détour, s’il les trouvait à sa portée, et qu’il n’en sentait pas le besoin, s’ils lui manquaient. Et ceci : que personne n’a pu dire qu’il fût un sophiste, une âme triviale, un désœuvré, mais au contraire que c’était un homme mûr, accompli, inaccessible à la flatterie et susceptible de diriger et ses propres affaires et celles des autres. Et encore : respecter les Vrais servants de la philosophie ; et, quant aux autres, ne point les offenser ni se laisser leurrer par eux. Et ceci : son commerce agréable et sa bonne grâce infastidieuse ; le soin mesuré qu’il prenait de son corps, non pas en homme amoureux [36] de la vie, mais sans coquetterie comme sans négligence : aussi, grâce au soin qu’il eut de sa propre personne, presque jamais il ne fit appel à la médecine, aux remèdes et aux topiques. Et surtout : son art de s’effacer sans jalousie devant ceux qui s’étaient acquis quelque supériorité, comme, par exemple, dans la facilité de l’élocution, la connaissance des lois, des coutumes ou de toute autre matière, et son empressement à faire que chacun, selon sa spéciale capacité, soit honoré ; suivre en tout les traditions ancestrales sans afficher la prétention de garder les traditions des aïeux. Et ceci : ne pas aimer à se déplacer ni à s’agiter, mais se plaire à rester dans les mêmes lieux et dans les mêmes occupations ; après de violents accès de maux de tête, revenir aussitôt, avec un nouvel entrain et une pleine vigueur, à ses travaux coutumiers ; se souvenir qu’il n’eut pas beaucoup de secrets, mais fort peu et de très peu fréquents, et seulement à propos des intérêts de l’État ; sa sagacité et sa mesure dans la célébration des fêtes, dans la construction des édifices, les distributions et autres choses analogues, tel un homme qui ne regarde qu’à ce qu’il doit faire et non pas à la gloire que lui vaudra ce qu’il fait ; ne pas se baigner en temps inopportun ; ne pas aimer à construire des maisons ; ne pas se tracasser au sujet du manger, ni à propos du tissu ou de la couleur de ses vêtements, ni pour la tournure de ses serviteurs ; il tirait sa toge, de Lorium 22, de sa ferme d’en bas, et la plupart des vêtements qu’il portait en Lanuvium 23 ; à Tusculum 24, il demandait à son intendant ce qu’il lui fallait, et toute sa mise était à l’avenant. Personne ne le vit jamais dur, ni soupçonneux, ni emporté, de sorte que jamais on ne put dire de lui : « Il en sue ! » Mais toutes ses actions étaient distinctement réfléchies, comme à loisir, sans trouble, avec ordre, vigueur et accord dans leur suite. On pourrait lui appliquer ce qu’on rapporte de Socrate, qu’il était aussi capable de se priver que de jouir de ces biens, dont la plupart des hommes ne peuvent être privés sans amoindrissement ni en jouir sans s’y abandonner. Être fort et maître de soi, modéré dans les deux [37] cas, sont d’un homme ayant une âme équilibrée et inébranlable, comme il le montra dans la maladie dont il mourut.
XVII. — Des Dieux : avoir eu de bons aïeuls, de bons générateurs, une bonne sœur 25, de bons parents, de bons serviteurs, des proches et des amis presque tous bons ; ne m’être jamais laissé entraîner à aucune négligence vis-à-vis d’aucun d’eux, bien que j’eusse un caractère qui m’aurait permis, si l’occasion s’en était offerte, de m’en rendre coupable : c’est un bienfait des Dieux, s’il ne s’est trouvé aucun concours de circonstances qui aurait dû me confondre ; n’avoir pas été élevé trop longtemps chez la concubine de mon grand-père ; avoir conservé la fleur de ma jeunesse, et ne pas avoir prématurément fait acte de virilité, mais en avoir même retardé le moment ; avoir été sous les ordres d’un prince, d’un père qui devait m’enlever tout orgueil et m’amener à comprendre qu’il est possible de vivre à la cour sans avoir besoin de gardes du corps, de vêtements de parade, de lampadaires, de statues, de choses analogues et d’un luxe semblable, mais qu’il est possible de se réduire presque au train de vie d’un simple particulier, sans déchoir pour cela ou se montrer plus négligent, lorsqu’il s’agit de s’acquitter en chef de ses devoirs d’État ; avoir obtenu un frère 26 tel qu’il pouvait, par son caractère, m’inciter à me rendre vigilant sur moi-même et qui, en même temps, me rendît heureux par sa déférence et par son affection ; n’avoir pas eu des enfants 27 disgraciés, ni contrefaits ; n’avoir point fait de trop grands progrès en rhétorique, en poétique et en d’autres arts qui m’eussent peut-être retenu, si j’avais senti que j’y faisais de bons progrès ; avoir prévenu mes maîtres, en les établissant dans la dignité qu’ils me semblaient désirer, et ne m’être point remis à l’espoir, puisqu’ils étaient encore jeunes, que je pourrais plus tard réaliser ce dessein ; avoir connu Apollonius, Rusticus, Maximus ; m’être représenté clairement et maintes fois ce que c’est qu’une vie conforme à la nature, de sorte que, dans la mesure où cela dépend des Dieux, [38] des communications, des secours et des inspirations qui nous viennent d’eux, rien ne m’a, depuis longtemps, empêché de vivre conformément à la nature : si je suis encore éloigné du but, c’est par ma faute, et parce que je ne tiens pas compte des avertissements des Dieux et, pour ainsi dire, de leurs leçons ; avoir eu un corps assez résistant pour aussi longtemps supporter une pareille vie ; n’avoir touché ni à Benedicta, ni à Theodotus 28, et, plus tard, si j’ai été atteint par les passions amoureuses, m’en être guéri ; dans mon ressentiment contre Rusticus, n’avoir commis aucun excès dont j’aurais eu à me repentir ; que ma mère, qui devait mourir jeune, ait pu toutefois passer auprès de moi ses dernières années ; toutes les fois que j’ai voulu secourir un homme dans la gêne ou dans quelque autre besoin, ne m’être jamais entendu répondre que je n’avais plus d’argent pour me le permettre ; n’être pas personnellement tombé dans une pareille nécessité, de façon à devoir réclamer l’aide d’autrui ; avoir eu une femme 29 comme la mienne, si obéissante, si tendre, si simple ; avoir facilement trouvé d’excellents maîtres 30 pour mes enfants ; avoir obtenu en songe la révélation de divers remèdes, et en particulier contre les crachements de sang et les vertiges, et cela, à Gaète 31, comme par oracle ; lorsque j’eus pris goût à la philosophie, n’être pas tombé sur quelque sophiste, et ne point m’être attardé à l’analyse des auteurs ou des syllogismes, ni à observer les phénomènes célestes.
Tout ceci exige le secours des Dieux et de la Fortune.
1 Dans ce livre, Marc-Aurèle établit ce qu’il doit à chacun de ses aïeux, de ses parents, de ses amis, de ses éducateurs, et se propose comme modèles les exemples qu’ils lui ont donnés.
2 Annius Vérus, dans la maison duquel Marc-Aurèle fut élevé. Ancien préfet de Rome, deux fois consul, élevé au rang des sénateurs, Vérus, après la mort de son propre fils, avait adopté son petit-fils.
3 P. Annius Vérus, qui mourut encore jeune.
4 Domitia Lutina, fille de Celvisius Tullus, qui fut deux fois consul.
5 Il s’agit ici, sans doute, du bisaïeul maternel de Marc-Aurèle, Catilius Sévérus, deux fois consul et préfet de Rome.
6 Le nom de ce précepteur nous est inconnu. Les Verts et les Bleus, les Courts Boucliers et les Longs Boucliers sont les couleurs et les armes des gladiateurs ou des cochers du cirque, et le nom des factions de leurs partisans.
7 Diotogène était un peintre et un savant philosophe.
8 Nous ne savons rien de Bacchius et de Tandasis. Marcianus est peut-être Volusius Maecianus, qui enseigna le droit à Marc-Aurèle.
9 Junius Rusticus, stoïcien et conseiller intime de Marc-Aurèle.
10 Ville de Campanie.
11 Apollonius, de Chalcédoine ou de Chalcis, philosophe stoïcien.
12 Sextus de Chéronée, stoïcien, neveu de Plutarque.
13 Alexandre de Séleucie, grammairien, avait écrit un commentaire des poèmes d’Homère, et appris le grec à Marc-Aurèle.
14 Cornélius Fronton, le plus connu et le plus aimé des maîtres de Marc-Aurèle.
15 Selon Philostrate, cet Alexandre aurait été le secrétaire grec de Marc-Aurèle.
16 Cinna Catulus, stoïcien, inconnu par ailleurs.
17 Domitius est inconnu. Athénodote était le maître de Fronton.
18 Claudius Sévérus, péripatéticien. Son fils épousa Fadilla, seconde fille de Marc-Aurèle. Le mot frère est ici un terme d’amitié, ou bien désigne-t-il un cousin, un descendant de Catilius Sévérus ?
19 Stoïciens bien connus.
20 Claudius Maximus, stoïcien. Nommé consul par Marc-Aurèle, il fut ensuite légat en Pannonie supérieure, puis proconsul en Afrique.
21 II s’agit ici du père adoptif de Marc-Aurèle et de son oncle par alliance, l’empereur Antonin.
22 Lorium, sur la voie Aurélia, était une petite bourgade à la frontière de l’Étrurie et du Latium. Antonin y possédait une maison de campagne, où il habitait souvent et où il mourut en 161.
23 Lanuvium, ville du Latium, au sud de Rome.
24 Tusculum, ville du Latium, près de Frascati.
25 Annia Tornificia.
26 Lucius Vérus, frère d’adoption de Marc-Aurèle, dont la conduite fut loin d’être exemplaire.
27 Marc-Aurèle eut de Faustine trois fils : Vérus et Antonin, qui moururent jeunes, et Commode, qui lui succéda. Il eut aussi trois ou quatre filles Lucilla, Fadilla, Cornificia.
28 Benedicta et Théodotus nous sont inconnus.
29 Faustine la Jeune.
30 On cite parmi les maîtres que Marc-Aurèle donna à Commode : Onésicrate, Aristius Capella, Atéius Sanctius.
31 Gaète, ville sur la côte du Latium.
LIVRE II
I. — Dès l’aurore, dis-toi par avance : « Je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux. Pour moi, ayant jugé que la nature du bien est le beau, que celle du mal est le laid, et que la nature du coupable lui-même est d’être mon parent, non par la communauté du sang ou d’une même semence, mais par celle de l’intelligence et d’une même parcelle de la divinité, je ne puis éprouver du dommage de la part d’aucun d’eux, car aucun d’eux ne peut me couvrir de laideur. Je ne puis pas non plus m’irriter contre un parent, ni le prendre en haine, car nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celle d’en haut et celle d’en bas. Se comporter en adversaires les uns des autres est donc contre nature, et c’est agir en adversaire que de témoigner de l’animosité et de l’aversion. »
II. — Tout ce que je suis, c’est une chair, avec un souffle et un principe directeur. Renonce aux livres ; ne te laisse pas absorber : ce ne t’est point permis. Mais, comme un homme déjà en passe de mourir, méprise la chair : sang et poussière, petits os, tissu léger de nerfs et entrelacement de veines et d’artères. Examine aussi ce qu’est le souffle : du vent qui n’est pas toujours le même car à tout moment tu le rends pour en avaler [40] d’autre. Il te reste, en troisième lieu, le principe directeur. Pense à ceci : tu es vieux ; ne permets plus qu’il soit esclave, qu’il soit encore comme tiré par les fils d’une égoïste impulsion, ni qu’il s’aigrisse contre son sort actuel, ou bien qu’il appréhende celui qui doit venir.
III. — Les œuvres des Dieux sont pleines de providence ; celles de la Fortune ne se font pas sans la nature ou sans être filées et tissées avec les événements que dirige la Providence. Tout découle de là. De plus, tout ce qui arrive est nécessaire et utile au monde universel, dont tu fais partie. Aussi, pour toute partie de la nature, le bien est-il ce que comporte la nature universelle et ce qui est propre à sa conservation. Or, ce qui conserve le monde, ce sont les transformations des éléments, aussi bien que celles de leurs combinaisons. Que cela te suffise et te serve de principes. Quant à ta soif de livres, rejette-la, afin de ne pas mourir en murmurant, mais véritablement apaisé et le cœur plein de gratitude envers les Dieux.
IV. — Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard et combien de fois, ayant reçu des Dieux des occasions de t’acquitter, tu ne les as pas mises à profit. Mais il faut enfin, dès maintenant, que tu sentes de quel monde tu fais partie, et de quel être, régisseur du monde, tu es une émanation, et qu’un temps limité te circonscrit. Si tu n’en profites pas, pour accéder à la sérénité, ce moment passera ; tu passeras aussi, et jamais plus il ne reviendra.
V. — À tout moment, songe avec gravité, en Romain et en mâle, à faire ce que tu as en mains, avec une stricte et simple dignité, avec amour, indépendance et justice, et à donner congé à toutes les autres pensées. Tu le leur donneras, si tu accomplis chaque action comme étant la dernière de ta vie, la tenant à l’écart de toute irréflexion, de toute aversion passionnée qui t’arracherait à l’empire de la raison, de toute feinte, de tout [41] égoïsme et de tout ressentiment à l’égard du destin. Tu vois combien sont peu nombreux les préceptes dont il faut se rendre maître pour pouvoir vivre d’une vie paisible et passée dans la crainte des Dieux, car les Dieux ne réclameront rien de plus à qui les observe.
VI. — Injurie-toi, injurie-toi, ô mon âme ! Tu n’auras plus l’occasion de t’honorer toi-même. Brève, en effet, est la vie pour chacun. La tienne est presque achevée, et tu n’as pas de respect pour toi-même, car tu mets ton bonheur dans les âmes des autres.
VII. — Les accidents du dehors te distraient-ils ? Donne-toi le loisir d’apprendre quelque bonne vérité, et cesse de te laisser emporter par le tourbillon. Evite aussi désormais cet autre égarement. Insensés, en effet, sont ceux qui, à force d’agir, sont fatigués par la vie, et n’ont pas un but où diriger tout leur élan et, tout à la fois, leur pensée tout entière.
VIII. — Il n’est pas facile de voir un homme malheureux pour n’avoir point arrêté sa pensée sur ce qui passe dans l’âme d’un autre. Quant à ceux qui ne se rendent pas compte des mouvements de leur âme propre, c’est une nécessité qu’ils soient malheureux.
IX. — Il faut toujours se souvenir de ceci : quelle est la nature du Tout ? Quelle est la mienne ? Comment celle-ci se comporte-t-elle à l’égard de celle-là ? Quelle partie de quel Tout est-elle ? Noter aussi que nul ne peut t’empêcher de toujours faire et de dire ce qui est conforme à la nature dont tu fais partie.
X. — C’est en philosophe que Théophraste 32 affirme, dans sa comparaison des fautes, comme le ferait un homme qui les comparerait en se référant au sens commun, que les fautes commises par concupiscence sont plus graves que celles qui le sont par colère. L’homme en colère, en effet, paraît s’écarter de la raison avec quelque douleur et avec un certain resserrement [42] sur soi-même. Mais celui qui pèche par concupiscence, vaincu par la volupté, se montre en quelque sorte plus relâché et plus charmé dans ses fautes. À bon droit donc et en vrai philosophe, Théophraste a dit que celui qui faute avec plaisir mérite un plus grand blâme que celui qui pèche avec douleur. En somme, l’un ressemble plutôt à un homme offensé et forcé, par douleur, à se mettre en colère ; l’autre s’est jeté de lui-même dans l’injustice, se portant à faire ce à quoi l’incite la concupiscence.
XI. — Tout faire, tout dire et tout penser, en homme qui peut sortir à l’instant de la vie. Quitter les hommes, s’il y a des Dieux, n’a rien de redoutable, car ceux-ci ne sauraient te vouer au malheur. Mais, s’il n’y en a pas, ou s’ils n’ont aucun soin des choses humaines, qu’ai-je affaire de vivre dans un monde sans Dieux et vide de Providence ? Mais ils existent et ils ont soin des choses humaines, et, pour que l’homme ne tombe pas dans les maux qui sont des maux véritables, ils lui en ont donné tous les moyens. S’il était quelque mal en dehors de ces maux, les Dieux y auraient également pourvu, afin que tout homme fût maître d’éviter d’y tomber. Mais, comment ce qui ne rend pas l’homme pire pourrait-il rendre pire la vie de l’homme ? Ce n’est point pour l’avoir ignoré ni pour en avoir eu connaissance sans pouvoir le prévenir ou le corriger, que la nature universelle aurait laissé passer ce mal ; elle ne se serait pas, par impuissance ou par incapacité, trompée au point de faire échoir indistinctement aux bons et aux méchants une part égale de biens et de maux ? Or, la mort et la vie, la gloire et l’obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, toutes ces choses échoient également aux bons et aux méchants, sans être par elles-mêmes ni belles ni laides. Elles ne sont donc ni des biens ni des maux.
XII. — Comme tout s’évanouit promptement : les corps eux-mêmes dans le monde, et leur souvenir dans la durée ! Tels sont tous les objets sensibles, et particulièrement [43] ceux qui nous amorcent par l’appât du plaisir, qui nous effraient par l’idée de la douleur, ou bien qui nous font jeter des cris d’orgueil. Que tout cela est vil, méprisable, abject, putride et mort, aux yeux de la raison qui peut s’en rendre compte ! Que sont donc ceux dont l’opinion et la voix donnent la célébrité ? Qu’est-ce que mourir ? Si l’on envisage la mort en elle-même, et si, divisant sa notion, on en écarte les fantômes dont elle s’est revêtue, il ne restera plus autre chose à penser, sinon qu’elle est une action naturelle. Or celui qui redoute une action naturelle est un enfant. La mort pourtant n’est pas uniquement une action naturelle, mais c’est encore une œuvre utile à la nature. Comment l’homme touche-t-il à Dieu ? Par quelle partie de lui-même, et comment surtout cette partie de l’homme s’y trouve-t-elle disposée ?
XIII. — Rien de plus misérable que l’homme qui tourne autour de tout, qui scrute, comme on dit, « les profondeurs de la terre33