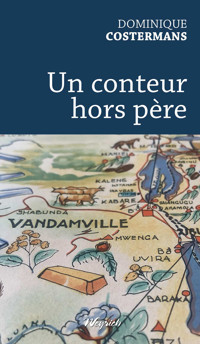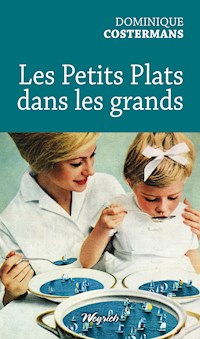
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
De la bolognaise congolaise au flan de Bon-Papa, chacun de ces Petits Plats puise avec tendresse ou drôlerie dans un moment culinaire. S’ouvre alors un monde, celui des goûts, des souvenirs d’enfance et des amours, amères ou joyeuses. Les ingrédients de leur écriture, sous l’égide de Marie Delcourt, Claire Lejeune ou Marguerite Duras, cristallisent chacun de ces fragments de vie, en une sorte de mémoire collective.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Amoureuse du texte court et de la nouvelle, genre dans lequel elle a déjà publié sept recueils,
Dominique Costermans est aussi l’autrice d’un roman,
Outre-Mère, et de plusieurs livres sur l’environnement, la santé ou le développement durable destinés aux enfants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
« Maman, pourquoi ne notes-tu pas tes recettes dans un cahier ? Toutes les mères font ça. Pourquoi ne fais-tu pas comme les autres mères ?
— Mais toutes les recettes sont sur Internet, aujourd’hui ! Pourquoi s’embêter à les noter ?
— Non, les recettes de famille ne sont pas sur Internet. Pas celles qu’on se transmet. Toutes les mères font ça, et à leur mort, les filles trouvent le cahier avec les recettes de famille. »
Marmiton.org a-t-il sonné le glas des carnets de recettes ? Sûrement au sens où le décrivait Marie Delcourt, celui « que nos mères enrichissaient pieusement depuis le jour de leur mariage jusqu’à celui de leur mort. À côté de chaque titre figure souvent un nom propre, celui de l’ami ou du parent qui a bien voulu livrer le secret d’un ragoût ou d’une timbale ». La disparition de ces carnets sera surtout celle de leur charme. Car ils sont bien plus que des carnets de recettes ; leurs pages marquées par maints effeuillages de travail, aux coins cornés, aux traces graisseuses, aux notes indéchiffrables (dates des repas, petits aménagements, noms des convives…) sont ce qui en fait non seulement une archive historique et sociologique, mais un journal intime qui ne dit pas son nom.
J’en prends pour célèbres exemples celui de Claire Lejeune et celui de Marguerite Duras, auxquels j’ajouterai celui de Marie Delcourt, citée plus haut. Trois femmes de lettres, trois femmes « attentives aux gestes quotidiens », comme le souligne Yves Namur à propos de Claire Lejeune, poète, essayiste et féministe (1926-2008), elle qui « avait des gestes de lavandière pour parler philosophie ou cuisine » (Marcel Moreau). Sa Cuisine1, ouvrage posthume, rassemble ses recettes « transmises de mères en filles, recueillies telles quelles […], les recettes des carnets, aujourd’hui en lambeaux, de ma mère et de la mère d’Edgar, et celles, transmises oralement, de Mémère Odile ». « En moi, écrit-elle en exergue de ce cahier destiné à ses filles, le goût de cuire, de faire à manger, précéda celui d’écrire, mais la popote et la poète ne cessèrent jamais de faire bon ménage, d’échanger leurs recettes, leurs tours de main. » C’est ainsi que le carnet de recettes se trouve entrelardé et farci d’extraits poétiques.
La cuisine de Marguerite2 – aujourd’hui interdit de diffusion et vendu sous le manteau – est à l’aune de ce que l’on goûte dans l’œuvre de l’immense écrivaine (1914-2008) : un certain exotisme, une étrangeté opaque, de l’énigme. « C’est difficile, écrit-elle de l’omelette vietnamienne. Il faut un feu très doux et du temps. Le secret c’est la patience. […] Il m’est arrivé de rater ce plat et je n’ai pas compris pourquoi. Les œufs devaient avoir trop cuit. Il m’est arrivé aussi de le réussir au-delà de ce que j’avais cru possible, je ne sais pas non plus pourquoi. »
Marguerite est la plus alchimiste de ces trois cuisinières-écrivaines. La cuisine (le lieu) est un creuset ; « on voudrait désapprendre aux gens à [y] manger et c’est là qu’ils se retrouvent, qu’ils vont tous le soir venu, c’est là qu’il fait chaud et qu’on reste avec la mère qui fait la cuisine ». Cuisiner, écrire sont deux expressions de la transformation, de l’œuvre au noir. Avec Marguerite, ne vous attendez pas à ce que les listes d’ingrédients soient précises et quantifiées, ni les étapes de la préparation d’un plat expliquées dans le détail. On lira la recette des Boulettes à la façon de la Grecque Melina pour l’histoire de Melina Mercouri et de Jules Dassin, et de leurs gouvernantes qui faisaient la cuisine grecque dans une chambre du Georges V. Et du fou rire entre Melina et Marguerite à Madrid, alors que Delon était venu les saluer. Et puis, « écoutez, pour le riz, écrit-elle, voilà comment il faut le faire, une fois pour toutes retenez ce qu’on vous dit ». Où l’on apprendra qu’il faut rincer le riz entre quatre et sept fois, entre autres considérations triviales sur les marques américaine et française, mêlées aux évocations parfumées de la cuisson du riz en Indochine. Quant au steak, « ça se rate toujours comme la tragédie ».
La grande helléniste Marie Delcourt (1881-1979) aurait pu être leur mère. Sa Méthode de cuisine à l’usage des personnes intelligentes3 s’inscrit à la fois dans tous les codes du genre et de l’époque – ces « livres de cuisine [qui] sont des enfilades de recettes qu’il faudrait appliquer à la lettre, sans chercher à comprendre le pourquoi d’aucun des gestes qu’elles décrivent » – et les transgresse avec une féroce jubilation. Car le manuel n’a pas été écrit pour les praticiens de la cuisine, mais « pour des femmes et des hommes qui, tout en exerçant un autre métier, se trouvent amenés tous les jours, ou fréquemment, ou quelques fois, à préparer leurs aliments ou ceux de leur entourage ». Un livre féministe avant l’heure ? Assurément. Car, « à part quelques femmes particulièrement douées et gourmandes, ravies de consacrer l’essentiel de la journée aux travaux gastronomiques, nous sommes toutes beaucoup trop occupées pour donner le meilleur de notre temps et de nos pensées à la préparation des repas. Aussi lisons-nous avec une stupeur consternée, dans les livres de cuisine de nos grands-mères, celle de la confiture de Bar, qui commence ainsi : Prenez deux livres de groseilles rouges. Enlevez avec une plume d’oie taillée en cure-dent les pépins de chaque groseille, en blessant le grain le moins possible. » N’y a-t-il pas de quoi, se demande Marie, être dégoûté des groseilles pour le restant de ses jours ?
La lecture de cette Méthode est un régal d’impertinence et d’esprit. Prenez par exemple l’article consacré à la confection des cannelloni farcis. La farce est un art périlleux, que vous dressiez les cannelloni à partir de la feuille (la replier, essayer d’en souder les bords) ou à partir des petits tubes (les remplir sans les briser). « Dans les deux cas, écrit Marie, c’est une besogne insupportable […]. Quand vous êtes chez vous, faites plutôt des spaghettis et, pour manger des caneloni [sic], profitez de ce que vous êtes dans un restaurant italien. »
Ce qui fait le plaisir de feuilleter ou de lire les Cuisines de Claire et de Marguerite et la Méthode de Marie, outre l’écriture et la langue – et ce n’est pas rien ! –, c’est leur inscription dans une époque, celle où ces femmes écrivaines devaient aussi assurer le couvert de la famille – un temps dont Marie Delcourt pressent et espère la fin prochaine, dans un élan visionnaire : « Dans le monde à venir, tout donne à penser que, de plus en plus nombreuses, les femmes mariées4, semblables à celles d’Utopie, auront un métier à l’extérieur. Pour augmenter la durée du loisir, on raccourcira le temps consacré au repas de midi. »
Il me fallait donc répondre à la double exigence de ma fille : nourrir et transmettre. Mais que transmettre quand on est née dans une famille où la transmission fait doublement défaut ? Du côté de ma mère (née en 1939), ni mère (disparue pendant la guerre) ni grand-mère (morte en couches), et aucun carnet de recettes. Aucune histoire de nourriture, sinon quelques souvenirs pénibles d’interminables heures passées devant une assiette de rutabagas sous l’Occupation. Du côté de mon père (né en 1912), une enfance bruxelloise et bourgeoise, une mère cheffe d’entreprise peu encline aux tâches ménagères mais une affectueuse cuisinière-nounou qui officiait dans le royaume d’une cuisine-cave5. Fin des années 1950, un veuvage et une dépression donnèrent à son meilleur ami, restaurateur à Léopoldville, l’occasion de lui apprendre la cuisine – et de le sauver : « René, c’est le coup de feu, ici. Tu ne viendrais pas m’aider en cuisine ? » Mon père, qui n’avait aucune compétence en la matière, apprit sur le tas le tour de main pour les sauces, sortit de sa dépression et, deux ans plus tard et de retour en Belgique, épousa ma mère. Elle avait vingt ans et ne savait pas cuire un œuf – l’expression est ici à prendre au sens littéral. La répartition des tâches ménagères se fit selon un ordre qu’on aurait pu qualifier d’avant-gardiste, du moins en ce qui concerne la cuisine et les courses. À cette modernité – car c’est là le troisième défaut de mon petit héritage culinaire familial –, il faut ajouter le recours sans complexe à toutes les facilités industrielles de l’époque, depuis les sauces en bocaux jusqu’aux mousses au chocolat vendues par quatre en petits pots de plastique en passant par les surgelés. De légumes frais, outre les crudités, nous ne connûmes que le chou-fleur et les infâmes escaroles – parfois des haricots ; le reste, carottes, petits pois, salsifis, chou rouge, épinards, champignons, pieds de céleri, betteraves rouges… arrivaient la plupart du temps directement dans la casserole depuis le congélateur ou la boîte de conserve. Les frites étaient achetées surgelées et précuites, la purée en flocons. Même quand on avait des invités ? Surtout quand on avait des invités.
Qu’allais-je transmettre à mon tour, moi qui dès mes douze ans papillonnais autour de Papa en cuisine et qu’il autorisait à peler les pommes de terre ou à laver les plats, jusqu’à ce que j’obtienne, petit à petit, de monter en grade, de farcir les tomates, de faire la démonstration d’une pissaladière goûtée en vacances ou d’une vraie mousse au chocolat ? S’il s’agissait de rendre à ma progéniture ce que j’ai reçu de mes parents, ce ne pourrait être qu’un « Manuel d’anticuisine ». Puisque j’héritais de pas grand-chose, sinon du génie paternel pour les sauces, j’ai décidé d’apprendre et j’ai pris goût à explorer bien des possibilités de la cuisine bourgeoise et populaire, de la blanquette au waterzooi (pillant Les recettes de Tante Léa), des profiteroles au forêt-noire (car jeune mariée modèle, j’ai suivi un cours de pâtisserie), mettant à profit les recettes de confitures de ma belle-famille et collectionnant tous les suppléments cuisine des magazines féminins.
Il y a donc de quoi remplir un carnet de recettes et le léguer à mes filles, comme il semble que doive le faire toute bonne mère (et n’y voyez aucun antiféminisme : leur père et leur beau-père cuisinent aussi). Mais à l’heure d’Internet et de Marmiton.org, quel intérêt ? L’écriture manuscrite, les notes, les commentaires et comme un fumet échappé d’entre les pages, le souvenir des moments partagés ? Elles en jugeront elles-mêmes, le jour où elles hériteront du cahier de recettes familiales que j’ai fini par tenir, où elles trouveront les secrets de l’osso bucco et de sa gremolata, du crumble de lieu noir aux câpres et aux olives, du tajine aux citrons amers et du pavlova. Mais ceci n’amuserait pas le lecteur ou la lectrice. À vous, je préfère raconter des histoires. Et tant qu’à faire, puisque le prétexte est là, je vous raconterai des histoires de recettes, de tablées familiales, d’expériences culinaires, de voyages imaginaires ou réels au pays des papilles.
Ce recueil n’est donc pas un carnet de recettes. Même si, pour vous, j’ai mis Les petits plats dans les grands. Ce recueil est un hommage à Claire Lejeune, Marguerite Duras et Marie Delcourt, ces trois femmes qui ont jeté des ponts entre l’art culinaire et l’art littéraire. C’est Marguerite Duras qui résume peut-être le mieux ce lien entre l’écriture et la cuisine, que je fais complètement mien :
« Vous voulez savoir pourquoi je fais la cuisine ? Parce que j’aime beaucoup ça… C’est l’endroit le plus antinomique de celui de l’écrit et pourtant on est dans la même inventivité… On est un auteur… »
D. C.
À mes filles, ces histoires de bouche,de table, de famille.
La bolognaise congolaise de Bon-Papa
La succession des menus familiaux s’opérait dans un ordre immuable, avec pour seuls changements ceux qu’imposait l’alternance des saisons. À l’époque, même si les surgelés et les conserves triomphaient, on ne trouvait cependant pas comme aujourd’hui courgettes et laitues dans les bacs toute l’année. D’ailleurs, il y a plein de choses qu’on ne trouvait pas du tout, et dont on ignorait carrément l’existence : les aubergines que je n’ai découvertes qu’une fois adulte, par exemple. Ou la roquette, que j’ai goûtée quand j’étudiais à Florence au début des années 1980. J’ai dû faire figure d’originale auprès de mes colocataires quand j’ai semé sur le balcon les graines que j’avais ramenées. Quant aux légumes que nous appelons maintenant « anciens » : potirons, panais, topinambours, rutabagas, ils devaient sembler trop rustiques à nos parents. Des légumes de pauvres. En fait, ils leur rappelaient la guerre. Concession était faite aux navets dans le ragoût d’agneau, aux betteraves rouges et aux cornichons au vinaigre. Les origines slaves de ma mère ?
Bref, il y avait les menus d’hiver : côtes de porc, oiseaux sans tête, pain de viande, carbonnades, chicons au gratin… et les menus d’été, aux légumes de saison : chou-fleur, haricots, crudités. Le samedi, beefsteak, avec laitue pour nous, salade de blé pour ma mère, frites et une cuiller à café de béarnaise Calvé. Le dimanche, poulet-compote ou rôti de porc. Les lundis d’hiver : pain de viande, stoemp aux carottes ; les lundis d’été : tomates farcies avec du riz. Le vendredi, immuablement, du cabillaud bouilli nappé de béchamel – traumatisée, j’ai longtemps cru que je détestais le poisson.
Pour les autres jours, ma mémoire s’embrouille un peu, mais le mardi, tout le monde s’en souvient chez nous, c’était le jour des pâtes. Le mardi fut très longtemps mon jour préféré.
C’était des pâtes Rivoire & Carret, une marque française. Parfois au fromage et au jambon. Parfois au gratin, en béchamel. Mais le plus souvent, c’était spaghettis bolognaise, et la bolognaise, c’était le rayon de Bon-Papa.
Je ne crois pas qu’il en tenait la recette de bien plus loin qu’un livre de cuisine, mais il la faisait à sa façon, fameuse grâce à un ingrédient secret : le pili-pili.
Faire revenir dans l’huile d’olive un oignon émincé et un éclat d’ail dont on aura éventuellement retiré le germe. Quand l’oignon est transparent, ajouter entre 400 et 600 grammes de haché de bœuf (qu’en Belgique on appelle américain). Aider le haché à colorer en le cassant et en le retournant avec la cuiller en bois, jusqu’à ce qu’il soit cuit.
Ensuite, les épices : sel, poivre, une branche de thym, une feuille de laurier et le pili-pili. Une gousse soigneusement émiettée. Si tu mets la gousse entière, l’un de tes convives risque de tomber dessus et de s’arracher la langue. Et puis on se lave les mains, histoire de ne pas devenir aveugle si on devait se frotter les yeux, à cause des oignons, par exemple. Je parle d’expérience.
Le pili-pili était rangé dans un petit bocal en verre sans marque. Il avait été ramené en 1963 par Parrain Jean-Marie, le fils aîné de mon père, qui vivait au Congo. De Parrain, je n’avais gardé aucun souvenir, mais ses lettres sur fin papier bleu régulièrement acheminées by airmail et ses photos de brousse illustrant le récit de son quotidien (la plantation de café, la chasse d’un prédateur, ses boys