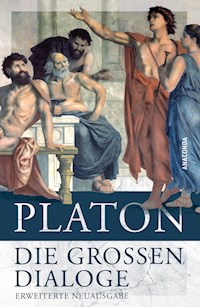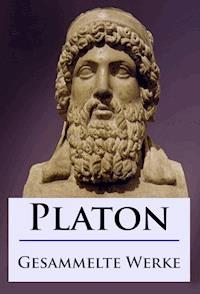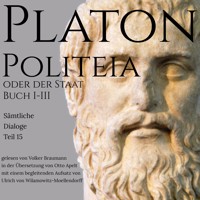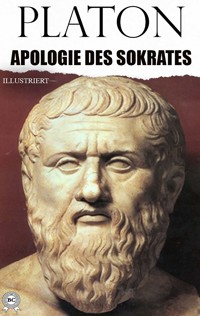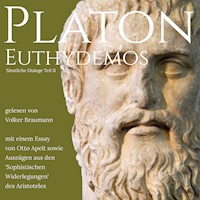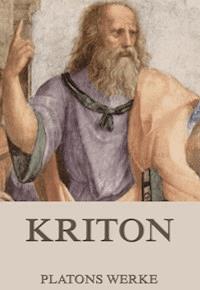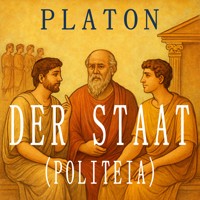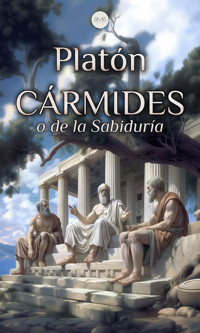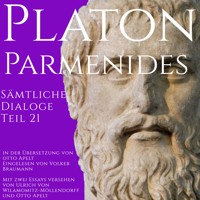Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "SOCRATE : Mon cher Phèdre, où vas-tu donc, et d'où viens-tu ? PHEDRE : De chez Lysias, fils de Céphale, Socrate, et je vais me promener hors des murs ; car je suis resté longtemps chez lui, toujours assis depuis le matin, et suivant les prescriptions d'Acoumène, ton ami et le mien, je fais mes promenades sur les routes ; car il prétend qu'on s'y délasse mieux que dans les galeries couvertes."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097344
©Ligaran 2015
Socrate rencontre Phèdre qui sort de chez son ami Lysias, ravi d’un discours que cet orateur a composé sur l’amour. Socrate demande à l’entendre, et les deux amis vont s’étendre, pour en faire la lecture, à l’ombre d’un platane au bord de l’Ilissos.
Le thème du discours est qu’il vaut mieux accorder ses faveurs à un poursuivant sans amour qu’à un amant. Lysias étaye son paradoxe sur les raisons suivantes : Un amant n’a pas plus tôt satisfait ses désirs qu’il se repent du bien qu’il a fait : sa tendresse est éphémère. Comment se lier d’ailleurs à un malade ? car l’amour n’est autre chose qu’une maladie de l’âme. En outre le nombre des amants est limité et permet peu de choix, tandis que les prétendants sans amour sont légion. Rien n’est plus indiscret qu’un amant et plus préjudiciable à la bonne renommée. Deux causes s’opposent à la durée de l’amour : la jalousie toujours en éveil de l’amant, et l’ignorance où il est, quand il s’éprend de la beauté physique, du vrai caractère de celui qu’il aime. L’amant par ses flatteries gâte le caractère de son bien-aimé et nuit à son perfectionnement moral. Mais peut-être dira-t-on que des relations sans amour sont languissantes : à ce compte il faudrait répudier aussi les affections de famille et l’amitié, et, s’il faut favoriser les gens en raison de la violence de leurs désirs, il faut donc aussi obliger, non les plus dignes, mais les plus affamés. Ceux qu’il faut favoriser sont au contraire ceux qui sauront le mieux témoigner leur reconnaissance.
Dans ce discours, où la fécondité de l’argumentation remplit Phèdre d’admiration, Socrate ne trouve à louer que l’élégance de l’expression ; il en critique l’ordonnance, qui est si arbitraire et si décousue qu’on peut aussi bien en commencer la lecture par la fin que par le début, et il entreprend à son tour de traiter le sujet, sans craindre la comparaison avec Lysias.
D’abord il définira l’amour, car, dit-il, toute discussion bien conduite doit partir d’une définition exacte. Nous sommes gouvernés par deux principes : le désir instinctif du plaisir et le goût réfléchi du bien. Quand le premier étouffe le second et se porte vers le plaisir que promet la beauté corporelle, il s’appelle amour. Or celui que ce désir possède cherchera dans l’objet de son amour le plus de plaisir possible, et pour cela il voudra l’asservir à ses caprices et supprimer en lui toute supériorité ; il le détournera de la philosophie, dans la crainte de devenir pour lui un objet de mépris, et le maintiendra dans l’ignorance pour le forcer à n’avoir d’yeux que pour lui. Nuisible à l’âme de celui qu’il aime, l’amant est également nuisible à son corps : ce qui lui plaît c’est un corps délicat, efféminé, étranger aux mâles travaux. Il nuit aussi à ses intérêts : pour l’avoir tout à lui, il le voudrait sans parents, sans fortune, sans femme ni enfants. Il lui est insupportable par ses assiduités que la différence d’âge rend plus importunes encore. Enfin, quand sa passion s’éteindra, il se montrera sans foi, et le bien-aimé s’apercevra avec indignation qu’il s’était abandonné à un maître perfide, incommode, jaloux, nuisible à sa fortune, à sa santé, au perfectionnement de son âme, qui est la chose la plus précieuse que l’homme possède.
– Ton discours n’est pas fini, dit Phèdre : tu n’as pas parlé de l’homme sans amour. – Je me bornerai à dire, reprend Socrate, qu’on trouve dans le commerce de l’homme sans amour autant d’avantages qu’il y a d’inconvénients dans celui de l’amant.
Là-dessus Socrate veut repasser l’Ilissos ; mais il a senti le signal divin qui l’arrête au moment de prendre quelque résolution. Nous avons, dit-il, offensé Éros ; il faut expier ce sacrilège et lui offrir une palinodie pour apaiser sa colère. Phèdre est enchanté d’entendre un nouveau discours.
– Non, dit Socrate, il ne faut pas dédaigner un amant passionné, sous prétexte qu’il est en délire. Car le délire, quand il est envoyé par les dieux, nous procure les plus grands biens, témoin le délire qui inspire l’art augural, les rites expiatoires et la poésie. Il y a une quatrième espèce de délire, la plus divine, celle de l’amour. Mais pour prouver que l’amour est le plus grand des biens, il faut d’abord déterminer la nature de l’âme humaine.
Toute âme est immortelle ; car l’essence de l’âme est la puissance de se mouvoir elle-même, et tout ce qui se meut soi-même, étant principe de mouvement, n’a ni commencement ni fin. Pour faire comprendre sa nature, on peut l’assimiler à l’assemblage que formeraient un cocher et un attelage de deux chevaux, l’un généreux et docile, l’autre brutal et insoumis. Mais comment y a-t-il des êtres mortels et des êtres immortels ? L’âme universelle fait le tour de l’univers, en se manifestant sous mille formes. Quand elle est parfaite et ailée, elle plane au haut des cieux et gouverne l’ordre universel ; quand elle a perdu ses ailes, elle roule dans les espaces jusqu’à ce qu’elle s’attache à un corps, lui communique sa force et forme avec lui un être mortel. Quant aux êtres immortels, nous savons qu’ils sont, mais nous ne les connaissons pas et n’en pouvons rien dire. Les âmes divines, qui se nourrissent d’intelligence et de science sans mélange, montent au point le plus élevé de la voûte des cieux, pour goûter les délices du banquet divin ; elles la franchissent et s’arrêtent sur sa convexité ; là est le séjour des essences, de la justice en soi, de la sagesse en soi, de la science parfaite. Les dieux les contemplent et s’en rassasient jusqu’à ce que le mouvement circulaire qui les emporte les ramène au point d’où ils étaient partis. Les autres âmes s’efforcent de suivre le cortège des dieux : les unes réussissent, malgré la turbulence du cheval indocile, à monter de l’autre côté du ciel et à jouir quelques instants de la vue des essences ; mais beaucoup, entraînées par leur attelage mal apparié, retombent les unes sur les autres, se froissent, perdent leurs ailes, et, n’ayant pu voir l’absolu, sont réduites à se repaître des conjectures de l’opinion. Quand elles ne peuvent plus suivre les dieux, les âmes s’abattent sur la terre et y subissent un exil de dix mille ans, réduit à trois mille ans pour les âmes des philosophes. Après le premier millénaire, les âmes sont appelées à un nouveau partage des conditions ; mais elles ne peuvent entrer dans le corps d’un homme que si elles ont entrevu jadis la vérité dans le ciel. L’homme en effet doit comprendre le général, c’est-à-dire s’élever de la multiplicité des sensations à l’unité rationnelle ; or cette faculté n’est autre chose que le ressouvenir de ce que notre âme a vu, quand elle contemplait l’être véritable, à la suite de l’âme divine. C’est pour cela qu’il est juste que l’âme du philosophe ait seule des ailes ; car elle s’attache aux essences.
Entre toutes les essences il en est une qui brillait d’un éclat particulier : c’est celle de la beauté ; c’est aussi celle dont le souvenir s’éveille le plus facilement à la vue des beautés d’ici-bas. Il est vrai que beaucoup d’âmes corrompues ont oublié la beauté idéale : à celles-là la contemplation des beautés terrestres n’inspire qu’un désir brutal ; mais l’âme qui a jadis été initiée à la beauté absolue et qui en a conservé un souvenir distinct, ressent devant la beauté terrestre la terreur religieuse qu’elle a éprouvée autrefois ; elle la vénère comme un dieu, nage dans la joie en sa présence, se tourmente en son absence et sacrifie tout pour la suivre et la contempler.
Chaque homme honore et imite dans sa vie le dieu dont il suivait le cortège dans le ciel et se choisit un amour selon son caractère : les suivants de Zeus recherchent une âme qui ait le goût de la sagesse et du commandement, ceux de Héra une Âme royale, et chacun en général une âme où il retrouve les attributs de son dieu. C’est par-là que l’amour exerce une influence heureuse sur l’amant et sur l’aimé : l’amant, excité par l’enthousiasme, se perfectionne sur son divin modèle, et il ne cesse de persuader à son bien-aimé d’en faire autant.
Mais comment l’amour naît-il dans l’âme de l’aimé ? C’est que le courant des émanations que sa beauté dégage revient de l’amant sur lui et le dispose à aimer ; il ressent une affection qui est comme l’image de l’amour qu’on a pour lui. Si la sagesse l’emporte sur les désirs des amants, ils vivent pour la vertu et à leur mort ils en sont récompensés par un bonheur divin ; s’ils ont au contraire la faiblesse de céder au plaisir, ils n’en restent pas moins unis, et quoique à leur mort leurs âmes restent sans ailes, ils sont réservés à une vie heureuse et brillante.
Phèdre admire la beauté de ce discours et craint que son ami Lysias ne puisse ou ne veuille à son tour composer sa palinodie et affronter la comparaison avec Socrate. D’ailleurs un homme d’État a tout dernièrement fait honte à Lysias de composer des discours et l’a traité dédaigneusement de logographe. – Mais, dit Socrate, l’homme d’État lui-même ne compose-t-il pas des discours ? Ce n’est pas à écrire des discours qu’il y a de la honte, c’est à en écrire de mauvais. Si tu veux, nous allons examiner ce qui fait un bon ou un mauvais discours. Ne faut-il pas d’abord connaître la vérité sur le sujet qu’on veut traiter ? – J’ai entendu dire, Socrate, que la connaissance de la vérité n’est pas nécessaire à l’orateur, que la vraisemblance lui suffit. – Mais s’il ignore la vérité sur le bien et le mal, il s’expose à conduire le peuple dans des voies mauvaises, et s’il prétend fonder l’art de la persuasion sur autre chose que la vérité, il se leurre. Car, même pour tromper les auditeurs, il faut leur présenter les choses comme vraies, et pour les rapprocher ainsi de la vérité, il faut la connaître. Prenons nos exemples dans les discours de Lysias et dans les miens. L’amour étant matière à discussion, il fallait d’abord le définir. C’est ce que Lysias n’a pas fait. Il a commencé par où il aurait dû finir, et jeté ses arguments dans un pêle-mêle dérisoire. Qu’avons-nous fait nous-mêmes ? Nous avons mis en œuvre deux procédés : la définition et la division du sujet. J’appelle dialecticiens ceux qui appliquent ces deux procédés. Les rhéteurs font grand bruit de leurs artifices : exorde, narration, dépositions, preuve, présomptions, etc. ; mais ce qu’ils enseignent par-là, ce sont les notions préliminaires de l’art ; ils oublient d’enseigner l’essentiel, l’art de disposer tous ces moyens en vue de la persuasion. Pour acquérir l’art véritable, il faut faire comme Périclès, il faut étudier la philosophie sans laquelle on ne saurait avoir l’esprit élevé ni se perfectionner dans aucune science. Il faut surtout étudier la nature de l’âme, qu’on ne peut d’ailleurs connaître sans connaître la nature universelle. Il faut savoir si elle est une substance simple ou composée, décrire ses facultés et les diverses manières dont elle peut être affectée ; enfin, après avoir fait une classification des différentes espèces d’âmes et de discours, il faut apprendre à agir sur les âmes, en appropriant chaque genre d’éloquence à chaque auditoire, certains discours étant propres à persuader certains esprits, et n’ayant aucune action sur les autres. L’art oratoire est une œuvre immense et qui exige un prodigieux labeur, et si l’homme s’y soumet ce ne sera pas pour plaire aux hommes, mais aux dieux.
Quant à la convenance qu’il peut y avoir à écrire ou à ne pas écrire, disons d’abord que l’écriture, comme le roi Thamous le dit à son inventeur, le dieu ; Theuth, favorise la paresse, et n’est en réalité qu’un mémento qui rappelle les choses à celui qui les sait. En outre le discours écrit n’est pas vivant, il ne peut répondre aux questions qu’on lui fait. Il y a un autre discours, celui qui vit dans l’âme ; de l’homme qui sait, qui se reproduit dans les autres âmes et propage ainsi éternellement la semence de la science. Un sage ne doit écrire que pour la vérité ; mais il doit préférer pour la faire connaître et la défendre, la parole vivante à la parole écrite. C’est un idéal que Lysias n’a pas visé, mais qu’Isocrate réalisera peut-être.
On le voit par l’analyse que nous venons de faire, l’objet de l’ouvrage est complexe. Il semble d’abord qu’il y ait deux sujets distincts : une sorte de traité de l’amour, puis un traité de rhétorique. C’est le Banquet et le Gorgias réunis. Les discours dont la première partie se compose sont le prétexte d’une discussion sur l’art oratoire et fournissent des exemples des défauts qu’il faut éviter et des qualités qu’il faut poursuivre. Ce n’est là qu’un lien apparent, et, si les deux parties n’avaient entre elles que ce rapport, on pourrait dire que l’ouvrage est double et mal composé. Mais il y a un rapport naturel entre les deux parties, et ce sont des raisons profondes qui en ont réglé l’assemblage. Platon, impatienté de l’ascendant que les rhéteurs avaient pris à Athènes, se donne pour tâche de détromper la jeunesse qui suivait leurs leçons. Il leur reproche de fonder l’art de la parole, non sur la vérité, mais sur la vraisemblance et de ne voir que le succès, sans s’inquiéter de l’honnêteté des moyens et du but. Ils sont fiers d’avoir inventé des noms pour désigner chaque partie du discours, exorde, preuve, confirmation, etc. ; mais ils oublient d’apprendre à leurs disciples ce qu’il faut mettre dans chacun de ces cadres. La philosophie seule est capable de le faire convenablement. Sans une haute culture philosophique, l’orateur est condamné à ramper et à suivre la routine des rhéteurs ; jamais il ne s’élèvera au-dessus des questions qu’il traite et ne les dominera : il ne sera qu’un Tisias ou un Lysias, il ne sera pas un Périclès. Ce qui a fait la grandeur de Périclès, c’est l’habitude des spéculations philosophiques qu’Anaxagore lui avait donnée. Quiconque aura l’ambition d’être un grand orateur, devra donc être un philosophe. Il devra sentir en son cœur l’amour, principe des belles connaissances, qui s’élève des beautés terrestres jusqu’aux beautés véritables, jusqu’aux Idées. Celui qui ne sent point en lui cet aiguillon divin est condamné aux grossiers plaisirs et aux ténèbres de l’esprit ; celui que l’amour tourmente consacrera sa vie à retrouver les vérités que son âme a entrevues jadis et dont elle a gardé l’éblouissement ; il s’adonnera à la dialectique, c’est-à-dire à la recherche et à la discussion méthodique de la vérité, seul moyen que nous ayons ici-bas de nous élever jusqu’aux Idées. Quand par l’amour et la dialectique il sera parvenu à la connaissance du vrai, du beau et du bien, il sera l’orateur parfait, celui qui sème et fait fructifier la Vérité et la science dans les âmes de ses auditeurs.
On voit à présent ce qui fait l’unité du Phèdre. La théorie de l’amour est au fond de la doctrine platonicienne : nul ne sera philosophe s’il n’a reçu le don divin de l’amour, aiguillon de la recherche philosophique, et s’il ne poursuit la vérité suivant la seule méthode qui mène jusqu’à elle, la dialectique ; or nul ne sera un grand orateur s’il n’est philosophe. Si la philosophie et l’art se confondent ou tout au moins se conditionnent, c’est dans la partie philosophique de l’œuvre qu’il faut chercher les principes que Platon met à la base de l’art oratoire. Ainsi le centre de l’ouvrage est la palinodie ; ce magnifique exposé des doctrines platoniciennes semblait déjà aux anciens la partie essentielle, si l’on en juge par les sous-titres Du Beau, De l’Âme, que portent les manuscrits. Les deux discours qui précèdent la palinodie ne sont que des spécimens du genre sophistique et une sorte d’introduction à la vraie doctrine de l’amour ; enfin la deuxième partie est la critique des procédés en vogue et l’établissement des règles oratoires qui résultent de la doctrine philosophique. Ainsi se justifie la composition du Phèdre ; elle se conforme à la manière ordinaire de Platon. Ses dialogues semblent avoir été composés au hasard de l’improvisation ; au premier abord la marche en paraît réglée sur les écarts d’une verve intarissable et sur les caprices d’une conversation sans apprêt ; mais à la réflexion tout paraît calculé par un puissant esprit qui rattache toutes les questions particulières aux idées les plus générales, et qui dans chaque discussion jette dans la balance tout le poids de son système philosophique.