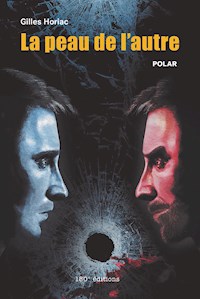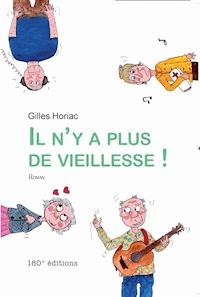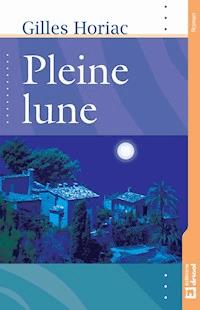
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Dricot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
C'est l'été. La nuit est tombée sur le village de Saint-Maël. Poussés par la peur, la faim ou le besoin d'aventure, huit personnages déambulent dans les ruelles.
Il y a la veuve Suzie, Antoine-le-délinquant, une adolescente écervelée, un ermite en quête d'amour, un loup égaré, un enfant désobéissant, un aveugle et un fantôme. A leur insu, tous redonneront vie à une légende qu'on croyait oubliée. Ces huit personnages ne se connaissent pas. Ils n'ont qu'une complice : la lune…
Un roman haut en couleur pourvu de personnages plus attachants les uns que les autres
EXTRAIT
Un incendie a complètement détruit la bibliothèque de Saint-Maël. Il n’y a pas eu de victimes, mais tous les livres qu’elle abritait ont été réduits en cendres. Bien peu de journaux ont relaté l’événement. A peine un entrefilet dans un quotidien local. Il faut dire que la plupart des gens ignoraient l’existence d’une bibliothèque dans un si petit village et que celle-ci n’ouvrait ses portes qu’une matinée par semaine, à condition que l’employé municipal responsable n’en ait point oublié les clefs. Il serait exagéré de dire que les quelque quatre cents livres passablement poussiéreux et rangés de manière anarchique sur six étagères en bois vermoulu constituaient un trésor de littérature : tout juste quelques récits de voyage, des légendes de la région ainsi que deux ou trois fardes d’archives départementales, dont on ignorait comment elles avaient un jour abouti à la bibliothèque de Saint-Maël.
Parmi ces livres, il en était un qui relatait une bien curieuse histoire, qui se serait déroulée au sein même du village. C’était un opuscule d’apparence insignifiante, dont la couverture en carton était protégée par une toile brute, au ton écru. L’ouvrage n’était pas signé. Il racontait l’histoire de Saturnin, un jeune poète, qui habitait seul à l’entrée du village. Tout le monde aimait le voir parcourir les rues, de sa démarche chaloupée. Sous sa chevelure hirsute, ses yeux semblaient toujours rire, et sa barbe claire s’ouvrait sur un sourire immuable.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gilles HORIAC est né à Bruxelles en 1954. Professeur de français dans la banlieue de la capitale, il se sent très concerné par l'éducation des jeunes les plus défavorisés. Gilles HORIAC est également auteur compositeur de chansons françaises.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le puits des neuf quatrains
Un incendie a complètement détruit la bibliothèque de Saint-Maël. Il n’y a pas eu de victimes, mais tous les livres qu’elle abritait ont été réduits en cendres. Bien peu de journaux ont relaté l’événement. A peine un entrefilet dans un quotidien local. Il faut dire que la plupart des gens ignoraient l’existence d’une bibliothèque dans un si petit village et que celle-ci n’ouvrait ses portes qu’une matinée par semaine, à condition que l’employé municipal responsable n’en ait point oublié les clefs. Il serait exagéré de dire que les quelque quatre cents livres passablement poussiéreux et rangés de manière anarchique sur six étagères en bois vermoulu constituaient un trésor de littérature : tout juste quelques récits de voyage, des légendes de la région ainsi que deux ou trois fardes d’archives départementales, dont on ignorait comment elles avaient un jour abouti à la bibliothèque de Saint-Maël.
Parmi ces livres, il en était un qui relatait une bien curieuse histoire, qui se serait déroulée au sein même du village. C’était un opuscule d’apparence insignifiante, dont la couverture en carton était protégée par une toile brute, au ton écru. L’ouvrage n’était pas signé. Il racontait l’histoire de Saturnin, un jeune poète, qui habitait seul à l’entrée du village. Tout le monde aimait le voir parcourir les rues, de sa démarche chaloupée. Sous sa chevelure hirsute, ses yeux semblaient toujours rire, et sa barbe claire s’ouvrait sur un sourire immuable.
– Ho, Saturnin ! Combien, ce soir ?
– Trois ! clamait-il avec fierté. Trois quatrains que je viens d’écrire pour la veillée de ce soir !
– Félicitations, Saturnin ! Tu es un grand poète ! A ce soir, alors !
Saturnin n’était pas seulement poète. C’était un véritable animateur, et cela, bien avant que le terme ne soit entré et souvent galvaudé dans le langage courant. Chaque soir, peu après le coucher du soleil, il réunissait tous les habitants du village sur la Place Blanche pour la veillée. La Place Blanche n’avait que peu de points communs avec la Grand-Place du village, flanquée de l’église et de la mairie. C’était un petit espace carré, situé au carrefour de quatre ruelles et au centre duquel se trouvait un puits, probablement utilisé jadis. Les maisons chaulées qui ceinturaient la place étaient toutes munies de minuscules fenêtres aux châssis bleus, qui s’ouvraient presque toutes ensemble lorsque la veillée débutait, comme autant de regards curieux et impatients. Saturnin profitait des dernières clartés du jour pour exécuter deux ou trois mimes ; certains d’entre eux singeaient gentiment les notables du village, de la région, ou même du pays. Assis ou debout autour du puits ou contre les façades, les spectateurs jubilaient. Parfois, l’un d’eux se levait et enjambait le public assis pour rejoindre Saturnin au centre du cercle.
– J’ai une histoire à raconter ! clamait-il.
Et avec l’humilité des grands, le poète lui cédait la place en l’encourageant par des applaudissements. Il arrivait même que la mercière se lance dans une chanson du cru, pour laquelle elle quémandait l’aide de l’épouse du maire, réputée pour son joli filet de voix. Lorsque les paupières s’alourdissaient ou que se faisaient entendre les premières jérémiades d’enfants fatigués, Saturnin comprenait que le grand moment était venu.
– Avant de nous dire bonne nuit, j’ai trois quatrains à vous lire. Ils sont tout frais de ce matin.
Un « Ah » de satisfaction saluait ce moment qui, invariablement, constituait l’apothéose de la veillée. Quand le poète lisait ses vers, on n’entendait pas un murmure. Même les enfants cessaient de pleurer, les insectes, de vrombir, le vent, de bruire. Et surtout, les étoiles semblaient briller plus fort et plus nombreuses, comme si elles aussi tenaient à s’enivrer de la magie des vers, de la musique des mots qui s’égrenaient de la bouche de Saturnin comme des pétales de bonheur. Après la veillée, chacun rentrait chez soi, le cœur joyeux et l’âme légère.
Avec les années, l’assistance aux soirées animées par Saturnin devint moins nombreuse. Le poète n’avait pourtant rien perdu de son imagination ni de sa faconde. Sa peau s’était ridée et ses cheveux avaient blanchi, mais sa verve et son enthousiasme étaient restés intacts. Tous les jours, il inventait de nouveaux quatrains, dont la lecture restait le point fort de la veillée. Mais malgré tous ses efforts, Saturnin devait bien se rendre à l’évidence : le public, de plus en plus clairsemé, disparaîtrait s’il ne réussissait pas un grand coup. Il dormait de moins en moins. La plupart de ses nuits, il les occupait à imaginer de nouveaux tours, à apprendre des chansons, et surtout, à écrire des vers. C’est ainsi qu’un jour, on le vit déambuler dans les rues du village avec un air de vainqueur.
– Neuf ! J’ai réussi à composer neuf quatrains pour ce soir ! Et pas des redites ! Les plus beaux vers que j’aie jamais écrits !
– C’est bien, Saturnin, lui répondait-on avec le ton du psychiatre tentant de calmer un patient agité.
– Madame Dureil ! Vous viendrez les écouter, n’est-ce pas ? voulut-il s’assurer en secouant la vieille mercière.
– Non, mon pauvre Saturnin. Tu sais bien que mes jambes ne me portent même plus jusqu’à la Place Blanche.
– Et vous, Martin ? fit-il au boucher.
– Oui, oui, nous verrons.
– Et vous, les jeunes ? fit-il en s’adressant à quatre grands adolescents qui s’affairaient autour d’un chapeau de poker.
– Tu veux que je te dise, Saturnin, répondit le plus âgé. Tes poèmes, ils n’intéressent plus personne. Même mieux : ils nous em-mer-dent ! acheva-t-il en s’esclaffant.
Le poète devenait comme fou. Il préféra se tourner vers les anciens, ceux qui avaient connu les vraies, les grandes veillées de Saint-Maël. Avec l’énergie du désespoir, il implorait :
– Ce soir, ce sera la plus merveilleuse veillée que le village ait connue. Et elle sera clôturée par neuf quatrains beaux comme des fruits mûrs. Il faut venir ! En plus, c’est pleine lune cette nuit ! Il faut venir !
– Mais oui, Saturnin, ne t’en fais pas ! On viendra, lui répondait-on pour le faire taire.
Saturnin avait retrouvé le vieux chapeau melon de ses débuts.
Il se souvenait qu’il faisait rire les enfants. Paré de son plus beau costume, il arpenta les rues qui menaient à la Place Blanche. Arrivé le premier, il en profita pour répéter ses quatrains. Tout de même ! C’était la première fois qu’il en lirait neuf en une soirée ! L’éclairage public n’avait pas été installé sur la place et Saturnin s’en félicitait. Le soleil avait complètement disparu ; l’heure de la veillée était là. L’amuseur était prêt, mais son cœur était gonflé d’angoisse. Il n’avait qu’un seul spectateur : un chat tigré et famélique qui achevait sa toilette sur le seuil d’une fermette, avant de se retirer d’un air digne. Autrefois ouvertes à cette heure, les fenêtres des maisons qui ceinturaient la place étaient toutes closes. Les rideaux tirés laissaient entrevoir quelques lueurs bleutées. Les veillées et les fêtes se vivaient maintenant seuls, enfermés chez soi. Saturnin s’approcha du puits, s’assit sur la margelle. Il tenait toujours les vers qu’il avait écrits et qui maintenant lui brûlaient les doigts. Dans un mouvement de colère et de désespoir, il les jeta au fond du puits. La lune léchait les façades d’une lumière laiteuse. Elle semblait dévisager le poète déchu… était-ce un regard moqueur ou compatissant ?
Elle seule sait ce qu’il est devenu. Car depuis sa veillée manquée, Saturnin n’a plus jamais reparu. Certains prétendent que, fou de chagrin, il s’est jeté dans le puits pour y rejoindre ses quatrains. Toujours est-il que de curieux phénomènes ont commencé à se produire dès le lendemain de sa disparition. Chacun remarqua d’abord que les nuits étaient beaucoup plus noires sur Saint-Maël. Si la lune brillait encore, les étoiles, elles, s’étaient complètement éteintes, même les soirs de beau temps. Et surtout, les gens commencèrent à se haïr. Quand l’épicière revenait de la ville, fière des deux nouvelles robes qu’elle y avait trouvées, au lieu de se réjouir avec elle, on se demandait comment cette personne d’apparence modeste pouvait s’offrir une garde-robes si luxueuse. Quand Brigitte, une brunette de dix-huit ans, sortait de la forge de son père pour se promener dans la campagne, les jambes nues et les cheveux au vent, certains murmuraient entre eux :
– Pas étonnant qu’elle ait arrêté ses études. Tous les hommes la regardent : le fils du meunier, celui du boulanger, et même Armand, le vieux menuisier… Elle attend le plus offrant…
On détruisait les haies qui séparaient les champs, et l’on se disputait pour quelques centimètres de terre. On accusait le notaire d’être corrompu par l’une ou l’autre partie. On était loin de l’insouciance et de la bonne entente qui réunissaient autrefois tous les Saint-Maëliens. Les automnes pluvieux devenaient longs et ennuyeux. Jadis, les hivers constituaient les principales périodes de fêtes et de réjouissances : Noël, la fête des rois mages, le mardi gras… tout était prétexte pour se retrouver entre amis, boire, manger et rire ensemble. Eh bien, ces hivers se traînaient maintenant, glacials et lugubres. Les seules paroles qui s’échangeaient étaient des reproches ou des sous-entendus imbibés de malveillance et de fiel. Dans les regards, on ne lisait plus que la suspicion et la jalousie.
Enfin, il y avait les maladies, plus nombreuses, plus longues et plus meurtrières qu’avant : la femme du boucher, emportée par une hépatite, le petit de l’empailleur, foudroyé par la méningite ; le coiffeur et sa mère, tous deux rongés par le cancer. Et d’autres encore…
Plus personne n’évoquait Saturnin. Cependant, en disparaissant, il avait laissé une légende sur ces terres, où même les plus belles histoires tombent dans l’oubli : pour retrouver la chance, la joie et la prospérité dans le village, il suffirait qu’une nuit de pleine lune, neuf personnes écrivent chacune un quatrain et le déposent dans le puits de la Place Blanche.
Ce geste paraît simple, mais ce serait un hommage rendu au poète Saturnin, une manière de le consoler après sa dernière veillée, boudée par les habitants. Neuf quatrains à déposer dans le puits pour réparer l’affront fait au poète, pour laver son chagrin et ainsi réveiller sa bonté. Alors, Saturnin, l’amoureux des gens et des mots, redonnerait au village son harmonie d’antan.
Mais ce n’est qu’une légende. Qui croit encore aux légendes aujourd’hui ?
Et celle-ci se trouvait enfermée dans un opuscule, lui-même coincé entre deux gros livres, sur une étagère de la bibliothèque de Saint-Maël. Et comme aujourd’hui, cette bibliothèque a été réduite en cendres, la légende n’est plus écrite nulle part. Est-elle morte, dévorée par les flammes, elle aussi ? Non, comme toutes les légendes, elle flotte dans les airs ; elle taquine les consciences, elle s’incruste dans les croyances, elle visite les rêves et vient se fondre dans les mémoires. Une légende ne meurt pas… Elle se faufile dans un être dès sa naissance. Aujourd’hui, la plupart des enfants n’ont jamais entendu parler du Petit Chaperon Rouge. Et pourtant, ils ont encore tous peur du loup.
Les gens connaissent les légendes sans les avoir entendues : ce sont les fantômes de leur conscience.
Suzie
Les économies de Suzie étaient réunies dans une énorme serviette en chagrin, munie d’une fermeture éclair, elle-même renforcée par un petit cadenas. Pour la troisième fois aujourd’hui, Suzie chercha une nouvelle cachette dans son vaste appartement situé au dernier étage d’un des immeubles luxueux récemment érigés au début de la rue de l’Ouest.
– Là, sous la casserole en fonte, les voleurs ne la trouveront jamais, se dit-elle.
Après avoir dissimulé sa fortune, elle revint, satisfaite, s’installer au salon dans son grand fauteuil recouvert de velours bleu-roi. Mais sa sérénité ne dura pas. Elle se demanda si un cambrioleur venu visiter sa cuisine ne trouverait pas étrange d’apercevoir une lourde casserole surélevée, alors que les autres étaient posées à même la planche. Alors, elle se releva et, s’efforçant de se glisser dans la peau du voleur, retourna à la cuisine.
– Tout de même… Je devrais peut-être éparpiller mon bien dans tout l’appartement. Peut-être qu’alors, les bandits se contenteront d’une partie de mes richesses.
La fortune de Suzie était considérable. Des dizaines de liasses de grosses coupures attachées les unes aux autres par de la ficelle, des rubis, des montres de valeur, des colliers sertis de diamants véritables, une chevalière surmontée d’une énorme émeraude. Chaque objet était glissé dans une pochette en velours fin et presque tous les jours, Suzie prenait plaisir à les extraire de la serviette et à en recueillir le contenu au creux de ses mains. Elle pouvait passer des heures à contempler ses joyaux, moins pour le plaisir des yeux que pour cette sensation de force et de puissance qui lui traversait le corps, lorsque, pour elle-même, elle disait :
– Tout cela, c’est ma propriété maintenant. Personne ne pourra m’en priver.
Personne… sauf les voleurs, qu’elle redoutait par-dessus tout. Elle les voyait partout, du charpentier qui la croisait dans la rue jusqu’à la vieille Adèle qui, aidée de sa canne, descendait les marches de l’église après sa messe quotidienne. Elle avait même renvoyé vertement le sous-directeur de la Banque du Centre, venu lui rendre visite pour tenter de la convaincre de ne pas laisser dormir ses avoirs. Il lui avait parlé sécurité, intérêts, très convaincant dans son joli costume bleu marine, mais Suzie l’avait jeté hors de chez elle en le traitant de chenapan et de voleur.
C’est qu’elle avait trimé toute sa vie pour la gagner, sa fortune. Puis, elle ne pouvait oublier que pendant des années, Gustave, son mari, lui avait pris tout ce qu’elle rapportait à la maison. Tous les jours de la semaine, elle partait à l’aube faire le ménage dans les familles les plus riches de Saint-Maël. Quand elle rentrait, fourbue, son mari n’avait jamais eu un mot gentil pour elle. Il lui ordonnait seulement :
– Donne-moi ta paie, et prépare à manger : j’ai faim.
Gustave, lui, ne faisait rien. On le voyait traîner ses galoches dans tout le village. Il s’arrêtait pour s’acheter du tabac et pour boire son anisette au bistrot de la Grand Place. Il prétendait « gérer l’argent du ménage ». En réalité, il s’appropriait les quelques billets que lui ramenait sa femme et il les dissimulait dans une cachette connue de lui seul.
C’est à cette époque que l’idée était venue à Suzie de ne donner à son homme qu’une partie de l’argent gagné. Elle cachait le reste dans une vieille soupière en porcelaine, ou entre les mailles du sommier, ou encore sous les semelles d’une paire de chaussures usagées. Mais Gustave, qui n’avait rien d’autre à faire, parvenait toujours à débusquer ses trésors. Il prenait cela comme un jeu, et avec un rictus sarcastique, il interpellait sa femme :
– Je n’ai pas très bien dormi cette nuit… Les billets de banque, ça forme des bosses qui donnent mal au dos.
Ou bien :
– J’ai jeté tes vieilles chaussures à talons hauts, que tu ne mettais plus jamais. De toute façon, elles ne valaient plus rien… enfin… si on peut dire !
A la mort de sa mère, Suzie avait hérité d’une confortable somme et de plusieurs bijoux de grande valeur. Le tout avait été immédiatement confisqué par Gustave. Suzie en avait pleuré et souvent, elle avait hurlé sa colère et son chagrin. Mais le mari paresseux n’en avait cure ; il prenait un air mauvais et répondait avec rudesse :
– Tu n’es bonne qu’à nettoyer les saletés des autres ! Moi, je suis un intellectuel : je réfléchis à la manière de bien gérer notre fortune.
Un soir qu’elle rentrait, harassée par une longue journée de travail, elle avait découvert Gustave étendu à plat ventre sur le tapis du salon, une jambe curieusement repliée sur elle-même. Un peu de sang s’écoulait de son nez. Il ne bougeait plus. Suzie avait eu la force de retourner le corps. Elle avait dû réprimer un mouvement de répulsion à la vue des mains osseuses de son mari, qui étreignaient un vieux sac de jute. A l’intérieur, les colliers, les pierres précieuses, les bagues en or et des centaines de billets. Elle avait eu du mal à s’emparer du sac, tant les doigts de Gustave étaient crispés sur le trésor, comme s’il avait voulu l’emporter avec lui dans la mort. Suzie s’était aperçue qu’elle n’éprouvait aucune tristesse : du soulagement plutôt. Aussi fourbe que fainéant, il ne l’avait jamais aimée. Il n’avait même jamais souhaité lui faire d’enfants, prétextant que leur éducation