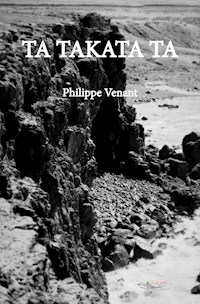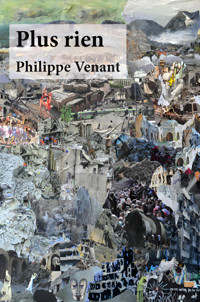
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une road-story… une de plus ? Oui, mais c’est l’ultime de l’espèce humaine. L’errance d’un « expurgateur » qui n’a plus qu’une obsession : faire table rase, veiller à ce que l’extinction de l’espèce nuisible, la sienne, soit complète. Créature de labo, une « omégane » le suit comme son ombre, à la recherche d’une direction, d’une destination, d’un sens à ce qui n’en a peut-être plus aucun. Et puis en contrepoint se font entendre les récits macabres et burlesques de pilleurs de bunkers. Né d’une colère contre les saccageurs de planète et d’avenir, "Plus Rien" est un roman imprécatoire et exhortatif. Il entend mener le lecteur jusqu’au bout du cauchemar pour l’en réveiller.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Prix de la Nouvelle Francophone de Palaiseau (1991), Philippe Venant a d’abord publié des nouvelles en revue (L’Encrier Renversé), puis deux romans : "Concerto pour la Main Gauche" (L’Harmattan 2013) et "Ta Takata Ta" (5 Sens Éditions 2022). Il est actuellement directeur du Centre Culturel du Grandvaux (39).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philippe Venant
PLUS RIEN
Pour Paul, Fantin, Nino et Louison,
leurs enfants et petits-enfants,
qu’ils fassent en sorte que cette histoire
demeure une fiction.
Mais moi je n’ai rien vu qu’une planète désolante
Paysages lunaires et chaleur suffocante
Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim
Comme tombent les mouches…
Jusqu’à c’qu’il n’y ait plus rien…
Plus rien…
Plus rien…
Les Cow-boys Fringants – 2004
ici Soleil et Lune
font les deux roues dentées savamment engrenées
d’un Temps à nous moudre féroce
Aimé Césaire
Comptine – Ferrements – 1960
Je ne sais plus qui a dit « Il n’existe que trois sortes de chant : d’amour, de mort, et de pirates. » Mais il avait raison.
Phil Coming
Encyclopédie des Résonances Irraisonnées – 2010
1
Rien d’autre que le silence d’un ciel vide. Rien d’autre que le silence d’une terre sans vie. Rien d’autre, sinon les moignons d’arbres morts, le paillasson d’herbes sèches, le sillon d’un ruisseau évaporé. Vestiges d’un lieu jadis humide ayant thésaurisé son eau aussi longtemps que possible. Avant de ne plus dégorger que de la poussière. Comme partout ailleurs.
Une ancienne tourbière tapie au creux d’une combe. Et quelque part, l’emplacement.
Le soleil disparu, la fournaise atténuée, Alzéra sort de derrière un rocher. Un quartier de lune dispense des ombres estompées. Alzéra se retourne. Quelques pas en arrière, l’omégane. Surgie de nulle part. Elle le suit. Sans trop s’approcher. Une ombre furtive. Toujours attachée à ses pas.
Alzéra s’accroupit. Scrute le sol. Se relève. Avance de quelques pas. S’accroupit de nouveau. De la tête acquiesce pour lui-même. Il lit sur cette terre stérile la présence de l’homoncule. Ces craquelures. Trop rectilignes. C’est là. Insère ses doigts. Trois bouts de planche recouverts de terre. Une trappe rudimentaire. Le terrier d’un homoncule. Plus rien à voir avec les somptueux bunkers de naguère.
D’un étui en bandoulière, il dégaine son poignard qu’il fiche en terre le temps d’enlever avec précaution les planches. Quelques marches terreuses mal façonnées, à moitié éboulées. La patte malhabile de l’homoncule traqué. L’accès est trop bas pour se tenir debout. Il faudra avancer courbé dans l’obscurité, tête la première, ou plutôt poignard en tête. Alzéra ne craint pas l’obscurité. Elle est son alliée. À force de débusquer l’homoncule dans sa tanière, il pressent sa présence, anticipe ses gestes et surtout, flaire ses odeurs, décrypte les nuances de sa sueur. Ce trou suinte âcre, très âcre. Ça pue l’épouvante. La panique sourde d’un individu à bout. Alzéra sait ce qui lui reste à faire. Il entame la descente des marches sans plus aucune discrétion. Au contraire, respire et renifle fort, avec des soupirs excédés.
En bas des marches, le plafond s’élève un peu, Alzéra se redresse, lève la tête, les narines offertes aux effluves. Ça pue bien plus fort sur sa gauche. L’homoncule se tapit là. Alzéra n’a plus qu’à attendre, le poignard brandi devant lui. Il pousse encore un ou deux soupirs rauques, effrayants. Ça y est, l’homoncule remue, se précipite sur lui, s’empale sur le poignard qu’Alzéra remonte comme une fermeture éclair. Le corps s’affaisse sans cri ni râle. Le mutisme résigné de la bête immolée. Sûr qu’il n’avait même pas une arme. Terré dans sa terreur. Incapable de se défendre. Se jetant sur la lame comme une délivrance. Piteuse fin. Sort désormais inexorable des nuisibles. Chacun son tour.
La pestilence fécale et l’âcreté du sang risquent de masquer les autres odeurs. Si quelqu’un pénétrait dans le terrier, il ne le sentirait pas. Ne pas traîner ici. Vite fouiller ce trou exigu sans même allumer une bougie pour dévisager l’homoncule. Éculée, l’excitation d’autrefois à reconnaître le faciès d’un dominant célèbre, à l’étriper en pleine lumière pour contempler sa morgue lui dégouliner des yeux et le quitter avec sa tripaille. Regarder ces loques crever dans leur abjection et leurs déjections devenait rasoir. Alzéra préfère à présent les expédier dans le noir. Les dominants en ont tellement rabattu. Ils l’ont bien ravalée, leur arrogance. Mais pour en arriver là, il avait fallu endurer fléaux et chaos, briser des digues, abattre les obstacles, à commencer par leurs saloperies de bunkers. Et Gaïa avait dû en faire des tonnes, écrouler des dominos grands comme des montagnes et des calottes glaciaires, tempêter, inonder, éructer sa lave, fouailler de ses tornades, pour qu’enfin, enfin ! le dominant se ratatine en homoncule.
Soleil descend
Dans la terre
Plus de lumière
L’Autre descend
Dans la terre
Sans lumière
Il voit clair dans
Le même noir
Que son regard
Peur de suivre
De descendre
Dans son regard.
Alzéra cherche à tâtons des denrées. Il piétine dans l’étroit terrier, foule du sang, des entrailles, de l’excrément. Aucun dégoût. Les marches incessantes ont corné ses pieds comme du sabot. Il en a la plante aussi insensible que son cœur. Gaïa s’abreuve du sang et des viscères de ceux qui l’ont tant dessiquée… juste retour !
Encore un trou à rat pas étayé pouvant s’effondrer à tout moment. Certains homoncules finissent ainsi. Étouffés par la terre qu’ils ont rendue sèche et stérile. Le dominant multipropriétaire de villas fortifiées, îles artificielles, bunkers somptueux et autres délires, pensait-il finir son ère d’opulence et d’impunité ainsi, contraint de squatter les tanières des pauvres hères que sa cupidité inconséquente avait dépouillés et forcés à se terrer sans subsistances, loin des villes indigentes et chaotiques ? Ceux-ci n’avaient pas tenu bien longtemps dans de telles conditions. Tous disparus. Qu’un individu végète dans un terrier, forcément un ex-dominant. Ou un ancien expurgateur pilleur de bunkers. Peu importe. Dominants, asservis, expurgateurs, tous destinés à l’extinction complète. Et c’est tant mieux.
Pas besoin de lumière pour identifier, dans un sac plastique, une trentaine de tubes de pâte alimentaire. Et à côté, le plus précieux : trois packs de bouteilles d’eau minérale. L’or translucide. Ultime monnaie d’échange avant que sa rareté le rende inestimable et que chacun le garde pour soi. Proverbe survivaliste : la vie ne tient qu’à un pack.
Rien d’autre. Avec si peu de réserves, l’homoncule n’en avait plus pour longtemps. Alzéra s’en contentera. Le travois est déjà bien pourvu. Inutile de le charger plus que ne peuvent le supporter les perches et ses propres forces pour le tracter.
Hors du trou. Il déchire le film d’un pack pour en placer les bouteilles sur la plate-forme du travois. Leur plastique est déformé par la chaleur. Les bouteilles se vrillent, se contorsionnent, contrefont d’étranges sculptures que des douleurs tourmentent. Même cette saleté de plastique a l’air de souffrir, qui est pourtant la dernière chose à pulluler sur terre !
La plate-forme est une plaque de tôle aux bords recourbés pour former une ridelle. Il l’avait trouvée telle quelle, et n’avait eu qu’à en trouer les coins pour passer les cordes qui l’assujettissent aux perches. Hélas le morfil des trous effiloche peu à peu la corde. Il en possède encore un rouleau entamé. Il s’en sert pour remplacer les liens proches de rompre. Suffira-t-il pour le dernier bout de chemin ?
Il sort une partie de ses stocks afin de tout placer et caler au mieux. Pour l’essentiel, des bouteilles et des tubes de pâte alimentaire. De quoi tenir trois semaines. De quoi attiser une sacrée hargne pour débusquer le prochain terrier.
Le quartier de lune luit, grisâtre. Il doit traîner là-haut des nappes d’on ne sait quoi. Des saloperies toxiques. De l’haleine d’homoncule. La Lune, comme une trace de doigt sur la suie de la nuit. À peine suffisante pour distinguer l’omégane. Elle n’a pas bougé de là où il l’avait laissée. Sa silhouette sombre, guère plus qu’une ombre. Une ombre qui le suit. Et que pour l’instant il laisse en vie.
Peur devant
Peur derrière
Nulle part
Où aller
L’Autre sait
Suivre
Loin derrière
Là où
Pas de regard
Nulle part
Où aller
L’Autre sait
La peur
Traverser
N’a peur
De la peur
Cela aussi
Fait peur
L’Autre sait
Suivre
Loin derrière
Le regard.
2
Trouver de l’ombre avant l’arrivée du jour. Pas question de faire étape dans un terrier. L’homoncule se terre, l’expurgateur s’aère. L’un croit se protéger sous terre, l’autre ne craint pas la mort à découvert. Alzéra l’a donnée tant de fois qu’il n’a pas peur d’elle. Certes pas une amie. Juste une compagne de voyage. Furtive et muette. Pareille à l’omégane qui le suit comme son ombre, une ombre détachée de lui, méfiante, distante. L’ombre que ne fournissent plus les arbres disparus. L’ombre qu’Alzéra cherche pour bivouaquer tandis que la nuit grisonne, se débarrasse de ses nippes vaporeuses, redonne de l’éclat à la Lune. L’éclat du Soleil d’avant, clément, bienveillant, bienfaiteur. L’actuel, intraitable et létal, ne va pas tarder à darder son fer rouge. Malgré cette imminence, Alzéra chemine avec lenteur jusqu’au bout de la combe. Ne jamais se presser. La température a beau baisser un peu la nuit, la chaleur demeure extrême et ne permet que petits pas, gestes mesurés, efforts restreints, sous peine de suffocation, voire pire.
Là-bas ce gros rocher. Mais il se dresse plein sud, s’affaissant vers le nord-ouest. Il n’offrira de l’ombre que tard dans l’après-midi, bien trop tard. La combe se termine par une petite falaise. Orientée plein ouest. Donc à l’ombre toute la journée. Elle fera l’affaire. L’ombre, c’est la survie. La lumière n’apporte plus que la mort. Alzéra se retourne. L’omégane le suit toujours. À quoi bon ? Lui emboîter le pas ne mène qu’au néant.
Au pied de la falaise, Alzéra se dégage du travois, en pose les perches par terre, masse ses épaules rendues calleuses par le frottement du bois. Rasant les reliefs, le Soleil dénude de son voile nocturne l’étendue parcourue. La lumière aveuglante est saturée d’ocre, de blanc, d’orangé. Alzéra s’empare d’une paire de lunettes de soudeur, en noue autour de sa tête la cordelette qui remplace l’élastique de serrage depuis longtemps hors d’usage.
Le jour n’est plus supportable que fumé. L’homoncule pétri et bouffi d’innovation avait recouru à des protections oculaires connectées, implantées sur l’œil. Elles le préservaient des U.V. tout en restituant une image non assombrie. Comme tout le high-tech, elles avaient fait long feu. Pénurie d’énergie, adieu connectique ! Pas extraites à temps des yeux, elles condamnaient à la cécité… Bien vu ! Le high-tech menait à l’aveuglement. Les dominants en avaient usé et abusé pour ce qu’il était avant tout : un outil de cécité de masse. Mieux valait de bonnes vieilles lunettes de soudeur.
L’omégane n’en a pas. Elle va finir par se griller les yeux. Vu le peu de temps à vivre pour elle, mieux vaut qu’elle s’aveugle, elle ne le verra pas s’approcher, le moment venu.
Le dernier bunker, on en a trissé comme des éclaboussures. La salle de contrôle clignotait, trémulait, hululait de toutes ses alarmes, mais pas aussi fort que Lowlander qui braillait dans le micro : « On fout l’camp ! Tout l’monde dehors ! Bande de crottes de cancrelats ! » Il aimait ça, gueuler, et haranguer, et insulter, mais là pas besoin d’insister, ça cuisait trop sous nos fesses. La centrale bouillait de radioactivité après avoir lampé toute la nappe phréatique. À sec, l’immense nappe immensément profonde qui aurait pu les abreuver durant des décennies voire des siècles ! Ces abrutis de dominants avaient préféré alimenter leur mini-centrale pour leur saleté de luxe, de standing, d’aïe-tech, leur saloperie de vanité malfaisante ! Faut dire qu’ils n’avaient pas soif, avec ces montagnes de packs d’eau minérale alignées dans des hangars presque aussi grands que leur cupidité, pour se donner une idée… Des pyramides de bouteilles plastiques ! Ils se croyaient les pharaons de l’eau minérale conditionnée. On en avait fait, des bunkers, mais question packs d’eau, ça battait tous les records. On n’en demandait pas tant, on tirait tous la langue, à en suer du sable et pisser des cailloux tant on s’était rétrillonné le liquide avant d’atteindre ce bunker qui était le dernier – mais on ne le savait pas alors… Les couillons ! À peine croyait-on avoir déniché l’Eldorad’eau, qu’il fallait qu’on déguerpisse fissa voire fission ! Et qu’on amasse du kilomètre entre ce bunker qui voyait rouge et nous, sous peine de se faire au choix pulvériser, carboniser ou irradier. C’était la nuit, encore heureux, on pouvait espérer quelques performances pédestres en surface à poursuivre l’horizon aussi vite que le permettaient nos guiboles déglinguées par les crapahutages. En plein jour, on aurait été piégés comme des merguez entre deux fusions, solaire et nucléaire ! Jouissif ! Bref, il y avait unanimité sur le verdict : sauve qui peut ! Rien à voir avec les premiers bunkers où on ne levait l’ancre qu’après des tas de pinaillages parce qu’il y en avait toujours pour prendre du bon temps et se pavaner dans la soie encore tiède du dominant occis. Lowlander beuglait : « On fout l’camp ! On fout l’camp ! Ouste les cancrelats ! » Ce n’était pas la peine de s’égosiller, on était tous raccord pour gicler hors de la taupinière comme un jet de carotide !
Alzéra gratte avec son poignard la terre durcie, en prend de pleines poignées, s’en enduit le corps, le haut du visage – le bas est mangé par la barbe –, son crâne chauve. La sueur fait adhérer la terre à la peau. Plus tard il faut recommencer, tant que dure le jour. Je m’enterre à l’air libre, songe-t-il parfois. L’ombre ne protège plus assez de la réflexion solaire et ses méfaits. Les vêtements, on n’y pense plus. Ça se salit, ça s’empuantit, ça tombe en charpies, et puis on n’en trouvait plus. Aux oubliettes, la mode girouette, la frénésie du shopping, les dressings indécents… À poil et terreux. Les derniers homoncules vaquent nus comme les vers qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être.
Alzéra tâte un tube de pâte alimentaire. Pas durci, donc encore mangeable. Comme sur tous les tubes, images et inscriptions sont décolorées ou effacées. Peu importe, les arômes chimiques ont un rapport si lointain avec les saveurs évoquées – et le temps n’arrange rien –, qu’il est inutile de savoir si c’est un tube « couscous » ou « forêt noire ». Avec un peu d’eau minérale, Alzéra humecte ses lèvres craquelées, sa bouche sèche. Sinon, ça ne passe pas, ça reste collé au palais sans parvenir à déglutir. Il dévisse le bouchon, presse le tube, une pâte grisâtre en sort. Il en renifle le fumet rance, se colle le tube à même la bouche, avale sans chercher à deviner ce que cette saveur peu ragoutante prétend suggérer. Un tube est censé correspondre à une ration quotidienne. Il l’ingurgite presque en entier. Puis va déposer le restant ainsi qu’un fond d’eau dans un gobelet non loin de l’omégane, à une distance où il sait qu’elle osera s’aventurer. Un partage inéquitable qu’il fait pourtant de mauvaise grâce. Le ravitaillement est une incertitude permanente. Scinder sa ration, même petitement, c’est peut-être mordre dans son reliquat de vie, surtout si le prochain ravitaillement se fait trop attendre. Quand il a découvert que l’omégane le suivait, il avait le choix entre la tuer ou la distancer – seule et sans réserves, c’était la mort assurée. Il n’en fit rien, sans trop savoir pourquoi. Elle n’aurait pas dû être là, elle n’aurait pas dû exister. Avait-il besoin d’abord de se convaincre de sa présence ?
L’omégane se tient accroupie, immobile. Elle aussi s’est enduite de terre sans qu’il l’ait vue faire. C’est l’heure où la chaleur commence de pétrifier le corps. Il n’est plus possible de bouger, le temps lui-même semble ne plus pouvoir avancer. Alors pour le tromper, Alzéra se met à parler, dans sa barbe ou dans sa tête, il ne sait plus vraiment. Sa voix sourd quelque part en lui, dans sa gorge ou dans son crâne, charrie des faits révolus qu’il sasse et ressasse jusqu’à en être dégoûté et n’en plus vouloir. Il passe en revue son passé, ce qu’il a vécu, subi, commis. À force de les remâcher, ses souvenirs et réflexions s’évaporent dans la fournaise du présent. C’est ainsi qu’il s’en débarrasse. Peu à peu sa mémoire se dessique elle aussi. Il espère finir amnésique de cette mauvaise fable. Avec un seul dessein en tête, inoubliable celui-là : l’éradication de l’homoncule.
Sa voix s’arrête de maugréer quelque part en lui ou hors de lui. L’omégane est toujours accroupie à sa place. Mais le tube est aplati et le gobelet vide. Elle semble deviner quand s’absente l’esprit d’Alzéra.
Lune éclaire
Soleil rougit
Taches
Sur les mains
Sang de la terre
La blesse la soigne ?
Descendre pour savoir ?
Trop peur
De la terre
Sans lumière
Sang frais
Rouge
Sang sec
Noir
Jour rouge
Nuit noire
Nuit sans Lune
Sang noir.
Le Soleil atteint seulement son zénith, l’acmé de son exacerbation. Il semble ne plus vouloir en bouger, comme s’il faisait fondre le ciel et s’y engluait. Il faut subir encore et encore ce temps mort, fastidieux, interminable, en étant terrassé par la touffeur et son bâillon bouillant sur la bouche et le nez.
Alzéra est assis contre la falaise, bras et jambes écartées, pour mieux ventiler son corps. Vouloir lutter contre la chaleur est vain. Il la laisse le traverser comme s’il était du vide ou du minéral. Quelque chose d’inerte et d’insensible. Il pourrait s’abandonner à la torpeur. Aucun danger possible aux alentours. Pour l’assaillir, il faudrait traverser cette étendue sans ombre, sous le pilon torride du Soleil. Agonie assurée avant d’atteindre la falaise. L’impitoyable fournaise représente une enceinte plus protectrice qu’un champ de mines ou un quadrillage de drones. Son seul avantage.
Mais il ne s’assoupit pas. Plus jamais il ne dort. Ça évite de souffrir en se réveillant, pour peu qu’un ruisseau bordé d’herbe verte ait traversé son rêve. Ne plus rêver. Ne plus rien laisser affleurer du monde d’avant. Rien ne doit troubler sa détermination. N’être plus qu’inhumain. « L’humain » – quel mot grotesque ! –, on a assez vu de quoi il était capable. Du pire. Seulement du pire.
L’omégane non plus ne dort. Assise à quelques mètres d’Alzéra, recroquevillée, bras autour des jambes. Elle aussi garde les yeux ouverts. Ils se plissent sous l’effet de la lumière, mais aussi d’une espèce d’inquiétude, qu’elle-même semble peiner à identifier.
La tête légèrement tournée vers elle, le regard invisible derrière ses lunettes de soudeur, Alzéra la scrute du coin de l’œil. Quel âge paraît-elle ? Treize, quatorze ans ? Plus ou moins ? La maigreur est tellement trompeuse. Et les bidouillages de labo avaient rendu l’apparence corporelle si peu en rapport avec l’âge… Elle a tout d’une omégane. Et pourtant ne peut pas en être une. Ça date tellement, les omégas. Du temps des labos dans les bunkers, de leurs « couveuses » à maturation accélérée, interrompue au stade qui excitait le plus la perversité du dominant. Cette croissance artificielle en faisait des êtres infertiles – mais on était tous en train de le devenir ! – et peu viables. Sortis des couveuses, ils ne vivaient guère plus qu’un an ou deux. Le dominant se dépêchait d’en profiter, lui qui se croyait tout permis. Dans ces alcôves vivotaient des êtres sans identité, du petit enfant à l’adolescent, rarement plus âgés. Des deux sexes, et aussi beaucoup d’intersexués qui de toute évidence faisaient salement fantasmer l’homoncule vicelard. Dans l’univers clos des bunkers s’assouvissaient les pires pulsions pédophiliques. La jouissance du pouvoir et son addiction passaient par les plus viles transgressions. Et nul doute que jouir tandis qu’en surface les gueux souffraient et agonisaient décuplait le plaisir. L’ultra-richesse soulageait de toute éthique. Et permettait d’entretenir la libido dépravée à coups d’hormones, de molécules et de bien d’autres panacées dont n’avaient aucune idée les exclus de la survie, laissés-pour-compte au-dehors, rendus stériles et asexués par ils ne savaient quoi non plus, traitements inoculés de force, pollutions chimiques, électromagnétiques, substances et radiations traînaillant un peu partout, dans l’eau, l’air, le sol. Poisons pour la plupart des gueux. Mais pour quelques-uns, inexplicablement, jouvence. Ces derniers avaient vu leur durée de vie s’allonger de manière conséquente, avec un fort ralentissement des effets du vieillissement. Au point de concurrencer les recherches les plus pointues pour atteindre l’immortalité. Au moment où les dominants ne s’attendaient plus à croiser grand monde sur leur chemin, tant les conditions de survie à la surface étaient devenues critiques, ils se heurtèrent à ces vieux de la vieille increvables, souvent reconvertis, après l’extinction des meutes, en expurgateur solitaire, enragé et jusqu’au-boutiste. Ultime confrontation entre spécimens d’une espèce de toute façon condamnée. Entretemps, avec la chute et la destruction de leurs bunkers, les dominants avaient perdu puissance, impunité et suprématie. Ils ne faisaient plus les fiers et gambergeaient dur.
Alzéra, lui, avait acquis au fil du temps une opiniâtreté froide et inexorable.
Il observe, sous la fine couche de terre, la forme naissante de petits seins. Une omégane bloquée en début de puberté. L’âge où jadis on disait avoir la vie devant soi. Elle n’a devant elle que le dernier lambeau à peine vivable d’une planète exsangue. Et en elle, juste le besoin de mixture en tubes et d’eau en bouteilles. Pourquoi dormirait-elle ? Elle n’a plus rien à rêver. À sec, les rêves. Comme le reste.
Les premiers assauts ne servirent qu’à se faire massacrer. Drones, mines, snipers, s’en donnaient à cœur joie. On était hachés menu comme chair à pâté sans en avoir vu ni entamé le moindre bout, de leur chair à eux. Les sécuritaires ressemblaient à leurs maîtres : ils savaient garder leurs distances. Ils nous toisaient de haut et de loin, à travers leurs caméras, lunettes, écrans, pour mieux nous flanquer la camarde en tripotant leurs boutons, gâchettes, manettes. Un jeu (vidéo) de massacre. On n’avançait pas, on était cloués au sol, des clous au métal brûlant qui te perforaient et te pulvérisaient comme de l’éclaboussure de chiasse. Tu parles d’un assaut ! C’était plutôt un « à terre » ! À terre les vers, et tortillez-vous pour disparaître dedans ! On enrageait d’impuissance, on s’était donné tant de mal pour le débusquer, ce satané bunker. Un temps fou à chercher et à recouper les tuyaux, et aussi à bourlinguer, guerroyer, survivre, pour aller le débusquer jusque là-bas, dans le tréfonds du continent. On n’arrivait pas à l’investir pour une simple raison : on essayait encore de ne pas mourir. Jusqu’au moment où la faim, la soif, les privations nous ont rendus à l’évidence. Elles piquaient les reins mieux que toutes les stratégies, et Lowlander se fit leur porte-parole, si on peut dénommer ainsi ce gueulard illuminé : « Faut se remuer le cul, les cancrelats ! Sinon on aura fait tous ces efforts pour rien, on finira par crever ici comme ailleurs, gueule ouverte, tête vide et estomac creux, comme des sacs à néant, à n’avoir plus qu’à se compter les os sous la peau ! Plus de recul, plus de calculs, sauf un seul : on est plus nombreux, bien plus nombreux que leurs balles, mines, obus, bots et drones ! Les munitions de leurs armes seront épuisées avant nos munitions en chair et en os ! » C’est vrai, on était de plus en plus nombreux à s’agglutiner dans ce coin perdu – du moins tel que l’avaient escompté les maîtres du bunker, perdu au point de n’être jamais trouvé… Raté ! À croire qu’une fois connu l’emplacement du bunker, l’info avait contaminé tous les gueux faméliques tenant encore debout ! On était étonnés du nombre de cancrelats avec assez de forces pour ramper jusque-là. Parce qu’en termes de locomotion, on ne pouvait déjà plus compter que sur nos deux guiboles pour bourlinguer… Ça rappliquait, encore et encore. Comment l’avaient-ils su ? Les infos étaient censées ne plus circuler, il n’y avait plus de médias – comment diffuser sans plus aucune énergie disponible ? De toute façon, après des décennies de propagande torrentielle, l’ultime tactique des dominants avait été le black-out. On n’avait plus que le bouche-à-oreille, alors qu’on était dans le chacun pour soi et tu devais plutôt faire gaffe que la bouche de l’autre ne te bouffe pas l’oreille ! L’info s’était pourtant propagée plus fissa que le plus vicelard des virus qu’ils nous pondaient de temps à autre pour nous exterminer plus vite. À voir le grouillement autour du bunker, elle s’était instillée dans beaucoup de trous, recoins et terriers, au point d’en faire sortir et migrer tous les gueux vers ce bout de continent où, paraît-il, on avait enfin déniché un de ces bunkers tant fantasmés, nids bétonnés d’ultra-riches où luxe et victuailles foisonnaient au-delà de l’imagination. Lowlander avait raison : on ne pouvait plus reculer, ça grouillait trop dans notre dos où toute la populace se massait. On n’avait rien sauf une chose : le nombre. Quand on est seul dans son coin, séparé des autres crevards, on se résigne à canner la gueule ouverte. Entassez-nous les uns sur les autres, on retrouve bientôt la hargne. Quitte à crever de faim, on donnerait bien quelques coups de crocs à son voisin ! C’est comme ça qu’ont vrillé les ciboulots. Mais pour une fois, dans le bon sens. Foutus pour foutus, autant se jeter sur les sécuritaires – du moins sur leurs mines et projectiles dans un premier temps – plutôt que s’entredévorer. Une sorte de rage collective a pris le dessus sur l’instinct de préservation individuelle. Une irrépressible frénésie. Le cocktail faim soif haine désespoir. Et désormais l’évidence pour nous galvaniser : nous étions trop nombreux pour eux. Leur armement et leur technologie n’y suffiraient pas. Comment ne pas s’en être aperçu plus tôt ? On se croyait survivants esseulés dans des trous à rat, petites poignées de pelade homonculienne, et voilà qu’autour de ce bunker posé là comme une belle crotte luisante s’agglutinaient les mouches à merde : nous ! Une nuée de claque-faim n’ayant plus rien à perdre, même la vie qui n’en était plus une ! Les dominants nous avaient exterminés, pour ça on avait bien dérouillé, mais pas assez !… À force de voir tous les jours des fous furieux se jeter sur leurs balles et leurs mines, et revenir sans cesse en piétinant les cadavres de la veille, les sécuritaires ont fini par gamberger. Leurs maîtres avaient été les rois des chiffres, des ratios, des excédents, des dividendes. Les rois des calculs. Ils s’étaient juste trompés sur un seul : on était et serait toujours plus nombreux qu’eux ! On finirait par leur grouiller dessus telle la vermine nettoyant jusqu’à l’os le macchabée. Beaucoup de sécuritaires finirent par le comprendre : ils avaient misé sur la mauvaise martingale. Les abandons de poste se multiplièrent. Les rats quittaient le bunker. Surtout la nuit, furtivement. Chacun pour soi. Dehors, ils tentaient de se fondre dans la masse. Démasqués, gare au lynchage ! Pas de mort douce pour le sécuritaire défroqué ! Leur mine de bien portants les trahissait. Et aussi leurs sacs bouffis d’armes et de vivres qu’ils ne pouvaient s’empêcher de trimballer et essayaient de planquer, incapables de se résigner à notre dénuement de pouilleux. Du moment que le sécuritaire commençait de déserter, le temps du dominant était compté. Pas facile de se défendre soi-même quand on a toujours asservi pour être servi. Pas doué pour le self-service, le prétendu self-made-man qui avait surtout abusé du slave-service ! On l’a eu comme ça, le premier bunker. À l’énergie du désespoir.
3
Fin de journée. Le Soleil a franchi la falaise. Ses rayons traquent l’ombre à son pied, l’auront bientôt refoulée. Il est temps de se déplacer vers le gros rocher qu’Alzéra a repéré en arrivant. Sans quoi l’heure à venir sera invivable. Comme se retrouver dans un bain de braises.
Cent mètres à parcourir. Une épreuve dans cet air surchauffé, sur ce sol brûlant, avec cet astre sadique surexcité par une proie enfin à sa portée, pour un peu on l’entendrait crépiter tel un feu de bois sec. Le Soleil est le Grand Expurgateur. Trop grand. Des homoncules lui échappent. Dans les trous, les encoignures. Le bipède à poignard doit terminer le travail. Soleil et expurgateur, des alliés de circonstance. Mais l’un finira par dévorer l’autre.
Malgré des pas mesurés, Alzéra atteint le rocher en nage, souffle court, cœur battant chamade. Sa tête cogne furieusement. Il a laissé le travois contre la falaise. Impensable de le tracter sous le cagnard. Même sur une courte distance. Le travois va souffrir durant une bonne heure. Perches et cordes vont devenir encore plus cassantes, tubes alimentaires plus insipides, bouteilles amollies plus informes, leur eau plus infecte à cause du goût de plastique calciné. Tant qu’il le peut, Alzéra évite cette cuisson en règle du travois. Mais ici, la configuration du lieu