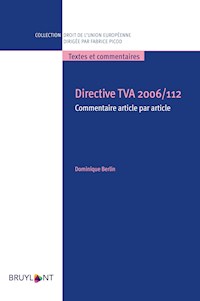134,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Collection droit de l'Union européenne - Traités
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
À une époque où parler d’Europe se résume à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n’existe pas, il est important de montrer que la construction européenne n’est pas un vain mot, même si elle prend du temps. C’est l’ambition de cet ouvrage de montrer de manière synthétique les principales réalisations des politiques européennes.
On s’apercevra que le travail réalisé est considérable, tant en matière monétaire, commerciale, de concurrence qu’en matière de transports ou d’agriculture, mais également de protection des consommateurs ou de protection de l’environnement. Il l’est d’autant plus que, dans une partie préliminaire, on aura constaté que les États membres ont limité les capacités financières de l’Union, alors que comme chacun sait l’argent est le nerf des politiques. Certes, tout n’est pas parfait ni complètement achevé.
Précisément, l’ouvrage s’efforce de mettre en perspective les réalisations pour replacer chaque politique dans son histoire et dégager les futurs tendances et défis. De surcroît, l’exposé de l’état des réalisations passe par un examen des textes mais également par celui des nuances apportées par la jurisprudence. Enfin, au-delà du caractère très fourni du matériau scientifique qui accompagne les développements, des graphiques ou des définitions permettent de rendre plus clair ce qui peut apparaître complexe. Au total, tout honnête homme désireux de se faire une idée exacte de comment fonctionne cette Union européenne dont il entend parler un peu partout pourra trouver dans cet ouvrage les éléments nécessaires à la formation de sa propre opinion.
Il s’adresse aux praticiens spécialisés en droit de l’Union européenne (avocats, notaires, magistrats…) ainsi qu’aux universitaires et à toute personne intéressée par le sujet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2544
Ähnliche
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.
Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.
La «photo-pillage» menace l’avenir du livre.
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.
© Groupe Larcier s.a., 2016
Éditions Bruylant
Espace Jacqmotte
Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN 9782802756835
Collection de droit de l’Union européenne – série Traités
Directeur de la collection : Fabrice Picod
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Chaire Jean Monnet de droit et contentieux de l’Union européenne, dirige le master 2 Droit et contentieux de l’Union européenne, président honoraire de la Commission pour l’étude des Communautés européennes (CEDECE)
La Collection de droit de l’Union européenne, créée en 2005, réunit les ouvrages majeurs en droit de l’Union européenne.
Elle est composée de sept grandes séries : une série « Thèses » qui publie les meilleurs travaux de thèses de doctorat en Europe, une série « Colloques » dans laquelle trouvent leur place les actes des colloques les plus importants sur des sujets d’actualité, une série « Grands écrits » reprenant les plus grands écrits ainsi réédités, une série « Manuels » répondant à l’enseignement du droit de l’Union européenne, une série « Traités » destinée aux praticiens du droit et aux universitaires, une série « Monographies » se consacrant à des thématiques bien précises et une série « Grands arrêts » sélectionnant et commentant chaque année les décisions significatives de la Cour de justice de l’Union européenne dans toutes les matières de l’Union européenne.
PARU PRÉCÉDEMMENT DANS LA MÊME SÉRIE :
1. Traité de droit européen de l’environnement, 3e éd., Patrick Thieffry, 2015.
Sommaire
Introduction
Partie PréliminaireLes moyens financiers des politiques de l’Union
TITRE ILes Ressources
CHAPITRE 1. – Aspects institutionnels de la notion de ressources propres
CHAPITRE 2. – Aspects matériels de la notion de ressources propres
CHAPITRE 3. – Régime juridique des ressources propres
TITRE IILa dépense budgétaire
CHAPITRE 1. – Contenu du budget de l’Union
CHAPITRE 2. – L’adoption du budget de l’Union
PARTIE ILES POLITIQUES À COMPÉTENCE EXCLUSIVE
TITRE ILes Politiques économiques
CHAPITRE 1. – La politique monétaire
CHAPITRE 2. – La politique de concurrence
TITRE IILes Politiques extérieures : la politique commerciale commune
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. – Problèmes de compétences et d’autorité
CHAPITRE 1. – Objectifs de la politique commerciale
CHAPITRE 2. – Le contenu de la politique commerciale
PARTIE IILES POLITIQUES À COMPÉTENCES PARTAGÉES
TITRE IDes politiques sectorielles particulières
CHAPITRE 1. – La politique des transports
CHAPITRE 2. – La politique agricole
TITRE IIDes politiques transversales plus récentes
CHAPITRE 1. – La politique de protection des consommateurs
CHAPITRE 2. – La politique de protection de l’environnement
Conclusions
Bibliographie sommaire
Table chronologique de la jurisprudence citée
Index
Table des matières
Introduction
1. De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque le terme de « politiques » de l’Union ? En faisant, un instant, abstraction du pluriel, le terme politique peut présenter plusieurs acceptions selon la traduction grecque qu’on lui donne. Ainsi, dans un sens relativement large, le terme politique qui se rapproche de celui de civilité1 renvoie au cadre général d’une société organisée et développée. Sans que ce sens soit inapproprié pour décrire l’organisation de l’Union européenne, ce n’est pas cette signification qui sera retenue ici. Selon un contour plus précis2, la politique serait constituée par tout ce qui touche à la constitution et donc à la structure et au fonctionnement d’une communauté. La politique regrouperait donc les actions, l’équilibre, le développement interne ou externe de cette communauté, ses rapports internes et ses rapports à d’autres communautés. Il s’agirait donc principalement de ce qui a trait au collectif. C’est dans cette conception que la science politique entend s’intéresser à tous les domaines d’une société (économie, droit, sociologie, etc.). Dans la mesure où seront examinées ici les différentes actions de l’Union tant internes qu’externes, il est possible de rapprocher le sens de « politiques » utilisé ici de cette conception. Toutefois, ce n’est pas la définition exacte qui en sera donnée. Enfin, il est un sens du mot « politique » beaucoup plus étroit3 qui renvoie à la pratique du pouvoir, mais dans une perspective se rapportant aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes et des femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, mais également à la gestion de ce même pouvoir. Sans ignorer que le contenu des politiques reflète nécessairement le résultat de ces luttes de pouvoirs, ce n’est pas non plus le prisme qui sera adopté ici4.
2. C’est en effet une définition plus fonctionnelle qui sera retenue. Une politique c’est tout d’abord des buts à atteindre. La manière dont ces buts sont choisis et hiérarchisés est un autre objet d’étude plus proche de la science politique (au sens de Politike), ou de l’étude plus institutionnelle de l’Union européenne (au sens de Politikos cette fois). Plus simplement, il s’agira ici d’identifier ce que sont ces objectifs, dans le cadre de chacune des politiques ici retenues. Mais la politique ce n’est pas que des finalités, ce sont aussi des moyens choisis et mis en œuvre pour atteindre ces buts. Finalement, une politique c’est un ensemble de moyens au service d’un ou plusieurs buts relatifs à l’organisation interne de la communauté (ici l’Union européenne) ou à ses relations avec d’autres ensembles. De ce point de vue, une politique de l’Union européenne ressemble à une politique d’un État, du moins à première vue.
3. Car le terme « politiques » ne doit pas tromper. Il ne signifie pas que l’Union européenne serait un État, de type fédéral, dont le « gouvernement » mènerait des politiques comme le font les gouvernements nationaux.
4. D’abord l’Union européenne, même si elle aspire à le devenir, n’est pas un État. La théorie kelsénienne de l’ordre juridique le montre très clairement. Elle est, dans la construction centralisation/décentralisation, une organisation internationale originale, très centralisée, mais une organisation internationale.
5. La meilleure preuve réside dans le fait que les États membres ne sont pas prêts à renoncer à leur souveraineté. Certes, l’Union économique et monétaire constitue une avancée importante et un « abandon » de souveraineté important (cf. infra,nos 212 et s.). Si l’on considère que les symboles de la souveraineté étatique demeurent le glaive (l’armée) et l’écu (la monnaie), cette dernière composante a certainement disparu, du moins pour un certain nombre d’États. Mais précisément pas tous, et le fait qu’il reste des monnaies nationales au sein de l’Union montre l’absence de caractère étatique de celle-ci. Seuls 19 États membres sur 28 font partie de ce que l’on appelle la zone euro c’est-à-dire qu’ils partagent la même monnaie.
6. Quant à la défense au sein de l’Union, elle repose au mieux sur la création d’une unité commune, mais plus sûrement sur une coopération étroite entre les États membres qui ne sont pas prêts à se dessaisir de leurs moyens et compétences militaires au profit de l’Union.
7. De sorte que si l’Union est une organisation internationale tout à fait particulière, non assimilable aux autres, elle demeure encore une organisation internationale. Elle coexiste avec les États membres en tant que sujets de droit international. L’article 4, § 2, du TUE le dit clairement : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. »
8. Du même coup les politiques menées par cette organisation ne seront pas de même nature que celles d’un État. Comme on va le voir, ces politiques (au pluriel) sont de ce point de vue le reflet de la nature de l’Union (i).
9. Mais, on l’a dit, si ces politiques traduisent la volonté de l’Union de s’auto-organiser, elles révèlent également le souci d’organiser les relations de celle-ci avec d’autres ensembles, avec le monde. De ce point de vue, ses politiques sont également le reflet des relations de l’Union avec le reste du monde (ii).
10. Reflets de la nature de l’Union, les politiques le sont de plusieurs points de vue. En premier lieu, elles obéissent aux rapports de l’Union avec ses États membres. Et ceux-ci ont évolué. Auparavant le cours dans les facultés de droit s’intitulait « Actions et politiques » : on entendait par là faire la distinction entre les véritables politiques, sous-entendues pour lesquelles la Communauté disposait de compétences en principe exclusives (et elles étaient trois, commerciale, agricole et transport), et les actions pour lesquelles la Communauté était certes compétente mais ne disposait pas de la compétence exclusive (et ces actions peu nombreuses au départ n’ont cessé de s’élargir).
11. Aujourd’hui, cette distinction n’a plus lieu d’être. Certes il est des domaines où la compétence de l’Union est exclusive (politique commerciale), mais il ne viendrait à l’idée de personne de contester le caractère de politique, à l’action de l’Union dans le domaine agricole, alors que depuis le traité de Lisbonne, cette politique est devenue un domaine de compétences partagées. De surcroît, l’intervention de l’Union en faveur des régions, ou du consommateur, voire de la protection de l’environnement, domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union, fait l’objet d’un corpus normatif si important qu’il paraît abusif, voire trompeur, de ne pas qualifier cette intervention de politique.
12. Il n’y a donc plus lieu de distinguer et de réserver le terme de « politiques » aux actions de l’Union qui relèvent de sa compétence exclusive. La ligne de partage passe ailleurs. En effet, les compétences de l’Union et leur exercice sont gouvernés, comme le rappelle l’article 5, § 1, du TUE, par le principe de spécialité et le principe d’attribution : « Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences5 ». De manière encore plus explicite, pour nous, le paragraphe 2 du même article explique que : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres. »
13. De sorte que, en premier lieu, il est exclu que l’Union devienne toute seule un État : elle ne peut accroître seules ses propres compétences6. Toute modification en la matière nécessite un accord des États membres qui prendra la forme d’un traité modificateur. En second lieu, les politiques de l’Union ne seront que l’exercice par celle-ci des compétences qui lui seront attribuées. Encore plus clairement, les buts de l’Union, donc des politiques, rappelées à l’article 3 TUE, pourront n’être que partiellement poursuivis dans le cadre des politiques de l’Union, si les États ont décidé qu’ils seraient également, voire seulement, compétents pour les atteindre. Deux exemples suffiront à le faire comprendre.
14. (i) L’article 3, § 1, déclare que « l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples ». Il est facile de comprendre qu’à l’heure actuelle, la « promotion de la paix » ressortit à la compétence exclusive des États membres, si l’on entend par là la défense nationale. Il n’existe en effet aucune attribution de compétence dans le traité au profit de l’Union en ce domaine, sauf peut-être, et encore, dans le domaine de la politique étrangère. Il n’y a donc pas de « politique de l’Union » pas même de compétence d’appui (cf. art. 6 TFUE) en ce domaine, même si certaines actions de l’Union peuvent indubitablement contribuer à la réalisation de cet objectif.
15. (ii) Le second exemple est sans doute encore plus significatif, car il touche à ce que l’on considère comme le cœur des politiques de l’Union. L’article 3, § 3, TUE dispose : « L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. » Or pour agir en ce domaine, ou du moins pour atteindre cet objectif « l’établissement d’un marché intérieur », l’Union ne dispose que d’une compétence partagée avec les États membres, comme le confirme l’article 4, § 2, TFUE7.
16. On ajoutera pour terminer ce point qu’à supposer même que l’Union dispose d’une compétence partagée pour mener une politique dans un domaine, comme l’établissement d’un marché intérieur, elle sera limitée dans l’exercice de ses compétences (i.e. dans l’utilisation des moyens au service de la fin poursuivie), par le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité comme le rappelait l’article 5, § 1, TUE cité plus haut. Ce qui signifie concrètement que : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union »8.
17. Cela étant dit, l’Union présente suffisamment de caractéristiques pour la distinguer des organisations internationales classiques, qui font de ses politiques des actions tout à fait originales. Sur le principe tout d’abord et dans le cadre des domaines de compétences partagées, on relèvera que l’article 2, § 2, du TFUE confère aux compétences étatiques un rôle subsidiaire ou second. En effet, « lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne. »
18. Cette affirmation peut paraître surprenante dans la mesure où elle paraît contredire, sinon le principe, du moins l’esprit des compétences d’attribution de l’Union selon lequel tout ce qui n’est pas expressément attribué à l’Union est conservé par les États. Pour concilier les deux il faut d’abord admettre que l’on parle ici de l’exercice de compétences conservées (et partagées) et non de l’attribution desdites compétences. Ainsi, les États sont-ils également compétents pour l’établissement du marché intérieur, mais ils n’exercent leur compétence que dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. Mais il faut ensuite se rappeler qu’en fonction du principe de subsidiarité, l’Union n’aura exercé la sienne qu’en démontrant que l’action pour atteindre le but, sera plus efficace à son niveau qu’à celui des États membres (cf. protocole).
19. Ces précisions étant apportées, il ne fait pas de doute que cette primauté chronologique confère aux politiques de l’Union, du moins à l’exercice par l’Union de ses compétences de mise en œuvre de ces politiques, une importance significative qui de surcroît ne va que grandissante dans la mesure où plus le nombre d’États membres augmente, plus la probabilité de l’efficacité de l’action au niveau de l’Union s’accroît. Et les compétences étatiques pour partagées qu’elles soient deviennent de plus en plus complémentaires ou, par un retournement des choses, subsidiaires de fait, si l’on ose ce néologisme. D’autant plus d’ailleurs qu’en vertu du devoir de coopération loyale (repris sur le fond à l’article 4, § 3, TUE9) les États membres ne peuvent (négativement) adopter des actes contrevenant aux objectifs poursuivis par l’Union, mais doivent également mettre tout en œuvre (positivement) pour assurer l’effet utile des politiques de l’Union.
20. Mais les politiques de l’Union sont également le reflet de la nature de l’Union, et plus particulièrement de la nature juridique particulière de celle-ci. On pourrait évidemment rappeler ici l’originalité de la structure institutionnelle de l’Union qui marque évidemment une différence fondamentale avec les autres OIG10. Toutefois, on se contentera de renvoyer sur ce point aux différents manuels de droit institutionnel pour insister plutôt sur le cadre juridique dans lequel s’inscrit nécessairement toute mise en œuvre des politiques de l’Union et qui donne à celle-ci une portée effective inégalée.
21. Dès lors que l’Union dispose d’une compétence expresse ou implicite pour adopter des règlements, il en découle nécessairement (art. 288 TFUE) que leur contenu s’intègre immédiatement dans l’ordre juridique des États membres. Même dans le cas où l’Union a procédé à l’harmonisation des législations par voie de directives, ces directives sont progressivement remplacées ou complétées par des règlements11 renforçant évidemment l’immédiateté de la norme et son respect par l’État. Car cette immédiateté se double d’une primauté qui assure l’effectivité de la norme centrale, pour revenir à Kelsen.
22. L’effet direct des normes de l’Union, c’est-à-dire le fait que ces dernières aient également pour sujets de droit les ressortissants des États membres et, ce qui va de pair, la faculté pour ceux-ci d’en demander l’application à l’encontre de leur propre État devant leurs tribunaux nationaux, n’est peut-être pas l’équivalent d’un ordre juridique étatique, mais comme dirait encore Kelsen, une forme particulière de concentration normative par rapport à l’échelon décentralisé, qui contribue néanmoins fortement à l’effectivité de la norme centrale.
23. Mais ce cadre juridique tout à fait particulier doit être mis en perspective avec les caractéristiques particulières de la construction de l’Union, ce que l’on peut appeler la dynamique de la construction. Quelques exemples permettent de mieux comprendre comment les politiques peuvent s’enrichir en dépit de l’article 5, § 1, TUE (cf. supra,n° 12).
24. La mise en place d’un marché unique a donné les moyens aux fraudeurs d’exercer à l’échelle de l’Union. Il a donc fallu trouver un accord pour que les administrations et les justices nationales puissent coopérer et s’assister mutuellement. Or, pendant longtemps, et dans une certaine mesure encore aujourd’hui, le droit pénal est resté un domaine réservé national. Cependant, l’article 83, § 1, TFUE a permis à l’Union d’adopter des règles minimales relatives à la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière12. De surcroît, l’UE dispose également de la compétence (art. 83, § 2, TFUE) d’adopter des règles minimales communes quant à la définition des infractions pénales et des sanctions si celles-ci sont essentielles pour garantir l’efficacité d’une politique harmonisée de l’UE. En effet, les politiques de l’Union européenne contiennent des règles allant de la protection de l’environnement à la conservation des ressources halieutiques, de la sécurité routière à la réglementation des services financiers13 ou encore, de la protection des données à la protection des intérêts financiers de l’UE. Ces politiques dépendent d’une mise en œuvre efficace. Le droit pénal comme mesure de dernier ressort peut jouer un rôle important quand d’autres méthodes de mise en œuvre ont échoué14.
25. Un autre bon exemple de cette dynamique touche aux récents événements découlant de la crise financière à partir de la fin de l’année 2008. Sans revenir en détail sur les origines de cette crise, on se limitera à rappeler qu’elle a eu une conséquence particulière dans la zone euro (alors même qu’il ne s’agissait pas d’une crise de l’euro), où les États membres n’ont plus le contrôle de la monnaie unique, contrôle dévolu au SEBC et principalement à la BCE (cf. infra,nos 214 et s.). Dans le souci de venir en aide au secteur bancaire et financier, frappé de plein fouet par un endettement abyssal, les États se sont portés au secours de leurs établissements en leur injectant des montants de capitaux si importants qu’ils ont dû s’endetter sur les marchés internationaux. De ce mouvement, il est résulté deux conséquences qui sont d’ailleurs plus une accélération de la construction de l’Union, qu’un changement de nature de l’Union. La première est la prise de conscience que la libération des services bancaires et financiers dans le marché intérieur ne pouvait se passer de la mise en place d’une Union bancaire, et notamment d’une plus grande surveillance bancaire, afin que la légèreté de la gestion des établissements bancaires ne se reproduise plus dans l’avenir. La seconde, liée à la première, est que la crise des dettes souveraines, et ses conséquences budgétaires, a montré la nécessité dans une zone de monnaie unique, d’une plus grande coordination (surveillance ?) budgétaire qui a débouché sur la signature le 2 mars 2012 du traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance.
26. Ces deux exemples montrent bien que la dynamique de la construction de l’Union place périodiquement les États membres devant les conséquences (souvent douloureuses pour eux) du caractère inachevé de la construction d’un espace économiquement intégré mais politiquement encore éclaté. Ils montrent également que le contenu des politiques sera le reflet de la nature de l’Union et de ses caractéristiques.
27. Mais, on l’a dit, le contenu des politiques de l’Union sera également le reflet des rapports que cette dernière entretient avec le (reste du) monde. Quelques exemples devraient permettre d’illustrer cette affirmation. En premier lieu, et paradoxalement à l’inverse de cette idée, il est possible de rappeler que l’Union a vu ses compétences en matière de relations extérieures étendues à raison de l’exercice par elle de ses compétences internes. Est-il besoin de citer ici la jurisprudence bien connue AETR15 ? Paradoxal, cet exemple peut le paraître, dans la mesure où il semble illustrer une dynamique inverse, celle d’un développement de ses compétences du fait des progrès ou des avancées de la construction interne de l’Union. Toutefois, le raisonnement juridique sur lequel s’appuie cette avancée ne doit pas faire oublier qu’il est intervenu à l’occasion de la volonté de l’Union (la Communauté à l’époque) de participer aux négociations et à la conclusion d’un accord avec les pays tiers. De ce point de vue, ce sont ces relations externes qui ont permis à la Cour de faire avancer le droit interne de l’Union, même si c’est en matière de compétences externes de l’Union. On pourrait d’ailleurs tenir le même raisonnement à propos des accords dits Open-Sky dans le domaine du transport aérien16.
28. De manière plus cohérente, peut-être en tout cas plus évidente, c’est évidemment la nécessité toujours plus grande d’inclure les investissements dans les accords commerciaux conclus entre l’Union et ses partenaires qui a conduit à la réforme issue du traité de Lisbonne incluant les investissements étrangers directs dans le domaine de la politique commerciale commune (art. 207 TFUE). Cet exemple est particulièrement topique puisque d’un domaine de compétence nationale on est passé à un domaine de compétence exclusive de l’Union. C’est également pour faire face au phénomène de mondialisation des problèmes écologiques et tout particulièrement celui du réchauffement climatique que l’Union s’est dotée d’un système d’échange de quotas (certificats) d’émission de gaz à effet de serre17, ajoutant ainsi un volet non prévu à la politique de protection de l’environnement. Sans doute plus discutable18, mais guère niable, est la réforme de la politique agricole commune, notamment la suppression des restitutions à l’exportation et des prélèvements à l’importation, et l’instauration du paiement unique découplé, en liaison avec le cycle de négociation de Doha du GATT19.
29. Les politiques de l’Union sont donc à la fois en phase avec les développements de la construction de celle-ci, ce qui n’est guère surprenant mais n’est néanmoins pas toujours suffisamment pris en compte, et en lien avec l’évolution du reste du monde. Ces deux caractéristiques n’en sont d’ailleurs pas réellement puisqu’elles sont communes aux politiques nationales. Et ce qu’elles partagent également avec ces dernières ce sont les problèmes de financement comme il va être exposé dans une partie préliminaire.
(1) On emploie parfois le terme Politikos en grec.
(2) Qui correspondrait cette fois au sens grec de Politeia.
(3) Que l’on peut rapprocher du terme grec de Politikè.
(4) On pourra se reporter pour un tel prisme à l’ouvrage de H. Lelieveldt et S. Princen,The Politics of the Europen Union, 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
(5)Cf.G. A. Bermann, « Taking Subsidiarity Seriously », Journal of Law, 1994 : « The elevation of subsidiary to a first principle of Community constitutional law contrasts sharply with the apparent indifference to subsidiarity both as an abstract tenet and a working instrument of U.S. federalism. There is, of course, no necessity that the constitutional design of the emerging European Union mirrors either the normative or the operational features of the United States. The point of the comparison is plainly enough not to have the United States join the subsidiarity band-wagon--far from it ; it is, rather, to ask whether the tepid embrace of subsidiarity in U.S. federalism signals that subsidiarity has indeed been oversold in the Community, and if not, why not. If subsidiarity is not equal to federalism’s task in the United States, it is certainly fair to ask why it should be considered fit for those purposes in Europe. » Et surtout : « To maintain that subsidiarity “fits” the European Community at its present juncture is not to ignore its shortcomings. As I have argued in Part II, subsidiarity is immensely difficult to operationalize, particularly if the legislative process is at the same time to pay due regard to proportionality as a governing value ; a realistic view of the interplay between subsidiarity and proportionality suggests that tradeoffs of an irreducibly political character will be involved. This in turn means that, justiciable though it may be, subsidiarity will not easily be judicially enforced. »
(6) Et indépendamment de l’article 352 TFUE (ex-art. 308 TCE et 235 CE) qui se lit : « 1. Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l’unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l’article 5, § 3, du traité sur l’Union européenne, attire l’attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.
4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l’article 40, second alinéa, du traité sur l’Union européenne » (en italique, paragraphes ajoutés par le traité de Lisbonne). L’article 353 TFUE ajoute d’ailleurs que l’article 48, § 7, du TUE relatif à la possibilité de modifier la règle de l’unanimité en majorité ne s’applique pas à l’article 352 TFUE.
(7) « 2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants : a) le marché intérieur ; (…) ».
(8) Le protocole annexé au traité de Lisbonne traite de la mise en œuvre concrète de ces principes.
(9) Article 4, § 3, TUE.
« 3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union » (italique ajouté).
(10) Même si l’intergouvernementalité a retrouvé récemment des vertus, notamment durant la crise financière, une perspective à moyen-long terme montrerait que cette intergouvernementalité est soluble dans le droit de l’Union.
(11)Cf. dans le cadre de la politique commerciale commune et plus particulièrement de l’union douanière le remplacement de directives (entre autres, directive [CEE] du Conseil 79/623 du 25 juin 1979 relative à la dette douanière ou directive 76/119/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 18 décembre 1975, concernant le régime du perfectionnement passif) par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (JOCE, L 302 du 19 octobre 1992, p. 1) maintes fois modifié et remplacé à compter du 1er mai 2016 par le Code des douanes de l’Union, règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, JOUE,L 269 du 10 octobre 2013, p. 1 (complété par le règlement délégué de la Commission [UE] n° 2015/2446 du 28 juillet 2015, JOUE,L 343 du 29 décembre 2015, p. 1, lui-même rectifié par le règlement délégué [UE] n° 2016/651 de la Commission du 5 avril 2016, JOUE,L 111 du 27 avril 2016, p. 1). Il est entré en vigueur le 30 octobre 2013. Même dans le cadre de la politique fiscale, la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA est « doublé » par un règlement d’exécution (règlement d’exécution [UE] n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JOUE,L 77 du 23 mars 2011, p. 1).
(12) L’UE peut adopter des directives établissant des règles minimales concernant la définition des infractions pénales, c’est-à-dire des règles précisant les comportements considérés comme constituant un acte criminel et le type et le niveau de sanctions applicables pour de tels actes. Ces domaines sont : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. Le 5 février 2013, la Commission a proposé une nouvelle directive relative à la protection de l’euro et d’autres monnaies contre le faux monnayage au moyen du droit pénal (COM[2013] 42). Cette directive remplacerait la décision-cadre 2000/383/JHA.
(13) Afin de mieux protéger et renforcer l’intégrité des marchés financiers de l’Union européenne, la Commission européenne a proposé le 20 septembre 2011 des règles s’appliquant à l’ensemble de l’Union européenne afin d’assurer des sanctions pénales minimum pour les manipulations de marché et les opérations d’initiés. Les régimes de sanctions actuels appliqués dans les États membres en matière de délits d’abus de marché se sont montrés inefficaces. Ils n’utilisent pas toujours les mêmes définitions de ces délits et sont trop hétérogènes, permettant aux personnes responsables d’utiliser des échappatoires. Selon la proposition de directive, « les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour garantir que les délits d’opérations d’initiés et de manipulation de marché soient soumis à des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres doivent aussi mettre en œuvre des sanctions pénales aux faits d’incitation, d’aide ou soutien à l’abus de marché, aussi bien qu’aux tentatives d’abus de marché. La directive vient en complément de la proposition de règlement sur l’abus de marché, qui améliore le cadre législatif existant dans l’Union européenne et renforce les sanctions administratives. » Avec cette proposition, la Commission utilise pour la première fois le nouvel article 83 (2) TFUE comme base légale et s’engage sur la voie tracée par sa récente Communication « Vers une politique de l’UE en matière pénale : assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal ».
(14) La Commission européenne a publié en septembre 2011 une communication (communication sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administrative COM [2011] 0293 final) visant à présenter un cadre pour le développement futur d’une politique pénale de l’UE en la matière, s’appuyant sur les principes de proportionnalité et de subsidiarité. On ajoutera que pour protéger l’argent des contribuables dans un contexte d’austérité budgétaire, la lutte contre l’usage impropre des fonds publics de l’UE constitue une priorité pour l’Union. Cette priorité est reflétée dans le traité de Lisbonne (art. 310, § 6, 325, §§ 85 et 86) qui prévoit l’obligation, ainsi que les bases juridiques adéquates, d’agir pour la protection des intérêts financiers de l’UE, y compris à l’aide du droit pénal.
(15) CJCE, 31 mars 1971, aff. 22/70, Commission c/ Conseil, Rec.,p. 263.
(16)Cf. CJCE, 5 novembre 2002, aff. C-476/98, Commission c/ RFA, Rec.,p. I-9855 ; du même jour, aff. C-475/98, Commission c/ Autriche, Rec.,p. I-9797 ; du même jour, Commission c/ Luxembourg, Rec.,p. I-9741 ; du même jour, aff. C-471/98, Commission c/ Belgique, Rec.,p. I-9681 ; du même jour, aff. C-469/98, Commission c/ Finlande, Rec.,p. I-9627 ; du même jour, aff. C-468/98, Commission c/ Suède, Rec., p. I-9575 ; du même jour, aff. C-467/98, Commission c/ Danemark, Rec.,p. I-9519 ; du même jour, aff. C-466/98, Commission c/ Royaume-Uni, Rec.,p. I-9427.
(17) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JOUE,L 275 du 25 octobre 2003, p. 32. Modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, JOUE,L 338 du 13 novembre 2004, p. 18, par la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, JOUE,L 8 du 13 janvier 2009, p. 3, et par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, JOUE,L 140 du 5 juin 2009, p. 63. Adde décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, JOUE,L 49 du 19 février 2004, p. 1, et règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE,L 270 du 14 octobre 2010, p. 1.
(18) En ce que la réforme de la PAC (mais on devrait dire les réformes) doit autant à des raisons internes, propres au dysfonctionnement de l’ancien système, qu’à des raisons externes liées à sa compatibilité avec les accords OMC.
(19) La quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Doha (Qatar) en novembre 2001, a lancé le nouveau processus de négociations agricoles. La déclaration finale de la Conférence a confirmé les objectifs des travaux préparatoires, précisé le cadre général des négociations – qui se dérouleront désormais dans le cadre du « Programme de Doha pour le développement » (PDD) – et fixé un nouveau calendrier. Les membres se sont engagés à négocier des améliorations substantielles à l’accès aux marchés, des réductions de toutes les formes de subventions à l’exportation en vue de leur retrait progressif, ainsi que des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, en intégrant aux éléments négociés le traitement spécial et différencié réservé aux pays en développement et en tenant compte des considérations autres que d’ordre commercial évoquées dans les propositions de négociation présentées par les États membres de l’OMC.
Partie Préliminaire Les moyens financiers des politiques de l’Union
TITRE I. – Les Ressources
TITRE II. – La dépense budgétaire
30. Il ne servirait à rien en effet de dresser la liste des politiques ou d’étudier leur contenu en oubliant que leur mise en œuvre n’est pas seulement dépendante d’une volonté politique, mais également de l’existence de moyens financiers. Tout but fixé resterait un vœu pieux si des crédits n’étaient pas affectés aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces buts.
31. Dans la plupart des organisations internationales, pour ne pas dire dans toutes, ces moyens financiers passent par des contributions versées par les États membres. C’est à la fois une garantie et une menace pour ces organisations. C’est évidemment une garantie que les États qui ont accepté de créer l’organisation, et la plupart du temps de limiter leurs compétences souveraines à son profit, fourniront à celle-ci les moyens de ses ambitions sans qu’elle ait elle-même à rechercher des fonds nécessaires à son fonctionnement sur les marchés internationaux. Mais, dans le même temps, l’origine publique de sa trésorerie constitue une menace, pour elle, du moins pour son indépendance et sa politique. En effet, les contributions étatiques sont très généralement proportionnelles à la richesse des membres. Les plus gros contributeurs sont donc les États les plus prospères, mais deviennent également les plus influents, notamment sur le contenu de la politique de l’organisation. L’exemple de la menace puis de la concrétisation du retrait des États-Unis de l’UNESCO en offre une parfaite illustration20.
32. Sans même parler d’influence politique, le système des contributions paraît également affecté d’un vice structurel qui fait dépendre le versement des contributions de la situation économique et politique interne de chaque État membre. Il va de soi que sur le plan économique, tout ralentissement de l’activité et toute diminution des recettes publiques amèneront les États membres au mieux à différer leur versement au pire à le remettre en cause. D’autant que ce versement n’est pas de droit car il suppose, le plus souvent, l’approbation annuelle du parlement en tant qu’autorité budgétaire ce qui expose le financement de l’organisation et donc la mise en œuvre de ses politiques aux remous secouant les équilibres politiques internes des États membres21.
33. C’est pour échapper à ces difficultés que les auteurs du traité de Rome22 avaient dès l’origine prévu qu’à terme la Communauté économique européenne serait dotée de ressources qui lui seraient propres d’où l’idée d’indépendance financière, même si cette indépendance est toute relative (titre I).
34. Mais, au-delà du financement desdites politiques, il convient, tout comme pour les États, de faire approuver les différentes dépenses concrétisant la mise en œuvre de ces politiques. Or entre les ressources disponibles et l’engagement des dépenses il y a parfois un écart important, voire des choix à effectuer qui vont dépendre de l’autorité budgétaire. De ce point de vue, l’adoption de l’acte budgétaire, puisque c’est de cela qu’il s’agit, ne peut être détachée du contexte dans lequel les politiques sont censées s’inscrire. C’est ainsi que dans une période d’envolée des dettes souveraines, le budget de l’Union ne peut ignorer les politiques nationales d’austérité budgétaire (titre II).
(20) M. Shultz, secrétaire d’État des États-Unis, avait fait parvenir le 28 décembre 1983 une lettre avisant l’UNESCO de son retrait au 31 décembre de l’année suivante. Motif officiellement invoqué : la lourdeur administrative de l’UNESCO qui selon les États-Unis dépensait trop pour sa simple gestion tout en subventionnant des projets contraires à la charte. Mais le communiqué de la Maison-Blanche était plus direct « la politisation extrême en dehors des attributions contribue à saper la base d’une société libre – tout particulièrement une presse libre, des marchés libres et, par-dessus tout, les droits de l’individu », ce qui est regrettable, de même que l’hostilité endémique envers les institutions » (à la suite, le Royaume-Uni et Singapour se sont retirés de l’Organisation, avec effet au 1er janvier 1986. Le Royaume-Uni avait réintégré l’institution fin 1997). À la suite du 11 septembre 2001, les États-Unis étaient revenus au sein de l’institution en 2003 au motif que « l’institution s’est réformée dans les domaines que les États-Unis ont cherché à réformer depuis leur départ, ce qui inclut une gestion plus saine, une épuration des activités et une adéquation avec ses missions, notamment la liberté de la presse » (président George W. Bush, 57th UN General Assembly, 12 septembre 2002). Mais les États-Unis ont à nouveau suspendu le 31 octobre 2011 leur participation, après l’admission de la Palestine au sein de l’organisation, qui représente 60 millions de dollars, soit 22 % du budget de l’institution. Le département d’État s’était dit contraint par deux lois américaines du début des années 1990 qui interdisent en effet le financement d’une agence spécialisée des Nations Unies qui accepterait les Palestiniens en tant qu’État membre à part entière, en l’absence d’accord de paix avec Israël. Les conséquences du retrait financier des États-Unis de l’UNESCO après l’admission de la Palestine au sein de l’organisation ne se sont pas fait attendre : le jeudi 10 novembre 2011, la directrice générale, Irina Bokova, a annoncé la suspension de l’exécution des programmes de l’agence onusienne jusqu’à la fin de l’année 2011.
(21)Cf. le refus de financement par la France de l’intervention des casques bleus au Congo (ONUC) en 1962, et sur la question plus générale du financement des dépenses de l’ONU l’avis consultatif du 20 juillet 1962 de la Cour internationale de justice sur certaines dépenses des Nations Unies (art. 17, § 2, de la Charte).
(22) Pour ceux du traité de Paris (1951), l’indépendance financière de la CECA était déjà en grande partie réalisée grâce à l’attribution à celle-ci par le traité, d’un pouvoir quasi fiscal lui permettant de percevoir, directement sur le chiffre d’affaires des entreprises productrices de charbon et d’acier, un « prélèvement CECA ».
TITRE I Les Ressources
Chapitre 1. – Aspects institutionnels de la notion de ressources propres
Chapitre 2. – Aspects matériels de la notion de ressources propres
Chapitre 3. – Régime juridique des ressources propres
35. À l’origine, on l’a dit, les Communautés européennes, à l’exception de la CECA, ne différaient guère des autres organisations internationales. L’article 200 du traité de Rome prévoyait ainsi les clés de répartitions des contributions financières entre les États membres23. Toutefois, à la différence, d’autres organisations, le traité CEE contenait un article 201 selon lequel « la Commission [devait étudier] dans quelles conditions les contributions financières des États membres prévues à l’article 200, pourraient être remplacées par des ressources propres (…) ».
36. Il fallut attendre treize ans et de longues négociations24 pour que ce projet voie le jour avec la décision 70/243/CECA/CEE/Euratom du 21 avril 197025. On retracera brièvement les aspects institutionnels (chapitre 1), matériels (chapitre 2) et juridiques (chapitre 3) de cette notion de ressources propres.
(23) Il se lisait : « Les recettes du budget comprennent sans préjudice d’autres recettes, les contributions financières des États membres déterminées selon la clé de répartition suivante : Belgique, 7,9 ; Allemagne, 28 ; France, 28 ; Italie, 28 ; Luxembourg, 0,2 ; Pays-Bas, 7,9. » Le paragraphe 2 du même article établissait des clés de répartition distinctes pour les dépenses du Fonds social européen.
(24) Sur l’histoire de l’adoption de la décision ressources propres et ses interférences avec l’harmonisation fiscale, cf. not. D. Berlin, Politique fiscale, coll. Commentaire J. Mégret, Bruxelles, ULB, 2012, vol. I, spéc. pp. 115 et s., nos 168 et s.
(25)JOCE, L 94 du 28 avril 1970.
Chapitre 1 Aspects institutionnels de la notion de ressources propres
37. À l’origine, les traités (art. 200 traité CEE puis art. 269 TCE) avaient imaginé une procédure de caractère hybride pour décider du principe de l’attribution de ressources propres aux Communautés de l’époque. Cette procédure prévoyait que sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, le Conseil statuant à l’unanimité arrêterait les dispositions dont il recommanderait ensuite l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. C’est bien la procédure qui a été suivie en 1970. La disposition appelle cependant plusieurs remarques.
38. La première a trait à la procédure évoquée ci-dessus. L’article 311 TFUE26, issu du traité de Lisbonne, modifie doublement le dispositif. En premier lieu, et s’agissant du cadre général, il opte pour une terminologie différente, bien que les acteurs impliqués demeurent les mêmes. C’est pour tenir compte de la nouvelle segmentation du traité de Lisbonne27 qu’il est précisé que c’est par la voie législative spéciale que le Conseil adopte la décision, l’approbation des États membres étant toujours requise. Mais cette terminologie ne change rien au cadre purement « européen » de cette procédure. La seule innovation concerne l’objet de cette procédure qui couvre non seulement la création de ressources propres, mais qui peut également aller jusqu’à « établir de nouvelles catégories de ressources propres ou abroger une catégorie existante », ce qui n’allait pas forcément de soi.
39. En second lieu, l’article 311, dernier alinéa, ajoute, pour la distinguer, la procédure propre aux règlements d’exécution. En effet, désormais, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. Il s’agit donc bien d’un règlement d’exécution de la « décision ressources propres » et non de cette dernière, et d’un règlement qui n’est envisageable que si la décision ressources propres le prévoit28. Ces règlements d’exécution sont ensuite adoptés selon la procédure législative spéciale, c’est-à-dire celle où le Conseil statue en dernier ressort, après approbation du Parlement européen29.
40. La deuxième remarque réside dans la constatation qu’hier comme aujourd’hui, ce que l’on appelle « décision ressources propres », publiée au Journal officiel de l’Union européenne avec un numéro d’ordre, est un acte hybride sur le plan juridique, puisque cette décision présente, comme les actes internationaux, et à la différence des actes de l’Union, la particularité de devoir être « approuvée par les États membres selon leurs règles constitutionnelles », en clair et en France, être ratifiée. Cette nature hybride aurait pu l’exposer à une contestation de nature constitutionnelle au moment de sa ratification. Cependant, le Conseil constitutionnel français30, pour des raisons qui lui appartiennent, a considéré que « la décision du 21 avril 1970, qui recommande le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, a le caractère d’une mesure d’application des dispositions sus-rappelées des traités instituant les Communautés européennes, dès lors qu’elle est prise dans les conditions prévues notamment à l’article 201 du traité ». De sorte qu’à partir du moment où la mesure fait l’objet d’une loi autorisant sa ratification, le contrôle de constitutionnalité se limite à cet aspect procédural et la mesure doit être considérée comme une mesure d’application des traités ne nécessitant pas de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité au fond.
41. La troisième remarque réside dans le fait que tout comme un accord international, l’adoption de la décision ressources propres doit recueillir l’unanimité des voix au sein du Conseil (outre bien entendu la consultation du Parlement), ce qui, dans une Union à 28 (pour n’y plus revenir, on conservera le chiffre 28 en dépit de l’adhésion de la Croatie, afin d’anticiper sur le Brexit), est plutôt difficile à réaliser. Au demeurant, la difficulté réside moins dans la réunion de 28 votes positifs, que dans la tentative d’éviter le vote négatif d’un seul État. Or, l’histoire montre par exemple qu’un État, en l’espèce le Royaume-Uni, a pu exercer son veto dans les années 1980 pour s’opposer à toute (décision portant) augmentation des ressources propres tant qu’une réforme, budgétaire31 en l’espèce, n’était pas intervenue. Il est donc toujours possible que les ressources de l’Union, donc la mise en œuvre des politiques, dépendent d’une stratégie de négociation d’un ou plusieurs États membres désireux d’obtenir l’accord de leurs collègues sur d’autres questions. Ce qui, on en conviendra, n’est pas la meilleure solution pour programmer sur plusieurs années les actions nécessaires à la réalisation de certains buts des politiques de l’Union.
(26) Il se lit : « L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.
Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l’Union. Il est possible, dans ce cadre, d’établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d’abroger une catégorie existante. Cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. »
(27) Distinction entre la procédure législative spéciale (art. 289, § 2, TFUE), principalement celle où le Conseil a le dernier mot et où le Parlement n’a qu’un rôle consultatif, et la procédure législative ordinaire (art. 294 TFUE) ou procédure de codécision.
(28) Ce qui avait déjà été le cas à plusieurs reprises, sans que la formule « règlement d’exécution » propre au traité de Lisbonne n’ait été évidemment utilisée, bien qu’il s’agit effectivement de règlements pris pour l’exécution de la décision ressources propres, cf. par ex. règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés (JOCE, L 130 du 31 mai 2000, p. 1, sur la base de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994, relative au système de ressources propres des Communautés européennes, et notamment son article 8, § 2), avant la décision 2014/335/UE, Euratom, décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne, JOUE,L 168 du 7 juin 2014, p. 105, not. son article 9 : « Conformément à la procédure visée à l’article 311, quatrième alinéa, du TFUE, le Conseil fixe les mesures d’exécution relatives aux éléments suivants du système des ressources propres : a) la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l’article 7 ; b) les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des ressources propres visées à l’article 2, y compris les obligations applicables en matière d’information ». Et ont été adoptés à ce titre le règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne, ibid., p. 29, et le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte). Adde le règlement modificateur (UE, Euratom) n° 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016, JOUE,L 132 du 21 mai 2016, p. 85.
(29) Cette procédure de l’approbation et celle de l’ex-avis conforme qui, si elle donne un pouvoir certain au Parlement européen, le place devant le dilemme du tout ou rien : soit refuser son approbation et le Conseil s’incline, soit l’accorder sans rien pouvoir négocier.
(30) Décision 70-39 DC du 19 juin 1970.
(31) Outre la volonté d’obtenir un accord de principe sur la diminution de l’importance de la dépense agricole (plafonnement en valeur absolue et en valeur relative tendanciellement), le Royaume-Uni faisait dépendre son accord sur la décision ressources propres (qui devait être adoptée en 1988) d’un accord (accordé depuis le Conseil européen de Fontainebleau de 1984) sur ce que l’on appelé le « chèque britannique », mais qui trouvait sa source dans un mécanisme obtenu dès le lendemain de l’adhésion et pudiquement appelé mécanisme correcteur en faveur des pays en situation de déséquilibre économique, cf. règlement (CEE) n° 1172/76, du 17 mai 1976, JOCE, L 131 du 20 mai 1976, p. 7.
Chapitre 2 Aspects matériels de la notion de ressources propres
Section 1. – Les ressources propres traditionnelles
Section 2. – Les nouvelles ressources
Sous-section 1. – La ressource TVA
Sous-section 2. – La ressource RNB
Les recettes de l’Union européenne en 2014 selon le projet de budget du Conseil
42. C’est donc la décision du 21 avril 1970 qui a, la première32, donné, corps à la notion de ressources propres. L’article 2 de cette décision disposait : « À partir du 1er janvier 1971, les recettes provenant : a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, dans le cadre de la politique agricole communeainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, ci-après dénommés “prélèvements agricoles” ;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, ci-après dénommés “droits de douane”, constituent, dans les conditions prévues à l’article 3, des ressources propres inscrites au budget des Communautés.
Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d’autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique pour autant que la procédure de l’article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l’article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique a été menée à son terme » (italique ajouté).
43. En clair, constituaient des ressources propres, au sens expliqué infra,chapitre 3, dès l’origine deux types de ressources, dénommées « les ressources propres traditionnelles » (ou selon l’acronyme RPT), dans la mesure où elles découlaient et découlent encore de politiques traditionnelles de la Communauté (ou de l’Union aujourd’hui) : à savoir la politique agricole (cf. infra,nos 934 et s.) et la politique commerciale (du moins dans sa partie union douanière, cf. infra,nos 611 et s.). En ce sens il s’agit de ressources « propres par nature ». On traitera de ces ressources traditionnelles dans une première section (section 1). Mais l’article 2 envisageait d’autres ressources que l’on examinera dans une seconde section (section 2).
Section 1. – Les ressources propres traditionnelles
44. Ces ressources propres sont de deux sortes. De première part, il s’agit des droits du tarif douanier commun33, ou comme l’indique la décision elle-même, des droits de douane. À dire vrai cette catégorie n’appelle guère de commentaires, si ce n’est que ces droits, issus du tarif douanier commun, sont certes perçus par les autorités douanières des États mais sont décidés, dans leur principe et surtout dans leur montant, par le Conseil des ministres de l’Union, chaque année34 en modifiant l’annexe du règlement portant tarif douanier commun35. Il s’agit donc d’une compétence exclusive de l’Union. Ces droits sont perçus aux frontières extérieures sur les importations. Le tarif douanier est devenu « commun », c’est-à-dire non seulement commun à tous les États membres mais relevant de la compétence de l’Union, en 1968, soit deux ans plus tôt que prévu initialement. Les droits de douane avaient été inscrits dans le traité de Rome en tant que la ressource à attribuer en premier à la Communauté économique européenne (CEE) pour le financement des dépenses. Les droits de douane de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) sont intégrés à cette ressource depuis 1988.
45. Sur un plan quantitatif, ces droits représentent aujourd’hui (2015) environ 11,9 % des ressources propres. Mais, surtout, ils ne peuvent que baisser tendanciellement en importance tant les droits de douane font l’objet, sur le plan mondial, et dans le cadre des cycles de négociation du GATT, d’abaissements réguliers. Sans être appelés à disparaître, ces droits de douane ne peuvent donc constituer une assise solide pour le développement des politiques de l’Union.
46. À côté des droits de douane, on trouve une catégorie relativement hétérogène, bien que généralement regroupée sous l’appellation « droits agricoles ». Dans cette catégorie on trouve d’abord les droits agricoles qui s’appelaient à l’origine prélèvements agricoles. Ils furent instaurés en 1962. À l’origine, il s’agissait de taxes qui variaient en fonction des prix du marché mondial et ceux du marché européen. Après la transposition des accords multilatéraux en matière de commerce (Uruguay Round, avril 1994) en droit de l’Union, il n’y a plus de différence technique entre les droits agricoles et les droits de douane. Les droits agricoles sont simplement des droits d’importation prélevés sur les produits agricoles importés des États tiers. À ces taxes s’ajoutent les cotisations sur la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline. Ces cotisations sont perçues sur les producteurs de sucre et d’isoglucose à l’intérieur de l’Union, contrairement aux taxes sur les importations agricoles. La taxe a été étendue aux producteurs d’isoglucose afin d’éviter une rupture de la concurrence entre les producteurs de sucre, déjà taxés lorsqu’ils dépassaient les quotas de production et ceux d’isoglucose qui ne l’étaient pas encore dans les années 197036. La même extension a frappé le sirop d’inuline37.
47. Quantitativement, elles ne représentent pas grand-chose, puisqu’en pourcentage du total des recettes budgétaires elles se situaient en 2015 à moins de 1 % (dont 0,89 % pour la cotisation isoglucose). On remarquera cependant que la décision de 1970 laissait la place au développement de ces taxes en valeur absolue, puisque, en premier lieu, s’agissant des prélèvements sur les produits agricoles de pays tiers, la décision évoquait les droits existants ou « à établir ». Ensuite, le même article 2 de la même décision qualifiait également de ressources propres, sous réserve de suivre la procédure de l’article 201 du traité « les recettes provenant d’autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune »38.
48. L’actuelle décision sur les ressources propres (art. 1, § 3) de 200739 accorde aux États membres une ristourne de 25 % du montant des ressources propres traditionnelles perçues à titre des frais de perception. À compter du 1er janvier 2014, les États membres devraient retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants qu’ils ont perçus selon la nouvelle décision ressources propres40 lorsqu’elle sera en vigueur41.
Section 2. – Les nouvelles ressources
49. Les ressources traditionnelles n’ont même pas suffi à couvrir les besoins budgétaires de la première année suivant l’adoption de la décision de 1970, c’est d’ailleurs pour cela que les articles 3 et 4 de celle-ci prévoyaient des dispositions transitoires42. Mais il avait surtout prévu une recette d’appoint.
50. L’article 5 de la décision de 1970 avait en effet envisagé la création, à l’horizon 1975, d’un mécanisme de recettes « provenant de la taxe à la valeur ajoutée et obtenues par l’application d’un taux qui ne peut dépasser 1 % à une assiette déterminée d’une manière uniforme pour les États membres, selon des règles communautaires ». Toutefois, en raison de ces caractéristiques mal appréciées à l’origine, la ressource TVA a dû être complétée et presque remplacée en 1988 par une nouvelle ressource qui n’a plus, si l’on ose dire, de propre que le nom. Reprenons ces deux points.
Sous-section 1. – La ressource TVA
51. Dans l’esprit du législateur de 1970, cette ressource devait clairement jouer le rôle de recette d’appoint. En d’autres termes, elle devait servir, et être calculée de telle manière à boucler le solde budgétaire une fois appliquées les RPT43. Un tel rôle, compte tenu du fait que le taux d’appel de la ressource (cf. infra,n° 59) était fixé par un taux plafond, n’était concevable que si la masse des dépenses à financer ne progressait pas trop vite, sauf à réunir une nouvelle unanimité au sein du Conseil pour déplafonner le taux maximal.
52. Par ailleurs, l’expression « ressource TVA » doit être bien comprise. Il ne s’agissait pas (et il ne s’agit toujours pas) de la création d’un impôt européen. Loin de mettre en place un lien de fisc entre le contribuable européen et l’Union elle-même, la ressource TVA s’adossait sur l’impôt national. Toutefois, là encore, il serait erroné de croire que cette ressource TVA est constituée par une fraction des recettes de la TVA nationale44. Comme l’explique le passage cité (cf. supra,n° 50), le taux d’appel de la ressource propre était censé s’appliquer sur l’assiette de la TVA, ce qui est tout autre chose45.
53. S’agissant précisément de cette assiette, la décision de 1970 précisait qu’elle devait être déterminée selon des règles uniformes communautaires. Pour quelles raisons ? Lorsque la Commission et le Conseil ont réfléchi à la création de cette nouvelle ressource propre, l’idée était de trouver un mécanisme juste qui fasse contribuer chaque État selon sa richesse. Il a semblé dans un premier temps (cf. infra,nos 60 et s.) que la valeur ajoutée en un an sur le territoire de chaque État était un bon reflet de sa richesse relative. C’est la raison pour laquelle, la TVA, et surtout l’assiette de cet impôt46