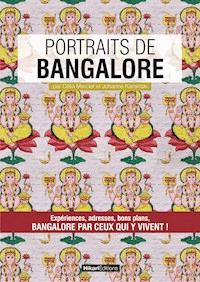
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hikari Editions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Découvrez Bangalore à travers les yeux de ses habitants
Portraits de Bangalore est un livre dans lequel ceux qui vivent dans la ville vous en donnent les clés. Mieux qu’un guide de tourisme, mieux qu’un récit d’expatriés, nous allons dresser ici une dizaine de portraits, à la première personne, dans lesquels vous découvrirez l’histoire de ceux qui ont décidé de venir vivre dans cette étonnante cité.
Chaque voyage, chaque départ, a sa propre histoire. On s’exile par amour, pour travailler, pour fuir. C’est une aventure permanente qui a un immense mérite pour celui qui la pratique : ouvrir les yeux. Certains de ceux que vous allez découvrir dans les prochaines pages sont des personnalités de Bangalore. D’autres de parfaits inconnus. Nous les croisions sans jamais leur avoir parlé vraiment. Pour ce livre, nous avons pris le temps d'écouter leur histoire. Cet objet littéraire est donc hybride. Entre le récit et le guide pratique. Il s’adresse aux visiteurs, aux touristes, à ceux qui veulent vivre à Bangalore, ou en Inde. Ils s’adressent à ceux qui sont curieux, et qui veulent trouver dans les parcours de leurs semblables des idées pour assouvir leur penchant.
Un guide à plusieurs voix rempli d'adresses utiles !
A PROPOS DE LA COLLECTION « VIVRE MA VILLE »
Vivre ma ville, ce sont des livres de voyage avec supplément d'âme. Ils donnent les clés, les conseils, les bonnes adresses, grâce à l'expérience de ceux qui vivent sur place, là où les autres guides se contentent d'auteurs professionnels de passage. Ils offrent aussi des histoires, une chair littéraire par les interviews-portraits d'une dizaine de personnes qui présentent leur lieu de vie. Chaque portrait est un roman. Chaque portrait a un enjeu : comprendre le choix de cette vie-là. Chaque portrait permet aussi au lecteur de s'identifier, et donc de choisir ses destinations en fonction de ses affinités, en fonction du personnage qui résonne le plus en lui.
LES ÉDITIONS HIKARI
Hikari Éditions est un éditeur indépendant, dédié à la découverte du monde. Il a été fondé par des journalistes et des auteurs vivant à l'étranger, de l'Asie à l'Amérique du Sud, souhaitant partager leur expérience et leurs histoires au-delà des médias traditionnels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PORTRAITS DE BANGALORE
par Célia Mercier et Johanne Kaminski
PORTRAITS DE BANGALORE
par Célia Mercier et Johanne Kaminski
Un livre de la collection Portraits de ville.
Directeur de la publication : Anthony Dufour.
Éditrice : Marie Duchaussoy.
Maquette et mise en page : Chase media & co., Cambodge.
Relecture : Yannick Dufour.
Imprimé en France par Dupli-Print, 2 rue Descartes, 95330 Domont.
Crédit photo de couverture : © Cyril Papot / www.fotolia.com. Représentation de Ganesh, le dieu hindou à tête d’éléphant.
Photographies pages intérieures : tous droits réservés.
Hikari Éditions© Hikari Éditions4, avenue Foch, 59000 Lille (France).ISBN 9782367740041www.hikari-editions.comISSN 2265-3082Aucun guide n’est parfait, des erreurs et des coquilles se sont peut-être glissées dans celuici malgré toutes nos vérifications. Les informations peuvent également avoir été modifiées entre l’écriture de ce guide et le moment où le lecteur le prend en main. Bangalore est une ville où tout change très vite… Merci de nous suggérer toute correction utile que nous pourrons intégrer dans la prochaine édition en nous écrivant à : [email protected].
Portraits de ville
Portraits de Bangalore, de la collection Portraits de ville, est un livre dans lequel ceux qui vivent dans la ville vous en donnent les clés. Mieux qu’un guide de tourisme, mieux qu’un récit d’expatriés, nous allons dresser ici une dizaine de portraits, à la première personne, dans lesquels vous découvrirez l’histoire de ceux qui ont décidé de venir vivre dans cette étonnante cité.
Chaque voyage, chaque départ, a sa propre histoire. On s’exile par amour, pour travailler, pour fuir, pour découvrir. C’est une aventure permanente qui a un immense mérite pour celui qui la pratique : ouvrir les yeux.
Certains de ceux que vous allez découvrir dans les prochaines pages sont des personnalités de Bangalore. D’autres de parfaits inconnus. Nous les croisions à Bangalore sans jamais leur avoir parlé vraiment. Pour ce livre, nous avons pris le temps d’écouter leur histoire.
L’objet littéraire qui suit est donc hybride : entre le récit et le guide pratique. Il s’adresse aux visiteurs, aux touristes, à ceux qui veulent vivre à Bangalore, ou en Inde. Ils s’adressent à ceux qui sont curieux et qui veulent trouver dans les parcours de leurs semblables des idées pour assouvir leur penchant.
Ce livre est écrit en toute indépendance, il n’a reçu aucun financement, aucune publicité, susceptible d’influencer ses résultats. Nous en sommes fiers, c’est unique dans l’univers des guides qui vous proposent leurs adresses en Inde. Les lieux que nous vous proposons sont ceux de nos invités, ceux qu’ils ont décidé de partager avec vous, dans la plus grande liberté, en toute subjectivité.
Bangalore en un clin d’œil
Selon une légende, le nom de Bangalore provient de Benda kaal Ooru en kannada, la langue locale et signifie « la ville des haricots bouillis ». Au XIe siècle, au cours d’une partie de chasse le roi Vira Ballala II se perdit dans la région et rencontra une pauvre femme qui lui offrit un plat de haricots pour se restaurer. En signe de gratitude, le roi donna ce nom au lieu-dit. Au XVIe siècle, Kempe Gowda, un seigneur local, considéré comme le fondateur de la ville, y construisit un fort. Bangalore était encore assoupie, dans l’ombre de Mysore, la ville royale du Karnataka. Mais en 1831, les Britanniques prirent le pouvoir dans la région et Bangalore fut promue capitale administrative. Séduits par son climat plaisant, épargné par les canicules et peu arrosé par la mousson, les colons y installèrent des garnisons et créèrent des parcs et jardins verdoyants. En 1906, bien en avance sur le reste du pays, la ville éclaira ses rues à l’électricité. C’est aussi devenu la ville de l’aérospatiale indienne et un centre universitaire et scientifique reconnu, avec le campus du prestigieux Indian Institute of Science fondé en 1909.
Dans les années 1990, la capitale de l’état du Karnataka a décollé brusquement suite aux réformes économiques qui ouvrirent l’Inde au reste du monde. Grâce aux pionniers de l’informatique Infosys et Wipro, implantés à Bangalore, la ville devient bientôt selon l’expression consacrée, la Silicon Valley de l’Inde. Elle attire les grands noms de l’informatique qui trouvent ici de jeunes ingénieurs venus de toute l’Inde, une main d’œuvre compétente et moins chère qu’en Occident. Comme certaines entreprises françaises délocalisent ici une partie de leur service informatique, une importante communauté expatriée s’installe à Bangalore. Américains, Européens et Asiatiques, mais la ville attire aussi des résidents permanents, en contrat local ou des entrepreneurs qui montent leur affaire.
Malgré ce surnom de Silicon Valley, il ne faut pas s’attendre pour autant à trouver les banlieues aseptisées et proprettes de San Francisco. S’il y a bien ici un quartier dédié aux nouvelles technologies, « Electronic city », des parcs industriels flambants neufs à l’architecture design et lisse, les buildings climatisés de Google, Yahoo ! et IBM, Bangalore reste chaotique, trépidante, odorante voire suffocante. En vingt ans, sa population a doublé pour atteindre 10 millions d’habitants, mais les infrastructures n’ont pas suivi et sont saturées : les embouteillages qui génèrent une pollution importante de l’air, les coupures d’électricité et d’eau sont des maux quotidiens, comme dans les autres mégapoles du pays. Le nouveau métro, qui permettra à terme de soulager le trafic effrayant aux heures de pointe, n’a ouvert pour le moment que six stations. Vaches et chiens errants se promènent dans les rues et certains quartiers ont gardé une ambiance très traditionnelle.
Ville symbole de la croissance indienne, Bangalore a changé de visage ces dernières années. La classe moyenne s’est enrichie, la ville attire des jeunes diplômés de tout le pays. Le soir, bars, restaurants, théâtres et cinémas font le plein, malgré la fermeture imposée de tous les lieux nocturnes à 23h30. Des centres commerciaux et des magasins de luxe sont sortis de terre, de nouvelles résidences et des buildings se construisent partout. Et la ville s’étend en tache d’huile, les petits villages traditionnels des faubourgs sont peu à peu happés par la mégalopole qui grignote les campagnes environnantes.
Mais au pied des chantiers, des bidonvilles de tentes abritent les « migrants », ces familles venues des campagnes qui travaillent dans la construction et vivent dans des conditions extrêmement précaires. À l’image de l’Inde, Bangalore reste une ville à deux vitesses. Car on y trouve aussi une douzaine de milliardaires indiens, comme le baron de l’alcool Vijay Mallya, le patron de Kingfisher, ou encore Narayana Murthy, fondateur d’Infosys et Azim Premji, celui de Wipro.
Le gouvernement local est issu du parti du Congrès (actuellement au pouvoir en Inde) et dirige l’état du Karnataka depuis mai 2013. Il a succédé au BJP - Bharatiya Janata Party - parti fondamentaliste hindou, dénoncé comme incompétent et englué dans des affaires de corruption. Le Congrès quant à lui, a promis de s’attaquer en priorité au problème de la pauvreté.
Bangalore reste un melting pot tolérant, où les différentes communautés cohabitent sans heurts. Églises, mosquées et temples hindous se dressent parfois côte à côte. Les habitants sont hindous à 80 % et leurs fêtes religieuses sont célébrées avec ferveur, comme le Ganesh Chaturthi, où l’on voit de grandes processions porter des statues du dieu à tête d’éléphant dans les rues avant de les plonger dans les nombreux lacs de la ville. Bangalore est aussi surnommée la « ville des jardins » avec ses parcs assez plaisants, comme le grand jardin botanique de Lal Bagh, qui permettent d’échapper un peu à la pollution ambiante.
Table des matières
Mariannick Halai
Les adresses de Mariannick
Jonathan Rouffet
Les adresses de Jonathan
Étienne Huret
Les adresses d’Étienne
Geneviève Messmer
Les adresses de Geneviève
Franck Barthélémy
Les adresses de Franck
Mathilde Legrand
Les adresses de Mathilde
Maxence Guegano
Les adresses de Maxence
Viren Khanna
Les adresses de Viren
Antonin Ancelle
Les adresses d’Antonin
Benjamine Oberoi
Les adresses de Benjamine
Jean-Michel Jasserand
Les adresses de Jean-Michel
Célia Mercier Et Johanne Kaminski
Les adresses de Célia et Johanne
Classement des adresses
Bangalore pratique
MARIANNICK HALAI
Mariannick, 40 ans, a longtemps navigué entre l’Asie du Sud-Est, la Tunisie où elle créait des objets artisanaux et l’Angleterre, pays de son conjoint. Avec sa petite famille, elle décide un jour de tenter sa chance en Inde. L’aventure sera mouvementée. Pour la jeune femme et son mari, le grand saut dans l’inconnu aboutira à un véritable succès : sa boulangerie-restaurant Chez Mariannick est devenue un incontournable de Bangalore… Non sans rebondissements.
« Je suis née à Lorient, mon père est breton. Il était militaire et il a été muté à Valence où j’ai grandi. Mais il avait gardé son âme bretonne. À la maison, on mangeait des crêpes le week-end et on écoutait Tri Yann… Quand j’entends de la musique celtique, cela me fait toujours vibrer ! J’ai beaucoup voyagé, j’ai exercé plusieurs métiers : j’ai été danseuse du ventre au Japon, j’ai ensuite longtemps travaillé en Tunisie, un pays que j’adorais et qui me manque terriblement. Là-bas, je fabriquais de l’artisanat pour les touristes, mais quand tous les bibelots chinois ont commencé à déferler sur le marché, ma petite entreprise n’était plus rentable. Il a fallu trouver autre chose, surtout que nous avions déjà nos deux enfants avec mon conjoint. La famille de mon mari est anglaise d’origine indienne. Lorsque mon beau-père est décédé, nous nous sommes rendus avec toute la famille en Inde pour jeter ses cendres dans le Gange, selon la tradition hindoue. Nous sommes ensuite allés rendre visite à la tante de mon mari à Bangalore, avec nos enfants qui avaient un et deux ans. De retour en Angleterre, on s’est dit : « L’Inde pourquoi pas ? On pourrait y tenter notre chance, on a de la famille là-bas… ». J’avais beaucoup voyagé en Inde quand j’étais jeune, j’allais chaque année dans le nord du pays pour acheter des collections de vêtements pour ma mère, qui tenait une boutique de vêtements « exotiques ». Personnellement, je n’avais jamais envisagé de m’y installer et j’avais même des appréhensions : le souvenir des poubelles partout dans les rues, de ces hommes qui harcèlent les femmes étrangères… Mais quand on y est retourné en famille, ça s’est bien passé. J’ai trouvé que le sud du pays était plus relax que le nord. Alors je me suis dit : « Pourquoi ne pas vivre à Pondichéry ? Il y a la mer et puis une bonne école française… Ce ne serait pas un changement si radical que cela. » On est donc partis avec le projet bien précis de s’installer à Pondichéry.
Quant à ce que l’on allait faire sur place, ce n’était pas encore bien défini. Un tas d’idées nous sont passées par la tête : ouvrir une crêperie (une idée de ma belle-mère indienne), créer de l’artisanat… Il y avait aussi l’idée de faire du pain. Je me suis dit : « Au cas où, autant se former. » et j’ai récupéré des cours de BEP de boulangerie. J’ai bossé comme une folle là-dessus, c’était devenu une passion. En vacances en France chez ma famille, je suis allée en stage chez mon boulanger. J’avais donc une idée relativement précise de la manière de faire du pain.
Pour mettre un peu d’argent de côté, nous avons posé des parquets à Londres pendant quelques mois. Et un jour, on s’est dit : « Au mois d’octobre, on s’en va ! ». Pourquoi octobre ? Juste une date comme une autre, je ne sais pas pourquoi. On est donc partis en octobre, avec les deux marmots, les deux poussettes et cinq grosses valises. On a débarqué avec tout ça à Bombay, de là on est allés à Pune voir des amis. À chaque fois, on voyageait dans les transports locaux et il fallait trois rickshaw pour mettre toutes nos valises, ça a été un cirque incroyable !
De Pune, on a pris la direction de Goa, puis le bus de nuit jusqu’à Bangalore, chez la tante et le grand-père de mon mari qui habitaient dans le quartier de Brookefield. On s’est posés là quelque temps mais le grand-père ne supportait pas le bruit que faisaient les enfants, il a fini par nous mettre dehors. C’était le moment ou jamais d’aller à Pondichéry, voir ce qu’il s’y passait. Nous sommes donc partis, avec notre rêve de nous installer là-bas en ouvrant notre boulangerie. Mais, à peine arrivés sur place, nous sommes tombés nez à nez avec une boulangerie française flambant neuve, tout juste implantée… Or Pondichéry, ce n’est pas grand. En plus, il y avait un boom de l’immobilier, la ville devenait à la mode auprès des riches habitants de Madras, beaucoup de monde achetait dans le quartier français huppé de Pondichéry, alors les loyers des locaux commerciaux s’étaient envolés, alors que nous, nous arrivions avec trois cacahuètes en poche… Cela a été une énorme déception de réaliser que notre projet à Pondichéry n’allait pas être possible.
Nous sommes retournés à Bangalore où nous avons trouvé une guest house, plus que sobre pour ne pas dire sordide… Il nous fallait réfléchir à ce que nous allions faire de notre vie. En attendant, nous avons trouvé une école pour les enfants dans le quartier de la tante de mon mari. C’était un tout petit établissement Montessori, il n’y avait que cinq ou six enfants par classe et les frais de scolarité n’étaient pas trop élevés mais c’était loin de notre guest house. Nous avons acheté un scooter pour emmener les enfants tous les matins, cela nous prenait trois quarts d’heure… Ensuite, on réfléchissait à notre avenir. C’était une période avec de grosses interrogations mais il y avait toujours ce projet de boulangerie.
Un jour, nous avons rencontré l’ancien chauffeur du grand-père de mon mari. Il nous a invités à dîner chez lui dans le quartier de Whitefield. C’était une famille très chaleureuse et quand ils ont appris que nous étions dans notre guest house pourrie, ils nous ont immédiatement proposé de vivre chez eux. Leur appartement était minuscule : une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, une cuisine mouchoir de poche… Ils nous ont accueillis comme des membres de la famille tous les quatre, avec tout notre bazar, pendant trois semaines. On était au ras-des-pâquerettes financièrement, tout nous semblait cher, on dépensait à peine.
Dans notre parcours, tout s’est souvent mis en place de manière accidentelle mais parfois les choses qui se passent mal, tournent finalement pour le mieux. Nous sommes donc partis en quête d’un toit. On quadrillait le quartier où nous habitions pour trouver un logement susceptible d’accueillir aussi un four pour notre future boulangerie. Comme nous n’avions pas d’argent, il allait bien falloir commencer la fabrication du pain à la maison. Nous étions aussi désespérés d’avoir un chez-nous et chez la famille du chauffeur, c’était vraiment trop petit, nous étions dans l’urgence. Au bout de nos recherches, nous avons repéré un bâtiment en construction dans le quartier. Le propriétaire ne parlait que la langue locale mais nous avons fini par comprendre que les appartements seraient prêts en janvier, il nous restait donc un mois à attendre. Nous sommes venus le harceler tous les jours, il a fini par craquer et nous a laissé l’appartement en avance, le 24 décembre. L’appartement coûtait 6 000 roupies (environ 95 euros), vide. Le lendemain on est allés au supermarché Big Bazar et on a dépensé 1 lak (1 500 euros) pour meubler l’appartement de A à Z : lits, sofa, télé, assiettes, etc. Enfin, on pouvait souffler : nous étions chez nous ! Tout autour c’était des champs, des villages avec des vaches.
Nous avons ensuite démarré notre projet de boulangerie. Nous avions réalisé qu’avec un four électrique, ça n’allait pas être possible à cause des coupures d’électricité intempestives. Quant aux fours de boulangerie importés de France, ils coûtent le prix d’une maison ici ! Impensable donc. Les fours locaux, eux, sont conçus pour cuire des pains de mie. Nous avons alors trouvé la solution de la construction d’un four à bois. Mon mari a regardé sur Internet, il y avait tout un tas de paramètres à respecter pour réussir son pain. Il a dessiné un plan. Ensuite, où allions-nous le mettre ? Nous avons repéré un champ à côté où se trouvait une cabane qui servait à ranger des outils et nous l’avons louée pour mettre notre futur four, très expérimental qu’il fallait chauffer tous les jours pour qu’il sèche, c’était un four « Cro magnon » avec des briques d’argile.
Cela a pris trois mois pour qu’il soit prêt et qu’il y ait une température idéale pour ajuster les cuissons. Et puis où trouver du bois ? Nous sommes allés chez un boulanger indien, il nous a expliqué qu’il brûlait des feuilles d’eucalyptus. Il y a beaucoup de forêts d’eucalyptus dans le coin, une espèce utilisée pour les échafaudages et le combustible. Nos premières fournées étaient donc cuites avec des feuilles d’eucalyptus, ça sentait bon mais ce n’était pas terrible ! Finalement, nous avons trouvé un fournisseur de bois d’eucalyptus, c’est ce qu’il y a de mieux.
Ensuite nous avons essayé toutes les farines disponibles, toutes les marques… Puis nous avons acheté un pétrin en ville. Je m’entraînais à faire des baguettes et des croissants dans ma cuisine, c’était une obsession à l’époque. Mais les paramètres ici sont tellement différents de la France que cela ne marchait pas, je me cassais les dents… Avec la chaleur en plus, décourageant ! Le beurre des croissants fondait… Mon ami boulanger en France m’a prévenue : « Tu n’y arriveras jamais » ! Chaque jour, on distribuait gratuitement nos fournées de baguettes expérimentales dans les villages sauf qu’ici les gens ne mangent que de la farine complète ! On se prenait pour les bons Samaritains mais en fait, ils s’en fichaient complètement. Combien de fois ai-je vu un chien errant trainer une de mes baguettes dans sa gueule…
À ce moment-là, je suis tombée malade et j’ai été alitée pendant un mois. Mon mari, très têtu et que rien n’arrête, a alors pris en main la fabrication des baguettes et des croissants. Et comme lui n’avait jamais été formé, il a tenté des expériences. Finalement, il a mis au point quelque chose qui fonctionnait. On a repris courage, enfin ça marchait !
C’est à cette période aussi que nous avons rencontré une jeune femme étrangère, Dana, qui habitait dans le quartier. Elle nous a dit : « Dites-moi quand vous êtes prêts, je vous aiderai ». Début avril, on commençait à être au point, j’ai employé une jeune villageoise pour nous aider, elle était illettrée mais très sérieuse et intelligente. Elle ne parlait que le telugu et moi je parlais quelques mots de gujrati, on communiquait par gestes… On s’est mutuellement construit notre langage, comme une ratatouille linguistique : j’inventais des mots, elle les répétait. Plus tard, j’ai étoffé mon hindi.
Nous avons donc prévenu Dana qui nous a proposé de nous prêter sa maison pour organiser une dégustation de nos produits. Elle vivait dans un compound* comme il y en a beaucoup dans le quartier mais à l’époque, nous n’avions aucune idée de la présence de tous ces expatriés tout près de chez nous ! Nous nous étions installés dans ce quartier par hasard.
Pendant son jogging, l’adorable Dana avait distribué nos prospectus dans toutes les maisons de sa résidence. Nous avions prévu des viennoiseries, des baguettes… Il fallait préparer la pâte la veille au soir pour la laisser monter dans le frigo et être prêts dans les temps. Nous nous sommes couchés dans l’angoisse du lendemain. Et à 2 heures du matin, on a entendu un énorme bruit ! La pâte avait tellement levé que tout était tombé dans le frigo. À 3 heures du matin, il a fallu refaire toute la pâte. En plus, c’était au mois d’avril, en pleine saison chaude à Bangalore, la température la plus difficile à gérer pour le pain. Quant à notre four à bois, il avait besoin de cinq heures de chauffe, pour ensuite retirer les cendres et les braises, laver la paroi avec un chiffon mouillé et attendre enfin une demi-heure pour que la température redescende. C’est un processus très long et compliqué qu’on ne maîtrisait pas encore très bien alors.
Donc ce matin-là, les baguettes avaient levé mais le four n’était pas arrivé à la bonne température. Et les baguettes se sont aplaties comme des crêpes… Quand je suis arrivée en taxi, j’ai découvert le compound de Palm Meadows qui ressemblait à Beverly Hills. J’étais vraiment dans mes petits souliers. Après une nuit blanche, des cernes sous les yeux, des baguettes plates, des croissants brûlés, une demi-heure de retard et la maison de Dana remplie ! Tout le monde me regardait et moi j’apportais des produits horribles, j’étais crevée, j’avais honte… La catastrophe complète. Je me suis affairée dans le salon, j’ai coupé mes baguettes pourries. Les invitées, elles, s’émerveillaient. Je les trouvais trop gentilles et indulgentes. Elles m’ont laissé leurs coordonnées dans un carnet. Le lendemain, j’ai rappelé tout le monde et j’ai obtenu mes premières commandes. Depuis ce jour-là, ça ne s’est plus arrêté, une vraie déferlante : nous étions complètement débordés, c’est devenu une véritable industrie. Je devais aussi m’occuper de mes deux enfants, encore petits, je me suis rendue compte que je les négligeais. Ca a duré deux ans, c’est devenu n’importe quoi, jusqu’à ce que je fasse réellement une dépression ! Cet immense succès avait été trop brutal et nous avions trop peu d’aide.
Nous avons aussi découvert à nos dépens que trouver du personnel était très difficile. Deux femmes du quartier sont venues nous aider, l’une nous a laissé tomber, l’autre, Lakshmi, est toujours là. Mais c’était sans cesse la valse du personnel qui va et vient, ne s’implique pas, qui part pour un oui ou un non, sans avertir. On pensait former des gens pour faire le travail de nuit. C’était utopique ! Du coup, le four ne pouvait chauffer que le matin tôt et nos baguettes n’étaient prêtes que l’après-midi. On a fini par trouver Arun, un homme dévoué, qui a vite compris comment ça marchait. Même si Arun et Lakshmi sont devenus nos piliers, ce n’était pas suffisant. Les gens d’ici n’ont pas envie de travailler de longues heures pour devenir esclave du travail. Ils préfèrent rester dans ce qui nous semble être la misère. Ils ne sont pas impliqués de la même façon, ils ne voient pas plus loin que le lendemain. Il y avait un adolescent qui nous donnait un coup de main pour installer les tables. Il est parti quinze jours sans nous prévenir. Finalement, il est revenu le sourire aux lèvres, puis un jour, il a juste disparu et on ne l’a jamais revu.
Nous avons maintenant sept employés principaux, qui forment le noyau dur. Mais nous sommes sous l’emprise de notre personnel, il faut composer avec eux car on a passé du temps à les former et s’ils nous laissent tomber, on est fichu. D’autant qu’ils trouveront sans problème ailleurs. Quant à employer un étranger ici, c’est impensable, il faudrait débourser un salaire minimum de 25 000 dollars par an selon la réglementation indienne.
Bien sûr, il y avait aussi les problèmes quotidiens avec les sacs de farine qui se suivent et ne se ressemblent pas. Les fournées parfois désespérantes, à cause d’une farine de mauvaise qualité, le pain qui était dur et sec… Je devais tout refaire et ensuite tout livrer. On a eu une période où il n’y avait plus de beurre en vente dans les magasins. Pendant trois mois, nous avons dû faire notre propre beurre avec un fouet électrique. Pour la livraison du pain, je partais en scooter. Je ressemblais à un âne, j’avais un panier derrière, un sac entre les jambes, un sac sur le guidon. Combien de fois le scooter s’est écrasé sous le poids ! Je travaillais quatorze heures par jour à fabriquer le pain, emballer, livrer. Quand je rentrais le soir, les enfants n’avaient pas mangé et il fallait encore remplir tous les papiers, gérer les factures, répondre au téléphone, prendre les commandes, non-stop… C’était trop, cette pression permanente. Des journées où tu trimes comme un âne pour une existence où tu gagnes trois cacahuètes. La difficulté du matériel. Les gens qui ne comprennent pas tes attentes. Le personnel qui nous plantait. Les retards de livraison. À l’époque, on n’avait pas trop d’argent, on réinvestissait, il fallait payer le personnel, le loyer qui augmentait… On faisait attention à la moindre roupie. C’est l’Inde, un pays pas facile, sans aucune protection, où on travaille comme des fous. Tout ce stress en permanence, quand j’y repense, je me dis que j’y ai laissé ma santé !
Mais nous avions une clientèle fidèle, nos produits étaient bons. Il fallait développer notre business parce que nous savions que nous n’aurions pas de retraite. Alors je me suis dit, pourquoi pas ouvrir aussi une crêperie ? J’avais ramené de Quimper des plaques à crêpe en fonte de 8 kilos chacune. Notre restaurant a ouvert le 14 février 2010, pour le week-end de la Saint-Valentin. Nous avions prévu une formule spéciale et ça s’est très bien passé. Le restaurant a vite été plein à craquer. C’était un succès immédiat comme pour la boulangerie ! Ensuite, les clients nous ont dit : « Vous avez des fours, vous devriez faire des pizzas ! ». On a rajouté les pizzas le week-end, puis finalement aussi la semaine parce que ça marchait bien. On a aussi proposé des quiches et des desserts. Moi, après m’être occupée du pain, je me retrouvais seule pour faire aussi la pâte à crêpe, avec le resto plein à craquer, sans me poser une seconde. J’allais me coucher vannée et il fallait recommencer tous les matins à 6 heures, gérer les commandes, les factures… J’ai fini par craquer, je broyais du noir, c’était trop. Finalement, mon mari a redistribué les tâches entre les gens de l’équipe, pour me soulager.
Pour monter notre commerce, nous avons dû créer une structure légale. Mon mari est d’origine indienne, il a donc un statut d’OCI, Oversea Citizen of India, qui lui permet de travailler, de faire du business, il a tous les droits sauf celui de voter. Mes enfants, étant d’origine indienne également, ont le même statut. Moi en tant qu’épouse, j’ai le PIO, « Person of Indian Origin », qui me permet d’avoir un visa de 15 ans. Notre affaire est légale, enregistrée. Mais ce n’est pas moi qui m’occupe du côté administratif… Cela ne m’intéresse pas vraiment, c’est très complexe et fastidieux. Alors quand je vois sur des forums de jeunes Français qui écrivent : « Je vais aller en Inde et je vais ouvrir un restaurant », j’essaie de les recadrer direct ! J’imagine ces petits jeunes, pleins d’illusion, qui n’y connaissent rien, débarquer ici et se faire arnaquer par un local qui voit tout de suite en eux la poule aux œufs d’or… Je ne veux pas les décourager mais arriver ici sans aucune expérience, en rêvant de l’Inde exotique… À moins d’être un gros businessman aussi requin que les autres, c’est très risqué.
Pour mes enfants, c’est le bonheur ici. Ils se sont indianisés, ils parlent anglais avec l’accent indien et ils dodelinent de la tête. Ils ont une enfance bien meilleure qu’en Europe, ils ont gardé leur innocence. Ils ne veulent pas à tout prix les dernières Nike, le dernier jeu vidéo, ma fille de 9 ans ne veut pas déjà s’habiller en femme. Ils sont insouciants. C’est l’enfance que j’ai eu, moi, dans les années 1970. On allume rarement la télévision, ils vont dehors jouer avec les voisins, c’est une enfance de qualité à mes yeux.
Et même si je peux me plaindre de toutes nos galères, mon business fonctionne comme il ne fonctionnerait nulle part ailleurs. Et avec la conjoncture actuelle, je serais inconsciente de tout plaquer. L’équipe tourne, il faut juste que moi j’accepte la mentalité des gens, c’est tout. Même si la condition des femmes ici m’insupporte vraiment.
Voici une anecdote qui touche au problème des castes en Inde. Notre employée Lakshmi, que j’encense et qui nous est indispensable, nous annonce un matin qu’elle nous quitte, qu’elle ne veut plus travailler ici. Et elle s’en va. Avec mon mari, on est restés comme deux ronds de flanc. On s’est dit qu’elle reviendrait demain, après-demain. Mais six mois plus tard, toujours pas de nouvelles. À mesure que le temps passait, on se remettait en question et en discutant avec le personnel, on a réalisé plusieurs choses. Quand nous avions embauché Lakshmi, le seul travail qu’elle ait jamais connu, c’était le travail des champs. Elle appartient à une sous-caste, tout en bas du système des castes indien. Elle ne connaît pas son âge mais elle a été mariée très jeune, sur sa photo de mariage, on dirait une fillette de 9 ou 10 ans. C’est vraiment l’Inde profonde et pas forcément glorieuse. À mon avis, cette jeune femme a une intelligence bien supérieure à la moyenne. D’ailleurs, elle est devenue rapidement boulangère en chef chez nous. Je pense que cela a provoqué plusieurs choses. D’une part, sa propre fierté d’être parvenue au poste de chef d’équipe et d’avoir obtenu autant de confiance. Cela a dû lui monter un peu à la tête. Et pour Lakshmi ce business était aussi « son bébé ». Si elle voyait le moindre relâchement, la moindre fainéantise dans l’équipe, elle remettait les pendules à l’heure. Et les autres, ça ne leur plaisait pas car ils ne pouvaient pas rester une minute à glandouiller sans se faire rabrouer. D’autre part, les autres membres du personnel ne s’adressaient pas à elle avec respect, surtout les hommes : se faire donner des ordres et remonter les bretelles par une femme intouchable non éduquée, cela ne passait pas. Dans la langue locale, il y a tout un panel de pronoms entre le vouvoiement et le tutoiement : il y a du « moins que tu », du « tu », du « un peu plus que tu » et du « vous ». C’est très subtil. Or apparemment les autres employés s’adressaient à Lakshmi avec le tutoiement le plus familier, ils la prenaient de haut et elle en a eu assez. Nous, on n’avait rien vu venir. Un matin, elle s’est simplement dit : « Je pars ». Ce départ, je l’ai vécu comme une rupture. Comme si j’avais perdu quelqu’un de cher, c’était très difficile. Cela me faisait mal au cœur. J’attendais le moment où je la reverrai et je voulais la serrer fort dans mes bras.
À l’époque, notre boulangerie était bien classée sur le site Trip Advisor, qui est un baromètre pour tous les commerçants qui travaillent pour le secteur touristique. Et mon mari avait promis à nos employés qu’ils auraient un bonus si nous devenions n°1 sur ce site. Nous avons finalement atteint la première place du classement. Lakshmi n’était plus là mais elle avait participé autant que les autres, si ce n’est plus, à notre réussite, donc elle méritait son bonus. Un dimanche, on a préparé une enveloppe de billets et on est partis la voir. On est arrivés chez elle, on s’est jetées dans les bras l’une de l’autre. Il n’y avait aucune rancœur. Entre temps, elle était devenue nounou dans une famille. Nous avons parlé, vidé notre sac, et je lui ai demandé de revenir, en lui expliquant qu’elle avait plus de perspectives de progresser chez nous qu’en restant nounou. Elle a fini par accepter et on lui a augmenté son salaire. Nous avons ensuite eu une discussion avec tout le personnel, nous leur avons demandé de s’adresser correctement et poliment à Lakshmi. Nous avons expliqué que nous formions une équipe et qu’il fallait que cela se passe bien dans les relations au quotidien. Depuis, Lakshmi ne nous a plus quittés.
LES CASTES EN INDE
C’est un système social propre à l’Inde, mentionné dans la Bhagavad-gîtâ, un texte sacré fondateur de l’hindouisme. Selon cette doctrine, la société doit être divisée en quatre varnas ou classes héréditaires (le mot caste, du portugais casta, signifie pur, non mélangé). Les castes recensées dans les textes sont :
- Les brâhmanes : prêtres, enseignants.
- Les kshatriya : les guerriers et classe dirigeante (rois, administrateurs).
- Les vaishya : artisans, commerçants, hommes d’affaires, paysans.
- Les sudra : serviteurs.
Il existe une dernière caste, non mentionnée dans les textes religieux, ce sont les« intouchables » (aussi appelés Dalits, « opprimés », ou Harijans « enfants de Dieu »). Ils effectuent traditionnellement des métiers considérés comme impurs (boucher, sage-femme, éboueur, croque-mort…) ou sont des paysans sans terre. Les membres des hautes castes considèrent qu’ils doivent éviter leur contact, ainsi que celui des hindous des basses castes, pour conserver leur propre « pureté ». Ce système a été combattu avec ardeur par les réformateurs indiens, dont le plus célèbre est Bhimrao Ramji Ambedkar, rédacteur de la constitution de l’Inde, intouchable converti au bouddhisme. Bien que théoriquement abolies par la constitution, les castes restent une réalité en Inde, notamment pour les mariages. Quant aux Dalits, malgré des politiques de discriminations positives, ils sont encore très souvent victimes de violences et de rejet.
Voici une autre histoire qui nous est arrivée, un sacré souvenir. Il y a quelques années, mon mari m’a offert un diamant d’un demi carat. C’était un gros achat pour nous ! Un jour, alors que j’étais en train de pétrir le pain, je m’aperçois que le diamant a disparu de ma bague. C’était la panique. Avec ma belle-mère, nous avons retourné tout l’appartement, toute la boulangerie, vidé toutes les poubelles par terre, tout passé au peigne fin. Il fallait absolument retrouver ce diamant. Évidemment, personne ne le trouvait. Nous avons alors pensé qu’il était peut-être tombé dans la pâte. Les baguettes venaient d’être roulées et je me souviens qu’il y en avait trente-neuf. Elles étaient levées, parfaites, bien dodues, prêtes à être enfournées. Mon mari décide donc de les étaler une par une avec un rouleau pour retrouver ce diamant… Une première baguette, une deuxième, une troisième, etc. Au moment de cette histoire, c’était encore extrêmement difficile pour nous d’obtenir de belles baguettes. Alors, voir toutes ces jolies baguettes aplaties, c’était dramatique. Mon mari arrive à la dernière baguette, toujours rien. Il avait complètement perdu espoir, alors par dépit, au lieu de l’aplatir, il l’a écrasée dans ses mains et l’a jeté en haut de la pile. J’ai levé les yeux et c’est là que j’ai vu le diamant qui me regardait, collé dans cette dernière baguette ! Nos beaux produits étaient fichus, impossible de livrer ce jour-là. Et à l’époque, nous étions tellement désespérés de réussir, de faire au mieux, de satisfaire les clients, que prendre mon téléphone et appeler notre clientèle pour leur annoncer que je ne pourrai pas livrer, cela a été une expérience horrible. À tous, j’ai raconté l’histoire du diamant pour qu’ils comprennent. »
*Ensemble de villas, clôturé et gardé où vivent de nombreux expatriés et de riches Indiens.
Les adresses de Mariannick
LES RESTAURANTS DE MARIANNICK
SUE’S FOOD PLACE
Cuisine trinidadienne
Du côté d’Indiranagar, j’aime bien Sue’s Food Place, qui donne sur 100 Feet Road. Sue est une trinidadienne d’origine indienne et elle a ouvert ce petit restaurant il y a une quinzaine d’années. Elle est très sympa et chaleureuse ! Elle propose une formule buffet où la nourriture est honnête, simple, faite maison et qui correspond au goût français. Ça fait un peu auberge, l’ambiance est familiale.
4, Subadar Garden,
Sri Krishna Temple Road, Indiranagar
Tél. : +91 80 2525 2494 / +91 98 8613 9201
Ouvert tous les jours de 12h à 15h30 et de 19h à 22h45.
LIKE THAT ONLY
Multicuisine





























