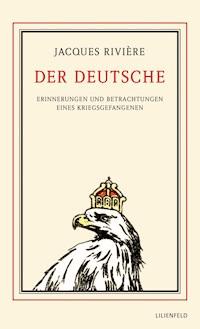Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ce livre explore les œuvres et les travaux de Freud et Proust en étudiant ce qu’ils apportent de nouveau en psychologie, et les progrès qu’ils peuvent nous faire accomplir dans la connaissance de ce qu’on appelait, à l’âge classique, le cœur humain.
Ces progrès peuvent être de deux ordres : Ils peuvent consister dans la conquête de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations, de nouvelles couches de la conscience, ou dans l’invention de nouvelles méthodes pour explorer celle-ci, dans l’invention d’une nouvelle manière d’attaquer les sentiments et les sensations. Nous distinguerons ces deux ordres de progrès, mais sans trop de rigueur pour ne pas nous interdire les points de vue qui se présenteraient et qui excluraient cette différence.
Une remarque encore. Notre étude ne sera pas un simple exposé. Il ne faudra pas vous attendre à sortir de ces causeries avec la connaissance du système de Freud et du système de Proust, comme on peut sortir d’un cours de la Sorbonne avec la connaissance du système de Platon. Je ne chercherai qu’à extraire du système de nos deux auteurs — si tant est qu’ils aient tous les deux un système — ce qui pourra être mis en rapport avec notre expérience intime et ce qui recevra de celle-ci une lumière.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et Proust.
Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et Proust.
Les trois grandes thèses de la Psychanalyse.
Chaque fois que j’entreprends des causeries, je fais le vœu formel d’écarter toutes précautions oratoires. Ce vœu, je l’ai fait cette fois-ci encore. Et pourtant, je ne peux me décider à aborder directement mon sujet sans quelques mots d’apologie, et surtout sans vous dire au préalable ce que j’en pense, de ce sujet.
Je vous avouerai naïvement que je le trouve à la fois d’un prodigieux intérêt et très délicat. Il a, à la fois pour lui et contre lui, d’être, du moins sous l’angle où je veux l’aborder, à peu près complètement inexploré.
Il y a, sur Freud, surtout en langue étrangère, une immense littérature — que d’ailleurs je ne connais pas. La mort si déplorable de Marcel Proust a déjà fait éclore de nombreux articles ; La Nouvelle Revue française du 1er janvier en contient à elle seule une cinquantaine.
Malgré cela, mon sujet, tel que je l’entends, continue à m’apparaître tout à fait inexploré, et si cela m’encourage, cela m’intimide aussi.
Cela m’intimide parce que je ne sais pas très bien où je vais, parce que je sens que je n’ai aucune chance d’arriver à des constatations définitives.
Je vois des quantités d’idées à soulever, à étudier, à suivre, mais un peu comme un ingénieur au centre d’une mine et qui se demande quels sont les filons qui vont donner, quelles galeries sont à percer, lesquelles le maintiendront le plus longtemps sur la veine. Je ne suis sûr que d’une chose, c’est que je m’engagerai dans des impasses, c’est qu’il me faudra par moments rebrousser chemin, c’est que peut-être je ne ferai qu’effleurer le principal, tandis que je m’empêtrerai dans l’accessoire. Il m’arrivera certainement de vous dire des choses qui m’apparaîtront moins vraies aussitôt que je les aurai dites et qu’il me faudra, ou retirer, ou transformer.
Excusez-moi, je vous prie. Ces mésaventures auxquelles je vous expose d’un cœur que vous pourrez trouver bien léger, elles sont la rançon de l’extrême importance, de l’extrême richesse et de l’extrême nouveauté du sujet que nous abordons. Si Proust a démontré quelque chose, c’est que rien ne pouvait suppléer le temps. En matière d’idées, moins qu’en toute autre matière. Celles que nous allons remuer n’ont pas reçu encore cette influence des années, qui, comme un lent soleil, peut seule les mûrir. Il n’y a pas là de ma faute. Je mets donc en fait, d’une façon peut-être un peu présomptueuse, mais il me semble, tout de même, justifiée, que les hésitations et peut-être les piétinements de l’étude que nous entreprenons en commun sont inévitables et ne devront pas m’être imputés à crime.
Mais ce sujet si nouveau, si admirable, et qui doit me mériter votre indulgence, il est temps de le définir, au moins en gros.
Je n’ai pas, comme vous pouvez bien penser, l’intention d’épuiser ce qu’on peut dire sur Freud et sur Proust. Non, c’est sous un angle très déterminé que j’entends les étudier. Grossièrement je voudrais étudier ce qu’ils apportent de nouveau en psychologie, je voudrais fixer les progrès qu’ils peuvent nous faire accomplir dans la connaissance de ce qu’on appelait, à l’âge classique, le cœur humain ; (et je vous prie de laisser ici à cœur son sens le plus vague).
Ces progrès peuvent être de deux ordres : Ils peuvent consister dans la conquête de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations, de nouvelles couches de la conscience, ou dans l’invention de nouvelles méthodes pour explorer celle-ci, dans l’invention d’une nouvelle manière d’attaquer les sentiments et les sensations. Nous distinguerons ces deux ordres de progrès, mais sans trop de rigueur pour ne pas nous interdire les points de vue qui se présenteraient et qui excluraient cette différence.
Une remarque encore. Notre étude ne sera pas un simple exposé. Il ne faudra pas vous attendre à sortir de ces causeries avec la connaissance du système de Freud et du système de Proust, comme on peut sortir d’un cours de la Sorbonne avec la connaissance du système de Platon. Je ne chercherai qu’à extraire du système de nos deux auteurs — si tant est qu’ils aient tous les deux un système — ce qui pourra être mis en rapport avec notre expérience intime et ce qui recevra de celle-ci une lumière.
Abordons maintenant l’étude de Freud.
On a reproché à Freud, Jules Romains entre autres, une certaine légèreté scientifique, c’est-à-dire une certaine tendance à transformer ses hypothèses en lois sans avoir accumulé la quantité d’expériences et de constatations objectives qui l’y autoriseraient.
Entre deux idées de savant, dit Jules Romains, il n’hésite pas à jeter une de ces « vues brillantes » qui témoignent, à coup sûr, d’une grande activité de pensée, qu’on a envie de déclarer géniales, mais qu’on ne range pas ensuite dans le même coin de l’esprit que la bonne monnaie scientifique. Ce sont valeurs fiduciaires, liées au sort de la banque d’émission.
En beaucoup de passages pourtant, Freud fait preuve d’une prudence tout à fait remarquable et prend même la peine d’indiquer lui-même les lacunes de sa doctrine, et les points où l’expérience ne l’a pas encore confirmée. La réponse à cette question, écrit-il dans l’Introduction à la Psychanalyse, ne me paraît pas urgente et, surtout, elle n’est pas assez sûre pour qu’on se hasarde à la formuler. Laissons se poursuivre le progrès du travail scientifique et attendons patiemment. Au seuil d’une généralisation tentante d’une idée qu’il vient d’émettre, il remarque : L’explication psychanalytique des névroses n’a cependant que faire des considérations d’une aussi vaste portée.
Il examine toujours avec beaucoup de soin les objections qu’on lui présente. On trouve par exemple au dernier chapitre de l’Introduction à la Psychanalyse une discussion remarquable de l’idée que toutes les découvertes de la Psychanalyse pourraient n’être qu’un produit de la suggestion exercée sur les malades. Quand on songe à la gravité de cette objection et quand on voit la façon magistrale dont Freud y répond, on ressent une impression de confiance à la fois pour l’honnêteté et pour la force de son esprit.
Cependant il faut l’avouer : quelque chose subsiste de la critique de Jules Romains et il y a certains défauts de méthode chez Freud dont il faut absolument que nous soyons avertis et que nous tenions compte avant de nous engager à sa suite.
Il est évident que nous avons affaire à une imagination extrêmement vive et allante et qui réagit parfois un peu trop vite aux premières indications de l’expérience. On est frappé, en lisant Freud, de la rapidité de certaines de ses conclusions. Très souvent on le voit, d’un seul fait qu’il rapporte, faire sortir une affirmation immédiatement générale ; très souvent aussi il lui suffit de pouvoir interpréter un fait dans le sens de sa théorie pour que toute autre interprétation lui paraisse exclue.
D’autre part la victoire incontestable sur les énigmes de la nature que représente son idée maîtresse lui donne une espèce d’ivresse qui le conduit à l’impérialisme. Je veux dire qu’il cherche à annexer trop de phénomènes à son explication. En particulier son interprétation des rêves et des lapsus, qui est pleine de remarques profondes, me semble tout de même dans l’ensemble, beaucoup plus factice et beaucoup moins convaincante que sa théorie des névroses. Et quand j’apprends que, historiquement, c’est par une explication des symptômes névrotiques qu’il a commencé, je me demande si toute sa théorie des rêves et des lapsus n’est pas une extension un peu arbitraire, ou du moins trop systématique, d’une idée juste à un domaine qui ne pouvait pas la recevoir, tout au moins sous sa forme textuelle.
En d’autre termes, je me demande si l’ordre d’exposition de sa doctrine que Freud a choisi dans son Introduction à la Psychanalyse et qui est, comme on sait, le suivant : Actes manqués, Rêves, Névroses, n’est pas extrêmement spécieux et s’il ne risque pas de tromper sur la démarche véritable de son esprit, au cours de ses découvertes et sur la valeur même de ses découvertes. Même s’il semble logique de montrer d’abord l’inconscient à l’œuvre dans les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne normale, cela devient une erreur de méthode si l’on ne peut pas le révéler avec autant d’évidence dans ces actes que dans les actes pathologiques, si son intervention y est plus contestable et si en fait ce n’est pas d’abord dans ces actes qu’il a été décelé.
J’ai beau faire : la théorie des lapsus et la théorie des rêves m’apparaissent comme une sorte de double portique qui a été construit après coup par Freud devant le monument qu’il avait élevé. Il croit que cela peut former un accès plus agréable et plus convaincant à ce monument ; mais à mon avis il se trompe parce qu’on n’a pas, dans cette première partie, assez fortement l’impression d’être en contact avec une expérience irréfutable, invincible, avec celle qui a imposé la théorie. On sent la subtilité de l’auteur, mais pas assez son bon droit.
C’est pourquoi je crois qu’il faut avoir sans cesse principalement en vue sa théorie des névroses si l’on veut saisir sa pensée en son point d’intention maximum et si l’on veut se rendre compte de toutes les conséquences qu’elle implique, de toutes les généralisations qu’elle est susceptible de recevoir, de sa plus grande portée, ou, si l’on préfère, de sa plus grande force explosive.
Je voudrais, dans ce qui va suivre, non pas analyser en détail la doctrine freudienne, mais au contraire, la supposant connue de mes lecteurs, faire apparaître, si l’on peut dire, ses virtualités. Je voudrais présenter les trois grandes découvertes psychologiques dont il me semble que nous sommes redevables à Freud et montrer quelle lumière prodigieuse elles peuvent infuser dans l’étude des faits intérieurs et en particulier des sentiments. Je voudrais surtout faire sentir combien elles sont extensibles, quelle forme plus souple et, si l’on peut dire, plus généreuse encore que celle que Freud leur a donnée, elles peuvent revêtir.
*
Dans l’exposé des faits qui lui ont suggéré la première idée de sa théorie et qui sont, comme on sait, l’ensemble des manifestations de l’hystérie, Freud insiste avec une force particulière sur la complète ignorance où se trouvaient ses patients des causes et des fins des actes qu’ils accomplissaient : Pendant qu’elle exécutait l’action obsessionnelle, écrit-il, le « sens » en était inconnu à la malade aussi bien en ce qui concerne l’origine de l’action que son but. Des processus psychiques agissaient donc en elle, processus dont l’action obsessionnelle était le produit. Elle percevait bien ce produit par son organisation psychique normale, mais aucune de ses conditions psychiques n’était parvenue à sa connaissance consciente… C’est à des situations de ce genre que nous pensons quand nous parlons de processus psychiques inconscients2. Et Freud conclut : Dans ces symptômes de la névrose obsessionnelle, dans ces représentations et impulsions qui surgissent on ne sait d’où, qui se montrent si réfractaires à toutes les influences de la vie normale et qui apparaissent au malade lui-même comme des hôtes tout-puissants venant d’un monde étranger, comme des immortels venant se mêler au tumulte de la vie des mortels, comment ne pas reconnaître l’indice d’une région psychique particulière, isolée de tout le reste, de toutes les autres activités et manifestations de la vie intérieure ? Ces symptômes, représentations et impulsions nous amènent infailliblement à la conviction de l’existence de l’inconscient psychique3.
Il ne semble pas, au premier abord, qu’il y ait, dans ces passages, une nouveauté bien extraordinaire et l’on pourra trouver paradoxal que nous y voulions apercevoir une des sublimités de la théorie freudienne. L’inconscient n’est pas une découverte de Freud. On citera tout de suite des noms qui semblent réduire aux plus minces proportions son originalité sur ce point : celui de Leibniz déjà, ceux de Schopenhauer, de Hartmann, de Bergson, de bien d’autres.
Pourtant je réponds :
1º Qu’il y a une différence considérable entre une conception métaphysique et une conception psychologique de l’Inconscient, qu’admettre l’Inconscient comme un principe, comme une force, comme une entité, c’est tout autre chose que de l’admettre comme un ensemble de faits, comme un groupe de phénomènes ;
2º Qu’en réalité beaucoup de psychologues contemporains, en particulier Pierre Janet et son école, refusent encore d’admettre un inconscient psychologique ;
3º Enfin qu’en admettant que l’inconscient psychologique soit reconnu de tout le monde en tant que royaume, en tant que domaine, Freud est le premier à le concevoir :
a) Comme un domaine, ou un royaume déterminé, qui a une géographie arrêtée, ou, sans métaphore : qui contient des tendances, des velléités extrêmement précises, dirigées vers des buts particuliers ;
b) Comme un domaine, ou un royaume qui peut être exploré, en partant du conscient, et même qui doit l’être si l’on veut comprendre le conscient.
Ici, je retrouve confiance pour affirmer que la nouveauté me paraît entière, et d’une importance formidable. Songez que jusqu’ici on a conçu le conscient comme une chambre close, où les objets, en nombre défini, étaient comme inscrits sur un inventaire et ne soutenaient de rapports qu’entre eux, et que, pour tel incident de notre vie psychique, si on voulait l’expliquer, on ne pouvait aller chercher qu’un fait dont nous nous fussions précédemment aperçus. Songez que toute la psychologie se limitait à une explication logique de nos déterminations. Songez au pauvre matériel causal dont elle disposait et imaginez ce qu’elle peut devenir au moment où Freud lui ouvre l’immense réservoir des causes immergées.
Lui-même, d’ailleurs, a conscience de la révolution que cette seule proclamation de la réalité déterminée de l’inconscient peut produire dans l’histoire des idées et il ne se défend pas d’un mouvement d’orgueil : C’est en attribuant une importance pareille à l’inconscient, dans la vie psychique, s’écrie-t-il, que nous avons dressé contre la psychanalyse les plus méchants esprits de la critique… Et pourtant un démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu’il n’est seulement pas maître dans sa propre maison, qu’il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. Les psychanalystes ne sont ni les premiers, ni les seuls, qui aient lancé cet appel à la modestie et au recueillement, mais c’est à eux que semble échoir la mission de défendre cette manière de voir avec le plus d’ardeur et de produire à son appui des matériaux empruntés à l’expérience et accessibles à tous4.
Réfléchissons. Appuyons, si j’ose dire, contre nous ce principe, de l’inconscient comme siège de tendances déterminées qui viennent modifier le conscient ; rapprochons-le de notre expérience. Autrement dit : Songeons à tout ce que nous ne savons pas que nous voulons.
Est-ce que notre vie n’est pas la recherche constante de biens, de plaisirs, de satisfactions non seulement que nous n’oserions pas avouer désirer, mais que nous ne savons même pas que nous désirons, que nous cherchons ? Est-ce que ce n’est pas presque toujours a posteriori et au moment seulement où nous l’accomplissons que nous nous rendons compte du long travail psychique et de toute la chaîne de sentiments latents qui nous a conduits vers un acte ?
Et encore : à quel moment l’inspection directe de notre conscience nous renseigne-t-elle exactement sur tout ce que nous éprouvons et sur tout ce dont nous sommes capables ? Est-ce que nous ne sommes pas dans une constante ignorance du degré, et même de l’existence de nos sentiments ? Est-ce que, jusque dans la passion, il n’y a pas de moments où nous ne retrouvons absolument plus rien de cette passion, où elle nous paraît une pure construction de notre esprit ? Et est-ce qu’elle n’existe pas, pourtant, d’une façon, si j’ose dire, infiniment précise, à ce même moment, cette passion, puisque le plus petit accident qui survient pour en encombrer la carrière, ou rendre son but plus lointain, peut provoquer instantanément un bouleversement complet de tout notre être, qui se traduira jusque dans notre attitude physique et influera jusque sur la circulation de notre sang ?
Est-ce qu’en amour, par exemple, un amoureux sincère n’en est pas constamment réduit à recourir à des expériences et presque à des trucs pour ausculter son sentiment et savoir s’il existe encore ? Et cela dans le moment même où, si on venait lui annoncer qu’il doit renoncer à ses espoirs ou qu’il est trompé, il se découvrirait peut-être tout près du crime.
Donc une première grande découverte, (qu’on pourra peut-être présenter comme négative, mais les découvertes négatives ne sont pas moins importantes que les autres) doit être inscrite au crédit de Freud : c’est celle qu’une considérable partie de notre vie psychique se passe, si l’on peut dire, en dehors de nous et ne peut être décelée et connue que par un travail patient et compliqué d’inférence. Autrement dit : Nous ne sommes jamais tout entiers disponibles pour notre esprit, tout entiers objets de conscience.
*
Cette première analyse doit faire comprendre dans quel esprit j’ai abordé l’étude de Freud et de quelle façon j’entends la poursuivre. Je ne prétends nullement accompagner pas à pas toutes les démarches de sa pensée ; je recherche simplement et je saisis les uns après les autres, sans me soucier de marquer comment ils se rattachent, les points de sa doctrine qui me paraissent pouvoir être agrandis en vérités psychologiques d’intérêt général. Je suis un profane qui pille égoïstement un trésor et qui l’emporte loin du temple. On peut me juger sévèrement au point de vue moral ; mais en tous cas on ne doit pas me considérer comme obligé à cette allure lente et processionnelle qui s’impose aux prêtres de la Psychanalyse.
Qu’on veuille donc sauter avec moi à l’examen d’une autre idée de Freud, qui me paraît d’une importance considérable ; je veux parler de l’idée du refoulement, à laquelle il faut rattacher celle d’une censure des rêves.
On sait quelle en est l’essence : en se fondant sur son expérience de praticien, Freud croit constater qu’il y a chez tout sujet qu’on analyse ou même simplement qu’on interroge, une résistance instinctive à toute question, à tout effort pour pénétrer dans l’arrière-plan de sa pensée. Cette résistance est soumise d’ailleurs à des variations d’intensité. Le malade est plus ou moins hostile, plus ou moins critique, suivant que la chose que le médecin cherche à amener au jour lui est plus ou moins désagréable.
La résistance semble donc être l’effet d’une force, de nature proprement affective, et qui s’oppose à l’apparition dans la conscience claire, à l’illumination, de certains éléments psychiques qu’elle considère comme incongrus, comme impossibles à regarder en face.
Cette force qu’on rencontre lorsqu’on veut travailler à la guérison du patient, est celle-là même qui a d’abord produit la maladie en refoulant un processus psychique qui de l’inconscient tendait vers le conscient ; la tendance ainsi entravée s’est en effet transformée, déguisée, pour aller tout de même un peu plus loin, en un acte mécanique, sans signification apparente, mais qui s’impose invinciblement au sujet : c’est le symptôme : Le symptôme vient se substituer à ce qui n’a pas été achevé5.
Freud met donc en lumière la présence dans la conscience d’une activité réductrice ou déformatrice de notre spontanéité obscure. Il la montre également à l’œuvre dans nos rêves et l’appelle alors censure. Exactement comme la censure, pendant la guerre, ou bien mutilait les articles de journaux, ou bien forçait leurs auteurs à ne présenter leur pensée que sous une forme approximative ou voilée, de même une force secrète modifie et travestit nos pensées inconscientes et ne leur permet d’aborder notre esprit que sous les espèces énigmatiques du rêve.
Les tendances exerçant la censure sont celles que le rêveur, dans son jugement de l’état de veille reconnaît comme étant siennes, avec lesquelles il se sent d’accord… Les tendances contre lesquelles est dirigée la censure des rêves… sont des tendances répréhensibles, indécentes au point de vue éthique, esthétique et social… sont des choses auxquelles on n’ose pas penser ou auxquelles on ne pense qu’avec horreur6.
Les symptômes névrotiques sont des effets de compromis, résultant de l’interférence de deux tendances opposées, et ils expriment aussi bien ce qui a été refoulé que ce qui a été la cause du refoulement et a ainsi contribué à leur production. La substitution peut se faire plus au profit de l’une de ces tendances que de l’autre ; elle se fait rarement au profit exclusif d’une seule7.
Le rêve de même est une sorte de composé ou plutôt de compromis entre les tendances refoulées, à qui le sommeil rend de la force, et les tendances représentant véritablement le moi, qui continuent à s’exercer par le moyen de la censure déformatrice.
Autrement dit symptômes névrotiques et rêves correspondent à un effort de nos diverses sincérités pour se manifester à la fois.
L’ensemble de cette conception me paraît d’une importance et d’une nouveauté extraordinaires. Peut-être Freud n’a-t-il pas aperçu lui-même toute la généralité qu’elle était susceptible de recevoir.
La découverte en nous d’un principe trompeur, d’une activité menteresse, peut cependant fournir une vue absolument nouvelle de toute la vie consciente.
Je vais tout de suite exagérer mon idée : tous nos sentiments sont des rêves, toutes nos opinions sont le strict équivalent des symptômes névrotiques.
Il y a en nous, constante, obstinée, jamais à court d’invention, une tendance qui nous pousse à nous camoufler nous-mêmes. À tout prix, en toute circonstance, nous nous voulons, nous nous construisons autres que nous sommes. Naturellement le sens dans lequel s’exerce cette déformation et son degré varient extraordinairement suivant les natures. Mais en toutes, le même principe de ruse et d’embellissement est à l’œuvre.
Partir dans l’étude du cœur humain sans être informé de son existence et de son activité, et sans s’équiper contre ses subterfuges, c’est vouloir établir la nature des fonds marins sans sonde et en se laissant guider au seul visage des eaux. Ou mieux, comme dit Jules Romains, c’est faire comme l’analyse traditionnelle qui lors même qu’elle cherche les dessous se laisse diriger par les indications voyantes de la surface. Elle ne soupçonne un gisement de fer que si les roches du dessus sont toutes rouillées, un de charbon que si l’on piétine une poussière noire.
Qui de nous ne connaît ce démon que Freud appelle censure et qui fait sans cesse si subtilement notre toilette morale ? À chaque instant le tout de ce que nous sommes, j’entends la masse confuse et grouillante de nos appétits, est prise en main et attifée par lui. Il glisse dans nos plus bas instincts ce qu’il faut de noblesse pour que nous puissions ne plus les reconnaître. Il nous fournit en abondance ces prétextes, ces couleurs dont nous avons besoin de couvrir les petites turpitudes qu’il nous faut accomplir pour vivre. C’est lui qui nous pourvoit de ce que nous appelons nos « bonnes raisons ». C’est lui qui nous maintient avec nous-mêmes dans cet état d’amitié et d’alliance sans lequel nous ne pouvons pas vivre et qui est pourtant si complètement dépourvu de justification qu’on ne comprend pas comment il peut naître.
Mais je sens que je m’éloigne beaucoup de l’idée de Freud. Le principe qui préside au refoulement et à la censure, loin de travailler au triomphe de nos appétits, est, dans son esprit, ce qui les combat, ce qui les arrête. Il est le représentant des idées morales, ou tout au moins de la convenance, loin d’aider à la tourner.
Oui, mais il y a des cas où il est vaincu, partiellement tout au moins : le symptôme névrotique, le rêve, le lapsus, correspondent à des succès relatifs sur lui de la partie basse de nous-mêmes. Et s’il n’est pas directement agent d’hypocrisie, il le devient dans la mesure où il ne triomphe pas.
Quand je prétends que tous nos sentiments, toutes nos opinions sont des rêves ou des actes obsessionnels, je veux dire que ce sont des états impurs, masqués, hypocrites ; je veux dire une chose enfin qu’il faut bien voir en face : c’est que l’hypocrisie est inhérente à la conscience.
Poussant à bout l’idée de Freud, je dirai qu’avoir conscience c’est être hypocrite. Un sentiment, un désir n’entrent dans la conscience qu’en forçant une résistance dont ils gardent l’empreinte et qui les déforme. Un sentiment, un désir n’entrent dans la conscience qu’à la condition de ne pas paraître ce qu’ils sont.
À ce point de vue, le chapitre que Freud consacre aux procédés qu’emploie la censure pour déformer le contenu latent du rêve et pour le rendre méconnaissable, mériterait de recevoir une extension considérable. Plusieurs de ces procédés sont utilisés certainement par nous à l’état de veille, pour nous aider à nous représenter nos sentiments sous une forme acceptable. Je n’en retiens qu’un par exemple : le déplacement, le transport de l’accent sur un aspect de ce que nous ressentons, — ou avons besoin de ressentir en paix — qui n’est pas l’essentiel. Autrement dit : la rupture par l’imagination du centre de gravité de nos complexes sentimentaux.
Soit dit en passant, si je me suis montré sévère au début pour la théorie freudienne du rêve, c’est beaucoup parce que je regrettais de voir Freud appliquer trop minutieusement à un phénomène particulier une idée qui me paraissait d’une portée infinie. Son analyse du Symbolisme des rêves va beaucoup trop loin ; elle réintroduit dans cette conscience, dont il nous a montré la souplesse et l’extrême convertibilité, quelque chose de fixe qui ne me paraît pas pouvoir y trouver place. Il faut garder à la pensée de Freud sinon un certain vague, du moins une certaine généralité pour bien en comprendre toute la valeur.
Avant de quitter cette idée de la censure, il faut encore en bien saisir un aspect qui est d’une importance considérable.
Quand je dis que l’hypocrisie est inhérente à la conscience, je dis trop ou trop peu. La censure, la force qui préside au refoulement, ce sont en partie des apports extérieurs ; elles sont créées principalement par l’éducation ; elles représentent l’influence de la Société sur l’individu. Tout de même elles ne sont pas entièrement adventices, ni postiches ; elles finissent par former corps avec le moi. Freud les représente même comme les tendances constitutives du moi.
Et en effet ce serait simplifier beaucoup les choses que de représenter nos seuls instincts inférieurs comme vraiment constitutifs de notre personnalité. Ce qui les réprime fait partie de nous aussi.
Mais alors une conclusion s’impose. C’est qu’en tant que personnes morales, et même en tant que personnes tout simplement, nous sommes condamnés à l’hypocrisie. Ne disons plus : hypocrisie, si vous voulez. Mais nous ne pouvons pas éviter un autre mot : c’est : impureté. Vivre, agir, si ce doit être dans un seul sens et avec méthode et de façon à tracer de nous sur la rétine d’autrui une image, c’est être composite et impur, c’est être un compromis.
Sincère vient d’un mot latin qui veut dire : pur, en parlant du vin. On peut dire qu’il n’y a pas de sincérité, pour l’homme, dans l’intégrité. Il ne redevient sincère qu’en se décomposant. La sincérité est donc le contraire exactement de la vie. Il faut choisir entre les deux.
*
Le troisième point de la doctrine de Freud, qu’il me semble que nous pouvons, bien que dans de moindres proportions peut-être, agrandir, c’est la théorie de la sexualité.
On se rappelle quelle en est la ligne générale.
S’interrogeant sur la nature des tendances qu’arrête le refoulement et qui s’expriment par substitution dans les symptômes et dans les rêves, Freud, on le sait, croit constater qu’elles sont toutes de nature sexuelle.
Plusieurs nuances sont ici à noter. Freud ne dit pas, et même se défend d’avoir dit que tout ce qui paraît dans nos rêves est d’origine sexuelle. N’est d’origine sexuelle que ce qui apparaît camouflé.
D’autre part Freud ne dit pas et se défend d’avoir dit (par exemple dans la lettre que le professeur Claparède a publiée en appendice de la brochure la Psychanalyse) que tout notre être se réduit aux tendances sexuelles, même que l’instinct sexuel est le mobile fondamental de toutes les manifestations de l’activité psychique. Au contraire :