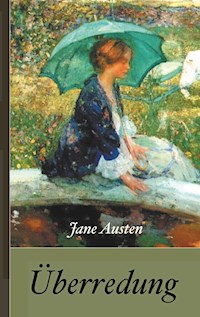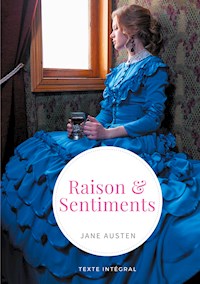
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Raison et Sentiments" est le premier roman publié de Jane Austen, offrant une exploration profonde des dynamiques sociales et des relations familiales dans l'Angleterre du début du XIXe siècle. L'histoire suit les Dashwood, une famille qui se retrouve dans une situation précaire après la mort du père. Les deux soeurs aînées, Elinor et Marianne, incarnent respectivement la raison et le sentiment. Elinor, l'aînée, est la voix de la prudence et de la retenue, tandis que Marianne est passionnée et impulsive. À travers leurs expériences amoureuses et leurs interactions avec divers personnages, Austen examine les tensions entre rationalité et émotion. Le roman met en lumière les défis auxquels les femmes de l'époque faisaient face, notamment en matière de mariage et de statut social, tout en critiquant subtilement les normes et attentes sociétales. Avec son style caractéristique, Austen allie humour, critique sociale et une compréhension aiguë de la nature humaine, offrant ainsi un récit à la fois divertissant et profondément réfléchi. "Raison et Sentiments" est une oeuvre qui continue d'inspirer et de captiver les lecteurs par sa pertinence intemporelle et sa finesse narrative. L'AUTEUR : Jane Austen, née le 16 décembre 1775 à Steventon, est l'une des romancières les plus acclamées de la littérature anglaise. Elle grandit dans une famille nombreuse et cultivée, ce qui lui permet d'accéder à une vaste bibliothèque qui nourrit son amour pour la lecture et l'écriture dès son plus jeune âge. Austen commence à écrire des histoires et des pièces de théâtre pour divertir sa famille. Ses romans, dont "Orgueil et Préjugés", "Emma" et "Mansfield Park", se distinguent par leur critique sociale subtile et leur exploration des relations humaines. Bien que ses oeuvres soient publiées de manière anonyme de son vivant, elles gagnent rapidement en popularité. Jane Austen ne s'est jamais mariée, choisissant de se consacrer à son art. Elle décède le 18 juillet 1817 à Winchester, laissant derrière elle un héritage littéraire qui continue d'influencer des générations de lecteurs et d'écrivains. Son style distinctif, mêlant ironie, réalisme et une profonde compréhension des complexités sociales, a solidifié sa place dans le panthéon des grands auteurs classiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVIII
Chapitre XXXIX
Chapitre XL
Chapitre XLI
Chapitre XLII
Chapitre XLIII
Chapitre XLIV
Chapitre XLV
Chapitre XLVI
Chapitre XLVII
Chapitre XLVIII
Chapitre XLIX
Chapitre L
I
La famille Dashwood était établie depuis longtemps dans le Sussex. Son domaine était vaste, et sa résidence était à Norland Park, au centre de la propriété, où, depuis de nombreuses générations, elle avait vécu d’une façon si bienséante qu’elle s’était acquis d’une façon générale la bonne opinion de ses connaissances à la ronde. Le défunt propriétaire de ce domaine était un célibataire, qui vécut jusqu’à un âge fort avancé, et qui, pendant de nombreuses années de sa vie, eut en la personne de sa sœur une compagne et une maîtresse de maison constante. Mais la mort de celle-ci, qui eut lieu dix ans avant la sienne, produisit un grand changement dans son intérieur ; car, pour suppléer à la perte de sa sœur, il invita et reçut chez lui la famille de son neveu, Mr. Henry Dashwood, l’héritier légal du domaine de Norland, et la personne à qui il se proposait de le léguer. Dans la compagnie de son neveu et de sa nièce, et de leurs enfants, les jours du vieux gentleman s’écoulèrent agréablement. Son attachement envers eux tous s’accrut. L’attention constante de Mr. et de Mrs. Henry Dashwood à ses désirs, laquelle procédait non pas simplement de l’intérêt, mais de la bonté du cœur, lui donna la pleine mesure de réconfort solide que pouvait recevoir son âge ; et la gaieté des enfants ajouta de la saveur à son existence.
D’un mariage antérieur, Mr. Henry Dashwood avait un fils ; de sa femme actuelle, trois filles. Le fils, jeune homme sérieux et respectable, était amplement pourvu par la fortune de sa mère, qui avait été considérable, et dont la moitié lui était revenue lors de sa majorité. Par son propre mariage, également, qui eut lieu peu après, il ajouta à sa richesse. Pour lui, en conséquence, le droit de succession au domaine de Norland n’était pas véritablement aussi important que pour ses sœurs ; car leur fortune, abstraction faite de ce qui pourrait leur revenir du fait que leur père héritât de cette propriété, ne pouvait être que petite. Leur mère ne possédait rien, et leur père n’avait que sept mille livres1 en propre, car la moitié restante de la fortune de sa première femme était également assurée à l’enfant de celle-ci, et il n’en possédait que l’usufruit viager.
Le vieux gentleman mourut, on procéda à la lecture de son testament, et, comme presque tous les autres testaments, il donna autant de déception que de plaisir. Il ne fut ni assez injuste ni assez ingrat pour priver son neveu de son bien ; mais il le lui laissa moyennant des conditions qui détruisirent la moitié de la valeur de ce legs. Mr. Dashwood l’avait désiré plutôt pour sa femme et ses filles que pour lui-même ou son fils ; mais c’est à son fils et au fils de celui-ci, enfant de quatre ans, qu’il fut assuré, d’une façon telle, qu’elle ne lui laissait nul moyen de pourvoir à ceux qui lui étaient le plus chers, et qui avaient le plus besoin qu’on assurât leur avenir, par quelque privilège grevant le domaine, ou par quelque vente de ses bois précieux. Le tout était réservé au profit de l’enfant, qui, lors des visites qu’il avait faites occasionnellement avec son père et sa mère à Norland, avait à tel point gagné l’affection de son oncle, grâce aux attraits qui ne sont nullement rares chez les enfants de deux ou trois ans – une articulation imparfaite, un désir instant d’en faire à sa tête, quantité de petits tours malins, et beaucoup de bruit –, qu’elle l’avait emporté sur toutes les attentions que, depuis des années, il avait reçues de sa nièce et des filles de celle-ci. Il n’avait toutefois nulle intention de se montrer désobligeant, et, comme marque d’affection envers les jeunes filles, il leur laissait à chacune un millier de livres.
La déception de Mr. Dashwood fut, au premier abord, fort vive ; mais son caractère était enjoué et optimiste, et il pouvait raisonnablement espérer vivre de longues années, et, en vivant économiquement, mettre de côté une somme considérable à provenir du produit d’un domaine déjà vaste, et susceptible d’une amélioration presque immédiate. Mais cette fortune, qui avait tant tardé à venir, ne fut sienne que pendant une année. Il ne survécut pas davantage à son oncle ; et il ne resta que dix milles livres2, y compris les legs récents, pour sa veuve et ses filles.
Il fit venir son fils dès qu’il se sut en danger, et Mr. Dashwood lui recommanda, avec toute la force et l’insistance que pouvait exiger la maladie, l’intérêt de sa belle-mère et de ses sœurs.
Mr. John Dashwood n’avait point les sentiments profonds des autres membres de la famille ; mais il fut touché par une recommandation d’une telle nature en un tel moment, et promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour les mettre à l’aise. Son père fut soulagé par une pareille assurance, et Mr. John Dashwood eut alors le loisir de réfléchir à ce qu’il pourrait être prudemment en son pouvoir de faire pour elles.
Ce n’était pas un jeune homme malintentionné, à moins que le fait d’avoir le cœur assez froid et d’être assez égoïste ne constitue de la malveillance ; mais il était, d’une façon générale, fort respecté ; car il se conduisait avec bienséance dans l’exercice de ses devoirs ordinaires. S’il avait épousé une femme plus aimable, on eût pu le rendre encore plus respectable qu’il ne l’était ; on eût même pu le rendre lui-même aimable ; car il s’était marié fort jeune, et il aimait beaucoup sa femme. Mais Mrs. John Dashwood était une caricature vigoureuse de ce qu’il était, lui ; plus étroite d’esprit et plus égoïste.
Lorsqu’il fit sa promesse à son père, il débattit en son for intérieur le projet d’accroître la fortune de ses sœurs par un présent de mille livres à chacune. Il se sentit alors véritablement de taille à le faire. La perspective de quatre mille livres par an, en plus de son revenu actuel, outre la moitié restante de la fortune de sa propre mère, lui réchauffa le cœur et le rendit capable d’un sentiment de générosité : « Oui, il leur donnerait trois mille livres ; voilà qui serait libéral et généreux ! Cela serait suffisant pour les mettre complètement à leur aise. Trois mille livres ! Il pouvait, avec peu de gêne, se priver d’une somme aussi considérable. » Il y songea toute la journée, et durant bien des journées consécutives, et il ne se repentit point.
Aussitôt terminées les obsèques de son beau-père, Mrs. John Dashwood, sans adresser le moindre avis de ses intentions à sa belle-mère, arriva avec son enfant et leurs domestiques. Nul ne pouvait contester son droit de venir ; la maison appartenait à son mari dès l’instant du décès du père de celui-ci ; mais l’indélicatesse de sa conduite en était d’autant plus grande, et, pour une femme dans la situation de Mrs. Dashwood et ne possédant que des sentiments ordinaires, elle devait être éminemment déplaisante ; mais il y avait dans son esprit, à elle, un sentiment si vif de l’honneur, une générosité si romanesque, que toute offense de ce genre, quel qu’en fût l’auteur ou la victime, était pour elle une source de dégoût incœrcible. Mrs. John Dashwood n’avait jamais été fort appréciée d’aucun des membres de la famille de son mari ; mais elle n’avait jamais eu l’occasion, jusqu’à celle-ci, de leur montrer avec combien peu d’égards pour les convenances d’autrui elle pouvait agir lorsque les circonstances l’exigeaient.
Mrs. Dashwood ressentit d’une façon si vive cette conduite peu aimable, et elle en méprisa avec une telle vigueur sa belle-fille, que, lors de l’arrivée de celle-ci, elle aurait quitté la maison à jamais, si les supplications de sa fille aînée ne l’avaient incitée à réfléchir au préalable à la convenance de ce départ ; et l’amour plein de tendresse qu’elle éprouvait pour toutes ses trois enfants la détermina ensuite à rester, et à éviter, par égard pour elles, une rupture avec leur frère.
Elinor, cette fille aînée dont les conseils furent si efficaces, possédait une vigueur de compréhension et une froideur de jugement qui la qualifiaient, bien qu’elle n’eût que dix-neuf ans, pour être la conseillère de sa mère, et lui permettaient de neutraliser à leur avantage à tous, cette ardeur d’esprit chez Mrs. Dashwood, qui eût en général conduit nécessairement à quelque imprudence. Elle avait excellent cœur, son caractère était affectueux, et ses sentiments étaient vifs ; mais elle savait les gouverner ; c’était là une connaissance que sa mère avait encore à acquérir, et que l’une de ses sœurs était résolue à ne jamais se faire enseigner.
Les capacités de Marianne étaient, à bien des égards, largement égales à celles d’Elinor. Elle était sensible et intelligente, mais ardente en toute chose ; ses douleurs, ses joies, étaient incapables de modération. Elle était généreuse, aimable, intéressante ; elle avait toutes les qualités, sauf la prudence. La ressemblance entre elle et sa mère était extrêmement frappante.
Elinor voyait avec inquiétude l’excès de sensibilité de sa sœur ; mais Mrs. Dashwood le prisait et le chérissait. Elles s’encouragèrent mutuellement, à présent, dans la violence de leur affliction. La douleur torturante qui les terrassa tout d’abord fut volontairement renouvelée, fut recherchée, fut mainte et mainte fois recréée. Elles s’abandonnèrent totalement à leur chagrin, cherchant un surcroît de misère dans toute réflexion qui le permettait, et résolues à ne jamais admettre de consolation à l’avenir. Elinor, elle aussi, était profondément affligée, mais elle put cependant lutter, elle fut capable de se démener. Elle put consulter avec son frère, recevoir sa belle-sœur à son arrivée, et la traiter avec les égards convenables ; et elle put s’efforcer d’inciter sa mère à s’employer de même, et l’encourager à une tolérance analogue.
Margaret, l’autre sœur, était une fille enjouée, au caractère facile ; mais elle s’était déjà imprégnée d’une bonne part du romanesque de Marianne, sans posséder beaucoup de son bon sens ; il ne semblait pas qu’elle dût, à l’âge de treize ans, égaler ses sœurs dans une période plus avancée de sa vie.
1 175000 francs-or. (N. du Tr.)
2 250 000 francs-or. (N. du Tr.)
II
Mrs. John Dashwood s’installa dès lors comme maîtresse de Norland, et sa belle-mère et ses belles-sœurs furent rabaissées à la condition d’invitées. Toutefois, en tant que telles, elles furent traitées par elle avec une civilité paisible ; et, par son mari, avec toute la bonté qu’il lui était possible d’éprouver envers qui que ce fût, en dehors de lui-même, de sa femme, et de leur enfant. Il insista véritablement auprès d’elles, avec une certaine ferveur, pour qu’elles considérassent Norland comme leur foyer ; et, comme aucun projet ne parut aussi convenable à Mrs. Dashwood que d’y rester jusqu’à ce qu’elle pût s’accommoder d’une maison dans le voisinage, son invitation fut acceptée.
Continuer à demeurer dans un lieu où tout lui rappelait la joie d’antan, c’était là exactement ce qui convenait à son esprit. Aux périodes de gaieté, nul caractère ne pouvait être plus joyeux que le sien, ni posséder dans une mesure plus considérable cette attente confiante de bonheur qui est le bonheur même. Mais, dans la douleur, il fallait qu’elle fût également emportée par son imagination, et tout autant au-delà de toute consolation que, dans le plaisir, elle l’était de tout mélange.
Mrs. John Dashwood n’approuvait nullement ce que son mari avait l’intention de faire pour ses sœurs. Enlever trois mille livres à la fortune de leur cher petit garçon, ce serait l’appauvrir dans la mesure la plus épouvantable. Elle le supplia de réfléchir à nouveau sur la question. Comment pourrait-il en répondre devant lui-même, s’il dépouillait son enfant – enfant unique, qui plus est – d’une somme aussi considérable ? Et quel droit pouvaient bien avoir sur sa générosité, dans une telle mesure, les demoiselles Dashwood, qui ne lui étaient apparentées que par la consanguinité, ce qu’elle considérait comme n’étant nullement une parenté ? On savait fort bien qu’aucune affection n’est jamais censée exister entre les enfants d’un homme quelconque, provenant de mariages différents ; et pourquoi devrait-il se ruiner, et ruiner leur pauvre petit Harry, en donnant tout son argent à ses demi-sœurs ?
– Ça a été la dernière requête que m’ait adressée mon père, répondit son mari, que j’aide sa veuve et ses filles.
– Il ne savait pas de quoi il parlait, j’en suis persuadée ; il y a dix à parier contre un, qu’il n’avait plus toute sa tête, à ce moment-là. S’il avait eu tous ses esprits, il n’aurait pas pu lui venir à l’idée de te supplier de donner la moitié de ta fortune en l’enlevant à ton propre enfant.
– Il n’a stipulé aucune somme déterminée, ma chère Fanny ; il m’a simplement prié, dans les termes les plus généraux, de les aider et de rendre leur situation plus aisée qu’il n’était en son pouvoir de le faire. Peut-être eût-il aussi bien fait de s’en remettre entièrement à moi. Il ne pouvait guère supposer que je les négligerais. Mais comme il a exigé la promesse, je n’ai pu moins faire que de la lui donner : c’est, du moins, ce qu’il m’a semblé à l’époque. La promesse, donc, a été faite, et il faut qu’elle soit tenue. Il faut donc qu’on fasse quelque chose pour elles, le jour où elles quitteront Norland et s’installeront dans un foyer nouveau.
– Soit, donc ; qu’on fasse quelque chose pour elles ; mais il n’est pas nécessaire que ce quelque chose soit trois mille livres. Songe, ajouta-t-elle, qu’une fois cet argent sorti de nos mains, il n’y pourra jamais revenir. Tes sœurs se marieront, et il sera disparu à jamais. Si, en effet, il pouvait jamais être restitué à notre pauvre petit...
– Ah, certes, dit son père, fort gravement, cela ferait une différence considérable. Il peut se faire qu’il vienne un temps où Harry regrettera que nous nous soyons départis d’une somme aussi importante. Au cas où il aurait une nombreuse famille, par exemple, cela constituerait un supplément fort utile.
– Assurément.
– Peut-être, alors, vaudrait-il mieux pour tous les intéressés que la somme fût diminuée de moitié. Cinq cents livres, ce serait un accroissement prodigieux de leurs fortunes !
– Oh ! Au-delà de tout ce qu’on peut concevoir de grand ! Quel frère au monde en ferait seulement la moitié pour ses sœurs, même si c’étaient réellement ses sœurs ? Et, en l’espèce, il ne s’agit que de consanguinité ! Mais tu as le tempérament tellement généreux !
– Je ne voudrais rien faire de mesquin, répondit-il. On aimerait mieux, dans les cas de ce genre, en faire trop que trop peu. Personne, du moins, ne pourra penser que je n’en ai pas fait assez pour elles : pas même ellesmêmes, elles ne peuvent guère en espérer davantage.
– On ne sait jamais ce qu’elles espèrent, dit la dame, mais nous n’avons pas à nous préoccuper de leurs espérances ; la question est : ce que tes moyens te permettent de faire.
– Certainement, et je crois qu’ils me permettent de leur donner à chacune cinq cents livres. Dans la situation actuelle, sans aucun supplément de ma part, elles auront chacune plus de trois mille livres à la mort de leur mère : c’est là une fortune fort agréable pour une jeune femme, quelle qu’elle soit.
– Assurément, et, à dire vrai, l’idée me vient qu’elles pourront n’avoir besoin d’aucun supplément. Elles auront dix mille livres à partager entre elles. Si elles se marient, elles se tireront fort bien d’affaire ; et si elles ne se marient pas, elles pourront vivre fort confortablement, toutes ensemble, avec les intérêts de dix mille livres.
– Voilà qui est bien vrai, et c’est pourquoi je ne sais si, toute réflexion faite, il ne conviendrait pas plutôt de faire quelque chose pour leur mère pendant qu’elle vit encore, que pour elles : une chose dans le genre d’une annuité, c’est cela que je veux dire. Mes sœurs en sentiraient le bon effet tout autant qu’elle-même. Cent livres par an, cela les mettrait toutes parfaitement à l’aise.
Sa femme hésita un peu, toutefois, à donner son consentement à ce projet.
– Assurément, dit-elle, cela vaut mieux que de se défaire d’un seul coup de quinze cents livres. Mais alors, au cas où Mrs. Dashwood vivrait quinze ans, nous serions complètement bernés.
– Quinze ans ! ma chère Fanny, on ne saurait lui en donner la moitié à vivre.
– Certes ; mais, remarque-le, les gens vivent toujours indéfiniment quand il y a une annuité à leur payer ; et elle est fort grasse et bien portante, et a à peine quarante ans. Une annuité, c’est une affaire fort sérieuse ; cela se reproduit d’année en année, et il n’y a pas moyen de s’en débarrasser. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Moi, j’ai beaucoup d’expérience des ennuis que donnent les annuités ; car ma mère a été empêtrée par l’obligation d’en payer trois, en raison du testament de mon père, à de vieux domestiques qui avaient passé l’âge, et elle trouvait cela étonnamment désagréable. Ces annuités devaient être payées deux fois par an ; et puis, il y avait l’ennui de leur faire parvenir la somme ; et puis, on a dit que l’un d’eux était mort, et il s’est révélé après coup qu’il n’en était rien. Ma mère en était véritablement lasse. Son revenu ne lui appartenait plus, disait-elle, avec toutes ces charges qui le grevaient ; et ç’a été d’autant plus dur de la part de mon père, que, sans cela, l’argent eût été entièrement à la disposition de ma mère, sans aucune restriction. J’y ai pris une telle horreur des annuités que je ne voudrais certes pas m’astreindre à en payer une, pour rien au monde.
– Il est certainement désagréable, répondit Mr. Dashwood, d’avoir des saignées annuelles de ce genre à son revenu. La fortune d’une personne, comme le dit fort justement ta mère, ne lui appartient pas. Être astreint au paiement régulier d’une telle somme, lors de chaque terme, ce n’est nullement désirable : cela vous ôte votre indépendance.
– Incontestablement ; et en fin de compte, on ne vous en sait nul gré. Elles se sentent en sécurité, vous ne faites rien de plus que ce que l’on attendait, et cela ne suscite absolument aucune gratitude. Si j’étais de toi, tout ce que je ferais serait effectué entièrement à ma propre discrétion. Je ne m’astreindrais pas à leur allouer quoi que ce soit à titre annuel. Il se peut que ce soit fort gênant, certaines années, de distraire cent livres, ou même cinquante, de nos propres dépenses.
– Je crois que tu as raison, ma chérie ; il vaudra mieux, en l’espèce, qu’il n’y ait point d’annuité ; ce que je pourrai leur donner occasionnellement leur servira beaucoup plus qu’une allocation annuelle, car elles ne feraient qu’enfler leur train de vie si elles se sentaient assurées d’un revenu annuel, et n’en seraient pas plus riches de six pence au bout de l’année. Ce sera certainement, de beaucoup, le meilleur moyen. Un cadeau de cinquante livres, de temps à autre, les empêchera d’être à court d’argent, et je crois que j’exécuterai largement, ainsi, la promesse que j’ai faite à mon père.
– Assurément. Et même, à dire vrai, je suis convaincue, en mon for intérieur, que ton père n’avait pas la moindre idée que tu dusses leur donner de l’argent. L’aide à laquelle il a pensé n’était sans doute que celle à laquelle on pouvait raisonnablement s’attendre de ta part : par exemple, rechercher pour elles une petite maison confortable, les aider à déménager leurs affaires, et leur envoyer des cadeaux, du gibier et du poisson, et autres choses de ce genre, quand en revient la saison. Je mettrais ma tête à couper, qu’il n’a rien voulu dire de plus ; voire, ce serait bien étrange et déraisonnable, s’il avait eu d’autres intentions. Songe donc, mon cher Mr. Dashwood, à la façon extrêmement confortable dont pourront vivre ta belle-mère et ses filles, avec l’intérêt de sept mille livres, outre les mille livres appartenant à chacune des filles, et qui leur rapportent cinquante livres à chacune ; et, bien entendu, elles rembourseront à leur mère, là-dessus, le prix de leur pension. Tout compris, elles auront cinq cents livres par an, à elles toutes, et que peuvent bien désirer de plus quatre femmes ? Elles vivront à si bon compte ! Leur ménage ne sera rien du tout. Elles n’auront ni voiture ni chevaux, et guère de domestiques, elles ne recevront pas, et ne pourront faire de dépenses d’aucune sorte ! Mais conçois donc comme elles seront à l’aise ! Cinq cents livres par an ! Je sais bien que je suis incapable d’imaginer comment elles en dépenseront la moitié, et quant à leur en donner davantage, il est absolument absurde d’y songer. Ce seront plutôt elles qui seront en mesure de te donner quelque chose.
– Ma parole, dit Mr. Dashwood, je crois que tu as parfaitement raison. Mon père n’a certainement pu vouloir rien entendre de plus, par la requête qu’il m’a faite, que ce que tu dis. Je comprends nettement à présent, et je tiendrai strictement mes engagements par des actes d’assistance et de bienveillance tels que tu les as décrits. Quand ma mère déménagera pour habiter une autre maison, mes services lui seront volontiers acquis pour l’installer, dans toute la mesure où je le pourrai. Quelque petit cadeau en matière de mobilier, aussi, pourra être acceptable à ce moment-là.
– Certainement, repartit Mrs. John Dashwood. Il y a toutefois une chose à considérer. Quand ton père et ta mère se sont établis à Norland, encore que le mobilier de Stanhill ait été vendu, toute la porcelaine, l’argenterie, et le linge ont été conservés, et restent maintenant à ta mère. Sa maison sera donc presque complètement installée aussitôt qu’elle la prendra.
– C’est là une considération importante, sans aucun doute. C’est un legs de valeur, certes ! Et pourtant, une partie de cette argenterie aurait fort agréablement complété notre propre fonds, ici.
– Oui, et le service à déjeuner en porcelaine est deux fois plus beau que celui qui appartient à cette maison. Beaucoup trop beau, à mon avis, pour n’importe quelle demeure dans laquelle leurs moyens leur permettront jamais de vivre. Mais enfin, c’est comme cela. Ton père n’a pensé qu’à elles. Et il faut que je le dise, tu ne lui dois aucune gratitude particulière, et tu n’es pas tenu de te préoccuper spécialement de ses désirs, car nous savons fort bien que s’il l’avait pu, il leur aurait laissé à peu près tout au monde.
Cet argument fut irrésistible. Il donna aux intentions de Mr. Dashwood ce qui pouvait leur manquer, au préalable, de décision ; et il résolut en fin de compte qu’il serait absolument superflu, sinon éminemment malséant, d’en faire plus, pour la veuve et les enfants de son père, que les actes de bon voisinage du genre de ceux qu’avait indiqués sa femme.
III
Mrs. Dashwood resta plusieurs mois à Norland ; non par aucune aversion à déménager quand la vue de chaque endroit bien connu eut cessé de susciter l’émotion violente qu’elle produisit pendant quelque temps ; car quand elle se remit à prendre courage, et que son esprit fut capable d’autres efforts que de celui de rehausser sa douleur par des souvenirs mélancoliques, elle fut impatiente de partir, et infatigable dans ses recherches en vue de trouver une demeure convenable à proximité de Norland ; car il lui était impossible de s’installer loin de ce lieu bien-aimé. Mais elle n’entendit parler d’aucune résidence qui répondît à ses idées de confort et d’aise, tout en convenant à la sagesse de sa fille aînée, dont le jugement plus équilibré rejeta plusieurs maisons comme étant trop grandes pour leur revenu, alors que sa mère les eût approuvées.
Mrs. Dashwood avait été informée par son mari de la promesse solennelle faite par son fils en leur faveur, promesse qui avait donné un réconfort à ses dernières réflexions d’ici-bas. Elle ne douta pas plus qu’il ne l’avait fait lui-même de la sincérité de ces assurances, et elle y songea avec satisfaction pour ses filles, encore que, quant à elle, elle fût persuadée qu’un capital bien inférieur à sept mille livres la maintiendrait dans l’abondance. Elle s’en réjouit aussi pour leur frère, pour son cœur même ; et elle se reprocha d’avoir été naguère injuste à l’égard de son mérite, en le croyant incapable de générosité. L’attitude pleine d’égards dont il faisait preuve envers elle et envers ses sœurs la convainquit que leur bonheur lui était cher, et, pendant longtemps, elle compta fermement sur la libéralité de ses intentions.
Le mépris qu’elle avait ressenti, dès le début de leurs relations, pour sa belle-fille, fut fortement accru par la connaissance plus poussée de son caractère, que lui permit une résidence d’une demi-année dans sa famille ; et peut-être, en dépit de toutes les considérations de politesse ou d’affection maternelle de la part de la première, les deux dames eussent-elles trouvé impossible de vivre ensemble aussi longtemps, s’il ne s’était produit une circonstance spéciale rendant plus désirable, selon l’opinion de Mrs. Dashwood, que ses filles prolongeassent leur séjour à Norland.
Cette circonstance, ce fut une affection croissante entre sa fille aînée et le frère de Mrs. Dashwood, jeune homme distingué et agréable dont elles firent la connaissance peu après que sa sœur se fut établie à Norland, et qui avait passé là la plus grande partie de son temps.
Il est des mères qui eussent encouragé cette intimité pour des motifs intéressés, car Edward Ferrars était le fils aîné d’un homme qui était mort fort riche ; et il en est qui l’eussent réprimée pour des motifs de prudence, car, à part une somme insignifiante, la totalité de la fortune du jeune homme dépendait de la volonté de sa mère. Mais Mrs. Dashwood ne se laissa influencer ni par l’une ni par l’autre de ces considérations. Il lui suffisait qu’il parût aimable, qu’il aimât sa fille, et qu’Elinor payât cette préférence de retour. Il était contraire à toutes les doctrines dont elle était imbue, qu’une différence de fortune séparât deux êtres quelconques qu’attirait une similitude de caractère ; et que le mérite d’Elinor ne fût pas reconnu de tous ceux qui la connaissaient, c’était là, pour sa compréhension, une chose impossible.
Edward Ferrars ne se recommandait à leur bonne opinion par aucune grâce spéciale de sa personne ou de son abord. Il n’était pas beau, et ses façons exigeaient l’intimité pour les rendre agréables. Il manquait d’assurance pour se faire valoir équitablement ; mais, une fois vaincue sa timidité, sa conduite donnait toutes les indications d’un cœur ouvert et affectueux. Son intelligence était sérieuse, et son instruction l’avait solidement améliorée. Mais il n’était adapté ni par ses aptitudes ni par son caractère à répondre aux désirs de sa mère et de sa sœur, qui auraient ardemment voulu le voir se distinguer comme... elles ne savaient guère comme quoi. Elles voulaient qu’il fît belle figure dans le monde, d’une manière ou d’une autre. Sa mère désirait l’intéresser aux affaires politiques, le faire entrer au Parlement, ou le voir en rapport avec quelques-uns des grands hommes du jour. Mrs. John Dashwood le désirait également ; mais en attendant, jusqu’à ce qu’un de ces bienfaits supérieurs pût être obtenu, son ambition eût été satisfaite de le voir conduire une calèche. Mais Edward n’avait aucune disposition pour les grands hommes ni les calèches. Tous ses désirs se centraient sur le confort domestique et le calme de la vie privée. Heureusement, il avait un frère cadet, qui donnait plus de promesses.
Il y avait plusieurs semaines qu’Edward était dans la maison, avant qu’il n’attirât une part appréciable de l’attention de Mrs. Dashwood ; car elle était, à cette époque, dans une détresse telle qu’elle la rendait insensible à ce qui l’entourait. Elle vit seulement qu’il était paisible et discret, et elle lui en sut gré. Il ne troublait pas la tristesse de son esprit par une conversation importune. Elle fut pour la première fois incitée à l’observer de plus près et à l’approuver, par une réflexion qu’Elinor fit par hasard un jour, sur la différence qui existait entre lui et sa sœur. C’était là un contraste qui le recommanda fort vigoureusement à la mère de la jeune fille.
– Voilà qui suffit, dit-elle ; dire qu’il ne ressemble pas à Fanny, cela suffit. Cela sous-entend tout ce qu’il y a d’aimable. Je l’aime déjà.
– Je crois qu’il vous plaira, dit Elinor, quand vous le connaîtrez mieux.
– Me plaire ! répondit sa mère, avec un sourire. Je suis incapable d’éprouver aucun sentiment d’approbation inférieur à l’amour.
– Vous pourrez l’estimer.
– Je n’ai encore jamais su ce que c’était que de séparer l’estime de l’amour.
Mrs. Dashwood prit dès lors la peine de faire connaissance avec lui. Elle avait des façons attachantes qui bannirent bientôt la réserve dont il avait fait preuve. Elle comprit rapidement tous ses mérites ; la conviction de ses sentiments envers Elinor aida peut-être à cette pénétration ; mais elle se sentit réellement assurée de sa valeur ; et cette tranquillité même de façons qui militait contre toutes ses idées établies de ce que devait être l’abord d’un jeune homme ne fut plus inintéressante, lorsqu’elle sut qu’il avait le cœur chaleureux et le caractère affectueux.
À peine eut-elle perçu quelque symptôme d’amour dans son attitude envers Elinor, qu’elle considéra comme certaine leur liaison sérieuse, et se fit une joie de leur mariage comme d’un événement qui s’approchait rapidement.
– D’ici quelques mois, ma chère Marianne, dit-elle, Elinor sera, en toute probabilité, établie pour la vie. Elle nous manquera ; mais elle sera heureuse.
– Oh, maman, que ferons-nous, sans elle ?
– Ma chérie, ce sera à peine une séparation. Nous vivrons à quelques milles les uns des autres, et nous nous verrons chaque jour de notre existence. Tu y gagneras un frère – un frère authentique et affectueux. J’ai la plus haute idée qui soit du cœur d’Edward. Mais tu prends un air grave, Marianne ; trouves-tu à redire au choix de ta sœur ?
– Peut-être, dit Marianne, puis-je le considérer avec une certaine surprise. Edward est fort aimable, et je l’aime tendrement. Mais pourtant, il n’est pas un de ces jeunes gens... il lui manque quelque chose, il n’est pas imposant de sa personne ; il n’a rien de cette grâce à laquelle je m’attendrais chez l’homme qui pourrait sérieusement retenir l’affection de ma sœur. Ses yeux manquent de cette ardeur, de cette flamme, qui annoncent à la fois la vertu et l’intelligence. Et outre tout cela, je crains bien, maman, qu’il n’ait aucun goût véritable. La musique ne semble guère l’attirer ; et bien qu’il admire vivement les dessins d’Elinor, ce n’est pas l’admiration d’une personne capable d’en comprendre la valeur. Il est évident, malgré l’attention qu’il lui témoigne fréquemment pendant qu’elle dessine, qu’en fait il n’y connaît rien. Il admire en amoureux, et non en connaisseur. Pour me satisfaire, il faut que ces deux caractères soient réunis. Je ne pourrais pas être heureuse avec un homme dont le goût ne coïnciderait pas en tout point avec le mien. Il faut qu’il participe à tous mes sentiments ; il faut que les mêmes livres, la même musique, nous ravissent tous les deux. Ah, maman, comme Edward manquait d’entrain, comme il était terne, en nous faisant la lecture, hier soir ! Je prenais vraiment en pitié ma sœur. Et pourtant, elle a supporté cela avec un tel calme ! Elle semblait à peine s’en apercevoir. Moi, j’avais peine à tenir en place ! Entendre ces vers splendides, qui ont fréquemment failli me faire délirer, prononcés avec un calme aussi impénétrable, une indifférence aussi affreuse !
– Il aurait certainement mieux fait valoir une prose simple et élégante. C’est ce que je me suis dit sur le moment ; mais tu as tenu à lui donner du Cowper.
– Voyons, maman, s’il ne s’enflamme pas avec du Cowper ! – mais il faut faire la part des différences de goût. Elinor n’a pas ma sensibilité, de sorte qu’il se peut qu’elle passe là-dessus, et qu’elle soit heureuse avec lui. Mais moi, cela m’eût brisé le cœur, si je l’avais aimé, de l’entendre lire avec si peu de sensibilité. Maman, plus je connais le monde, plus je suis convaincue que je ne verrai jamais un homme que je pourrai véritablement aimer. Je suis tellement exigeante ! Il faut qu’il ait toutes les vertus d’Edward, et que sa personne et ses façons ornent sa bonté de tous les charmes possibles.
– Rappelle-toi, ma chérie, que tu n’as pas dix-sept ans ! Il est encore trop tôt dans l’existence pour désespérer d’un tel bonheur. Pourquoi aurais-tu moins de chance que ta mère ? Puisse ta destinée, ma chère Marianne, ne différer de la mienne que par une seule circonstance !
IV
– Quel dommage, Elinor, dit Marianne, qu’Edward n’ait pas de goût pour le dessin.
– Pas de goût pour le dessin ? répondit Elinor ; qu’est-ce qui te porte à le croire ? Il ne dessine pas, quant à lui, certes, mais il prend grand plaisir à voir les exploits d’autrui, et je t’assure qu’il ne manque nullement de goût naturel, bien qu’il n’ait pas eu d’occasions de l’améliorer. S’il s’était préoccupé d’apprendre, je crois qu’il aurait fort bien dessiné. Il se méfie tellement de son propre jugement en ces matières, qu’il lui répugne toujours de donner son avis sur n’importe quel tableau ; mais il a une probité et une simplicité de goût innées, qui, en général, le dirigent d’une façon parfaitement juste.
Marianne eut peur de froisser sa sœur, et n’en dit pas davantage sur ce sujet ; mais le genre d’approbation qu’Elinor décrivait comme suscitée chez lui par les dessins d’autrui était bien éloignée de ce ravissement enthousiaste qui, à son avis, méritait seul le nom de bon goût. Pourtant, bien qu’elle sourît intérieurement de cette erreur, elle honorait sa sœur en raison de cette partialité aveugle à l’égard d’Edward, qui en était la cause.
– J’espère, Marianne, reprit Elinor, que tu ne le considères pas comme manquant de goût général. En vérité, je crois pouvoir dire que tu en es incapable, car ton attitude envers lui est parfaitement cordiale, et si c’était là ton opinion, je suis sûre que tu ne pourrais jamais être polie envers lui.
Marianne ne savait guère que dire. Elle ne voulait, pour rien au monde, blesser les susceptibilités de sa sœur, et pourtant, il lui était impossible de dire ce qu’elle ne pensait pas. Elle finit par répondre :
– Ne te froisse pas, Elinor, si mes louanges à son adresse n’arrivent pas en toute chose à la hauteur de ton appréciation de ses mérites. Je n’ai pas eu autant d’occasions que toi d’estimer les moindres tendances de son esprit, ses penchants et ses goûts ; mais j’ai la plus haute opinion qui soit de sa bonté et de son intelligence. Je crois qu’il est tout ce qu’il y a de digne et d’aimable.
– Je suis sûre, répondit Elinor avec un sourire, que ses amis les plus chers ne pourraient pas être mécontents d’un pareil éloge. Je ne perçois pas comment tu pourrais t’exprimer avec plus de chaleur.
Marianne fut ravie de constater que sa sœur était si facile à contenter.
– Quant à son intelligence et à sa bonté, reprit Elinor, nul, je le crois, ne peut en douter, qui l’a vu assez souvent pour entretenir avec lui une conversation à cœur ouvert. L’excellence de son entendement et de ses principes ne saurait être dissimulée que par cette timidité qui, trop souvent, le maintient silencieux. Tu le connais suffisamment pour rendre justice à son mérite solide. Mais en ce qui concerne ses moindres tendances, comme tu les appelles, tu en es restée, par suite de circonstances spéciales, plus ignorante que moi. Nous nous sommes, par moments, lui et moi, trouvés assez souvent en tête à tête, pendant que tu te consacrais totalement, d’après les principes les plus affectueux, à ma mère. Moi, je l’ai beaucoup vu, j’ai étudié ses sentiments et entendu son opinion sur les questions de littérature et de goût ; et, dans l’ensemble, j’ose avancer qu’il a l’esprit bien informé, qu’il prend un plaisir extrême aux livres, que son imagination est vive, ses facultés d’observation justes et correctes, et son goût délicat et pur. Ses capacités à tous égards s’améliorent à mesure qu’on le connaît mieux, tout autant que ses façons et sa personne. Au premier abord, il n’a certes pas l’aspect imposant ; et l’on ne saurait guère le qualifier de beau quant à sa personne, tant qu’on n’a pas perçu l’expression de ses yeux, qui sont exceptionnellement bons, et la douceur générale de sa physionomie. À présent, je le connais si bien, que je le trouve véritablement beau ; ou, du moins, presque. Qu’en dis-tu, Marianne ?
– Je le trouverai beau d’ici fort peu de temps, Elinor, si je ne le fais déjà. Quand tu me diras de l’aimer comme un frère, je ne verrai pas plus d’imperfections à son visage que je n’en vois maintenant à son cœur.
Elinor sursauta à cette déclaration, et regretta la chaleur à laquelle elle s’était laissé emporter en parlant de lui. Elle sentait qu’Edward occupait une situation très élevée dans son opinion. Elle croyait que l’estime était réciproque ; mais il lui fallait plus de certitude à cet égard pour lui rendre agréable la conviction de Marianne au sujet de leur affection. Elle savait que ce que Marianne et sa mère conjecturaient, un instant donné, elles le croyaient l’instant d’après ; que, pour elles, désirer c’était espérer, et espérer, prévoir. Elle essaya d’expliquer à sa sœur ce qu’il en était réellement.
– Je ne tente pas de nier, dit-elle, que je me fais une très haute idée de lui, que je l’estime fort, qu’il me plaît.
Marianne, à ce point de l’entretien, laissa éclater son indignation :
– Tu l’estimes ! Il te plaît ! Elinor au cœur froid ! Ah, pire que froid ! Honteuse d’être autre chose ! Prononce encore une fois ces mots-là, et je quitterai à l’instant cette pièce !
Elinor ne put s’empêcher de rire.
– Pardonne-moi, dit-elle, et sois assurée que je n’avais pas l’intention de t’offenser en parlant d’une façon aussi calme de mes propres sentiments. Crois bien qu’ils sont plus violents que je ne l’ai déclaré ; bref, crois bien qu’ils sont tels que peuvent le justifier, sans imprudence ni folie, son mérite et le soupçon – l’espoir – de son affection pour moi. Mais il ne faut pas que tu ailles plus loin dans ta croyance. Je ne suis nullement assurée de son estime pour moi. Il y a des moments où la mesure m’en paraît douteuse ; et tant que ses sentiments ne seront pleinement connus, tu ne saurais t’étonner si je désire éviter d’encourager mon propre penchant en le prenant pour plus qu’il n’est, ou en lui donnant un autre nom. J’éprouve en mon cœur fort peu de doute – c’est à peine si j’en ressens – quant à sa préférence. Mais il y a d’autres points dont il faut tenir compte, outre son inclination. Il est bien loin d’être indépendant. Ce qu’est réellement sa mère, nous ne pouvons le savoir ; mais d’après ce que dit de temps à autre Fanny de sa conduite et de ses opinions, nous n’avons jamais été portées à la croire aimable ; et je me trompe fort si Edward lui-même ne se rend pas compte qu’il y aurait beaucoup de difficultés en travers de son chemin, s’il désirait épouser une femme qui n’eût soit une grosse fortune, soit un rang élevé.
Marianne fut étonnée de découvrir à quel point l’imagination de sa mère et la sienne avaient outrepassé la vérité.
– Et tu n’es vraiment pas sa fiancée ? dit-elle. Pourtant, cela se produira certainement bientôt. Mais il résultera de ce retard deux avantages. Je ne te perdrai pas si tôt, et Edward aura plus d’occasions d’améliorer ce goût naturel pour ton occupation préférée qui doit être d’une nécessité aussi indispensable à ton bonheur futur. Ah ! s’il pouvait être à ce point stimulé par ton génie, qu’il en apprenne lui-même à dessiner, comme ce serait charmant !
Elinor avait donné à sa sœur son opinion sincère. Elle ne pouvait considérer son penchant pour Edward comme étant en un état aussi favorable que l’avait cru Marianne. Il y avait parfois, chez lui, un manque d’entrain qui, s’il ne dénotait pas l’indifférence, témoignait d’un quelque chose aussi peu prometteur. Un doute au sujet de l’estime d’Elinor, en supposant qu’il l’eût éprouvé, n’eût pas dû lui causer autre chose que de l’inquiétude. Il ne lui aurait vraisemblablement pas occasionné cet abattement d’esprit qu’il manifestait fréquemment. On y pouvait trouver une cause plus raisonnable dans la situation de dépendance qui lui interdisait de s’abandonner à son affection. Elle savait que la mère d’Edward ne se comportait envers lui ni de façon à lui rendre son foyer agréable présentement, ni de façon à lui donner quelque assurance de pouvoir se constituer un foyer personnel, sans qu’il ne répondît strictement aux projets qu’elle nourrissait de le pousser dans le monde. Sachant cela, il était impossible à Elinor de se sentir rassurée à ce sujet. Elle était loin de compter sur ce résultat de la préférence du jeune homme pour elle, que sa mère et sa sœur considéraient toujours comme certaine. Voire, plus ils étaient longtemps ensemble, et plus la nature de l’estime d’Edward semblait douteuse ; et parfois, pendant quelques minutes douloureuses, elle croyait que ce n’était rien de plus que de l’amitié.
Mais quelles que pussent être les limites réelles de ce sentiment, il fut suffisant, lorsque la sœur d’Edward s’en aperçut, à lui causer de l’inquiétude ; et en même temps (ce qui était encore plus commun) à la rendre impolie. Elle saisit la première occasion de faire un affront à sa belle-mère à ce sujet, en lui parlant d’une façon si expressive des grandes espérances de son frère, de la résolution de Mrs. Ferrars de faire faire à ses deux fils un beau mariage, et du danger que courrait toute jeune femme qui tenterait de l’attirer à elle, que Mrs. Dashwood ne put ni feindre de ne pas s’en rendre compte, ni s’efforcer au calme. Elle lui fit une réponse qui marquait son mépris, et quitta la pièce à l’instant, résolue, quelles que pussent être l’incommodité et la dépense d’un déménagement aussi soudain, à ce que son Elinor bien-aimée ne restât pas exposée une semaine de plus à de semblables insinuations.
C’est dans cet état d’esprit qu’elle reçut par la poste une lettre qui renfermait une proposition particulièrement opportune. C’était l’offre d’une petite maison, à des conditions fort douces, appartenant à un de ses parents, gentleman important et possédant des biens dans le Devonshire. La lettre était de ce gentleman lui-même, et écrite dans le véritable esprit d’accommodement amical. Il se rendait compte qu’elle avait besoin d’une demeure, et, bien que la maison qu’il offrait à présent fût un simple cottage, il lui donnait l’assurance qu’on y ferait tous les travaux qu’elle pourrait juger nécessaires, si le site lui plaisait. Il insistait vivement auprès d’elle, après avoir donné des détails sur la maison et le jardin, pour qu’elle vînt avec ses filles à Barton Park, lieu de sa propre résidence, d’où elle pourrait juger par elle-même si Barton Cottage – car les maisons étaient dans la même paroisse – pourrait, par quelques travaux d’aménagement, être rendue confortable pour elle. Il semblait véritablement fort désireux de les héberger, et toute sa lettre était rédigée en un style si amical qu’il ne pouvait manquer de donner du plaisir à sa cousine, et tout particulièrement en ce moment où elle souffrait de l’attitude de froideur et d’insensibilité de ses parents plus proches. Il ne lui fallut aucun délai pour délibérer ni pour s’enquérir. La résolution fut formée à mesure qu’elle lisait. La situation de Barton, dans un comté aussi éloigné du Sussex que l’était le Devonshire, situation qui, quelques heures seulement au préalable, eût constitué une objection suffisante pour l’emporter sur tous les avantages possibles que présentait la localité, était maintenant sa principale recommandation. Quitter le voisinage de Norland, ce n’était plus un mal ; c’était l’objet de ses désirs ; c’était une bénédiction, en comparaison du supplice qu’elle endurerait en continuant à vivre comme l’invitée de sa belle-fille ; et quitter à jamais ces lieux bienaimés, ce serait moins douloureux que d’y habiter ou d’y être en visite, pendant qu’une femme pareille en était la maîtresse. Elle écrirait aussitôt à Sir John Middleton pour le remercier de son amabilité et pour accepter sa proposition ; puis elle se hâta de montrer les deux lettres à ses filles, afin d’être assurée de leur approbation, avant que sa réponse ne fût expédiée.
Elinor avait toujours pensé qu’il serait plus sage de s’établir à quelque distance de Norland, qu’à proximité immédiate de leurs connaissances présentes. De ce chef, donc, ce n’est pas elle qui se fût opposée à l’intention de sa mère, de partir pour le Devonshire. La maison, aussi, telle que la décrivait Sir John, était de proportions si simples, et le loyer si exceptionnellement modéré, qu’elle ne lui laissait nul droit à soulever d’objection sur aucun de ces points ; en conséquence, bien que ce ne fût pas un projet qui présentât quelque charme à son imagination, bien que ce fût un éloignement hors de la proximité de Norland, qui dépassait ses désirs, elle ne tenta en rien de dissuader sa mère d’expédier sa lettre d’assentiment.
V
La réponse à peine expédiée, Mrs. Dashwood s’offrit le plaisir d’annoncer à son beau-fils et à la femme de celui-ci qu’elle était pourvue d’une maison, et ne les incommoderait pas plus longtemps qu’il ne faudrait pour que tout fût prêt à ce qu’elle l’habitât. Ils l’écoutèrent avec surprise. Mrs. John Dashwood ne dit rien ; mais son mari exprima courtoisement l’espoir qu’elle ne s’établirait pas loin de Norland. Elle éprouva une grande satisfaction à répondre qu’elle allait dans le Devonshire. Edward se tourna vivement vers elle en l’apprenant, et répéta, d’une voix de surprise et d’inquiétude, qui ne nécessitait pour elle aucune explication : – Le Devonshire ! C’est vraiment là que vous allez ? Si loin d’ici ! Et dans quelle partie de ce comté ? – Elle expliqua la situation des lieux. C’était à moins de quatre milles3 au nord d’Exeter.
– Ce n’est qu’une maisonnette, reprit-elle, mais j’espère y voir beaucoup de mes amis. On pourra y ajouter facilement une pièce ou deux ; et si mes amis n’éprouvent pas de difficulté à faire un si long voyage pour venir me voir, je suis sûre que je n’en éprouverai aucune à les héberger.
Elle termina par une invitation fort aimable à Mr. et Mrs. John Dashwood de venir lui rendre visite à Barton ; et elle en adressa une à Edward, avec plus d’affection encore. Bien que sa récente conversation avec sa belle-fille l’eût amenée à prendre la résolution de ne pas rester à Norland plus longtemps qu’il n’était inévitable, elle n’avait pas produit sur elle le moindre effet quant au point principalement en cause. Il était aussi éloigné que jamais de son dessein de séparer Edward et Elinor ; et elle désirait montrer à Mrs. John Dashwood, par cette invitation mordante à son frère, à quel point total elle négligeait sa désapprobation de ce mariage.
Mr. John Dashwood redit et répéta à sa mère à quel point il regrettait vivement qu’elle eût pris une maison tellement éloignée de Norland qu’il était empêché de lui rendre aucun service dans le déménagement de ses meubles. Il éprouva réellement une contrariété sincère à cette occasion ; car l’effort même auquel il avait limité l’exécution de la promesse donnée à son père fut, par cet arrangement, rendu impraticable. Le mobilier fut expédié en totalité par voie d’eau. Il se composait principalement de linge de maison, d’argenterie, de porcelaine et de livres, avec un magnifique pianoforte appartenant à Marianne. C’est avec un soupir que Mrs. John Dashwood vit partir les colis ; elle ne put s’empêcher de trouver dur que, puisque le revenu de Mrs. Dashwood allait être si insignifiant en comparaison du sien, elle possédât aucun beau meuble.
Mrs. Dashwood prit la maison pour une durée d’une année ; elle était toute meublée, et elle pouvait immédiatement en prendre possession. Il ne se présenta aucune difficulté, de part ou d’autre, dans le contrat ; et elle n’attendit que le temps de se défaire de ses effets personnels, à Norland, et de déterminer son ménage futur, pour se mettre en route pour l’ouest ; et, comme elle était extrêmement rapide dans l’exécution de tout ce qui l’intéressait, cela fut vite fait. Les chevaux qui lui avaient été laissés par son mari avaient été vendus peu de temps après sa mort, et comme il se présenta maintenant une occasion de se défaire de sa voiture, elle consentit à la vendre également, sur le conseil pressant de sa fille aînée. Pour l’agrément de ses enfants, si elle n’avait consulté que ses propres désirs, elle l’eût conservée ; mais la prudence d’Elinor prévalut. La sagesse de celle-ci limita à trois le nombre de leurs domestiques – deux femmes et un homme, qu’ils trouvèrent rapidement parmi ceux qui avaient constitué leur ménage à Norland.
L’homme et l’une des servantes furent immédiatement dépêchés dans le Devonshire pour préparer la maison en vue de l’arrivée de leur maîtresse ; car, comme lady Middleton n’était rien de plus qu’une étrangère pour Mrs. Dashwood, celle-ci aimait mieux se rendre directement dans la maisonnette que d’être reçue comme invitée à Barton Park ; et elle se fiait de façon si certaine à la description que Sir John avait faite de la maison, qu’elle n’éprouvait aucune curiosité à l’examiner elle-même avant d’y entrer comme chez elle. Son empressement à quitter Norland fut protégé contre toute diminution par la satisfaction manifeste de sa belle-fille à la perspective de son déménagement – satisfaction qu’elle ne tenta que mollement de dissimuler sous une invitation pleine de froideur qu’elle lui fit, de différer son départ. L’instant était à présent venu, où la promesse de son beau-fils au père de celui-ci pourrait, avec un à-propos tout particulier, se voir accomplie. Puisqu’il avait négligé de le faire dès l’abord, lorsqu’il avait pris possession du domaine, on pouvait considérer le moment où elles quittaient sa maison comme étant la période la plus convenable à son accomplissement. Mais Mrs. Dashwood commença bientôt à renoncer à tout espoir de ce genre, et à être convaincue, d’après le cours général de ses entretiens, que son aide ne s’étendait pas au-delà de leur entretien pendant une période de six mois. Il parla si fréquemment des dépenses croissantes du ménage, et des exigences perpétuelles auxquelles était soumise, au-delà de toute prévision, la bourse d’un homme jouissant de quelque situation dans le monde, qu’il semblait qu’il eût lui-même besoin de plus d’argent, plutôt que d’entretenir le dessein d’en donner.
Fort peu de semaines après le jour qui apporta à Norland la première lettre de Sir John Middleton, tout était suffisamment réglé au sujet de leur demeure future pour permettre à Mrs. Dashwood et à ses filles de commencer leur voyage.
Nombreuses furent les larmes qu’elles versèrent lors de leurs derniers adieux à un lieu tant aimé. « Cher, cher Norland ! dit Marianne, tandis qu’elle errait, seule, devant la maison, le dernier soir qu’elles y passèrent, quand cesserai-je de te regretter ? Quand apprendrai-je à sentir que j’ai un foyer en un autre lieu ? Ô maison heureuse, si tu pouvais savoir ce que je souffre en te contemplant maintenant de cet endroit, d’où peut-être je ne pourrai plus te contempler ! Et vous, arbres si bien connus ! Mais vous persisterez, toujours pareils ! Nulle feuille ne se flétrira parce que nous serons partis, et nulle branche ne s’immobilisera, bien que nous ne puissions plus vous observer ! Non, vous persisterez, toujours pareils, inconscients du plaisir ou des regrets que vous causez, et insensibles à tout changement chez ceux qui marchent sous vos ombrages ! Mais qui demeurera pour jouir de vous ? »
3 Rappelons que le mille anglais vaut environ 1600 m. (N. du Tr.)
VI
La première partie de leur voyage s’effectua dans un état d’esprit trop mélancolique pour qu’elle fût autre qu’ennuyeuse et déplaisante. Mais à mesure qu’elles s’approchaient de sa fin, l’intérêt qu’elles prirent à l’aspect d’une région qu’elles devaient habiter surmonta leur abattement, et une vue de la vallée de Barton, au moment où elles y pénétrèrent, leur apporta de l’entrain. C’était un lieu agréable et fertile, bien boisé et riche en pâturages. Après l’avoir parcouru en serpentant sur plus d’un mille, elles atteignirent leur propre maison. Une petite pelouse verte constituait la totalité de leur domaine, en façade ; et une barrière à claire-voie, bien propre, leur y donna accès.
En tant que maison, Barton Cottage, bien que petite, était confortable et resserrée ; mais en tant que chaumière, elle était défectueuse, car le bâtiment était de forme régulière, le toit était couvert en tuiles, les volets des fenêtres n’étaient pas peints en vert, pas plus que les murs n’étaient couverts de chèvrefeuille. Un couloir étroit menait directement, au travers de la maison, dans le jardin à l’arrière. De part et d’autre de l’entrée il y avait un petit salon, d’environ seize pieds de côté ; et plus loin il y avait les communs et l’escalier. Quatre chambres à coucher et deux mansardes constituaient le reste de la maison. Il n’y avait pas beaucoup d’années qu’elle avait été construite, et elle était en bon état d’entretien. En comparaison avec Norland, elle était certes pauvre et petite ; mais les larmes que suscita le souvenir lorsqu’elles entrèrent dans la maison furent bientôt séchées. Elles furent ragaillardies par la joie des domestiques à leur arrivée, et chacune d’elles, par égard pour les autres, résolut de paraître heureuse. On était tout au début de septembre ; la saison était belle, et de ce que leur première vue des lieux eût joui de l’avantage du beau temps, elles en reçurent une impression favorable, qui leur fut fort utile à les recommander à leur approbation durable.
La maison était bien située. De hautes collines s’élevaient immédiatement derrière, et à peu de distance de chaque côté, des collines dont quelques-unes étaient à l’état de prairies ouvertes, les autres cultivées et boisées. Le village de Barton s’élevait principalement sur une de ces collines et constituait une vue agréable, des fenêtres de la maisonnette. La perspective en façade était plus étendue : elle commandait l’ensemble de la vallée, et atteignait jusqu’à la campagne au-delà. Les collines qui entouraient la maison terminaient la vallée dans cette direction ; sous un autre nom, et dans une autre direction, elle se ramifiait entre deux des plus escarpées d’entre elles.
Mrs. Dashwood fut, dans l’ensemble, fort satisfaite des dimensions et des meubles de la maison ; car bien que son genre de vie antérieur rendît indispensables de nombreuses additions à ces derniers, ce lui était une joie de compléter et d’améliorer ; et elle avait à cette époque suffisamment d’argent liquide pour faire face à tout ce qui manquait, en fait de surcroît d’élégance, aux appartements. « Quant à la maison elle-même, certes, dit-elle, elle est trop petite pour notre famille ; mais nous nous y installerons raisonnablement à l’aise pour le moment, car il est trop tard dans l’année pour effectuer des travaux d’amélioration. Peut-être, au printemps, si j’ai assez d’argent, comme ce sera sans doute le cas, pourrons-nous songer à bâtir. Ces petits salons sont l’un et l’autre trop petits pour les réunions d’amis que j’espère voir souvent rassemblés ici ; et j’ai vaguement l’idée d’incorporer le couloir à l’un d’eux avec, peut-être, une partie de l’autre, et d’en laisser ainsi le reste pour servir d’entrée ; cette transformation, avec un nouveau salon qui pourra y être ajouté facilement, et une chambre à coucher, avec une mansarde au-dessus, en fera une petite maison fort confortable. Je voudrais que l’escalier fût beau. Mais on ne peut pas tout demander, encore que je ne suppose pas qu’il soit très difficile de l’élargir. Je verrai ce que j’aurai devant moi au printemps, et nous projetterons nos améliorations en conséquence. »
Entre temps, en attendant que toutes ces modifications pussent être faites sur les économies à provenir d’un revenu de cinq cents livres par an, à effectuer par une femme qui n’avait de sa vie rien économisé, elles eurent la sagesse de se contenter de la maison telle qu’elle était ; et chacune d’elles fut occupée à disposer ses objets particuliers et à s’efforcer, en plaçant autour de soi ses livres et autres effets personnels, de se constituer un intérieur. Le pianoforte de Marianne fut déballé et convenablement installé, et les dessins d’Elinor furent accrochés aux murs du petit salon.
Elles furent interrompues dans leurs occupations de ce genre, peu après le premier déjeuner, le lendemain, par l’entrée de leur propriétaire, qui se présenta pour leur souhaiter la bienvenue à Barton, et leur offrir tout accessoire, provenant de sa propre maison et de son jardin, qui pouvait manquer pour le moment aux leurs. Sir John Middleton était un homme d’aspect agréable, d’une quarantaine d’années. Il avait jadis été reçu à Stanhill, mais il y avait trop longtemps de cela pour que ses jeunes cousines se souvinssent de lui. Sa physionomie respirait la bonne humeur ; et ses façons étaient aussi amicales que le style de sa lettre. Leur arrivée parut lui procurer une réelle satisfaction, et leur confort semblait être pour lui un objet de sollicitude véritable. Il parla beaucoup de son désir sincère de les voir vivre en excellente entente avec les siens, et insista si cordialement pour qu’elles vinssent dîner tous les jours à Barton Park jusqu’à ce qu’elles fussent mieux installées chez elles, que, bien que ses supplications fussent poussées avec une persévérance qui dépassait la civilité, elles ne purent déplaire. Son amabilité ne se borna pas aux paroles ; car, moins d’une heure après qu’il les eut quittées, un grand panier rempli de produits du jardin et de fruits arriva en provenance du Park, et il fut suivi, avant la fin de la journée, d’un présent de gibier. Il insista, en outre, pour leur faire porter toutes leurs lettres à destination et en provenance de la poste, et ne voulut pas qu’on lui refusât la satisfaction de leur envoyer tous les jours son journal.
Lady Middleton avait envoyé par son entremise un message fort courtois, faisant part de son intention de rendre visite à Mrs. Dashwood dès qu’elle pourrait être sûre que cette visite ne l’incommoderait pas ; et comme ce message reçut pour réponse une invitation également polie, milady leur fut présentée le lendemain.
Elles étaient, bien entendu, fort impatientes de voir une personne dont devait dépendre pour une si large part leur bien-être à Barton ; et l’élégance de son aspect fut favorable à leurs désirs. Lady Middleton n’avait pas plus de vingt-six ou vingt-sept ans ; son visage était beau, elle était grande et imposante, et son abord était gracieux. Ses façons possédaient toute l’élégance qui faisait défaut à celles de son mari. Mais elles eussent été améliorées par une part de la franchise et de la chaleur de celui-ci ; et sa visite fut suffisamment longue pour ôter quelque chose à l’admiration qu’elles avaient éprouvée de prime abord, en laissant voir que, quoique d’une éducation parfaite, elle était réservée, froide, et n’avait rien à dire de son propre fonds, en dehors de l’interrogation ou de la remarque la plus banale.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)