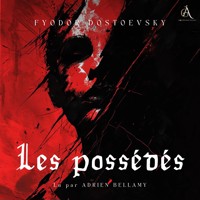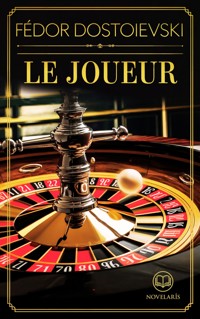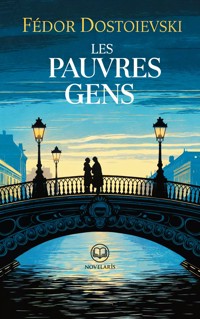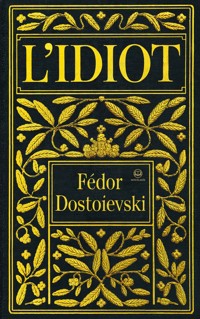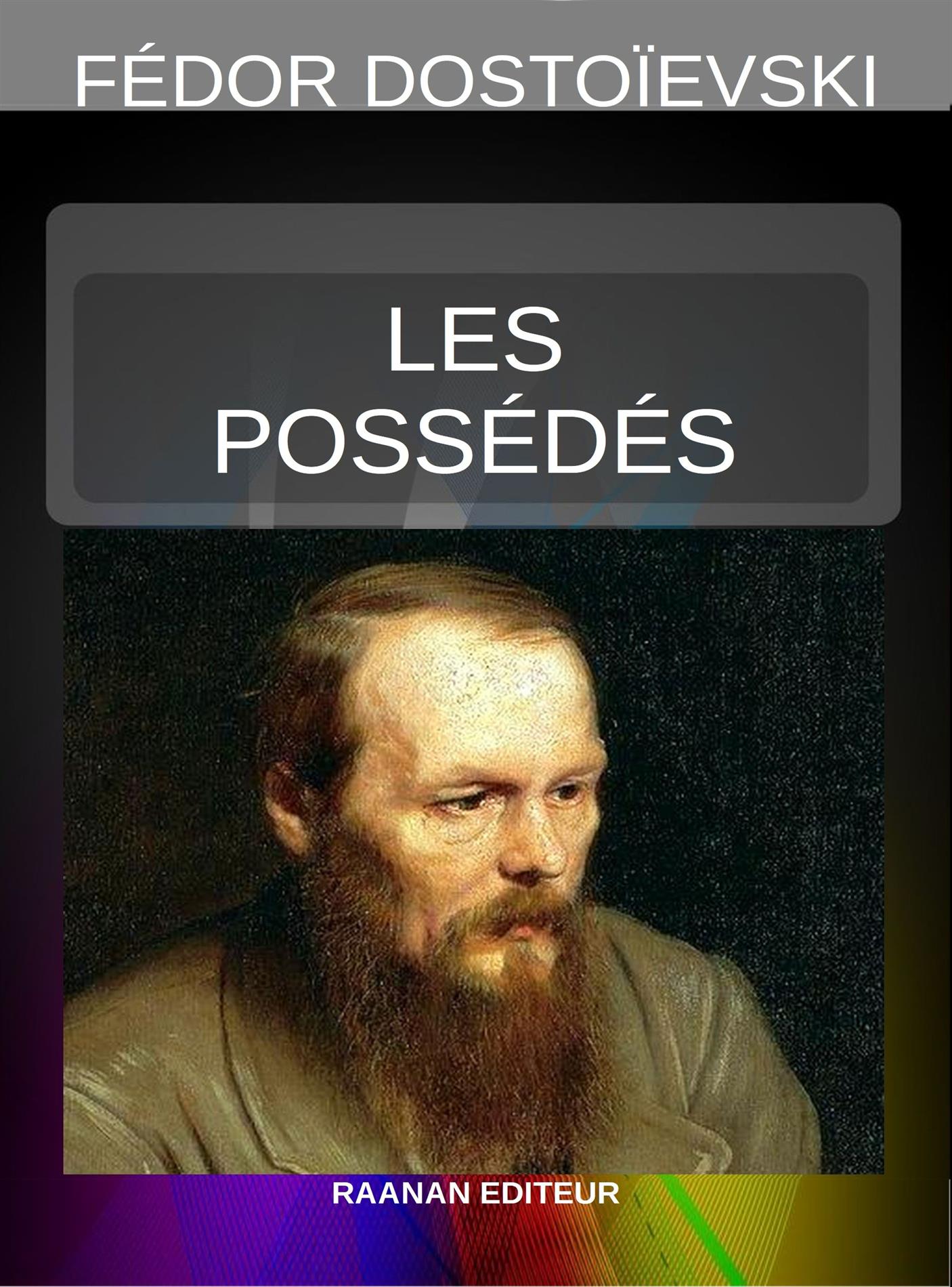Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : Ce recueil de nouvelles de Fédor Dostoïevski, intitulé "Recueil de Nouvelles", regroupe trois oeuvres significatives : "Les Nuits Blanches", "La Centenaire" et "L'arbre-de-noël". Dans "Les Nuits Blanches", Dostoïevski explore les profondeurs de la solitude humaine à travers l'histoire d'un rêveur solitaire qui, au cours de quatre nuits magiques à Saint-Pétersbourg, rencontre une jeune femme, Nastenka. Ce récit poignant met en lumière les thèmes de l'amour non réciproque et de l'espoir déçu, illustrant la fragilité des rêves face à la réalité. "La Centenaire" plonge le lecteur dans une atmosphère mystique, où une vieille femme raconte ses souvenirs d'un siècle de vie, mêlant histoire personnelle et événements historiques, tout en offrant une réflexion sur le passage du temps et la mémoire. Enfin, "L'arbre-de-noël" est une nouvelle qui, sous couvert de la féérie de Noël, aborde des thèmes plus sombres tels que la pauvreté et l'injustice sociale. À travers ces récits, Dostoïevski démontre son talent exceptionnel pour sonder l'âme humaine, alliant une prose poétique à une analyse psychologique fine. Ce recueil offre une plongée captivante dans l'univers de l'un des plus grands écrivains russes, où chaque page résonne d'une profondeur émotionnelle et d'une complexité intellectuelle qui captivent le lecteur. L'AUTEUR : Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski est né le 11 novembre 1821 à Moscou, en Russie. Considéré comme l'un des plus grands romanciers de la littérature mondiale, Dostoïevski a marqué le XIXe siècle par ses oeuvres profondes et psychologiquement complexes. Après des études d'ingénierie à l'École militaire supérieure de Saint-Pétersbourg, il se consacre rapidement à la littérature. Son premier roman, "Les Pauvres Gens", publié en 1846, connaît un succès immédiat et le propulse sur la scène littéraire russe. Cependant, sa carrière est interrompue par son arrestation en 1849 pour participation à un cercle intellectuel illégal, ce qui le conduit à être condamné à mort, peine commuée en exil en Sibérie. Cette expérience marquera profondément son oeuvre, influençant des romans tels que "Crime et Châtiment" et "Les Frères Karamazov", où il explore les dilemmes moraux et les tourments de l'âme humaine. Dostoïevski est également connu pour ses réflexions sur la foi, la liberté et la souffrance.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LES NUITS BLANCHES
1848
La Nouvelle Revue, 1887
Et n’était-ce pas sa part de bonheur,
Vivre seulement un instant
Dans l’intimité de ton cœur ?
Ivan TOURGUENEFF.
Sommaire
LES NUITS BLANCHES
PREMIÈRE NUIT{1}
DEUXIÈME NUIT
HISTOIRE DE NASTENKA
TROISIÈME NUIT
QUATRIÈME NUIT
LE MATIN
LE MOUJIK MAREY
KROTKAÏA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
LA CENTENAIRE
I
II
L’ARBRE DE NOËL
Indication
Page de copyright
PREMIÈRE NUIT{1}
La nuit était merveilleuse – une de ces nuits comme notre jeunesse seule en connut, cher lecteur. Un firmament si étoilé, si calme, qu’en le regardant on se demandait involontairement : Peut-il vraiment exister des méchants sous un si beau ciel ? – et cette pensée est encore une pensée de jeunesse, cher lecteur, de la plus naïve jeunesse. Mais puissiez-vous avoir le cœur bien longtemps jeune !
En pensant aux « méchants », je songeai, non sans plaisir, à la façon dont j’avais employé la journée qui venait de finir. Dès le matin, j’avais été pris d’un étrange chagrin : il me semblait que tout le monde me fuyait, m’abandonnait, qu’on me laissait seul. Certes, on serait en droit de me demander : Qui est-ce donc ce « tout le monde » ? Car, depuis huit ans que je vis à Pétersbourg, je n’ai pas réussi à me faire un seul ami. Mais qu’est-ce qu’un ami ? Mon ami, c’est Pétersbourg tout entier. Et s’il me semblait ce matin que « tout le monde » m’abandonnait, c’est que Pétersbourg tout entier s’en était allé à la campagne. Je m’effrayais à l’idée que j’allais être seul. Depuis déjà trois jours, cette crainte germait en moi sans que je pusse me l’expliquer, et depuis trois jours j’errais à travers la ville, profondément triste, sans rien comprendre à ce qui se passait en moi. À Nevsky, au jardin, sur les quais, plus un seul visage de connaissance. Sans doute, pas un ne me connaît parmi ces visages de connaissance, mais moi je les connais tous et très particulièrement ; j’ai étudié ces physionomies, j’y sais lire leurs joies et leurs tristesses, et je les partage. Je me suis lié d’une étroite amitié (peu s’en faut du moins, car nous ne nous sommes jamais parlé) avec un petit vieillard que je rencontrais presque tous les jours, à une certaine heure, sur la Fontanka. Un vénérable petit vieillard, toujours occupé à discuter avec lui-même, la main gauche toujours agitée et, dans la droite, une longue canne à pomme d’or. Si quelque accident m’empêchait de me rendre à l’heure ordinaire à la Fontanka j’avais des remords, je me disais : Mon petit vieillard a le spleen. Aussi étions-nous vivement tentés de nous saluer, surtout quand nous nous trouvions tous deux dans de bonnes dispositions. Il n’y a pas longtemps, – nous avions passé deux jours entiers sans nous voir, – nous avons fait ensemble simultanément, le même geste pour saisir nos chapeaux. Mais nous nous sommes rappelé à temps que nous ne nous connaissions pas et nous avons échangé seulement un regard sympathique.
Je suis très bien aussi avec les maisons. Quand je passe, chacune d’elles accourt à ma rencontre, me regarde de toutes ses fenêtres et me dit : « Bonjour ! comment vas-tu ? Moi, grâce à Dieu, je me porte bien. Au mois de mai on m’ajoutera un étage. » Ou bien : « Comment va la santé ? Demain on me répare. » Ou bien : « J’ai failli brûler, Dieu ! que j’ai eu peur ! » etc. D’ailleurs, je ne les aime pas toutes également, j’ai mes préférences. Parmi mes grandes amies, j’en sais une qui a l’intention de faire, cet été, une cure chez l’architecte : je viendrai certainement tous les jours dans sa rue, exprès pour voir si on ne la soigne pas trop, car ces médecinslà !… Dieu la garde !
Mais je n’oublierai jamais mon aventure avec une très jolie maisonnette rose tendre, une toute petite maison en pierre qui me regardait avait tant d’affection et avait pour ses voisines, mesquines et mal bâties, tant d’évident mépris, que j’en étais réjoui chaque fois que je passais auprès d’elle. Un certain jour, ma pauvre amie me dit avec une inexprimable tristesse : « On me peint en jaune ! les brigands ! les barbares ! Ils n’épargnent rien, ni les colonnes, ni les balustrades… » et en effet mon amie jaunit comme un citron. On eût dit que la bile se répandait dans son corps ! Je n’eus plus le courage d’aller la voir, la pauvre jolie ainsi défigurée, ma pauvre amie peinte aux couleurs du Céleste Empire !…
Vous comprenez maintenant, lecteur, comment je connais tout Pétersbourg.
Je vous ai déjà dit les trois journées d’inquiétude que je passai à chercher les causes du singulier état d’esprit où je me trouvais. Je ne me sentais bien nulle part, ni dans la rue ni chez moi. Que me manque-t-il donc ? pensais-je, pourquoi suis-je si mal à l’aise ? Et je m’étonnais de remarquer, pour la première fois, la laideur de mes murs enfumés et du plafond où Matrena cultivait des toiles d’araignées avec grand succès. J’examinais mon mobilier, meuble par meuble, me demandant devant chacun : N’est-ce pas là qu’est le malheur ? (Car, en temps normal, il suffisait qu’une chaise fût placée autrement que la veille pour que je fusse hors de moi.) Puis je regardais par la fenêtre… Rien, nulle nouvelle cause d’ennui. J’imaginai d’appeler Matrena et de lui faire des reproches paternels au sujet de sa saleté en général et des toiles d’araignées en particulier ; mais elle me regarda avec stupéfaction et c’est tout ce que j’obtins d’elle ; elle sortit de la chambre sans me répondre un seul mot. Et les toiles d’araignées ne disparaîtront jamais.
C’est ce matin seulement que j’ai compris de quoi il s’agissait : hé ! hé ! mais… ils ont tous fichu le camp à la campagne !… (Passez-moi ce mot trivial, je ne suis pas en train de faire du grand style.) Oui, tout Pétersbourg est à la campagne… Et aussitôt chaque gentleman honorable, je veux dire d’extérieur comme il faut, qui passait en fiacre, se transformait à mes yeux en un estimable père de famille qui, après ses occupations ordinaires, s’en allait légèrement dans sa maison familiale, à la campagne. Tous les passants, depuis trois jours, avaient changé d’allure et tout en eux disait clairement : Nous ne sommes ici qu’en passant, et dans deux heures nous serons partis.
S’il s’ouvrait dans ma rue une fenêtre où d’abord avaient tambouriné de petits doigts blancs comme du sucre, puis d’où sortait une jolie tête de jeune fille qui appelait le marchand de fleurs, il ne me semblait pas du tout que la jeune fille prétendît se faire, avec ces fleurs, un printemps intime dans son appartement étouffant de Saint-Pétersbourg, cela signifiait au contraire : « Ces fleurs ! ah ! bientôt, j’irai les reporter dans les champs ! »
Plus encore, – car j’ai fait des progrès dans ma nouvelle découverte, – je sais déjà, rien qu’à l’aspect extérieur, discerner dans quelle villa telle personne demeure. Les habitants de Kamenni, des îles Aptekarsky ou de la route de Petergov, se distinguent par des manières recherchées, d’élégants costumes d’été et de jolies voitures. Les habitants de Pargolovo et au delà ont un caractère particulier de sagesse et de bonne tenue. Ceux des îles Krestovsky ont une imperturbable gaîté.
Rencontrais-je une procession de charretiers qui marchaient paresseusement, les guides dans leurs deux mains, auprès de leurs charrettes chargées de montagnes de meubles, tables, chaises, divans turcs et pas turcs, ustensiles de ménage, le tout terminé assez souvent par une cuisinière qui, assise au sommet du tas, couvait les biens de ses maîtres ; regardais-je glisser sur la Neva des bateaux eux aussi chargés de meubles : charrettes et bateaux se multipliaient à mes yeux, il me semblait que toute la ville s’en allait, que tout déménageait par caravanes, que la ville allait être déserte. J’en étais attristé, offensé. Car moi, je ne pouvais aller à la campagne ! J’étais pourtant prêt à partir avec chaque charrette, avec chaque monsieur un peu cossu qui louait une voiture. Mais pas un, pas un seul ne m’invitait. On eût dit que tous m’oubliaient, comme si j’étais pour eux un étranger !
Je marchais beaucoup, longtemps, de sorte que je finissais par ne plus savoir où j’étais, quand j’aperçus les fortifications. Immédiatement je me sentis joyeux. Je m’engageai à travers les champs et les prairies, je n’éprouvais aucune fatigue. Il me semblait même qu’un lourd fardeau tombait de mon âme. Tous les gens en carrosses me regardaient avec tant de sympathie qu’un peu plus ils m’auraient salué. Tous étaient contents, je ne sais pourquoi ; tous fumaient de beaux cigares. Moi j’étais heureux. Je me croyais tout à coup transporté en Italie, tant la nature m’étonnait, pauvre citadin à demi malade, à demi mort de l’atmosphère empoisonnée de la ville.
Il y a quelque chose d’ineffablement touchant dans notre campagne pétersbourgeoise, quand, au printemps, elle déploie soudain toute sa force, s’épanouit, se pare, s’enguirlande de fleurs. Elle me fait songer à ces jeunes filles languissantes, anémiées, qui n’excitent que la pitié, parfois l’indifférence, et brusquement, du jour au lendemain, deviennent inexprimablement merveilleuses de beauté : vous demeurez stupéfaits devant elles, vous demandant quelle puissance a mis ce feu inattendu dans ces yeux tristes et pensifs, qui a coloré d’un sang rose ces joues pâles naguère, qui a répandu cette passion sur ces traits qui n’avaient pas d’expression, pourquoi s’élèvent et s’abaissent si profondément ces jeunes seins ? Mon Dieu ! qui a pu donner à la pauvre fille cette force, cette soudaine plénitude de vie, cette beauté ? Qui a jeté cet éclair dans ce sourire ? Qui donc fait ainsi étinceler cette gaîté ? Vous regardez autour de vous, vous cherchez quelqu’un, vous devinez… Mais que les heures passent et peut-être demain retrouverez-vous le regard triste et pensif d’autrefois, le même visage pâle, les mêmes allures timides, effacées : c’est le sceau du chagrin, du repentir, c’est aussi le regret de l’épanouissement éphémère… et vous déplorez que cette beauté se soit fanée si vite : quoi ! vous n’avez pas même eu le temps de l’aimer !…
Je ne rentrai dans la ville qu’assez tard ; dix heures sonnaient. La route longeait le canal ; c’est un endroit désert à cette heure… Oui, je demeure dans la banlieue la plus reculée.
Je marchais en chantant. Quand je suis heureux je fredonne toujours. C’est, je crois, l’habitude des hommes qui, n’ayant ni amis ni camarades, ne savent avec qui partager un moment de joie.
Mais ce soir-là me réservait une aventure.
À l’écart, accoudée au parapet du canal, j’aperçus une femme. Elle semblait examiner attentivement l’eau trouble. Elle portait un charmant chapeau à fleurs jaunes et une coquette mantille noire.
« C’est une jeune fille et sûrement une brune, » pensai-je.
Elle semblait ne pas entendre mes pas et ne bougea point quand je passai auprès d’elle en retenant ma respiration et le cœur battant très fort.
« C’est étrange, pensai-je ; elle doit être très préoccupée. »
Et tout à coup je m’arrêtai, il me semblait avoir entendu des sanglots étouffés.
« Je ne me trompe pas, elle pleure. »
Un instant de silence, puis encore un sanglot. Mon Dieu ! mon cœur se serra. Je suis d’ordinaire très timide avec les femmes, mais dans un pareil moment !… – Je retournai sur mes pas, je m’approchai d’elle et j’aurais certainement prononcé le mot : « Madame, » si je ne m’étais rappelé à temps que ce mot est utilisé au moins dans mille circonstances analogues par tous nos romanciers mondains. Ce n’est que cela qui m’arrêta, et je cherchais un mot plus rare quand la jeune fille m’aperçut, se redressa et glissa vivement devant moi en longeant le canal. Je me mis aussitôt à la suivre. Mais elle s’en aperçut, quitta le quai, traversa la rue et prit le trottoir. Je n’osais traverser la rue à mon tour, mon cœur sautait dans ma poitrine comme un oiseau en cage. Heureusement le hasard me vint en aide.
Sur le trottoir où marchait l’inconnue et tout près d’elle surgit un monsieur en frac ; d’un âge « sérieux » : on n’eût pu dire, par exemple, que sa démarche aussi fût sérieuse. Il se dandinait en rasant prudemment les murs. La jeune fille filait droit comme une flèche, d’un pas à la fois précipité et peureux, comme font toutes les jeunes filles qui veulent éviter qu’on leur offre de les accompagner ; et certes, avec son allure mal assurée, le monsieur dont l’ombre se dandinait sur les murs n’eût pu la rejoindre s’il ne s’était brusquement mis à courir. Elle allait comme le vent, mais son persécuteur gagnait du terrain, il était déjà tout près d’elle, elle jeta un cri, et… Je remerciai la destinée pour l’excellent bâton que je tenais dans ma main droite. En un instant je fus de l’autre côté, le monsieur prit en considération l’argument irréfutable que je lui proposai, se tut, recula et, seulement quand nous l’eûmes distancé, se mit à protester en termes assez énergiques ; mais ses paroles se perdirent dans l’air.
– Prenez mon bras, dis-je à l’inconnue.
Elle passa silencieusement sous mon bras sa main tremblante encore de frayeur. Ô le monsieur inattendu ! Comme je le bénissais !
Je jetai un rapide regard sur elle. Elle était brune comme je l’avais deviné, et fort jolie. Ses yeux étaient encore mouillés de larmes, mais ses lèvres souriaient. Elle me regarda furtivement, rougit un peu et baissa les yeux.
– Vous voyez ! Pourquoi m’aviez-vous repoussé ? Si j’avais été là, rien ne serait arrivé…
– Mais je ne vous connaissais pas, je croyais que vous aussi…
– Me connaissez-vous davantage, maintenant ?
– Un peu. Par exemple, vous tremblez, pensez-vous que je ne sache pas pourquoi ?
– Oh ! vous avez deviné du premier coup ! m’écriai-je transporté de joie que la jeune fille fût si intelligente, car l’intelligence et la beauté vont très bien ensemble. – Oui, vous avez deviné à qui vous aviez affaire. C’est vrai, je suis timide avec les femmes. Je suis même plus ému maintenant que vous ne l’étiez, vous, quand ce monsieur vous a fait peur. C’est comme un rêve… Non, c’est plus qu’un rêve, car jamais, même en rêve, il ne m’arrive de parler à une femme.
– Que dites-vous ? Vraiment ?
– Oui. Si mon bras tremble, c’est que jamais encore une aussi jolie petite main ne s’y est appuyée. Je n’ai pas du tout l’habitude des femmes… J’ai toujours vécu seul. Aussi je ne sais pas leur parler. Peut-être bien vous ai-je déjà dit quelque sottise ; parlez franchement, vous le pouvez, je ne suis pas susceptible…
– Vous n’avez pas dit de sottise, pas du tout, au contraire, et puisque vous voulez que je vous parle franchement, je vous dirai qu’une telle timidité plaît aux femmes, et si vous voulez tout savoir je vous dirai encore qu’elle me plaît particulièrement. Aussi je vous permets de m’accompagner jusqu’à ma porte.
– Mais, dis-je étouffant de joie, vous m’en direz tant que je cesserai d’être timide et alors, adieu tous mes avantages…
– Des avantages ! Quels avantages ? Pourquoi faire ? Voilà qui n’est pas bien.
– Pardon… Mais comment voulez-vous que je ne désire pas…
– Plaire, n’est-ce pas ?
– Eh bien ! oui. Oui, soyez bonne, au nom de Dieu ! Écoutez. J’ai vingt-six ans et personne encore ne m’a aimé. Comment donc pourrais-je parler adroitement et à propos ? Pourtant il faut que je parle, j’ai envie de tout vous dire, à vous… Mon cœur crie, je ne puis me taire… Mais le croiriez-vous… pas une seule femme, jamais, jamais… et pas un ami ! et tous les jours je rêve qu’enfin je vais rencontrer quelqu’un, je rêve, je rêve… et si vous saviez combien de fois j’ai été amoureux de cette façon !
– Mais comment ? de qui ?
– De personne, idéalement. Ce sont des figures de femmes aperçues en rêve. Mes rêves sont des romans entiers. Oh ! vous ne me connaissez pas… Il est vrai, – et il ne se pouvait autrement, – j’ai rencontré deux ou trois femmes, mais quelles femmes ! Ah ! l’éternel pot-au-feu !… Mais vous ririez si je vous racontais que j’ai plusieurs fois fait le rêve que je parlais, dans la rue, à une dame du plus grand monde. Oui, dans la rue, tout simplement : la dame était seule et moi je lui parlais respectueusement, timidement, passionnément. Je lui disais : que je me perds dans la solitude, qu’il ne faut pas me renvoyer, que nulle femme ne m’aime, que c’est le devoir de la femme de ne pas repousser la prière d’un malheureux, que je lui demande tout au plus deux paroles de sœur, deux paroles compatissantes, qu’elle doit donc m’écouter, qu’elle peut rire de moi s’il lui plaît, mais qu’il faut qu’elle m’écoute, qu’il faut qu’elle me rende l’espérance que j’ai perdue… Deux paroles, seulement deux paroles et puis ne la revoir plus jamais !… Mais vous riez… Du reste ce que je dis est en effet très risible.
– Ne vous fâchez pas. Ce qui me fait rire, c’est que vous êtes votre propre ennemi. Si vous essayiez vous réussiriez peut-être, même si la scène se passait dans la rue. Plus c’est simple et plus c’est sûr. Pas une femme de cœur, pourvu qu’elle ne fût ni sotte ni, en ce moment même, de mauvaise humeur, n’oserait vous refuser les deux paroles que vous implorez. Pourtant, qui sait ? Peut-être vous prendrait-on pour un fou. J’ai jugé d’après moi, – car moi je sais bien comme vivent les gens sur la terre…
– Oh ! je vous remercie, m’écriai-je. Vous ne pouvez comprendre le bien que vous venez de me faire !
– Bon, bon… Mais dites-moi, à quoi avez-vous vu que je suis une femme avec laquelle… eh bien, une femme digne… digne… d’attention et d’amitié ? En un mot pas… pot-au-feu, comme vous dites ? Pourquoi vous êtes-vous décidé à vous approcher de moi ?
– Pourquoi ? Mais… vous étiez seule, ce monsieur trop entreprenant… il faisait nuit, convenez que c’était le devoir…
– Mais non, auparavant déjà, là, de l’autre côté, vous vouliez m’aborder…
– Là, de l’autre côté ?… Mais vraiment, je ne sais comment vous répondre, je crains… Savez-vous ? Je me sentais aujourd’hui très heureux. La marche, les chansons que je me suis rappelées, la campagne… jamais je ne me suis senti si bien. Voyez… cela m’a semblé peut-être… pardonnez-moi si je vous le rappelle, j’ai cru vous avoir entendu pleurer, et moi… je n’ai pu supporter cela, mon cœur s’est serré. Ô mon Dieu ! étais-je coupable d’avoir pour vous une pitié fraternelle !… Pouvaisje vous offenser en m’approchant de vous malgré moi ?
– Taisez-vous… dit la jeune fille en baissant les yeux et en me serrant la main. J’ai eu tort de parler de cela, mais je suis contente de ne pas m’être trompée sur vous… Eh bien, me voici chez moi. Il faut traverser cette petite ruelle et il n’y a plus que deux pas. Adieu. Merci.
– Alors, nous ne nous verrons plus jamais, c’est fini ?
– Voyez-vous ! dit en riant la jeune fille, vous ne vouliez d’abord que deux mots, et maintenant… Du reste, nous nous reverrons peut-être…
– Je viendrai ici demain… Oh ! pardon, je suis déjà exigeant.
– Oui, vous n’avez pas de patience, vous ordonnez presque…
– Écoutez-moi, interrompis-je, je ne puis pas ne pas venir ici demain. Je suis un rêveur, j’ai si peu de vie réelle, j’ai si peu de moments comme celui-ci, que je ne puis pas ne pas les revivre dans mes rêves. Je rêverai de vous toute la nuit, toute la semaine, toute l’année. Je viendrai ici demain, absolument, précisément ici, demain, à la même heure et je serai heureux de m’y souvenir de la veille… Cette place m’est déjà chère. – J’ai deux ou trois endroits pareils dans Pétersbourg. Dans l’un d’eux j’ai pleuré… d’un souvenir. Qui sait ? il y a dix minutes, vous aussi vous pleuriez peut-être pour quelque souvenir. Peut-être autrefois avez-vous été très heureuse ici ?
– Je viendrai peut-être aussi demain à dix heures, je vois que je ne peux plus vous le défendre… Mais, il ne faut pas venir ici. Ne pensez pas que je vous fixe un rendez-vous, je prévois seulement que j’aurai à venir ici pour mes affaires, mais… eh bien, franchement, je ne serai pas fâchée que vous y veniez aussi. D’abord je puis avoir encore des désagréments comme aujourd’hui, mais laissons cela… En un mot, je voudrais tout simplement vous voir… pour vous dire deux mots. N’allez pas me juger mal pour cela. Ne pensez pas que je donne si facilement des rendez-vous ; je ne vous aurais pas dit cela si… mais que cela reste un secret, c’est la condition…
– Une convention, dites tout de suite que c’est une condition ! je consens à tout, m’écriai-je transporté, à tout, je réponds de moi, je serai obéissant, respectueux… vous me connaissez.
– C’est précisément parce que je vous connais que je vous invite demain ; mais vous, prenez garde à cette autre condition tout à fait capitale (je vais vous parler franchement) : ne devenez pas amoureux de moi, cela ne se peut pas, je vous assure ; pour l’amitié je veux bien, voici ma main ; mais l’amour, non, je vous en prie.
– Je vous jure…
– Ne jurez pas, vous êtes inflammable comme la poudre… Ne m’en veuillez pas pour vous avoir dit cela, si vous saviez… Moi non plus je n’ai personne au monde à qui faire une confidence, demander un conseil ; vous, vous êtes une exception, je vous connais comme si nous étions des amis de vingt ans… n’est-ce pas que vous ne me trahirez pas ?
– Vous verrez ! Mais comment vivre encore tout ce grand jour ?
– Dormez bien, bonne nuit, et rappelez-vous que j’ai déjà confiance en vous. Dites, on n’a pas à rendre compte de tous ses sentiments, même d’une sympathie fraternelle ? C’est vous qui m’avez dit cela, et vous l’avez si bien dit que la pensée m’est venue aussitôt de me confier à vous et de vous dire…
– Quoi, mon Dieu ! dire quoi ?
– À demain ! que cela reste un secret jusqu’à demain ! Ça vaudra mieux pour vous ! Ça ressemblera mieux à un roman !
– Peut-être vous dirai-je demain… tout, et peut-être ne vous dirai-je rien ! Je veux d’abord causer avec vous, vous mieux connaître.
– Moi, déclarai-je avec décision, je vous raconterai demain toute mon histoire ! Mais quoi donc ? Quelque chose de merveilleux se passe en moi. Où suis-je donc ? mon Dieu ! Eh bien ! n’êtes-vous pas contente maintenant de ne pas vous être fâchée tout à l’heure, de ne pas m’avoir repoussé dès le premier mot ? En deux minutes vous m’avez rendu heureux pour toute la vie, oui heureux ! vous m’avez réconcilié avec moi-même ! vous avez peut-être éclairci tous mes doutes ! S’il me revient des instants semblables… Eh bien, je vous dirai demain tout, vous saurez tout, tout…
– Alors c’est vous qui commencerez ?
– Entendu.
– Au revoir !
– Au revoir !