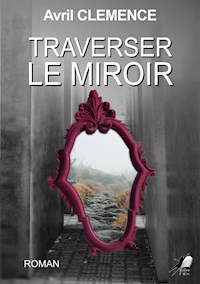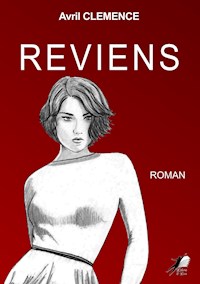
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Grandir et aimer quelqu'un qu'on ne devrait pas...
Elena n’a pas tout à fait quatorze ans, du moins officiellement. La vie s’étant chargée de la faire grandir au pas de course, c’est sans difficulté qu’elle se fond dans un groupe de jeunes adultes pendant les vacances d’été et qu’elle entame sa première histoire d’amour avec l’un d’eux.
Cette belle rencontre provoquera le tollé et l’incompréhension familiale. Elle marquera pour l’adolescente, le début d’une série de bouleversements psychologiques et de remises en question de sa propre identité.
Comment devenir une femme quand on est encore considérée comme une enfant ? A-t-on seulement le droit d’aimer ?
Laissez-vous bouleverser par cette histoire d'amour rendue difficile par la différence d'âge et les désapprobations familiales.
EXTRAIT
"« Il faut que je te dise un truc. » Nul… « Je t’ai menti. » Trop cash… « Maintenant qu’on se connaît mieux, on n’est plus à deux ou trois ans près, si ? »
Depuis cet après-midi pluvieux à l’atelier, je tiens ce genre de monologue intérieur au moins quatre fois par jour. Quand je le rejoins et quand je le quitte ; l’après-midi et le soir. À chaque fois, je me dis qu’il faut y aller et à chaque fois, je reporte. Après trois semaines, je commence à désespérer.
Le matin, c’est la première chose qui me vient à l’esprit. J’éprouve toujours une sorte de flottement désagréable au réveil en repensant au temps passé avec Tamao la veille et à mes occasions manquées. Surtout ces derniers jours, car nos affaires se corsent. Ma faute. Parfois la sienne. La faute à nos corps qui ne savent pas maintenir leurs distances, à ma curiosité, à sa douceur. À sa subtilité."
À PROPOS DE L'AUTEURE
Depuis l’enfance,
Avril Clémence aime la lecture, l’écriture et les langues étrangères ; trois passions qui l’ont conduite à exercer le métier de traductrice. Curieuse par nature, sa plume s’aventure souvent dans des intrigues réalistes, au cœur de la société actuelle, ses mœurs et les équivoques qu’elles suscitent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Avril CLEMENCE
Reviens
Roman
Cet ouvrage a été composé en France par Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN papier : 978-2-490522-33-0ISBN Numérique : 978-2-490522-34-7Dépôt légal : Janvier 2020
© Libre2Lire, 2020
IOn s’en fout, des chiffres
1.
Quatre heures. Quatre heures de voyage et de silence. De paysages qui s’effacent un peu plus à chaque kilomètre parcouru. De taches colorées, toujours les mêmes, qui défilent devant mes yeux indifférents. Jaune colza. Vert maïs. Gris bitume. À gauche, l’ennui. À droite, la monotonie. Entre les deux, rien ; Louise et moi. Un duo mère-fille défiant les lois du calcul, où un et un ne s’additionnent pas.
La voiture glisse sur l’asphalte et m’emporte inexorablement, tout droit vers… Où allons-nous, déjà ? Je ne sais même pas le nom de la commune. Me l’a-t-on dit ? Les informations m’ont été livrées au compte-gouttes, avec réticence, et d’une façon si peu détaillée qu’à ce stade j’imagine un toit posé sur quatre murs incolores, au beau milieu de nulle part. J’exagère : la propriété se trouve à proximité d’un village. Tout petit certes, et plutôt inerte compte tenu de la moyenne d’âge des habitants mais, dans ma situation, toutes les branches sont bonnes pour se raccrocher.
Louise a grandi là. Jusqu’à ses dix-huit ans, du moins, car ensuite elle est partie pour Paris sans un regard en arrière. J’ignore pourquoi. Je ne crois pas qu’elle prévoyait de revenir un jour, mais en léguant à sa fille unique la bâtisse de son enfance, sa mère lui a offert une maison de vacances. Une friandise irrésistible pour ma génitrice, puisque ce genre de possession fait toujours son effet auprès des gens. Et de ça, Madame se soucie grandement.
Elle balance ça sur un ton neutre, tout en empruntant la sortie vers une station-service.
Une chaleur étouffante me prend à la gorge et s’engouffre dans mes poumons dès que je quitte l’habitacle.
La climatisation, c’est la vie ! pensé-je.
La foule qui se presse devant les portes du bâtiment principal forme une boule compacte. Avec un soupir résigné, je me joins au flux des touristes et commence à piétiner vers l’entrée. Le rayon frais se situe à l’autre bout de la salle, il me faudra déployer des trésors d’adresse et de réactivité pour l’atteindre. Je zigzague entre les files d’attente, contourne les indécis, pile devant les pressés, repars vers l’objet de ma convoitise. C’est plus une danse qu’une marche vers le déjeuner. Un grand ballet désordonné. Les joies des grands axes routiers, au premier jour des vacances d’été !
Tout en continuant de songer à notre destination, je fais mes courses. Deux bouteilles d’eau…
Oh, et puis non, un Coca, pour moi. Le sucre aussi, c’est la vie !
… un sandwich – le premier qui passe – et une salade. La plus vierge possible, pour respecter le perpétuel régime de Madame. Gare à moi si je lui ramène un peu de fantaisie, comme… J’ose à peine y penser… des copeaux de parmesan!
Je vois la scène d’ici : la main sur le cœur, la grimace crispée. Désolée, gamine, le myocarde de ta maman n’a pas résisté.
Hélas, les industriels tentent par tous les moyens de rendre leurs produits attrayants. On trouve de tout désormais, et ce qui pousse le commun des mortels à consommer de la feuille fait fuir ma mère, généralement. Tomates séchées – Ça baigne dans l’huile, non ? –, œufs durs – Des protéines ? Vous n’y pensez pas ! –, pâtes, et autres « détritus » tels que le thon qui donnent mauvaise haleine, toutes ces propositions sont rédhibitoires pour elle. Alors me voici, bouche tordue, sourcils froncés, à deux doigts d’aller cueillir de l’herbe…
Finalement, ce que je cherche m’attend tout au bout du rayon : dans un coin, à l’écart, une salade déprime. Verte, striée de filaments orange. Je l’examine d’un peu plus près. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils y sont allés mollo sur la carotte… Parfait !
Je réintègre les rangs et me traîne avec les autres en direction de la caisse. Autant m’y habituer : traîner constituera ma principale activité pendant les deux mois à venir. Quand l’âge moyen de la population locale frise les quatre-vingts ans, c’est inévitable. Voilà toute l’étendue des informations lâchées par Madame au sujet des lieux de mon exil forcé. Ou tout ce que j’en retiens, si ça se trouve : à – presque – quatorze ans, la perspective de passer l’été en maison de repos n’a rien de réjouissant. Ça marque l’esprit, forcément.
La personne qui me précède vire à droite et disparaît de mon champ de vision. Il me faut quelques secondes avant de réaliser que c’est mon tour. Le jeune caissier s’offre déjà une excursion mentale au cœur de mon soutien-gorge. La balade semble agréable, il prend son temps. Je devrais le gifler. Ou retourner ses présentoirs. Me curer le nez peut-être, histoire de le dégoûter. Quoi que je fasse, mon agression n’égalera pas la sienne, en tout cas. Je croise les bras en le fixant d’un regard noir, j’attends. L’absence de mouvement doit attirer son attention car il ne tarde pas à s’éjecter de sa chaise en piquant un fard.
Le goujat s’active, annonce le tarif, tente un sourire poli. Je règle en faisant la gueule, et repars en silence.
Assieds-toi sur ma politesse, connard !
La fournaise extérieure m’avale toute crue sitôt que je pousse la porte. Un balayage rapide des environs me permet de repérer ma génitrice installée à une table de l’aire de repos. Elle a pris soin d’étaler une serviette sur le banc pour ne pas risquer de tacher son précieux tailleur. Je soupire encore, lève les yeux au ciel.
Un tailleur, sérieux !
S’apprêter de la sorte pour voyager relève du ridicule, selon moi. Pour elle, en revanche, c’est un impératif : avec Louise, il s’agit moins de bien se présenter que d’apparaître sous son meilleur jour en toutes circonstances. Et si elle tombait sur une connaissance ? Que penseraient les gens si elle négligeait sa tenue ? Ce à quoi elle ressemble en privé, ça la regarde. Le monde, lui, doit la percevoir comme une super-femme, une super-épouse, une super-maman, une super-tout. Quoi qu’il arrive. Alors, même pour faire sept heures de voiture, elle a scrupuleusement suivi sa routine ce matin, du choix méticuleux de ses fringues à l’indispensable lissage de sa jolie crinière blonde en passant par son maquillage léger, mais sophistiqué. Avec mon short en jean déjà porté une fois dans la semaine, mon débardeur anonyme et mes sandales sans artifices, je ne pouvais pas présenter de contraste plus net – sans parler de mes cheveux bruns rassemblés en chignon approximatif et fixés par une simple baguette.
Louise m’adresse de grands signes. L’agacement se lit sur son visage et la faim lui fait tendre des mains avides vers la salade à mon approche.
Tu m’étonnes ! Privé de pratiquement tout, son organisme doit attendre les heures de repas avec une impatience féroce !
Je m’installe de l’autre côté de la table, pas tout à fait face à elle, et nous entamons notre déjeuner en silence. Des rires éclatent sur ma gauche, où deux fillettes jouent. La plus jeune court en tous sens pour arracher un ballon aux pieds de sa sœur, tournicote autour d’elle, tente un ou deux tacles. Leurs cheveux roux flamboient dans leur sillage, on dirait deux petites comètes. La gosse finit par récupérer la balle, à grand renfort de bousculades. Ignorant les protestations de l’aînée, elle file à toute vitesse vers le gardien-papa qui l’attend plus loin, les jambes fléchies, les bras ouverts et le regard concentré. Peu avant d’atteindre son objectif, elle s’arrête, pose un pied confiant sur le ballon et dégage son visage des mèches trempées de sueur qui l’encombrent.
Le père rit. Moi aussi. Lassée de se sentir ignorée, la grande sœur repart en direction de la mère qui se tient assise sous un arbre. La gamine affiche une moue boudeuse et gesticule, tape du pied. Ses plaintes se perdent dans les bruits environnants.
Je n’ai pas vu le tir. Dommage. Le père soulève sa fille dans les airs pour fêter l’exploit puis la hisse sur ses épaules. Ensemble, ils s’en vont retrouver la maman, qui les couve d’un regard affectueux, et la sœur, de plus en plus grognon.
Enfant, je rêvais d’avoir un frère. Pour se disputer et se réconcilier, jouer à deux et chacun de son côté, se confier des secrets et s’ignorer. Tenir bon dans les moments difficiles. Depuis dix ans, c’est Fabian qui remplit ce rôle. Il valait mieux, en fin de compte. Que fait mon meilleur ami maintenant ? Lui et les autres doivent déjà être en Espagne, à cette heure-ci. J’aurais tant aimé partir avec eux ! Ces moments où la réalité me rattrape et me jette notre différence d’âge à la figure sont terribles, je les ressens comme une injustice. Pourtant, je sais que je ne peux pas tout faire comme mes potes : ils sont majeurs, eux, ou presque. Pas moi.
Les souvenirs de notre dernière sortie avant le grand départ affluent. Je revois Fabian remplir sa valise et proposer de me cacher dedans. Alyssa me présenter le bon côté des choses, argumenter en faveur de cette maison de vacances qui ouvre des perspectives intéressantes pour l’avenir.
J’entends Fab m’expliquer que même les petits bleds doivent vivre avec leur époque et qu’il doit y avoir un camping dans les parages. Une connexion Internet…
Trop occupée à m’inquiéter de notre séparation à venir, je n’ai pas écouté la suite du débat. Avec un recul de vingt-quatre heures et vu le néant qui caractérise ma situation actuelle, je le regrette : j’aurais pu trouver dans son écho de quoi divaguer un certain temps. Un tête-à-tête avec Louise n’est pas la perspective la plus fun au monde et l’arrivée du Chef, dans une semaine, n’améliorera pas les choses…
Madame repousse l’emballage de mon sandwich du bout des doigts. Elle vient sûrement de remarquer la mention « mayonnaise ».
Bon sang ! Si c’est pour devenir aussi aigrie, j’aime autant bombarder mon corps de saloperies !
Je soupire. Changeons de sujet.
À sa manière de froncer le nez, je devine qu’elle juge mon choix exagérément sobre, en fin de compte.
Le reste de ses commentaires s’évanouit quelque part entre sa bouche et mes oreilles. Je ne l’écoute déjà plus. Sa façon de parler de cette maison et de son contenu me sidère : elle la réduit à l’état de murs anonymes, et ses anciens propriétaires à celui d’étrangers. Si je peux concevoir qu’on n’attache pas une grande importance aux choses matérielles, je n’arrive pas à croire qu’elle ait pu détester ses parents et son enfance au point de les piétiner de la sorte. Tout ne peut pas être bon à jeter, si ? Même moi, je ne pense pas que je lui réserverais pareil traitement si je la perdais demain. Et pourtant, nos relations ne sont pas harmonieuses !
Mon mutisme finit par avoir raison de ses explications, ou peut-être n’a-t-elle plus rien à dire. Le silence reprend bientôt sa place naturelle entre nous et s’installe jusqu’à la fin du déjeuner. Nous nous remettons en route d’un accord tacite. Louise ne s’est pas encore engagée sur la quatre-voies que je sombre dans le sommeil.
***
La voiture s’arrête brusquement. Dans mon rêve, le sol s’incline et je bascule vers l’avant. La sensation de chute me réveille en sursaut. Du coin de l’œil, je perçois des mouvements sur ma gauche. Une forme allongée apparaît soudain devant mon nez et je l’attrape par réflexe ; ce n’est qu’une fois entre mes doigts que je l’identifie comme une clef.
La Mercedes attend, moteur ronronnant, devant un grand portail en fer forgé. Je m’extirpe de l’habitacle en me frottant les paupières pour chasser les dernières traces de fatigue, tourne autour du verrou sans réussir à introduire la clef. Madame s’impatiente déjà. J’essaie de recouvrer mes esprits en me secouant un peu, écarte enfin les portes puis me range sur le côté afin de laisser passer Sa Majesté et son carrosse. Fin du voyage. Un soupir m’échappe alors que je referme et que mon regard s’égare vers l’horizon.
Compte à rebours lancé : retour à la civilisation dans cinquante-huit jours. Voyons un peu la prison…
Mon corps se tourne lentement et je garde les cils baissés sur le sol le plus longtemps possible avant de regarder, comme si retarder l’échéance pouvait adoucir le verdict. Quand enfin je me décide, pourtant, ce que je découvre n’est pas si terrible. Pas du tout, même !
La bâtisse n’a rien de l’assemblage de briques insipide que j’avais imaginé. C’est une grande longère en pierres avec des volets bleu azur, dont la façade principale est traversée par une vigne vierge qui zigzague ici et là. Un jardin spacieux l’entoure, où se mêlent des effluves de lavande, un peu discrets, et de jasmin, plus prononcés. Deux buissons de roses orangées s’épanouissent de part et d’autre de la grille et un troisième, rouge celui-là, énorme, trône à côté d’une balancelle quelque peu rongée par l’air marin. Ma mauvaise humeur s’évanouit, chassée par une brise légère qui joue avec les mèches échappées de mon chignon. Des bruissements semblables à des murmures se propagent de loin en loin parmi les feuilles des arbres. Dans un rayon de soleil qui filtre entre les branches d’un noisetier, deux papillons colorés virevoltent. Ils s’attardent un moment dans la lumière dorée, tournoient, se pourchassent. Cette vision achève de me séduire.
Je pivote vers Louise, prête à lui reprocher de m’avoir laissée envisager le pire, et me coupe dans mon élan. Debout entre la portière et l’habitacle, un pied encore à l’intérieur, elle fixe la maison de son enfance du regard. Je guette une trace d’émotion sur son visage, mais celui-ci demeure parfaitement neutre. Rien ne transparaît, rien ne trahit la moindre de ses pensées. Ses mouvements sont aussi maîtrisés que d’habitude lorsqu’elle s’anime à nouveau. Ses jambes l’entraînent avec assurance vers la porte tandis que ses mains fouillent dans son sac. Elle ne tremble pas en glissant la clef dans la serrure, n’hésite pas sur le seuil avant d’entrer. Elle disparaît à l’intérieur le temps d’atteindre les fenêtres, refait surface en écartant les volets, s’éclipse encore, et son visage n’affiche toujours rien. Que peut-elle bien penser ? Qu’est-ce que ça lui fait de revenir ? De retrouver cette propriété, ce village, ce pan de sa vie qu’elle a fui si jeune ?
Je m’attarde un peu dans le jardin, fais le tour de la clôture, m’arrêtant ici pour humer le parfum d’une fleur, là pour en admirer les couleurs. L’exil me semble bien plus supportable à présent.
Une fraîcheur agréable m’accueille à l’intérieur de la maison. Le soleil pénètre par les fenêtres tout juste ouvertes en dessinant sur le sol de grands rectangles blancs qui tranchent avec l’obscurité ambiante. Madame ne s’accorde aucun répit et multiplie les allers-retours pour décharger la voiture, accompagnée par le cliquetis régulier de ses talons sur le carrelage.
J’attends que mes yeux s’acclimatent avant d’aller à la rencontre de ces lieux qui m’intimident. Peu à peu, les silhouettes se précisent, deviennent meubles, luminaires, babioles. Les murs de pierre brute se dévoilent, les dalles sous mes pieds se parent de motifs discrets. Je découvre une grande pièce à vivre comportant un imposant buffet, deux fauteuils, une bibliothèque, une table basse. Une cuisine carrelée de beige et arborant des coupes de fruits, avec des placards en bois sombre et des chaises à l’assise en osier tressé. Une salle d’eau peinte en vieux rose – une nuance que Louise s’empressera de faire disparaître, à n’en pas douter – et quatre chambres. La plus grande comprend un large lit à baldaquin, un fauteuil à bascule, une coiffeuse et une immense armoire. D’épais rideaux en velours encadrent les fenêtres et de nombreuses aquarelles ornent les murs. Je ressens une pointe de tristesse en déambulant dans ces pièces qui me dévoilent un peu de la vie de ces aïeux inconnus.
Le cliquetis des talons ralentit. Je perçois le bruit de valises posées à terre, de la porte d’entrée qui se referme. De retour dans le salon, je m’approche d’une commode où trônent plusieurs photographies. L’une d’elles attire tout de suite mon attention.
Mes parents ne tiennent pas d’album de famille et jugent le concept de portrait désuet. Pourtant, même sans avoir jamais vu mes grands-parents maternels, un regard me suffit pour établir la filiation : la femme courte sur pattes, aux yeux marron et cheveux raides, qui sourit sur ce cliché est une version plus âgée de ma mère, à ceci près que Louise ne tolérerait pas son embonpoint sur elle-même. À ses côtés se tient un homme ventripotent qui rit à gorge déployée, une main posée sur son épaule. Il la dépasse d’une tête au moins. Je les trouve beaux et me promets aussitôt de sauver cette photo si Sa Majesté décide, comme je le soupçonne, de tout jeter.
Là-dessus, elle me colle une parure de lit et un oreiller entre les bras.
Quel monstre !
Je prends soin d’opter pour la chambre la plus éloignée des autres, dans l’idée tout à fait illusoire de m’isoler autant que possible de ma mère et, dès la semaine prochaine, de mon père. Elle ne comporte qu’un lit deux places en bois massif, une armoire et une bibliothèque peu remplie. Je trouve le papier peint fleuri qui orne les murs assez repoussants mais, pour le reste, elle ne me déplaît pas. Je dispose même de ma propre salle de bain ! Sa fenêtre s’ouvre sur la partie arrière du jardin. Un petit portail bleu marine se dévoile dans le fond.
Je fais mon lit, range mes vêtements, constate avec effroi que la couverture réseau est quasiment inexistante et décide d’abandonner mon téléphone dans un coin. Je devrais réussir à m’occuper avec les livres éparpillés dans la bibliothèque.
Avec un grognement, j’obéis. Déjà à l’œuvre dans la grande chambre, ma génitrice renverse le contenu des tiroirs dans un sac poubelle. Elle me désigne aussitôt l’armoire ; un geste silencieux et non équivoque qui traduit une invitation à la rejoindre dans son expédition punitive.
N’obtenant pas de réponse, je la regarde jeter tout ce qui lui passe sous la main. Je me demande si le couple de la photo avait prévu ça au moment d’établir son testament.
Devant ma mine déconfite, elle ajoute :
Je capitule sur ce point.
L’espoir fait vivre, il paraît.
J’envisage de chercher un arbre auquel me pendre dès que j’aurai une minute.
2.
Nous consacrons la semaine qui suit au ménage et à ce que ma mère appelle le « tri ». En réalité, comme tout termine à la déchetterie, je parlerais plutôt de purge. Question de point de vue, sans doute. Nous démontons tous les meubles que nous pouvons, retirons tous les bibelots et objets personnels, décrochons les rideaux et arrachons les papiers peints. Sans la moindre hésitation ni le moindre état d’âme. Je parviens tout de même à sauver quelques photos, des livres et l’alliance de mon aïeule après m’être assurée, pour la forme, que Madame n’en voulait pas. Tout ce petit monde atterrit dans ma chambre, où je l’examine à la nuit tombée en songeant à l’absence totale d’émotions dont Louise continue de faire preuve et qui me laisse toujours aussi perplexe. Non pas qu’elle soit très expansive d’ordinaire, mais ici, c’est encore pire.
Les journées s’enchaînent, longues et intenses ; notre marathon semble sans fin. Madame suit à la lettre les consignes que le Chef lui transmet depuis Paris et met les bouchées doubles pour remplir les objectifs, paniquée à l’idée d’échouer. Nous ne prenons que peu de vraies pauses et, pour couronner le tout, exécutons les opérations dans un silence quasi religieux. Je meurs à la fois de fatigue et d’ennui.
Lorsque Monsieur arrive, le samedi, la maison est sans âme. Impersonnelle, triste. Il ne lui reste que sa façade ; une belle enveloppe pleine de vide. Heureusement, le jardin féerique demeure intact, lui.
Les cernes qui s’étalent sous mes yeux affolent le Chef. Il me relève de mes fonctions et déclare qu’il s’occupera du reste avec Madame, ce que je ne me fais pas répéter. Après le déjeuner, j’enfile mon maillot de bain et fonce à la plage, pour la première fois depuis notre arrivée. L’après-midi s’étire, puis passe. Je reste seule avec un Zola rescapé du massacre. Ainsi que l’avait promis Louise. Étendue sur le sable, j’écoute les vagues lessiver le rivage en pensant à Fabian et Alyssa. À mon portable qui demeure silencieux depuis leur départ. La couverture réseau s’arrange un peu dans cette zone, cependant je m’abstiens d’ouvrir Facebook : ma solitude est supportable en l’état, mais je crains que la jalousie et la frustration me fassent péter les plombs si je tombe sur les photos de mes amis. Je m’interdis de lire les messages que Fab m’envoie sur WhatsApp pour la même raison.
Au retour, je trouve mes parents dans la cuisine, penchés sur des plans compliqués. Visages sérieux, fronts plissés : l’architecte et la décoratrice d’intérieur sont en pleine réunion. La curiosité me pousse à les rejoindre.
Je quitte la table en étouffant un grognement. Manquait plus qu’eux ! Le premier, toujours sérieux, ne sourit que quand il se coince les doigts dans une porte ; le second n’a qu’une dizaine d’années de plus que moi et se croit obligé de commenter mes moindres faits et gestes – tous inappropriés, cela va sans dire – ; quant au troisième, c’est le spécialiste des blagues graveleuses. Un régal.
Je ne relève pas, trop occupée à me demander si j’arriverais à me noyer sous la douche, puis à constater que c’est déjà ma deuxième pensée suicidaire en l’espace d’une semaine.
***
Cela fait trois jours que je hante cette plage sans y croiser âme qui vive. Sans cette ombre venue envahir ma page, j’aurais conclu à une hallucination auditive et poursuivi ma lecture. Mais une fille, réelle apparemment, se tient devant moi et m’adresse un grand sourire. Brune, le teint mat, de longs cheveux roulés en boule sur le sommet du crâne, la vingtaine. Un paréo bleu noué à la taille, un ballon sous le bras. Une fille, quoi.
J’accepte, en me demandant si je discute avec le vide ou si cette fille existe bel et bien. Elle attend que je range mon bazar puis m’entraîne vers un petit groupe installé plus loin. Quand sont-ils arrivés ? Impossible de le savoir. Mon bouquin m’occupe depuis des heures, et le volume dans mes écouteurs était trop élevé pour percevoir quoi que ce soit.
À quelques pas de nous, deux garçons – un blond à l’allure sympathique et un grand maigrichon aux boucles brunes et yeux rieurs – sont en train de discuter, près de…
Bon sang ! Qu’est-ce que c’est que ce cliché ?
Corps tonique, abondante chevelure blonde, bikini tendance, lunettes démesurées et pose de magazine ; une créature qui pourrait prétendre au titre de Miss Monde repose sur un long paréo vert, légèrement cambrée, appuyée sur ses coudes.
Les gars se trouvant debout, j’en déduis que je vais remplacer la reine de beauté.
Je réponds « oui », mais ne tarde pas à découvrir que non, je ne le suis pas : mon équipier s’avère encore plus nul que moi, et d’une telle maladresse qu’il manque me noyer par trois fois ! Par chance, il est aussi vif dans un sens que dans l’autre et me repêche aussi vite qu’il m’expédie par le fond. À défaut de pouvoir nous appuyer sur nos compétences, nous opposons donc une mauvaise foi féroce à nos adversaires. Nous perdons la première manche en prétendant que c’était juste un tour de chauffe. À la seconde, j’exige de changer de côté en invoquant les reflets gênants du soleil et me raccroche aux branches avec un argument miteux :
Magnanime, Mélanie finit par nous accorder un point bonus, ce qui ne nous empêche pas de paumer aussi la manche suivante. Lorsque nous regagnons le sable, quelques dizaines de minutes plus tard, les garçons se chamaillent à propos du gage du perdant. J’entends Baptiste refuser de faire la vaisselle toute la semaine pendant que je rassemble mes affaires pour les rapprocher des leurs.
Dès mon retour, il se détourne de Loïs et crée une diversion en m’assaillant de questions. Trop vite à mon goût, nous frôlons le sujet que je redoute le plus, à savoir mon âge. J’y vois la confirmation irréfutable que mes nouveaux compagnons ne sont pas le simple fruit de mon imagination – nous n’aborderions pas ce point s’ils n’existaient que dans ma tête. Mes réponses détournées et l’intérêt que je leur porte à mon tour n’y font rien et la question de mon compteur biologique tombe, apparemment inéluctable.
Je ne peux me résoudre à avouer que j’aurai quatorze ans dans deux mois. Mon âge réduirait mon capital sympathie à coup sûr et je sais que l’occasion de rencontrer des jeunes ne se représentera pas de sitôt, alors je leur sers l’estimation que j’entends le plus souvent, c’est-à-dire seize ans. Baptiste déclare qu’il me croyait plus âgée d’au moins deux ans. Loïs et Mélanie trouvent qu’il exagère et me donnaient juste un an de plus. Johanne, qui jusqu’ici ne s’est intéressée à rien ni personne et ne semble pas occuper d’autre fonction que faire joli, affiche quant à elle un rictus éloquent.
Disant cela, elle récupère le paréo sur lequel elle reposait, salue l’assemblée d’un geste vague puis s’éloigne, un air d’ennui mal dissimulé sur le visage. Une sortie brusque et théâtrale qui me prend au dépourvu et me laisse plutôt mal à l’aise. Mel m’adresse un sourire rassurant.
L’accusée s’esclaffe, renverse la tête en arrière.
J’assiste à cet échange comme je regarderais un match de tennis : ma tête pivote au gré des répliques et je me sens divisée presque à parts égales entre perplexité et fascination.
Ses doigts parcourent déjà l’écran de son téléphone pour envoyer un SMS. La réponse ne se fait pas attendre.
***
Quelques heures plus tard, les gars rentrent de leur côté tandis que Mélanie me raccompagne. Nous avons déjà bien sympathisé à la plage et je me sens à l’aise en sa compagnie. Les traits de son visage oblong reflètent une infinie bienveillance et ses yeux sombres sourient en permanence, presque plus, même, que ses lèvres pleines. Le Chef tombe immédiatement sous son charme et se réjouit à la fois de cette rencontre et de l’invitation qui en découle. Louise se montre polie, sans plus.
Après son départ, je descends à l’épicerie acheter quelques bricoles pour la soirée et remonte prendre une douche. La perspective de passer le reste de mes vacances bien entourée me donne des ailes, je me sens bondir à chaque pas.
À son retour, ma nouvelle copine me trouve sur la balancelle, le nez en l’air et les yeux dans les nuages. Le Zola, ouvert à la même page qu’en début d’après-midi, gît plus loin dans l’herbe. L’impatience me tiraillait l’estomac et me poussait à vérifier l’heure toutes les trente secondes, impossible de m’y retrouver dans les descriptions à rallonge de l’auteur.
C’est la deuxième fois que l’un d’eux parle d’atelier. Même si le nom ne me dit rien qui vaille et m’évoque un endroit sombre et crasseux, je garde mes réflexions pour moi.
Nous empruntons la route qui part à gauche et la parcourons pendant une dizaine de minutes, jusqu’au prochain virage. Apparaît alors un terrain tout en longueur en bordure de falaise, clôturé par une haie et un long portail blanc. À quelques mètres, complètement excentrée, se tient une minuscule maison qui semble recroquevillée sur elle-même, comme impressionnée par tant d’espace.
Mélanie me guide vers le jardin. Trois tentes ont été dressées dans le fond et une table en bois munie de bancs, semblable à celles des aires de pique-nique, trône au milieu de la pelouse. Le reste du groupe de la plage m’accueille comme si j’étais une vieille connaissance : Baptiste, enfoncé dans une chilienne, se détourne de la vidéo qu’il visionne sur une tablette pour me gratifier d’un « Salut, Princesse » et Loïs, penché sur le barbecue un peu plus loin, m’adresse un large sourire accompagné d’un signe de la main. Miss Monde n’est pas là. Je me surprends à souhaiter qu’elle brillera par son absence, quand la créature sort de la maison. Ses grands yeux bleu lagon fixés sur Loïs, elle me passe devant en faisant mine de ne pas me voir. Je ne peux m’empêcher de la suivre du regard. Ni de loucher sur son fessier rebondi et ultra-ferme, qui la propulse illico au rang de Miss Univers.
Il y a des filles comme ça, me dis-je, contre lesquelles le commun des mortelles ne peut rien.
Baptiste me tire de mes réflexions en m’invitant à m’installer sur une chilienne près de la sienne, ce que je fais pendant que Mel apporte mes provisions au préposé aux grillades avant de disparaître à l’intérieur à son tour.
La vidéo de mon voisin ne retient pas mon attention. Mon regard volète du côté de Johanne et Loïs, une première fois, une deuxième… Jusqu’à ne plus les quitter. Il y a dans le comportement de cette fille une assurance et une conscience de ses charmes qui me fascinent et me rebutent. Un je-ne-sais-quoi d’animal dans sa façon d’incliner la tête quand elle parle à Loïs et de copier ses déplacements, d’onduler avec lui vers la gauche… la droite… Un peu comme un serpent face à un joueur de pungi, sauf qu’elle ne me donne pas véritablement l’impression de s’intéresser à lui. D’ailleurs, son corps et ses yeux envoient des signaux contradictoires, car l’un laisse penser qu’elle cherche à le séduire tandis que les autres se détournent de leur cible à intervalles réguliers. À moins… que la cible se trouve ailleurs ? Au bout de quelques minutes, je réalise en effet qu’elle regarde toujours au même endroit. Vers la maison.
Piquée par la curiosité, je tourne la tête dans cette direction et découvre un garçon élancé, aux traits asiatiques, qui discute avec Mel. À l’instant où je pose les yeux sur lui, mes muscles se contractent, comme enserrés tous ensemble par une main invisible. Le phénomène ne dure qu’une fraction de seconde, mais laisse sur ma peau une empreinte sensorielle aussi étrange qu’inédite.
Passé l’effet de surprise, je suis frappée par son tee-shirt. Pas parce que le tissu gris sublime l’arrondit de ses épaules, non. Pour le motif, qui figure une grande empreinte digitale rouge en train de s’effilocher. Ce n’est rien, pourtant l’originalité de son choix revêt une importance démesurée. Je le trouve parfait, ce choix, il me plaît, tout comme le jean brut et les Converse qui l’accompagnent. Mais il n’y a pas que ça. Il est vraiment beau – le mec, pas le tee-shirt. Sous ses cheveux noirs coupés en carré court un peu plongeant, son visage ovale présente des traits délicats, presque androgynes, et un grain de peau lisse et régulier.
Réagissant à une remarque de Mélanie que je n’entends pas, il se met à balayer le jardin du regard. La main invisible resserre son étreinte quand il s’arrête sur moi. Le jeune homme hoche la tête, m’adresse un sourire. Discret, mais terriblement efficace ! Mon cœur rate un battement dans ma poitrine. Sans prévenir, je me porte au-devant de mon hôte, poussée par une excuse toute trouvée qui se pare du nom de bienséance, mais cache des motivations beaucoup moins nobles : je dois le voir de près, interagir avec lui. Le fait que je m’arrête à une distance raisonnable pour la préservation de son espace vital tient davantage du réflexe que de la volonté.
Ma voix me présente et échange des politesses avec la sienne, en toute autonomie, semble-t-il, tandis que mes oreilles se concentrent sur la chaleur de son timbre, que mes yeux s’attardent sur ses pupilles sombres, bordées de longs cils, son nez fin et droit, ses lèvres pleines et bien dessinées qui forment un cœur, et sur…
Bloup ! La bulle dans laquelle je flottais sans m’en apercevoir éclate quand Loïs l’interpelle depuis le fond du jardin. Tamao s’excuse, pose une main légère sur mon épaule, s’éloigne. Je m’empresse de regagner ma place initiale, effarée – C’était quoi, ce moment d’absence ? –, en feignant de ne pas remarquer le regard et le sourire amusés que Mélanie m’adresse. Baptiste, qui entre-temps a laissé sa tablette de côté, recommence à me questionner sur l’endroit d’où je viens, ce que je fais, le genre de musique que j’écoute, la façon dont j’aime m’occuper. Mon égarement persiste et je ne parviens qu’à livrer des réponses hésitantes. Mel me sauve la mise en lui demandant s’il est de la police.
***
Les heures qui suivent se déroulent sans accroc. Mes affinités avec Mélanie et Baptiste se confirment et je tiens quelques conversations intéressantes avec Loïs, même si la magie opère un peu moins. Bien que Tamao se montre agréable et prévenant, je garde mes distances : le premier contact a tellement échappé à mon contrôle que je n’ose pas réitérer l’expérience. Il semble plutôt discret et parle peu, sans que j’arrive à déterminer si cela découle d’un état naturel chez lui ou du fait que Baptiste occupe volontiers le devant de la scène.
Comme ce dernier l’a dit à la plage, les trois garçons s’entendent bien avec Johanne. Si j’en crois mes yeux et mes oreilles, elle est drôle et tout à fait abordable, en fait. Avec eux. J’ignore si c’est à cause de mon âge – auquel cas il me faudrait espérer qu’elle ne découvrira jamais la vérité –, de mon empressement à aller saluer Tamao tout à l’heure, ou juste parce que ma tronche ne lui revient pas. Toujours est-il que si elle ne m’adresse pas la parole, elle met aussi un point d’honneur à ne pas se dérider avec moi. Chaque fois que j’ouvre la bouche, elle prend un air ennuyé et me regarde de travers. Ou encore, lorsque je décline la proposition de Baptiste de prendre notre revanche au volley demain, en lui rappelant qu’il a failli avoir ma mort sur la conscience aujourd’hui, je la vois soupirer en levant les yeux au ciel et commenter dans sa barbe.
À l’autre bout de la table, Tamao s’incline et lui murmure quelques mots à l’oreille. Johanne hoche la tête d’un air docile avant de me lancer un nouveau coup d’œil, presque neutre cette fois. D’après la moue qu’elle m’adresse, Mel aussi le remarque. Dans la foulée, Tamao regagne la maison et Miss Univers en profite pour reporter toute son attention sur Loïs, qu’elle avait pratiquement délaissé jusqu’ici. Lui ne semble pas s’offusquer de son attitude en dents de scie et l’accueille même à bras ouverts. Au sens propre !
Peu à peu, les convives se dispersent. Baptiste retourne s’affaler dans la chilienne qu’il occupait à mon arrivée, bientôt suivi de Mel. Les deux autres font des messes basses et finissent par se lever pour s’éclipser en direction du portail. Juste avant qu’ils disparaissent derrière le mur, je me souviens des paroles de Loïs, pour qui la conclusion de leur affaire était « juste une question de temps ».
L’attente n’aura pas été bien longue, me dis-je.
Dans mon dos, Baptiste éclate de rire et formule la même réflexion à voix haute. Il me propose aussi de le rejoindre, et je m’apprête à le faire lorsque la voix de Tamao s’échappe de la maison pour me chatouiller l’oreille, demandant si l’un d’entre nous veut boire un café ou un thé. Je prends donc les commandes et me charge de les lui transmettre, en rapatriant quelques assiettes au passage. Je n’avais pas encore mis les pieds à l’intérieur.
La quasi-totalité des lieux se dévoile au premier coup d’œil. Ça ne paraît pas si étriqué, en fin de compte. Il manque plusieurs murs, de sorte qu’il ne reste qu’une « grande » pièce, en plus de la salle de bain et des toilettes. Face à moi, un lit double trône entre deux cloisons, sans doute les vestiges d’une petite chambre. Un coin bureau a été aménagé à sa gauche. Viennent ensuite un canapé, une table basse et un fouillis qui n’est pas sans me rappeler le mien, à Paris. Rien à voir avec l’endroit glauque que j’imaginais, en tout cas. Au contraire, l’ensemble présente un aspect douillet qui me séduit d’emblée. De l’autre côté, Tamao sort des tasses d’un placard et les dépose sur un bar, près de l’entrée principale.
Le sourire qui accompagne ces derniers mots fait naître d’adorables fossettes sur ses joues et marque le retour de la grande main invisible. Je lui emboîte le pas en tâchant de rester naturelle malgré mes muscles devenus raides comme le bois.
L’annonce lui arrache un sourire blasé. Pourtant, c’est d’une voix neutre qu’il récapitule :
Je confirme d’un hochement de tête.
J’embrasse la pièce du regard. Elle paraît déjà moins anonyme et je repère, entre autres choses, un appareil numérique, quelques toiles encore vierges et un carnet de croquis.
J’arrête mon choix sur de la menthe. Pendant ce temps, il entreprend de remplir d’eau bouillante un mug déposé devant moi. Je profite de son inattention pour observer la ligne de son nez droit, ses longs cils. Sa peau. Je m’imagine l’effleurer du bout des doigts pour en découvrir la texture, le long de son avant-bras, autour de ses poignets fins. Sa tâche terminée, il redresse la tête. Trop vite pour mon cerveau ralenti : ses yeux me surprennent en pleine contemplation. Je pique un fard mémorable. Tamao a la délicatesse de ne pas trop sourire.
Je m’attends un peu à me faire envoyer sur les roses : ce ne sont pas mes oignons. Toutefois son sourire, loin de disparaître, s’élargit. Il se sert une tasse, s’installe sur le tabouret voisin du mien.
Je hausse les épaules, tempère :
« Il doit tout de même pivoter pas mal sur son axe ! » suis-je sur le point de rétorquer, quand Baptiste me coupe dans mon élan :
Bloup ! De nouveau, la bulle dans laquelle je dérivais sans le savoir éclate. Je prends note de surveiller ce phénomène de près à l’avenir. Tamao et moi échangeons un sourire et nous répartissons les tasses.
3.
Ma montre affiche presque minuit quand je décide de rentrer. J’aimerais rester plus longtemps, mais il s’agirait de ne pas abuser dès le premier soir pour ne pas risquer de me trouver privée de sortie tout l’été. Mel me raccompagne d’office. Nous parcourons les premiers mètres en silence, le nez levé vers les étoiles. Je ne me lasse pas de ce spectacle.
Je m’esclaffe.
Je n’en demande pas plus, et le reste du trajet se passe de commentaires.
J’attends de la perdre de vue puis me dirige vers la partie avant du jardin, la balancelle dans ma ligne de mire : la température, le parfum des fleurs, le chant des grillons, tout m’invite à rester dehors encore un peu. Je me berce un moment et dresse le bilan de ma journée – plutôt pas mal compte tenu de la manière dont elle avait commencé –, en soupirant d’aise et en tirant des plans sur la comète pour les semaines à venir. Quand un long bâillement menace de me décrocher la mâchoire, je me décide à gagner mon lit.
Tout à ma joie d’avoir passé une si bonne soirée, je ne m’alarme pas en constatant qu’il manque une voiture dans l’allée, pas plus que je ne m’étonne du silence qui me tombe dessus au moment où j’ouvre la porte, alors que la lumière brille dans plusieurs pièces. Là d’où je viens, ces deux détails me mettraient la puce à l’oreille. Mais ici, ce soir, mon esprit divague et les morceaux du puzzle ne s’assemblent que lorsque je décide de faire un crochet par la cuisine et découvre Louise. Elle se tient là, blanche comme un linge, et fait volte-face sitôt qu’elle m’aperçoit.
Il a recommencé…
Elle peut bien s’obstiner à me tourner le dos, j’ai vu. Les bris de porcelaine dans sa main, la pellicule de sueur froide sur son front. La peur résiduelle dans ses yeux et les plaques rouges sur son bras. J’ai entendu le hoquet désespéré ravalé à la hâte, les reniflements contenus. Je les entends encore…
Mes mâchoires se crispent au son de ce filet de voix qui peine à se frayer un chemin jusqu’à l’air libre. La mienne n’en paraît que plus forte.
Réagis, prié-je en moi-même. Rentre-moi dedans, défends-toi ! Ne me laisse pas t’agresser aussi…
Sa tête s’affaisse entre ses épaules, elle pousse un soupir las. Dieu, qu’elle semble petite, dans ces moments-là !
Putain, Louise !
Je serre les poings, ferme les yeux et compte jusqu’à dix, focalisée sur la brûlure que provoquent mes ongles en imprimant des sillons sur mes paumes. Mes paupières se rouvrent sur le même tableau. Le même petit corps abattu résolument tourné vers le mur pour échapper à mon regard.
Inutile d’attendre une réponse. Madame va rester là et faire semblant que ce n’est rien jusqu’à ce que Monsieur revienne, avec des fleurs et les excuses habituelles. Quelques larmes, pour la forme. Des promesses qu’il ne tiendra pas. Et elle lui tendra les bras, elle encaissera et mettra ses fleurs dans un joli vase. Elle boira ses paroles et continuera de se raconter des conneries qu’elle s’obligera à croire, parce que, hé ! la vie de couple, ce n’est facile pour personne !
Je claque la porte de ma chambre avec un coup de pied rageur. Mains sur la tête, doigts crispés dans les cheveux, j’arpente la pièce de long en large.
Son problème. Son choix. Sa faiblesse à elle !
Je supporte de plus en plus mal ces épisodes violents. Le fait que celui-ci ait été moins chaotique que d’autres et qu’il se soit produit plus loin dans le temps ne change rien.
« Il fait des efforts ».
Traiter sa femme avec respect ne devrait pas demander d’effort ! Et se faire battre par son mari ne devrait jamais être une option acceptable ! Son attitude me met hors de moi. Je lui en veux de supporter ça et de me l’infliger par la même occasion.
« Il fait des efforts ».
En effet : depuis le début de sa thérapie, il n’a pas raté la moindre séance. Il se contrôle mieux, il parvient à tout laisser tomber et à s’éloigner lorsque la colère commence à pointer le bout de son nez. Et si elle déborde, le plus souvent il arrive à ne s’en prendre qu’à des objets. Pas toujours, néanmoins, la preuve. À quand la dernière fois remonte-t-elle, exactement ? Que signifie « longtemps » pour une femme battue ? Je ne l’ai pas vue grimacer sans raison apparente depuis des semaines, maintenant que j’y pense. Petite, quand je lui demandais pourquoi ses bras, ses reins, son dos la faisaient souffrir si souvent, elle me répondait que son matelas lui donnait des courbatures. Une excuse qui me semblait étrange puisqu’elle dépensait de l’argent sans arrêt. Je ne comprenais pas pourquoi elle n’en achetait pas un autre. Et puis, il y a eu la crise du miroir et…
Stop ! Interdit de penser à ça !
Trop tard. Le souvenir que j’ai pris soin d’enfermer au plus profond de moi s’extirpe de sa cage et entame son ascension vers la surface en plantant des griffes acérées dans mon ventre, mes poumons, ma gorge. Mon pouls s’affole.
Ne pas pleurer, ne pas pleurer…
Les images affluent de toutes parts et envahissent mon champ de vision. Malgré moi, je revis la scène. La première fois qu’il l’a fait sous mes yeux. Je le revois arracher le grand miroir dans l’entrée et le jeter sur le sol en vociférant dans une pluie de bris argentés. Se précipiter sur sa femme qui s’est réfugiée dans un coin au lieu de quitter la maison et lui asséner des coups autrement plus violents que les fessées qu’il m’arrivait de prendre. Je la vois, elle, remonter les genoux sur sa poitrine et se cacher la tête dans les bras en demandant pardon sans savoir pourquoi. Je me regarde, petite, minuscule même, roulée en boule sous la table, pleurant si fort que je n’y vois plus rien, couinant comme une souris, appelant ma maman qui ne répond pas, paralysée par la peur malgré l’envie de faire pleuvoir mes petites mains sur ce monsieur qui n’est plus mon papa.
La pièce tangue et la tête me tourne. Je m’écroule sur le lit en tremblant.
C’est fini. Respire, Elena… N’écoute pas.
Le bruit sourd de la chair martelant la chair et les hurlements du tyran et de sa martyre résonnent dans mon crâne, leurs échos ballottés en tous sens, comme si je venais de les entendre.
Ce truc va me rendre dingue, il faut arrêter ça !
Je saisis mon iPod qui traîne sur la table de chevet, parcours son contenu à la recherche du « morceau magique ». J’enfonce les écouteurs dans mes oreilles en poussant le volume à fond pour couvrir l’horreur, ferme les yeux. Je m’oblige à me concentrer sur la musique et à respirer calmement. J’imagine mon corps sombrer dans le matelas, en partant des pieds. Je traverse les tissus, le sommier. Parvenue de l’autre côté, je flotte dans l’infini, un lieu paisible où rien ne peut m’atteindre. La colère reflue peu à peu et retourne se lover dans un coin de ma poitrine.
Au fil des années, j’ai additionné un et un et fini par comprendre que le Chef frappait d’abord là où personne ne pourrait le voir. Et pourquoi ma mère devenait si pénible avec moi les jours de « courbatures ». Je ne faisais jamais rien de bien, dans ces moments-là. Je ne me tenais pas assez droite, je n’étais pas assez gentille, pas assez jolie, pas assez brillante à l’école. Jamais au bon endroit, trop dans ses pattes, toujours trop près, ou l’inverse.
Les choses seraient-elles différentes entre nous aujourd’hui si elle n’avait pas cherché à se défouler sur moi à l’époque ? Si elle ne m’avait pas rejetée quand j’essayais de lui ouvrir mes bras alors que je n’y comprenais rien ?
Emportée par la musique qui tourne en boucle, je dérive dans mon vide artificiel pendant de longues minutes, qui se transforment en heures. Le téléphone affiche cinq heures du matin quand je me relève enfin.
Il faut arrêter de te mettre dans des états pareils, me dis-je en enfilant mes vêtements de nuit.
Des souvenirs plus ou moins bien enfouis continuent de défiler à l’arrière-plan de mes pensées, comme un mauvais air que je ne parviens pas à oublier. J’essaye de me distraire avec de la lecture, sans succès : les phrases se suivent sans s’imprimer dans ma tête et les mots perdent leur sens à mesure qu’ils se succèdent. Le sommeil ne me guette pas même un peu.
Une heure plus tard, je quitte ma chambre pour me réfugier sur la balancelle. La voiture du Chef est revenue. Je me berce et respire à pleins poumons les effluves de roses, tout proches, et de lavande, plus lointains. Je m’abreuve de pensées positives pour oublier les autres, me rappelle que dans quelques heures je sortirai d’ici pour retrouver Mel et Baptiste. Tamao et son visage ovale. Son sourire à fossettes…
Je ne peux m’empêcher de lui sourire en retour.
***
Le Chef quitte de nouveau la maison aux alentours de huit heures. Il passe près de mon perchoir sans remarquer ma présence, reprend sa voiture, disparaît. Je ne le vois que de dos et ne peux me prononcer sur son humeur, mais comme aucun bruit n’a perturbé le silence de la longère pendant la nuit, on peut supposer qu’il s’est calmé.
Ma mère et moi sommes attablées devant le petit-déjeuner à son retour, l’une prenant soin de ne pas regarder l’autre en se cachant derrière son bol de café, l’autre mâchonnant un biscuit sans en tirer le moindre plaisir. La bile me monte à la gorge lorsqu’il dépose un bouquet sur les genoux de Madame. Des roses. Rouges. Un simulacre de geste d’amour pour un simulacre de repentir.
Il mériterait qu’elle lui fourre son cliché dans le gosier pour l’étouffer. Qu’elle le torture avec les épines, qu’elle le griffe jusqu’à l’os. Pourtant, ils s’embrassent comme de jeunes mariés ; elle s’extasie sur la beauté des fleurs et lui n’a plus d’yeux que pour elle.
Profite, Louise : tu seras la reine aujourd’hui.