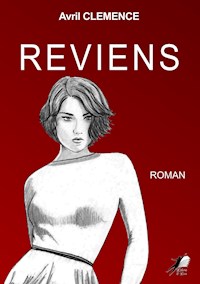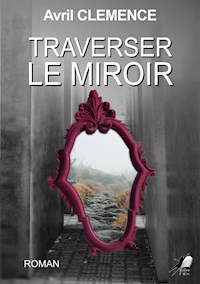
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libre2Lire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reviens
- Sprache: Französisch
Tamao et Elena se sont rencontrés puis perdus de vue voilà plusieurs années. À l’époque, écart d’âge, violences familiales, non-dits et maladresses avaient tué dans l’œuf cette relation qu’ils désiraient tous deux mais qui ne devait pas être. La vie leur offre une seconde chance : font-ils le bon choix ou poursuivaient-ils une chimère ?
Mélanie vient de se marier. Son union avec un homme a surpris tout le monde, elle que ses amis trouvent plus heureuse avec les femmes. Tout juste rentré de voyage de noces, le couple annonce une grande nouvelle à ses proches : Mel est enceinte ! Mais cette grossesse pourtant désirée ne semble pas combler la future maman.
Chacun à sa manière, ces trois narrateurs vont devoir se remettre en question et se regarder en face… à travers le miroir.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Depuis l’enfance,
Avril Clémence aime la lecture, l’écriture et les langues étrangères ; trois passions qui l’ont conduite à exercer le métier de traductrice. Curieuse par nature, sa plume s’aventure souvent dans des intrigues réalistes, au cœur de la société actuelle, ses mœurs et les équivoques qu’elles suscitent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Avril CLEMENCE
Traverserle Miroir
Roman
Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire
www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
ISBN papier : 978-2-38157-046-4ISBN Numérique : 978-2-38157-047-1
Dépôt légal : Novembre 2020
© Libre2Lire, 2020
Mot de l’auteure
Traverser le Miroir est la suite autonome de Reviens, également paru aux éditions Libre 2 Lire. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu le premier roman pour apprécier et comprendre celui-ci et la lecture du second ne vous gâchera pas le plaisir de découvrir le précédent. Toutefois, les deux sont complémentaires : si vous entamez cette lecture en ayant déjà suivi le parcours de ces personnages, vous saurez enfin ce que l’avenir leur réservait et, si vous faites leur connaissance à travers ce livre, vous prendrez toute la mesure de leur évolution en lisant Reviens.
Les avis de lecteurs sont toujours utiles et bienvenus, quelles que soient leur teneur et leur longueur. Aussi, n’hésitez pas à me faire part de votre ressenti sur la page dédiée du site de l’éditeur ou de Babelio, site privilégié par les libraires.
Enfin, je souhaite remercier Véronique et Olivier pour leur confiance renouvelée en mes écrits malgré ce contexte si particulier, ainsi que toutes les personnes qui ont accepté de lire, bêta-lire, commenter et corriger mon manuscrit : à tous, merci pour votre aide et votre expérience. Merci aussi à mes hommes, qui font de ma propre traversée du miroir la plus grande et la plus belle aventure qui soit.
Et merci à vous, qui prenez le temps de me lire et contribuez au partage de mes histoires. J’espère vous en raconter encore bien d’autres.
PROLOGUE :Raconter l’histoire
30 mars
13 h 26
Je me prends la tête depuis l’achat de ce carnet. « Il faut une belle entrée en matière », j’arrête pas de penser à ça. Ce cahier-là, je le veux parfait. Peut-être parce que ce sera le premier (le seul) que je tiendrai pour quelqu’un d’autre. Le premier voué à contenir plus de mots que d’images ; un carnet de voyage, un journal, une lettre… Une grosse responsabilité pour des épaules de papier.
Ça fait bien une semaine que je cherche la « bonne » amorce. L’avion vient de décoller, et moi de réaliser que je dois juste me lancer. Je retiens des événements de cette année qu’il ne faut pas attendre, pas pour ce genre de choses : demain, dans une heure, dans deux minutes, je ne pourrai peut-être plus rien remettre à plus tard. Alors tant pis pour le parfait incipit. De toute façon, ce qui compte, c’est de raconter l’histoire.
Elle commence de manière assez banale : un été dans un bled paumé, Frenne ; une rencontre avec une fille de la capitale. Elena. Un brin de femme comme on en croise peu, éveillée, intrépide, diablement belle. Avec une aura pareille à nulle autre et des nuances de vert incroyables au fond des yeux. Pour scènes principales de notre théâtre, deux maisons situées à dix minutes de marche l’une de l’autre : « l’atelier », minuscule bicoque qui me sert de point de chute quand je viens dans les parages, et « la longère », maison de vacances de sa mère.
Elle commence aussi avec un mensonge et un malaise : Elena prétend avoir seize ans, et moi du haut de mes vingt-et-un, je trouve l’écart gênant. Sur le papier, l’équation semble élémentaire : il suffit de ne pas se laisser tenter. Dans la pratique, ça se discute : cette nana qui fait plus que son âge m’oblige à réviser mes principes. « On s’en fout, des chiffres », elle me dit. Et moi, de toute façon mordu, je me convaincs qu’après tout, cinq ans d’écart… Ça passe.
C’est là que ça se corse. Elena vient d’un environnement familial compliqué, coincée entre une mère qui se réfugie derrière les faux-semblants et un père violent. Le Chef, elle l’appelle. Au début, il ne s’en prend qu’à sa femme, puis il découvre que sa fille vit des amours de grande et il lui tombe dessus. Ça la met au pied du mur : en se réfugiant chez moi, elle est bien obligée de m’expliquer pourquoi. Alors elle m’avoue qu’elle n’a pas seize ans, mais treize, et ça me secoue. Ça me fait peur. Ça me fait paniquer même, au point que je commets la première d’une longue série d’erreurs : je la rejette. Ça pourrait se terminer là, mais non. L’été touche à sa fin, Elena rentrera bientôt à Paris et je ne supporte pas l’idée qu’elle s’en aille sur le refus d’un chiffre qui ne lui correspond pas. Qu’elle s’en aille, tout court. Alors j’y retourne, en me promettant que ce sera la dernière fois. Je ne lui dis pas ce que je ressens pour elle, je ne lui propose pas de garder contact. Deuxième erreur.
Pendant les six mois qui suivent son départ, je vais voir ailleurs. J’essaye de la remplacer par des filles de mon âge, de classer l’épisode estival comme un accident de parcours. Ça ne marche pas, mais le temps fera son œuvre, il paraît.
De son côté, les choses vont mal. Son père devient ingérable et elle, pas taillée pour se soumettre, lui tient tête. Le conflit tourne à la guerre ouverte, il finit par lui retomber dessus. Bien plus lourdement que la première fois. Elle termine à l’hôpital, en ressort avec des côtes cassées, une cicatrice creusée dans la joue par un morceau de verre et un trauma profond dont sa mère, dépassée, ne réalise pas (ou minimise) l’ampleur.
Elena revient à Frenne pour les vacances. On se croise par hasard peu avant la fin de son séjour et à partir de là commence un grand festival de boulettes, pour ma part. Je tiens vraiment le rôle du con dans cette histoire.
La fille que je retrouve n’est même pas l’ombre de celle de mes souvenirs. Elle se planque, souffre, se mure dans le silence et moi, ça me tue de la voir dans cet état. Je voudrais l’aider, mais le temps presse (elle repart dans deux jours à peine, ma « copine » du moment m’attend), j’ignore tout des événements et je reste empêtré dans mon conflit intérieur entre l’interdit que présente une relation avec elle et mes sentiments que, de fait, je n’assume pas. Mais je lisais plutôt bien entre ses lignes avant, alors je me dis que je peux l’amener à s’ouvrir, me poser en confident, rien que ça. Tu vois venir la suite ?
On passe une soirée ensemble. Elle bloque tous les accès, pare toutes mes manœuvres et moi je sens le temps qui s’écoule et sa détresse me rend dingue, je me laisse déborder. Je finis par balancer le seul truc que je ne voulais pas lui dire. « Je t’aime ».
Sur le moment, je crois que ça m’échappe, mais avec le recul, peut-être pas tant que ça. Inconsciemment, je dois me douter que ça fera sauter le verrou. Et ça fait bien plus, en réalité. Ça provoque un cataclysme, elle se met à pleurer, et pleurer, et pleurer pendant des heures, plus rien ne peut l’arrêter. J’attends. La nuit passe et je ne sais toujours rien, sinon que je viens d’aggraver les choses et que j’ai pas les épaules assez solides pour ça. Alors je rétropédale, dès le lendemain matin. Je lui dis que je le pensais pas, que je la considère comme une amie, que c’était une erreur de sortir avec elle au départ. Je m’engouffre dans la plaie ouverte d’une gamine de quatorze ans déjà bien amochée et je la charcute sans pitié.
Elle part sans demander son reste. Je suis trop lâche pour la rattraper.
On perd contact pendant cinq ans. À ce moment-là, je crois qu’on ne se reverra jamais. Ça me hante, mais il faut arrêter les frais. Je fuis rejoindre mon frère à Melbourne, où lui-même s’est réfugié quelques années plus tôt après une rupture douloureuse avec ma meilleure amie. On privilégie l’exil de père en fils, dans la famille. Enfin ça, c’est une autre histoire, je la réserve pour plus tard.
Les deux premières années, je me concentre sur mon boulot. Je galère pour tout le reste, surtout avec les femmes, mais je réussis au moins ça, à m’installer comme photographe. Puis je rencontre Jessica, et ça va mieux. Elena, de son côté, commence par une belle descente en piqué. Sa ressemblance avec son père l’obsède et la parasite, elle redoute la colère et la violence qui l’habitent et se croit aussi malsaine que lui. La cicatrice qu’elle porte depuis leur dernière confrontation lui pourrit la vie. Ils ne se sont plus revus depuis cet épisode, mais dans sa tête, il ne la quitte jamais. Elle cherche à se punir de son capital génétique par tous les moyens, fréquente le mauvais gars. Heureusement, elle trouve Timéo sur sa route, il la remet sur les rails.
C’est à ce moment que le destin s’en mêle. Si je voulais verser dans les jeux de mots faciles, je dirais même qu’il s’en Mel : pour son mariage, ma meilleure amie décide de nous inviter tous les deux. Le semblant d’équilibre que je cultivais s’écroule, il me suffit d’un regard vers Elena pour comprendre que je n’enterrerai jamais cette histoire. Je sens qu’elle non plus n’a pas tourné la page.
C’est un gros pari, mais je le prends quand même : je ne peux pas laisser passer ma chance une fois de plus. Alors, profitant d’un séjour éclair à Paris avant de rentrer à Melbourne, j’y vais au culot et je l’invite à dîner. Je mets toutes les cartes sur la table, mea culpa pour toutes mes conneries, je promets de ne plus me défiler. Je reviendrai en France si elle le souhaite, j’irai au bout des choses avec elle, je ne permettrai plus aucun doute. Ça marchera ou pas, mais au moins, on saura.
On se quitte là-dessus. Je repars à l’hôtel récupérer mes affaires, prends le chemin de l’aéroport, pas certain qu’Elena saisisse la perche. J’ai commis trop d’erreurs peut-être, attendu trop longtemps, loupé le coche cinq, voire six ans avant.
Juste avant d’embarquer, mon téléphone se met à sonner. Je ne sais pas du tout à quoi m’attendre au moment de décrocher.
1. Reviens
(31 juillet, trois ans plus tôt)
Elle fixe la foule d’un air absent. L’horloge. Les écrans. Ses yeux brillent, elle évite les miens pendant que je fais le plein d’elle en prévision de son absence, imminente.
Je la capture par fragments, en plans serrés, comme les morceaux d’un puzzle à assembler plus tard, au creux des heures longues : sa nuque, caressée par de fines mèches de cheveux bruns. Ses iris, vert impérial aux éclats de topaze ; la forme en amande de leur écrin. Le grain de beauté discret posé, là, sur son menton boudeur. Et l’ourlet de ses lèvres, qui brusquement se pincent avant de libérer un filet de voix :
Je sais. Ça fait quelques minutes déjà. Je voudrais tout envoyer promener. Lui dire que j’irai pas, non : plus nulle part sans elle. Je récupère mon sac.
Elle hoche la tête. Son regard me fuit toujours et moi je la dévisage en me la jouant serein, pourtant je comprends ce qu’elle éprouve. Ce mélange de hâte d’en finir et d’envie de repousser l’échéance, que je connais bien pour le ressentir aussi au moment de rentrer chez moi. Correction : chez Jessica.
Elena se racle la gorge, lève les yeux vers moi. Je donnerais tout pour une tornade, une avarie matérielle, une mauvaise cuite du pilote, n’importe quel événement inattendu qui annulerait mon vol, mais je garde les pieds sur Terre. Il le faut. J’ai des clients, des projets sur le feu, des affaires à régler… Une rupture à terminer.
Je l’embrasse sur le front (toujours) pour ne pas risquer de viser sa bouche.
Pour toute réponse, elle pose ses lèvres au coin des miennes. Ça me fait sourire : elle se balade sur le fil avec plus d’aisance que moi.
Elle le murmure près de mon oreille, se détourne en me lâchant la main, s’éloigne. Je la regarde se perdre dans la foule, m’y perds un peu aussi… Allez, mon gars, reste pas là. T’en as pas les moyens, de toute façon.
Ouais. Ce changement de vol de dernière minute coûtait un bras, je vais devoir bosser comme un chien pour combler le trou qu’il laisse dans mon compte en banque. Alors je m’oblige à avancer pour passer les contrôles de sécurité. Ne pas se retourner…
La même hôtesse qu’hier m’accueille à l’étape finale. À mon approche, son visage se fend d’un sourire sceptique.
Combien de personnes s’effacent chaque jour sous son nez en prenant un appel et foutent ensuite le bordel pour rebrousser chemin ? À combien de gens ça arrive de rattraper une seconde chance de justesse ? Ça ne tient qu’à un fil, parfois. Si j’avais éteint mon portable, ou ignoré la sonnerie…
Toussotement discret. L’hôtesse me scrute sans plus sourire, les sourcils en circonflexe. Je promets de ne pas faire de vague aujourd’hui.
Restitution du billet, passeport, « bon voyage ». Je traverse la passerelle en traînant la patte. Sept heures de vol jusqu’à Doha, quinze heures d’escale, et encore quatorze heures avant Melbourne : j’embarque pour un jour et demi de chaos. Envie d’y aller ? Zéro.
Le personnel de bord s’affaire entre les passagers qui s’installent. Bientôt, les haut-parleurs recrachent le débit étouffé d’une voix plate, récitant les formules habituelles à toute vitesse. Je n’écoute pas. Tourné vers le hublot, je revis mon voyage avorté d’hier et me revois pendu à mon téléphone, dans l’attente des mots qui tardent à venir. Je redoutais la décision d’Elena tout en espérant que… C’était long, ce silence. Et puis, enfin :
Sa voix vibrait. Teintée d’un sentiment d’urgence, portée par un souffle de panique.
Putain, le soulagement ! Elle ne fermait pas la porte. Non, mieux : elle l’ouvrait en grand. Et moi qui pensais ne pas faire le poids face à son Monsieur Parfait ! Fallait quand même oser se pointer la bouche en cœur cinq ans plus tard, investi d’une assurance complètement feinte !
J’agonisais sur un siège du hall des départs, mort de fatigue, quand elle est arrivée ; pâle, les traits tirés. Magnifique. Pendant un instant, on s’est tenus face à face sans trop savoir quoi faire, presque sans y croire, puis je l’ai prise dans mes bras et on n’a plus bougé ni parlé : ça se passait de mot.
Billet de retour en poche, mon sac dans une main et celle d’Elena dans l’autre, restait à trouver un hôtel. Le stress accumulé pendant des jours avant de me décider à l’appeler, les heures de marche côte à côte dans Paris la veille au soir, à démêler passé et non-dits, puis une nuit blanche (ou quasi) pour elle et moi : il fallait qu’on se repose, on ressemblait à deux zombies.
Elle a protesté, au début. Elle voulait parler, s’affolait devant la fuite en avant des aiguilles, et en fin de compte, sa tête a touché l’oreiller et bim ! Rideau.
À mon réveil, elle dormait encore. Elle paraissait plus jeune dans son sommeil, plus proche des premières images stockées dans ma mémoire.
Les souvenirs me revenaient en bloc pendant que je l’observais : les fards qu’elle piquait sans arrêt, cette douceur qu’elle planquait sous des réparties assassines, ses éclats de rire, de voix. Son corps nu sous mes doigts… Puis mon attention s’est portée sur sa cicatrice et le rappel de ce foutu matin à l’atelier a tout balayé.
Ce souvenir-là ne s’estompe pas avec le temps, il empire. Plus les années passent, plus je prends la mesure du désastre et du poids de mes actes. De ce « je t’aime » que je voulais pas assumer. Allongé à côté d’elle dans cette chambre d’hôtel, je la revoyais pleurer pendant des heures, jusqu’à s’épuiser. Je me revoyais, moi, la déposer sur mon lit après la crise et, comme hier, la regarder dormir. Comme hier, fixer le Y cousu sur sa peau, bien plus net alors, et ses cernes, et ses joues creusées. Le jour qui se levait et moi qui restais planté là sans savoir quoi faire. Je ressentais encore la panique et la culpabilité. Le dégoût de moi-même en balançant que « les mots ont dépassé ma pensée ». Quel enfoiré !
Souvent depuis, je me suis dit que j’avais dû lui infliger la même entaille que son père à l’intérieur et j’ai imaginé mon mensonge la blesser comme le morceau de verre auquel elle doit sa balafre. Ça m’a valu un paquet de nuits blanches, ces cinq dernières années.
J’aurais mérité qu’elle me tourne le dos et je n’y croyais qu’à moitié en la rappelant ; et pourtant, elle était là…
J’ai regardé sa poitrine qui s’élevait et s’abaissait lentement ; contemplé la façon dont la lumière caressait son corps, avec l’envie d’en faire autant. J’ai divagué un peu dans ma tête avant de me rappeler qu’elle était toujours en couple et que je n’étais, de toute façon, pas prêt. Je ne pouvais pas rayer Jess d’un claquement de doigts. Deux ans, des projets à la pelle jusqu’à ce que le mariage de Mel change la donne, et maintenant une séparation à achever, tous mes trucs à emballer, un autre appart’ à trouver… À moi aussi, il me faudrait du temps. Enfin quand même, c’était tentant.
Je suis allé prendre une douche pour me recentrer. Pendant que l’eau se déversait sur ma tête, je me rappelais encore cette « gosse » rencontrée six ans plus tôt. Je revoyais cet éclat qui habitait ses yeux à l’époque, sa façon de mater le monde avec défiance, et en même temps, une perspicacité féroce. Je repensais à mon pote d’enfance me reprochant d’avoir continué à sortir avec elle malgré son âge et je me disais qu’il ne pouvait pas comprendre, il ne la connaissait pas assez. En vérité, à treize ans, sa maturité dépassait déjà la mienne. De nous deux, ç’a toujours été elle, la grande.
Plus tard, on est allés se balader. Ça faisait drôle de déambuler avec elle et de savoir qu’entre nous flottait la promesse tacite qu’on allait essayer. Qu’on ignorait encore quand et comment, mais qu’on ferait tout pour se retrouver et qu’on espérait ne plus se lâcher.
Je contemplais son sourire, j’écoutais sa voix claire et je me disais qu’on ne pouvait pas se rater. Qu’on serait forcément compatibles, aujourd’hui comme avant et dans une décennie comme maintenant. Je me surprenais à penser que je la suivrais n’importe où, que je l’épouserais, que je lui ferais des gosses… Moi ! Quand est-ce que j’étais devenu conventionnel, comme ça ? Puis jeregardais sa peau mate et je voulais la parcourir du bout des doigts, du bout des lèvres, du bout de la langue ; fouiller dans ses cheveux, la serrer contre moi ; retrouver la sensation de me perdre avec elle. En elle. Je voulais y aller doucement, et la seconde d’après je voulais tout, tout de suite !
Elle m’a tout raconté. Ces cinq années, ses travers, ses crises d’angoisse, son père, sa ressemblance avec lui, sa thérapie. « Il faut que tu saches dans quoi tu t’embarques », elle disait. Ça, et « je comprendrai si tu changes d’avis ». Mais je prends tout, moi ! Surtout que c’est pas comme si je me considérais beaucoup moins torturé qu’elle…
L’avion se positionne sur la piste. Les réacteurs se mettent en surchauffe et mon estomac se tasse : malgré l’habitude, le décollage me rend toujours anxieux.
L’appareil s’élance, il prend de la vitesse. Je garde les yeux tournés vers l’extérieur pendant qu’il s’élève, et je me dis qu’il est trop tard maintenant. Trop tard pour descendre, trop tard pour repousser le retour à Melbourne. Trop tard pour un baiser volé, trop tard pour briser mes propres règles (j’ai dit que je ne la partagerais pas). Trop tard, trop tard…
Non, pas trop tard. L’histoire commence tout juste, mon gars.
2. Tequila
(1er août)
Vrai. J’opterais sûrement pour d’autres termes et tenterais d’enjoliver la formule, mais oui, en substance, c’est bien ce qu’il s’est passé : avec le recul, ma recherche de Tamao dans les garçons qui lui ont succédé ne fait aucun doute. Qu’elle ait été consciente avec Antoine qui, à condition de l’observer sous le bon angle, lui ressemblait tout juste un peu, ou beaucoup plus involontaire – et plus désespérée encore –, avec Timéo dont il partageait le prénom, à deux voyelles près…
Je n’aimerais mieux pas. Là, tout de suite, à choisir je garderais ma posture de soumise, les cils baissés, la tête rentrée entre les épaules, dans une – vaine – tentative d’échapper à son averse d’interrogations devenue déluge de reproches. Je préférerais ne pas associer son visage à la déception, à la colère et au dégoût qui profanent sa voix autrefois douce et bienveillante. Mais puisqu’il le demande…
Je marque au moins trois arrêts dans mon ascension de la table vers son regard accusateur, à la recherche de points de fuite, de retardateurs. Un stratagème puéril et illusoire qui ne fait qu’alimenter son brasier, mais hé ! À ce stade, j’accepte toute l’aide possible !
Je voulais pourtant gérer ce rendez-vous comme une grande. Faire face avec dignité, endosser ma part de responsabilité sans chercher à me dédouaner et encaisser tout ce qu’il dirait sans moufter. Oh, pour me taire, je me tais ! Voilà bien un quart d’heure que j’en prends plein la tête en courbant l’échine pour lui offrir tout le loisir de me flageller.
Il a eu des mots durs, impitoyables même, et je me sens… Misérable. Fautive, impardonnable. Lâche.
Je ne comptais pas lui parler de Tamao. Je prévoyais de m’en tenir à une version simplifiée, sur fond d’amour qui s’estompe et de démons personnels à exorciser. Mais Tim me connaît bien, et quinze jours de vacances chez mon meilleur ami lui ont donné toute latitude pour repenser aux événements de ces derniers mois et s’apercevoir que le train a déraillé après le mariage de Mel. Alors il a demandé. Il a demandé si Tamao jouait un rôle quelconque là-dedans, si ma décision de rompre avait été influencée par une chose ou une autre pendant son absence, et moi je n’ai pas eu le cœur à lui mentir une fois de plus.
Certes cet aveu n’achètera pas ma rédemption, néanmoins je peux m’enorgueillir de ça : l’idée qu’en partant, je ne l’aurai pas privé des réponses auxquelles il avait droit.
Et mon intégrité – ou ce qu’il en reste. J’y tiens ! Avoir résisté à la tentation de le tromper alors que le bateau coulait à pic constitue ma seule fierté dans tout ce merdier.
C’est maigre. Miteux, même. Et je me suis adressée à son nombril, en prime !
Je m’apprête à répéter la formule – mon cerveau atrophié ne trouvant rien d’autre que « désolée » à m’envoyer – quand il se lève et ramasse mon trousseau de clefs sur la table. Il en détache celle de son appartement, jette le reste dans ma direction. Le tas de ferraille glisse sur quelques centimètres avant de venir se caler contre mon bras.
Le renvoi s’avère si soudain, si violent, si peu compatible avec ses manières habituelles que je demeure vissée à ma chaise, interdite.
J’obéis. Lentement. Appesantie par ma honte, ma culpabilité, mes regrets, mes excuses introuvables. Rendue aphone par la plainte qui s’échappera de ma gorge dès que j’atteindrai le couloir du palier. Si j’arrive à me maîtriser.
Par habitude, ou peut-être par miracle, je me retiens jusqu’à l’entrée du bâtiment. Jusqu’à l’endroit où aucun écho, aucune fenêtre ne pourra me trahir, et alors je me recroqueville contre un mur et laisse jaillir toutes les émotions qui se présentent. J’attends que le trop-plein se tarisse, consciente de ne rien récolter d’autre que mon propre semis. Consciente aussi du fait que malgré le sentiment d’échec et les remords, ma douleur n’égale pas la sienne. Parce que je pars, et lui reste. Parce que pour moi, au-delà de ce moment terrible à passer, la lumière point déjà au bout du tunnel.
Un temps indéfinissable plus tard, je quitte l’immeuble pour m’engouffrer dans la fournaise des rues. J’erre en me demandant si c’était là notre dernière rencontre. L’ultime contact. La pensée que le rideau se baisse sur une bouillie pareille me ronge les entrailles : nous méritions mieux que ça. Oui oui, même moi ! Ou pas ?
Pendant un instant, j’hésite à faire demi-tour, pour ne pas nous laisser seuls ni l’un ni l’autre, tenter de corriger mes fautes, mettre des mots sur mes silences. Lui dire que si, de tout mon cœur, je suis désolée. Désolée de ne pas avoir été à la hauteur, désolée de ne pas m’être davantage écoutée, désolée de lui avoir fait perdre son temps, désolée pour tout ce qu’il lui plairapourvu que ça ne finisse pas comme ça !
Mes réflexes me poussent vers les quais de Seine, où je poursuis ma route pendant de longues minutes avant de réaliser que je ne veux pas m’isoler ni m’en remettre aux miaulements énigmatiques du Squatteur, cette boule de poils maigrichonne qui passe de foyer en foyer par les toits de mon immeuble. Sur un coup de tête, je décide donc d’appeler Lulu. Le seul qui connaisse assez le contexte pour ne pas me presser de questions, le seul qui m’accueillera sans jugement, le seul qui… Le seul, point.
Ravi que je sorte « enfin » de ma coquille, celui-ci m’invite à le rejoindre dans un bar situé quelques stations de métro plus en amont du fleuve, où il profite du beau temps avec un ami. J’accepte, bien que l’éventualité de fondre en larmes devant un parfait étranger me donne envie de fuir dans la direction opposée.
Les deux hommes discutent en terrasse. Je les repère de loin grâce à l’impayable bermuda jaune fluo de Lulu. L’autre, un gars dans la trentaine coiffé d’un casque de boucles rousses, porte un jean et un tee-shirt sans fioritures. Je dois vraiment faire peine à voir, car Lulu tire une chaise et se met à me tapoter le dos avant même de songer à faire les présentations.
Décontenancé, Lulu m’observe un instant. Puis hausse les épaules, se tourne vers le garçon qui attend de conclure la commande.
*
Un violent mal de crâne et une bouche pâteuse saluent ma sortie du coma.
Ma première pensée ? La montée de l’escalier en colimaçon qui mène chez moi devrait figurer au Guinness des records, et l’on pourra parler de miracle si je n’ai pas déposé une galette sur chaque palier ! Je me vois déjà me confondre en excuses auprès des autres locataires pour le cadeau empoisonné. Il me faut un certain temps avant de réaliser que je ne garde aucun souvenir de cet ordre.
Tant bien que mal, je mobilise les quelques neurones encore disponibles afin de reconstituer le fil des événements. Des bruits de vaisselle qui s’entrechoque et d’eau qui coule échappés d’une pièce voisine balaient mes efforts comme un coup de vent pour les remplacer par une panique brutale.
Où suis-je ?
Mes yeux s’ouvrent sur un plafond blanc ornementé de moulures et un lustre de type baroque. Je gis sur un canapé de velours rouge au dossier capitonné. Une légère odeur de pain grillé flotte dans l’air et une saloperie de tic-tac retentit faiblement, quelque part sur ma droite. Un frisson d’horreur me parcourt le corps. Un besoin viscéral de réduire le mécanisme en bouillie commence à s’insinuer dans mes veines, mais j’entends aussi autre chose qui me distrait, comme un fredonnement. Lulu. Je suis chez Lulu.
OK, on se détend.
Les souvenirs commencent à remonter à la surface, par bribes. Je me rappelle de la première tournée – infecte ! – et aussi des deux d’après. Nous avons changé de quartier pour la quatrième. Ensuite, ça devient très flou, tout décousu. Je voulais lâcher prise et penser à autre chose… Mission accomplie, je dirais.
Je me souviens… Oui, je me souviens d’une discussion un peu nébuleuse mais hilarante avec l’ami de Lulu. Marco – non, Mario. Impossible de retrouver le sujet, en revanche. Je me souviens avoir demandé à Lulu si la couleur de son bermuda marquait sa sympathie pour les Gilets Jaunes et qu’il a piqué un fou rire, doublé d’un autre en voyant Mario trottiner gaiement derrière nous avec une sandale en moins, égarée qui sait quand et comment. Il faisait déjà nuit. Je me souviens avoir rebroussé chemin pour tenter de retrouver la tatane perdue et interrogé plusieurs passants à ce sujet.
Et puis… Je me souviens avoir assuré que non, ce n’était pas du vent. J’ai dit que j’avais changé de route grâce à Timéo, qu’il m’avait redonné l’envie d’y croire, rendue heureuse, et que dans un monde parfait j’aurais voulu tomber éperdument amoureuse de lui. Sauf que je ne sais plus à qui je l’ai dit.
Alors que je me creuse les méninges, un autre souvenir me frappe :
Je ne l’ai pas dit, mais écrit. Non, non, pas écrit ! Dit. À… Siri ?
Avec un gémissement plaintif, je m’assieds – me ramasse – la tête entre les genoux. Mon mal de crâne s’intensifie. Je ferme les yeux un instant, tâtonne sur le sol à la recherche de mon portable, m’en empare.
Mes doigts tremblent, en vol stationnaire au-dessus de l’icône des messages. Je me souviens, maintenant. Je me tenais ici même, Lulu venait d’aller se coucher après m’avoir donné une bassine, une couverture et un oreiller. Une foule de phrases me trottaient dans la tête et je voulais que Tim les entende, qu’il sache.
Un tas de conneries, à coup sûr… Vas-y, jette un œil, qu’on se marre…
Ou pas. Non. Pas encore. À la place, je me traîne donc vers l’origine des tintements de porcelaine et découvre Lulu en train de beurrer des tartines derrière un comptoir de cuisine. Il m’accueille avec une mimique mi-compatissante, mi-moqueuse, et se détourne pour sortir un verre d’un lave-vaisselle tandis que je m’installe sur le premier tabouret à ma portée.
J’esquisse un sourire.
J’avale un comprimé et sirote un peu de jus en observant les lieux. Perchées sur le frigo et le rebord des fenêtres, au bord des étagères, autour de l’évier, de nombreuses plantes envahissent la pièce inondée de soleil.
Je ne me souviens pas de ça.
Le grattement du couteau contre le pain grillé s’interrompt. Lulu replace le tout devant lui, se sert un autre verre.
Là-dessus, il tire un journal de sous le comptoir et entreprend d’en parcourir les titres en sifflotant. De temps à autre, il s’interrompt pour grignoter, boire un peu, répondre à un SMS…
… puis retourne à son canard. Il ne croise plus mon regard et évite de poser les yeux sur mon téléphone, qui tourne entre mes doigts pendant que je passe en revue les aveux que je pourrais ou me rappelle avoir dicté à Siri.
Allez, finissons-en ! m’exhorté-je en bloquant l’appareil.
Sans surprise, le fil de mes conversations avec Timéo figure en tête du classement. Je me sens pâlir à mesure qu’un long, très long bloc vert défile sous mon doigt, et gémis comme un chiot apeuré en découvrant que je n’ai pas envoyé un message, mais trois ! Trois pavés criblés de digressions inintelligibles et de remarques désobligeantes à l’égard de Siri, le tout sans la moindre ponctuation. Un bordel sans nom !
Je vide mon verre d’un trait pour endiguer une flopée de jurons. Lulu me presse la main avec douceur avant de tourner une page.
Pathétique…
Si c’est la première chose qui me vient à l’esprit, nul doute que Tim l’a pensé aussi. D’autant qu’il n’aura pas manqué de noter la vitesse à laquelle j’ai renoué avec mes pratiques d’adolescente, qui consistaient à noyer mon chagrin dans l’alcool – et dont je m’étais débarrassée grâce à lui, du reste. Parfait ! Je ne pouvais pas tomber plus à côté de la plaque. Du grand art !
Avec un soupir résigné, j’entame l’autopsie du désastre. Le principal objet de mon litige avec l’intelligence artificielle de mon téléphone semble avoir porté sur sa « patience quasi nulle ». Visiblement, je n’appréciais pas que mon secrétaire s’interrompe au beau milieu de mes élans lyriques et j’ai dû recommencer ma dictée plusieurs fois avant de… conclure ou capituler ; les deux paraissent probables. Mon élocution défaillante et mes hésitations ont donné naissance à quelques passages sans queue ni tête mais, en fouillant bien, on trouve les messages dont je me rappelais tout à l’heure. Des excuses en pagaille au sujet d’à peu près tout, et…
Ouch !
La bile vient me piquer la langue à la lecture du tronçon final – débité sans accroc, comme un fait exprès : « tu sais je regrette que ça se termine comme ça mais je dois redevenir actrice de ma vie aller au-devant des choses au lieu d’espérer qu’elles s’arrangeront toutes seules ou que quelqu’un fera des miracles à ma place je savais que Tamao était le bon c’était lui ç’a toujours été lui ».
Je repose le portable sur le comptoir, dégoûtée. Cette partie-là, je pouvais m’en passer.
Lulu tapote le meuble du bout des doigts pendant quelques secondes avant de remettre le journal à sa place.
La réponse lui arrache un gloussement de gallinacé et me vaut une nouvelle tournée de jus de tomate. S’il n’ajoute rien, son sourire ne le quitte plus pendant que nous terminons nos verres et remettons tout en ordre. Pour ma part, malgré ma piètre tentative humoristique, je n’en mène pas large : Tim doit être passé par toutes les couleurs à la lecture de ces satanés messages.
Je dissimule mon malaise en m’approchant de la fenêtre ouverte sous le prétexte de regarder dehors. Le quartier est bondé. Une rumeur de conversations enjouées s’échappe des commerces pour se répandre sur les trottoirs, se mêlant à celle des passants. La météo occupe une place de choix dans les commentaires qui me parviennent. La journée s’annonce chaude et belle une fois encore, et je me sens aussi déprimée qu’un matin d’hiver…
Sous les abondantes nuances de vert disséminées un peu partout se cachent en effet des meubles laqués de blanc et d’or, certes excentriques pour mes goûts mais plutôt classiques pour l’idée que je me faisais des siens.
Je m’exécute, puis replace les coussins sur le canapé.
En m’éloignant vers la cuisine, je songe que je pouvais difficilement choisir une autre voie, à l’époque : livrée à moi-même en plein chaos psychologique, émotionnel et familial, il n’est pas si surprenant que j’aie opté pour les mauvais palliatifs. Sans Tim qui, par le biais de mon meilleur ami, venait tout juste d’intégrer mon paysage, j’aurais d’ailleurs pu très mal tourner. Tout le monde avait renoncé à me sortir du bourbier dans lequel je m’obstinais à m’enfoncer, mais pas lui. Que je le repousse, que je l’insulte, que je déverse ma bile sur un bord de trottoir, il était toujours là. « Pourquoi tu fais ça ? » demandait-il à chaque fois.
Pourquoi… Pourquoi pas, en réalité ? Mon tyran de père m’avait défigurée et expédiée à l’hôpital avec trois côtes cassées, ma mère refusait de considérer mon agressivité permanente et l’apathie qui l’avait précédée comme autre chose qu’une banale crise d’adolescence, et Tamao, pour qui j’éprouvais un amour absolu mais tabou du fait de nos huit ans d’écart, m’avait réduite en bouillie en me déclarant sa flamme puis en se rétractant au moment pile où je comptais sur son appui…
Un léger flottement s’installe tandis que je danse d’un pied sur l’autre, soudain mal à l’aise.
Il y a quelques jours encore, je ne voyais dans l’homme qui se tient devant moi que le très excentrique client de la boutique où je travaille à mi-temps pour financer mes études et mon loyer. Sans le concours de circonstances par lequel nous nous trouvions réunis lorsque Tamao m’a téléphoné pour m’inviter à dîner, il le serait toujours. Or le soutien inconditionnel qu’il m’offre depuis hier relève de bien autre chose, et m’inspire en retour bien davantage, que de la simple politesse…
*
De retour au clapier qui me tient lieu de domicile, je m’offre un décrassage minutieux sous la douche. L’eau fraîche m’éclaircit les idées, et pourtant les rembrunit à égale mesure. Les derniers messages adressés à Tim me hantent, néanmoins je m’interdis de céder à l’envie de l’appeler : à sa place, je me rembarrerais vertement.
L’opération « remise à neuf » achevée, j’échoue sur le balcon. Mon regard erre en direction des toits voisins, puis se perche un moment au sommet de la Tour Eiffel avant de se fixer sur mon petit rosier. Ce dernier fait plus grise mine que jamais, au point que je le soupçonne d’avoir succombé, tout comme les dernières traces d’estime de Timéo à mon endroit, cette nuit sur les coups de quatre heures. Un examen approfondi semble confirmer mon diagnostic. Incapable de me résoudre à le jeter dans un linceul en plastique, je décide de ne pas y toucher pour l’instant : à défaut de pouvoir le faire pour mon histoire avec celui qui me l’a offert à notre premier rendez-vous, j’aimerais lui accorder une sépulture digne de ses trois années de bons et loyaux services. Lorsque mes divagations me conduisent à réfléchir à une épitaphe, je comprends que mon organisme continue de subir les effets de l’alcool ingurgité hier.
La situation pourrait sembler comique, mais elle ne l’est pas : j’espérais une sortie de route plus propre. Pourtant, en toute honnêteté, je me sens soulagée d’un poids, et pas des moindres : plus besoin de mentir, maintenant. À personne. Majeure, indépendante et, désormais, célibataire, je n’ai plus aucun compte à rendre, plus d’excuses à chercher, plus de sentiments à refouler. Une sensation de liberté teintée d’amertume et de regrets, mais qui n’en reste pas moins nouvelle et bienvenue pour moi.
Avec un dernier regard navré pour la plante meurtrie, je rentre avaler un verre d’eau et un comprimé d’ibuprofène afin de soulager le mal de crâne qui s’installe de nouveau, puis me couche, bien qu’il soit davantage l’heure de goûter que de dormir.
Un peu plus de quarante-huit heures se sont écoulées depuis le départ de Tamao. À Melbourne, il est deux heures du matin, demain.
Je me demande ce qu’il fait ; comment il gère ce retour dans un pays qu’il s’apprête à quitter ; s’il appréhende de revoir Jessica. A-t-il changé d’avis en ce qui nous concerne ? Il semblait sincère, et pourtant le doute me tenaille : il m’a déjà lâchée sans prévenir, auparavant.
Je me redresse, saisis mon téléphone : il faut que j’en aie le cœur net. L’espace d’une seconde, j’hésite – presque pour la forme, en vérité. Puis j’ouvre WhatsApp, cherche son nom dans la liste des contacts, et envoie :
3. Saloperies d’hormones
(2 août)
Pendant longtemps, j’ai détesté mon prénom. On ne rencontre jamais de Mélanie dans les histoires et, petite, je voulais m’appeler comme une héroïne de la littérature enfantine : Martine, ou Sophie. Surtout Sophie. Ça sent bon comme une crêpe au sucre. Ado, je trouvais que Mélanie ressemblait trop à « mélanome » et ça m’horripilait qu’on l’utilise en entier. Puis bon, mon prénom m’évoque quand même un radis (creux, en plus), donc pour le glamour, on repassera. Maintenant, je m’y suis faite. Je sais aussi que je pouvais tomber plus mal.
Camille quitte la route des yeux pour me regarder. Un sourire confiant accompagne sa proposition et le vent chaud qui s’engouffre dans la voiture fait danser ses cheveux bruns autour de son visage. Je secoue la tête.
L’impitoyable éclat de rire de mon mari me stoppe net dans mes explications.
Oui. Toujours, quand on va dans sa famille, et aujourd’hui le clan sera au grand complet : les parents, les quatre sœurs et les conjoints, plus les sept petits-enfants. J’en tremble d’avance !
Caroline, la plus jeune frangine de Cam, est en quelque sorte ma bouée de sauvetage dans ces réunions. C’est la seule avec qui je m’entende vraiment bien, la seule avec qui je puisse partager des choses et qui sorte un peu du lot. Les autres me paraissent trop plats, trop bien rangés.
J’entame tout juste ma grossesse. Dès notre retour de voyage de noces avant-hier, j’ai fait une prise de sang pour confirmer le test pipi effectué en Croatie. Euphorique, Cam souhaite profiter de cette réunion de famille pour l’annoncer, et tant pis pour la « règle » des trois mois. Je regrette un peu de mettre ses parents au courant avant les miens ; d’un autre côté, il faut bien commencer par quelqu’un et le hasard veut qu’on les voie en premier, alors…
Pendant que la voiture aborde le dernier virage avant le « Clos », le bed and breakfast que tient l’une des frangines de Camille avec son mari, je me raccroche à l’idée qu’au moins, cette réunion nous épargne une visite individuelle dans chaque foyer.
Cam se gare à la suite des autres, le long de la clôture. À en juger par le tumulte, il ne manquait plus que nous.
D’ordinaire, les assemblées sont convoquées chez mes beaux-parents, dans un vieux corps de ferme encombré de meubles anciens et plongé dans l’obscurité trois cent soixante-cinq jours par an. Cet endroit me met mal à l’aise ; par contre, j’aime beaucoup le Clos. Camille aussi. On voulait d’ailleurs y tenir la réception du mariage au départ, mais on était trop nombreux : voilà ce qui arrive quand on laisse l’aînée de la fratrie se mêler des invitations. Nous, on préférait un truc plus intime, avec juste une poignée de proches, mais devant les susceptibilités que ça chatouillait, on a fini par plier. Cam est le petit dernier, le seul garçon, ses sœurs et ses parents voyaient les choses en grand pour lui. On s’est dit que les laisser s’occuper des plans de table et de la décoration du « Domaine », où se déroulerait la soirée, ne nous demanderait pas un effort surhumain ; on pouvait bien leur concéder ça.
Ma belle-mère se charge de mettre le couvert sous l’ancienne grange avec l’aide de Delphine, la propriétaire des lieux, pendant que Caro et l’un des gendres apportent de la cuisine d’énormes saladiers pleins à ras bord. Le patriarche, déjà assis, lit son journal en fumant la pipe et Annabelle, la plus grande sœur de Cam, observe d’un air mécontent un groupe d’enfants qui joue au fond du jardin. Trois des quatre sont les siens. Trois autres encore, les plus jeunes, babillent entre eux à l’ombre d’un arbre tandis que Lucie discute avec son mari et son beau-frère sous la pergola.
La vue de tout ce monde me fait sourire en me rappelant mes premières sorties avec Camille : il m’a fallu des semaines avant de réussir à tous les situer et retenir leurs prénoms.
Cam me lâche la main pour aller embrasser sa mère. Les dix minutes qui suivent sont consacrées aux salutations ; les mêmes questions reviennent sans cesse et chacun de nous se borne à des réponses superficielles, sachant qu’on recommencera à table. Annabelle nous remarque à peine et reste tournée vers les enfants, les interpellant pour tout de son horrible voix nasillarde, les reprenant pour rien.
Annabelle ne semble pas l’entendre.
Delphine lève les yeux au ciel avant de s’éloigner vers la cuisine. Au même instant, mon beau-père replie son journal et tire un mouchoir de sa poche pour s’éponger le front.
On dirait que les autres attendaient l’invitation du chef de famille pour venir : encore dispersés aux quatre coins du jardin juste une poignée de secondes plus tôt, tous convergent vers la table et s’y installent tandis que je prends place. Camille à ma gauche, près de sa mère, Annabelle et Caro en face de nous, Delphine et son mari ensemble, puis Lucie, son homme et celui d’Annabelle aux emplacements qui restent. Comme toujours, les enfants mangeront de leur côté.
Camille se charge de raconter nos péripéties à ses parents pendant que je fais circuler les plats. Face à moi, Caro échange des textos en souriant, allant parfois jusqu’à se mordre la lèvre comme une jeunette, indifférente aux discussions de ses beaux-frères qui, comme d’habitude, comparent leurs boulots et leurs salaires respectifs, et aux éternelles chamailleries de ses sœurs.
Je m’ennuie et j’ai déjà mon quota d’Annabelle, qui critique toujours tout et ne fait jamais rien. Je l’entends reprocher à Delphine d’avoir eu la main trop lourde sur la mayonnaise dans l’une des salades.
La discussion s’arrête là. Je m’étonne toujours de constater à quel point les esprits se maîtrisent, dans cette famille. Les remarques fusent, puis chacun passe à autre chose l’air de rien.
Le coin de ma bouche s’étire de façon irrésistible. Annabelle ne conçoit pas qu’on n’exploite pas tous les filons dont on dispose, mais moi, je vois les choses d’un autre œil. Et de toute façon, ça ne la regarde pas. Je me penche donc vers elle par-dessus mon assiette et, sur un ton de conspiratrice, réponds :
Un rictus satisfait aux lèvres, Caro relève la tête pour admirer la scène (son sourire s’élargit encore devant l’air de chouette courroucée de sa frangine), avant de retourner à ses messages.
Sorry, Tamao, me dis-je en reprenant ma position initiale, c’était trop tentant.
Camille passe un bras autour de mes épaules, fait mine de m’embrasser sur la joue.
Il ne devrait pas s’inquiéter : sa sœur a déjà ravalé sa grimace de dégoût et se tourne maintenant vers sa voisine.
L’intéressée s’exécute sans piper mot, s’empare de sa fourchette et se met à piquer distraitement la nourriture, sans la porter à sa bouche. Annabelle le remarque aussi :