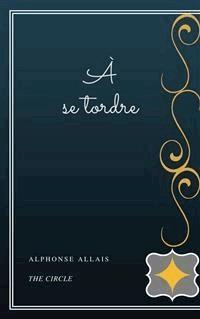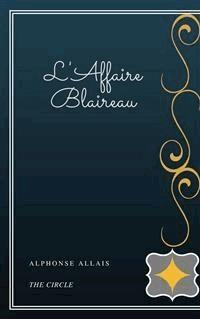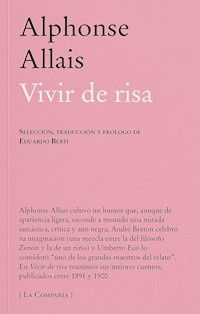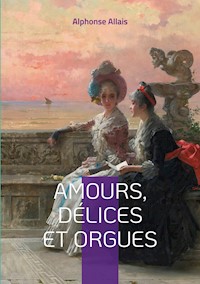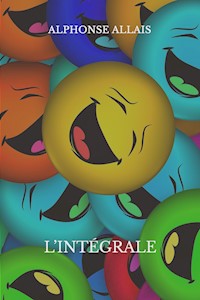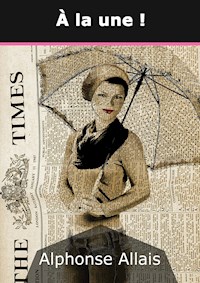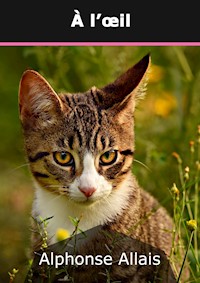2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alphonse Allais est un écrivain atypique avec un humour souvent acide que l'on rencontre dans la plupart de ses écrits. "Rose et vert-pomme" comme "Vive la vie" ne déroge pas à cette règle, bien au contraire. Ouvrage peu connu, il mérite d'être découvert. Vous retrouverez dans ce recueil de 44 nouvelles, toute la légèreté de ton qui caractérisent les recueils d'Alphonse Allais. Si vous avez déjà apprécié son humour si particulier, vous allez prendre beaucoup de plaisir à lire "Rose er vert-pomme". Dans le cas contraire, c'est le moment de faire une belle découverte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Rose et vert-pomme
Pages de titrePage de copyrightAlphonse Allais
Rose et vert-pomme
Rose et vert-pomme
Édition de référence :
Paris, Paul Ollendorff, Éditeur, 1894.
À Jules Lemaître.
Un coin d’art moderne
– Tiens, fis-je en recevant mon courrier, la drôle d’enveloppe !
C’était en effet une drôle d’enveloppe, entièrement couverte par une arabesque imprimée avec une encre vert-d’eau, pâle comme celle d’un serpent.
Cette enveloppe recelait une carte de même nature, à part ce détail que l’arabesque était à l’envers.
(Je veux dire par là que l’arabesque de la carte se contournait en sens inverse à celui de l’enveloppe. Car, où est l’être assez malin pour dire si une arabesque est à l’envers ou à l’endroit ?)
Avec une peine énorme, je pus enfin déchiffrer la teneur de cette carte toute typographiée de lilas-clair passé :
« Le groupe des Néo-Pantelants prie monsieur Un Tel de visiter son exposition qui se tiendra de telle date à telle date, telle rue, tel numéro. »
Je n’eus garde de manquer le vernissage de cette exposition, et, comme vous pourrez en juger vous-même, je ne regrettai point mon voyage.
Le public qui peuplait les salles des Néo-Pantelants se composait des jeunes hommes et des jeunes femmes qu’on ne rencontre guère qu’en ces sortes de solennités, ou bien alors aux représentations de Mæterlinck ou d’Édouard Dujardin.
Le feu de l’Art pour l’Art scintille en leurs prunelles. Les jeunes hommes portent leurs cheveux souvent très longs ; les jeunes femmes – hiératiques, oh ! combien ! – semblent fraîchement guéries d’une grave maladie, à moins qu’elles ne paraissent en couver une prochaine, aussi pernicieuse.
Il y avait, dans la peinture des Néo-Pantelants, un peu de tout : du symbole, du mystique, de l’arabesque, du tourbillonnisme, etc., etc.
(On me permettra de baptiser de ce dernier nom une étrange et nouvelle école où l’on semble voir la nature, à travers un éternel cyclone. Les arbres, le sol, la mer, les rochers, le ciel, toute la nature enfin, se tord comme en proie à d’inexprimables coliques. Spectacle pénible, en somme.)
Quant au pointillisme, je constatai sa pleine déchéance. On a employé tant de confetti, ces dernières années, que peut-être n’en reste-t-il plus pour la peinture au pointillé.
À peine entré dans une salle, je fus vivement frappé par la vue d’un tableau, duquel je m’approchai en vive hâte.
Ce tableau représentait deux personnages, assis à côté l’un de l’autre, un bonhomme et une bonne femme.
La bonne femme avait l’air très bête, et le bonhomme très fripouille.
Mais le plus curieux de cette œuvre d’art, c’était sa coloration : la bonne femme était orange et le bonhomme bleu.
Mais quel orange, mes pauvres dames ! Et quel bleu !
J’ai vu, dans ma déjà longue carrière, pas mal d’oranges et des bleus comme s’il en pleuvait. Eh bien ! je le jure, je ne me souviens pas d’avoir jamais rencontré des échantillons s’approchant, même lointainement, de ces deux tons-là.
Une étiquette sur le cadre du tableau portait ces deux mots :
Mes parents
J’avais beau lutter : une stupeur croissante me clouait devant le spectacle de ces deux bonnes gens et je n’arrivais pas à en rassasier mes pauvres yeux.
Un jeune homme, qui me regardait depuis quelque temps, vint à moi, et, d’une voix douce :
– Cette peinture semble vous intéresser, monsieur ? dit-il.
– À un point que je ne saurais dire, monsieur.
– Vous me flattez considérablement, monsieur, car c’est moi l’auteur.
– Ah ! monsieur... Et ne voyez, je vous en conjure, dans mes paroles, aucun parti pris de dénigrement... vous avez des parents d’une bien drôle de couleur !
– Mon Dieu, monsieur, je ne prétends pas que, dans la nature, mon père soit aussi indigo que cela, pas plus que ma mère ne se trouve, à ce point, orange. À vrai dire, mes dignes parents seraient plutôt roses. Mais si je les avais peints roses, je vous demande un peu ce que cela aurait bien voulu dire.
– ? ? ? ?
– J’ai voulu raconter, en affublant chacun d’eux d’une couleur complémentaire de l’autre, la parfaite harmonie qui n’a cessé de présider à l’existence de ces deux braves gens. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un rayon orange combiné avec un rayon bleu reconstitue la lumière blanche ?
– Je le sais, monsieur... J’ai voyagé trois ans dans une maison qui ne faisait que les couleurs complémentaires. Alors rien de ce qui touche à cette partie ne me demeure étranger... Voulez-vous me faire l’amitié d’accepter un bock au buffet ?
– Le plus volontiers du monde, monsieur.
Au buffet, nous fîmes plus ample connaissance. Charmant garçon, mon nouvel ami me présenta à quelques jeunes peintres de sa connaissance et m’invita, pour le soir même, au banquet qui devait fêter la fondation des Néo-Pantelants.
J’acceptai de grand cœur.
La plus franche cordialité ne cessa de présider à ces agapes esthétiques.
Seul un tourbillonniste, d’origine américaine, je crois, troubla, un instant, la sérénité du repas en chantant un couplet dû à la verve de son compatriote R. Shoomard :
Tout au fond du corridor sombre,
Les poissons pleuraient lentement ;
Et l’on apercevait dans l’ombre
Valser des filles, à deux temps.
Au bout d’une heur’ de c’t exercice,
On demanda de toutes parts :
Est-ce un petit feu d’artifice,
Où le gazouillis du têtard ?
Refrain.
Goui, goui, goui, goui, goui !
C’est le chant de la fauvette.
Goui, goui, goui, goui, goui !
C’est la voix du salsifis.
Goui, goui, goui, goui, goui !
C’est le cri de l’andouillette.
Goui, goui, goui, goui, goui !
C’est le chant du parapluie.
On eut toutes les peines du monde à imposer silence au Yankee, et la conversation se réinstalla sur le tapis de l’Art pur.
– Et à propos, fit quelqu’un à un autre, comment se fait-il que tu n’aies envoyé, cette année, rien de mystique ?
– Parce que, répondit froidement l’interpellé, j’ai soupé de la religion.
– Oh !
– Oui, mes amis, j’ai soupé de la religion depuis l’été dernier, par un soir d’orage... Mourez-vous d’envie de savoir les détails de mon désabus mystique ?
– Littéralement !
– Eh bien ! voici. C’était en Bretagne... Isolé de tout élément mondain, menant une vie calme, simple, à même la nature, jamais je ne m’étais senti l’âme aussi profondément religieuse... Un soir d’orage, qu’il tonnait, et que je me hâtais de regagner ma maison, je passai devant un christ, un de ces christs, comme il s’en trouve là-bas, naïfs et si touchants ! Je me jetai au pied du crucifix, et, dans un élan de foi ineffable, je priai le fils de Dieu. Puis, je me relevai et m’en allai. Je n’avais pas fait vingt pas que, machinalement, je tournai la tête. Et voici ce que je vis...
Une minute d’angoisse plana sur l’assistance. L’artiste reprit :
– Voici ce que je vis : le Christ avait détaché son bras droit de la croix. De sa main libre, il me faisait ce geste qu’on appelle, dans les régiments, tailler une basane. Alors vous comprenez si, depuis ce moment-là, j’ai soupé de la religion !
Ce récit fut suivi d’un silence pénible.
Le peintre américain en profita pour entonner le second couplet de sa chanson favorite, et nous reprîmes, tous en chœur :
Goui, goui, goui, goui, goui !
C’est le chant du parapluie.
Et je rentrai chez moi, entièrement conquis à la Néo-Pantelance.
Trépidation
Pour des raisons qu’il me serait pénible d’avouer publiquement, je viens d’accomplir un léger voyage dans le nord du Palatinat.
Au cours d’un trajet entre une petite cité que je ne nommerai pas et une grande ville que je vous demanderai la permission de ne pas désigner plus clairement, je vis une chose, une drôle de chose.
Oui, réellement, une drôle de chose.
Un homme et une dame se trouvaient sur le quai de la gare, disposés, sans nul doute, à partir pour quelque part.
La dame, une dame jeune et mince, détenait le record de la beauté piquante. (Je n’ajouterai pas un mot de plus à cette désignation ; je dirais des bêtises.)
Le monsieur, un monsieur mûr, adorné de favoris grisonnants très soignés, me fit l’effet d’un diplomate autrichien.
Pourquoi, diplomate ? Pourquoi, autrichien ! Hé ! le saurais-je dire ?
Depuis mon enfance la plus reculée, tous les messieurs entre deux âges, flanqués de favoris grisonnants très soignés, me font l’effet de diplomates autrichiens.
Vous me direz qu’à ce compte-là la diplomatie autrichienne serait à la tête d’un personnel plus nombreux que de raison.
Vous me direz aussi...
Vous me direz tout ce que vous voudrez.
Moi, je vous répondrai simplement ces paroles :
– Je ne vous ai jamais assuré que ce monsieur fût un diplomate autrichien : je disais simplement qu’il me faisait l’effet d’en être un.
Et puis, vous savez, assez là-dessus, hein ?
Le diplomate autrichien – je ne le désignerai pas autrement, en dépit de vos criailleries de sectaires – le diplomate autrichien, dis-je, conduisit la suggestive jeune femme à la portière d’un coupé-lit, dans lequel elle pénétra avec la légèreté de l’oiseau lancé d’une main sûre.
Jusqu’à présent, rien que de très naturel.
À partir de ce moment, les incrédules peuvent apprêter leurs faciles haussements d’épaules.
Le diplomate autrichien, après un petit salut qui signifiait à tout à l’heure, se dirigea vers le fourgon aux bagages, y grimpa d’un air d’ankylose et s’assit sur une malle.
Le sifflet de la locomotive déchira l’air de sa stridence ; je n’eus que le temps de regagner ma place.
Une grande stupeur lotissait mon âme inquiète : quelle étrange fonction ce diplomate autrichien peut-il bien remplir dans ce fourgon à bagages ?
Surveillerait-il point le traité d’alliance de la Triplice ? Pourquoi pas, mais tout de même rigolo !
Et la petite bonne femme, là, dans son coupé-lit, avec ses drôles de-z-yeux ?
Comme elle doit s’embêter toute seule.
Un des trucs les plus répandus pour faire cesser la solitude d’une jeune femme, consiste à la partager (la solitude, pas la jeune femme).
Oui, mais voilà. Le coupé est réservé. Et puis, le diplomate autrichien ne l’entendrait peut-être pas de cette oreille-là ?
Bref, je crus devoir ne pas rater l’occasion que j’avais de rester tranquille.
À quelques stations plus loin, le diplomate autrichien descendit de son fourgon et vint regagner la jeune personne.
De petites lueurs que j’aperçus dans les yeux de l’homme m’en apprirent plus long que les plus longs discours.
Et me revinrent en souvenance les vers de mon ami Paul Marot :
La trépidation excitante des trains
Vous glisse des désirs dans la moelle des
/ reins.
Il est évident qu’on est plus trépidé dans un fourgon à bagages que dans un car de luxe, mais comme c’est triste, d’en être réduit là, même pour un diplomate autrichien !
Le major Heitner
ou une concurrence au bon Dieu
Voici une quinzaine de jours que j’ai reçu la lettre qu’on va lire. Loin de Paris, à ce moment, je ne crus pas devoir la publier sans un contrôle préalable.
Les faits y énoncés étaient-ils bien exacts ? N’y avait-il pas, tout au moins, légère exagération ?
Ma première démarche en arrivant à Paris fut pour m’informer de cette question.
Aujourd’hui, ma religion est éclairée, et je vais publier la lettre de M. Tristan-Bernard, la tête haute, j’ose le dire :
« Mon cher Allais,
» Le major Heitner a été très touché des lignes aimables que vous lui avez consacrées à diverses reprises. Il vous aurait remercié lui-même, s’il n’avait craint qu’en publiant sa réponse, vous ne lui attiriez des difficultés. Il eût fallu demander l’autorisation à son supérieur hiérarchique. Mais le major a tellement permuté, de droite et de gauche, – pour faire plaisir à des camarades – qu’il ne sait plus à quelle arme il appartient. Serait-ce au 8e régiment groenlandais de l’armée marocaine, ou bien au Royal-Cocktail des lanciers verts d’Uruguay ?
» Le major nous réunissait l’autre jour en un dîner intime, pour fêter sa vingt-septième année (ne vous étonnez pas que, si jeune, il soit déjà parvenu à un si haut grade : il a reçu au berceau un brevet de général, et s’il est aujourd’hui major, c’est grâce à des dégradations successives ; gardez donc vos compliments).
« Frères, nous dit le major après le café, voulez-vous maintenant connaître les derniers télégrammes de ma pensée ? »
» Le major a pris l’habitude de nous appeler frères, d’abord parce que tous les hommes sont frères (Cf. Beethoven, symphonie avec chœurs), puis parce qu’il a été missionnaire chez les faux hommes sauvages des foires de l’Île-de-France. « Frères, je vais vous raconter le dernier tour que m’a joué Émile. »
» La personne que Jules Heitner désigne sous le nom d’Émile n’est autre que Dieu le père, que certains complaisants persistent encore à appeler le bon Dieu.
» Émile, selon le major, est avant tout un grand indifférent.
Du haut de son balcon, Émile, dit le Très-Haut,
Regarde toutes les âmes qui s’en vont à vau-l’eau.
» (Ces deux vers, comme tous ceux que fabrique le major Heitner, ont un minimum de douze syllabes garanti.)
» L’Éternel ne consent à se départir de son jemenfichisme que pour jouer des tours pendables à ses créatures ; son philanthropisme, sa prétendue bonté, ne sont qu’un habile moyen de réclame, et qu’un leurre des plus perfides pour nous faire monter à l’échelle de l’Espoir.
» Aussi, la grande préoccupation du major est-elle de combattre Émile par ses propres armes, de nuire à sa popularité en fondant des œuvres providentielles concurrentes. C’est ainsi qu’il a créé, sur le rebord de sa fenêtre, un hospice pour vieux moineaux, et fait graver cette inscription sur la pierre :
Aux parents infirmes des oiseaux,
Le major Heitner donne la pâture.
» Le major a pris ses dispositions pour qu’au printemps prochain les récifs les plus fréquentés par les naufragés soient recouverts d’affiches ainsi conçues :
Frein Heitner
Contre la fureur des flots
Sert aussi à arrêter les complots des
méchants.
» De plus, le major Heitner s’occupe à réunir un dossier des plus compromettants qui, lorsqu’il sera complet, lui fournira le sujet d’une jolie campagne de presse.
» Il paraîtrait qu’au moment de la Genèse, les choses ne se seraient pas faites toutes seules. La grosse affaire du défrichement du Chaos était convoitée par diverses puissances, dont nous ne soupçonnons pas l’existence. Il fallait agir auprès d’une personnalité dont il est difficile de dévoiler le nom, et c’est à l’aide dont on ne sait encore, au juste, quelles corruptions, que l’Éternel actuel serait arrivé à ses fins.
» Quand nous reviendrez-vous, mon cher Allais ?
» Bien vôtre,
» Tristan Bernard. »
Les faits avancés dans la fin de cette lettre ne sont pas dénués d’une certaine gravité.
M. Fernand Xau, notre jeune et intelligent directeur, me prie d’aviser le public que le Journal entend garder, dans cette question, une absolue neutralité.
Dont acte.
Le terrible drame de Rueil
Les voyages forment la jeunesse : c’est une affaire entendue.
Pour moi, qui, sans être un vieillard décrépit, ne suis plus un bébé ingénu, suffisent les petits trajets.
C’est ainsi que parfois je me rends à Bougival où Burn-Cottage, une charmante habitation de l’île, se trouve possédé par trois amis à moi, l’excellent André H..., le grouillant Georges B...t et le talentueux Jules P...t, plus connu sous son pseudonyme de M...x .
Au cours d’un de mes derniers voyages, il m’advint une de ces aventures dont le temps n’est pas près d’abolir en moi la souvenance, employât-il sa faux en guise de grattoir1.
On n’était plus qu’à un hectomètre environ de la gare de Rueil (la gare de toute la banlieue où les employés ont reçu la plus déplorable éducation. Oh ! les muffs !)
Déjà notre railway ralentissait sa marche.
(Encore un alexandrin.)
Tout à coup, un cri d’effroi retentit, poussé par une dame qui se trouvait à la portière de droite.
– Quoi ? Qu’y a-t-il ? fîmes-nous, angoissés.
– Là ! faisait la dame. Là !
Horreur des horreurs !
Dans un petit jardin contigu à la voie, un homme jeune encore était pendu à un arbre fruitier.
Jonchant le sol, tout près, une dame en costume d’amazone, un revolver au poing, venait de se tuer, probablement pour ne pas survivre au monsieur pendu.
À deux pas, sur le gazon, une femme entièrement nue, le ventre ouvert, les intestins au soleil, les yeux démesurément agrandis par la terreur suprême, gisait...
Et puis, d’autres cadavres de tout âge et de tout sexe !
Quel drame terrible venait donc de se passer ?
Nous étreignions nos crânes, prêts à voler en éclats.
Étions-nous le jouet de quelque hideux cauchemar ?
Au milieu de tout ce carnage, un homme d’allure bestiale et de quiétude parfaite, se promenait, tirant de sa pipe en écume d’épaisses volutes qu’il envoyait vers le ciel impassible.
Enfin le train s’arrêta.
Fébrilement, je sautai à terre et m’encourus vers la maison sinistre, une coquette demeure en briques que j’avais bien remarquée.
Je tirai un coup de sonnette où je mis toute mon énergie.
Une petite bonne vint m’ouvrir : une petite bonne rousse dont le nez retroussé indiquait une rare effronterie.
– Mademoiselle, haletai-je, il vient de se passer, dans votre jardin, des choses effroyables.
– Quoi donc ?
– Un monsieur est pendu à un arbre.
– Oui, je sais.
– Une dame vient de se tirer un coup de revolver dans la tempe.
– Oui, je sais.
– Une femme nue a le ventre ouvert.
– Oui, je sais.
Tant de calme chez cette jeune créature rousse m’affolait.
– Mais, mademoiselle, repris-je, il faut y aller... tout de suite !
– Ça n’est pas pressé... On les rentrera ce soir... parce qu’il pourrait pleuvoir dans la nuit.
J’eus le temps d’étreindre encore mon crâne toujours prêt à voler en éclats, et puis, j’eus la clef du mystère.
*
Le propriétaire de la maison est un ancien forain qui gagna des sommes considérables à montrer les crimes célèbres figurés en cire.
En se retirant des affaires, il n’eut point le courage de se séparer de ses sujets.
Seulement, des fois, pour éviter la moisissure, il les met à l’air.
L’étrange calcul
Appelé par une importante dépêche qui m’annonçait l’accaparement de toutes les moules de Honfleur et de Villerville par un syndicat juif, je n’eus que le temps de me jeter dans l’express de 8 h. 20 (train 15).
On a dit que l’appétit vient en mangeant : loin de moi l’idée de m’inscrire en faux contre cette assertion ; mais je puis certifier qu’il arrive parfois (l’appétit) sans cette formalité, et ce fut précisément mon cas, ce matin-là.
Dans la hâte de mon départ, je n’avais pas eu le loisir de me sustenter un peu. D’autre part, le temps me manqua pour acquérir quelques comestibles volants, tels que sandwiches ou autres.
Je ne devais déjeuner qu’au buffet de Serquigny, où cette excellente Compagnie de l’Ouest (je vous la recommande) permet au voyageur affamé d’engloutir une alimentation furtive, mais substantielle tout de même.
Quand on a très faim, c’est bien long à venir, 11 heures 20 ! Avez-vous remarqué ?
Heureusement, à la station de Beaumont-le-Roger, monta dans mon compartiment un jeune ecclésiastique dont la conversation m’abolit en partie l’angoisse de l’attente.
Il me conta qu’ayant touché la veille, d’une vieille dame irlandaise ivre-morte, une assez forte somme pour le denier de Saint-Pierre, il se rendait à Rouen dans le but de manger le magot sacré avec les pires drôlesses.
Enfin, Serquigny !
Nous descendîmes, l’abbé et moi, et nous dirigeâmes vers le buffet.
Le serviteur de Dieu devant prendre le train de Rouen à 11 heures 34, n’avait à sa disposition que 14 minutes, alors que moi, simple laïque, je me voyais à la tête de 20 belles minutes.
Par bonheur pour lui, mon jeune vicaire représente une des plus jolies et rapides fourchettes du diocèse d’Évreux : avaler une entrecôte purée, un demi-poulet, du veau froid, du macaroni, des haricots verts, un demi-camembert, une livre de cerises, etc., pour lui n’est qu’un jeu.
Moi, je mangeais plus posément.
Et pendant que nous déjeunions, le patron du buffet, très obligeamment, clamait d’une voix forte ces mots rassureurs :
– Messieurs les voyageurs pour la ligne de Cherbourg ont encore douze minutes. Messieurs les voyageurs pour la ligne de Rouen ont encore six minutes.
Et froidement, sérieusement, sans que le moindre tressaillement d’un muscle de sa face indiquât qu’il s’agissait d’une plaisanterie, le jeune vicaire de Beaumont-le-Roger disait :
– 12 minutes pour ceux de Cherbourg et 6 pour ceux de Rouen, ça fait 18... Nous avons le temps.
Le patron du buffet reprenait toujours de sa voix forte :
– Messieurs les voyageurs pour la ligne de Cherbourg ont encore 8 minutes. Messieurs les voyageurs pour la ligne de Rouen n’ont plus que 2 minutes.
Et mon ecclésiastique :
– 8 et 2... 10. Nous avons le temps.
À côté de nous, une manière de vieux colonel sanguin et décoré, ouvrait des yeux énormes.
Bientôt il n’y tint plus :
– Pardon, monsieur l’abbé, ayez donc l’obligeance de m’expliquer l’étrange calcul que vous opérez en totalisant deux nombres qui n’ont jamais été créés pour s’ajouter l’un à l’autre ?