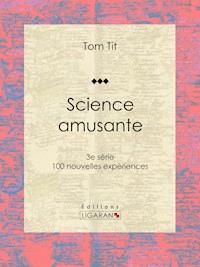
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Extrait : "La décoration d'un arbre de Noël n'offre pas de bien grandes difficultés ; un peu de goût suffit en général. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne le mode d'attache des bougies au bout des branches ; fixées avec du fil de fer tordu, elles se penchent mélancoliquement, aspergeant de stéarine les personnes placées près de l'arbre, et souvent même mettant le feu à une branche voisine."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050653
©Ligaran 2015
Comme dans les précédents volumes, l’amateur trouvera dans celui-ci des expériences de physique et de mécanique faciles à exécuter, sans dépenses et sans danger, à l’aide d’objets usuels. J’y ai joint un chapitre spécial sur les bulles de savon, ainsi que quelques récréations sur la géométrie.
Une partie importante a été réservée aux petits travaux manuels dont plusieurs, exécutés dans les réunions de patronage des « Bons Jeudis », peuvent être recommandés pour les réunions de jeunesse et les soirées de famille.
J’exprime ici ma plus vive reconnaissance aux nombreux amis, connus ou inconnus, de la Science Amusante, ainsi qu’à la MAISON LAROUSSE, pour le soin apporté par elle à la publication des trois volumes ; celui-ci, le dernier de la série, sera, je l’espère, accueilli avec la même faveur que ses deux aînés.
Arthur GOOD
(TOM TIT)
Paris, le 1er janvier 1906.
La décoration d’un arbre de Noël n’offre pas de bien grandes difficultés ; un peu de goût suffit en général. Mais il n’en est pas de même en ce qui concerne le mode d’attache des bougies au bout des branches ; fixées avec du fil de fer tordu, elles se penchent mélancoliquement, aspergeant de stéarine les personnes placées près de l’arbre, et souvent même mettant le feu à une branche voisine.
Aussi a-t-on inventé mille et un systèmes, plus ingénieux les uns que les autres, destinés à fixer les bougies à l’arbre, tout en assurant leur parfaite verticalité.
Vous pouvez leur ajouter le suivant, que je crois simple et pratique. Recourbez un bout de fil de fer (ou une épingle à cheveux, comme l’indique la figure de gauche de notre dessin) ; la petite branche ascendante verticale sera piquée dans le bas de la bougie et la grande branche descendante dans une de ces noix dorées ou de ces pommes d’api qui font partie de la décoration de tous les arbres de Noël. Vous posez l’arcade de fil de fer à cheval sur la branche, et, quelle que soit son inclinaison, la bougie restera toujours droite, grâce au contrepoids improvisé que vous lui avez fourni.
Voici un petit appareil qui semble contredire, par son fonctionnement, les lois immuables de la pesanteur ; à ce titre, nous pourrons le mettre à côté de celui que nous avons décrit dans un de nos précédents chapitres, et consistant en un double cône qui remonte le long d’un plan incliné.
Faites un anneau de papier fort, à l’intérieur duquel vous collerez un petit objet un peu lourd, un bouton de métal, par exemple, ou tout simplement un peu de cire à cacheter. Posez l’anneau verticalement sur un plan incliné, en ayant soin que la masse lourde soit tout près du diamètre vertical, mais en dehors de ce diamètre et du côté le plus élevé du plan. Abandonnez l’anneau à lui-même, et vous le verrez rouler en remontant le plan incliné, par suite de la pesanteur du poids additionnel. Lorsque ce poids sera arrivé au point le plus bas de sa course, l’anneau restera stationnaire. Cette expérience excitera la curiosité du public si, au lieu d’un anneau, vous opérez avec une boîte ronde dont le fond et le couvercle dissimuleront le poids additionnel aux spectateurs.
C’est un nouveau moteur que je viens vous présenter ici ; il ne fonctionne ni à la vapeur, ni à l’électricité, ni à l’air comprimé ; il ne comporte ni chaudière, ni cylindre, ni piston, et consiste… en une simple bougie ! Vous croyez que je plaisante ? Prenez une bougie, et faites vous-même l’expérience.
Piquez, perpendiculairement à la mèche, de part et d’autre de la bougie et en son milieu, les têtes de deux épingles préalablement chauffées ; ces deux épingles constituent l’axe de notre moteur, et vous poserez leurs extrémités sur le bord de deux verres.
Si vous allumez les deux bouts de la bougie, ils brûlent, je vous laisse à penser avec quel entrain, et une goutte de stéarine tombe dans l’une des assiettes placées au-dessous pour la recevoir. L’équilibre de notre fléau de balance est rompu, et l’autre bout de la bougie descend, faisant remonter le bout qui vient de perdre la première goutte de stéarine. Mais ce mouvement d’oscillation fait tomber plusieurs gouttes du bout qui vient de descendre et qui devient à son tour le plus léger ; il remonte donc tandis que l’autre descend, et le mouvement d’oscillation, d’abord petit, prend une amplitude de plus en plus grande, la bougie, faiblement inclinée, sur l’horizon au début, finissant par avoir une position presque verticale.
Rien de plus amusant que d’assister à ce mouvement de bascule désordonné, qui ne s’arrête que si vous soufflez les deux flammes ou lorsque la bougie est entièrement consumée, c’est-à-dire au bout d’une demi-heure. Nos aimables lectrices vont me reprocher de « faire brûler la chandelle par les deux bouts », mais il faut savoir sacrifier quelque chose à la science, et messieurs les fabricants de bougies ne me contrediront pas.
Voulez-vous maintenant utiliser le mouvement de votre bougie pendant qu’elle fonctionne ? Vous pouvez la relier, par un fil de fer léger, à de petits personnages en carton découpé et articulés qu’elle animera d’un mouvement de va-et-vient, par exemple des scieurs de long, un sonneur de cloche, été. Elle fonctionnera comme le balancier d’une machine de Watt, et vous attacherez chaque extrémité à un petit piston se mouvant dans un cylindre vertical ; enfin, et plus simplement, fixez sur l’axe (à l’aide d’épingles qui la maintiendront à distance pour éviter le contact des flammes) une bande de carton léger figurant une planche aux extrémités de laquelle vous collerez deux petits personnages qui joueront au jeu de bascule et rendront, pour les petits, l’expérience encore plus attrayante.
Vous venez de manger une orange ; l’une des demi-sphères creuses, en forme d’écuelle, que vous avez enlevée pour peler l’orange, va vous servir pour exécuter une expérience relative à la superposition de deux liquides, l’eau et le vin par exemple, par ordre de densité.
Percez, à l’aide d’un cure-dents en plume d’oie, deux trous à côté l’un de l’autre, dans le fond de l’écuelle, et placez votre peau d’orange au milieu d’un verre, la partie jaune en dessous. Son diamètre doit être un peu plus grand que celui du verre, et, par suite de son élasticité, elle se maintiendra contre les parois sans tomber. Versez dans la peau d’orange du vin rouge qui passera par les trous, jusqu’à ce que le niveau du vin touche le bas de l’écuelle.
Puis versez de l’eau dans le verre de façon à le remplir presque complètement. Vous voyez aussitôt un filet de vin monter, à travers l’un des trous, jusqu’au niveau de l’eau, tandis que l’eau, plus lourde, passe par l’autre trou pour descendre au fond du verre. Au bout de peu d’instants, au lieu d’avoir le vin au-dessous et l’eau au-dessus de la peau d’orange, l’échange des deux liquides a été complet, et c’est le contraire qui a lieu.
Vous pouvez placer deux tuyaux de plumes d’oie ou deux cure-dents dans les deux trous ; l’un allant du fond du verre au fond de l’écuelle, l’autre allant du fond de l’écuelle au niveau de son bord supérieur, mais ces deux tuyaux ne sont pas indispensables.
L’eau offre ce phénomène remarquable que, lorsque sa température s’abaisse, elle ne se contracte que jusqu’à 4° ; au-dessous de ce point, quoique le refroidissement continue, non seulement la contraction cesse, mais le liquide se dilate jusqu’au point de la congélation, qui a lieu, nous le savons, à 0°. L’eau possède donc, à la température de 4° centigrades, un maximum de densité, ainsi que l’ont prouvé les remarquables expériences de Hallstrom, de Despretz et de Hope.
Nous ne possédons pas les appareils délicats de ces savants, et n’avons à notre disposition qu’un œuf vide et un bocal (ou un seau) plein d’eau. Nous opérons en hiver, bien entendu. Voici comment se prépare l’expérience : dans une chambre dont la température est supérieure à 10°, mettons dans le vase plein d’eau notre œuf vide, dont les trous ont été bouchés avec de la cire, et auquel nous avons suspendu, par un crochet en fil de fer, des pièces de monnaie destinées à le lester suffisamment pour que ce lest ne vienne qu’effleurer le fond du vase, et qu’une très faible diminution de poids fasse remonter l’œuf à la surface du liquide. Ce réglage fait avec soin, mettez le vase en plein air, par une bonne gelée. L’eau se refroidit, la température descend graduellement de 10° (température de la chambre) à 4° au-dessus de 0, et sa densité augmente jusqu’à ce point : aussi voyez-vous l’œuf monter graduellement dans le vase, et rester stationnaire tout le temps que l’eau est à 4° exactement (ce que vous pouvez vérifier avec un thermomètre). L’eau a alors atteint son maximum de densité.
Laissez encore descendre la température de l’eau jusqu’à 0° par exemple, en maintenant le vase dehors ; la densité de l’eau diminue et l’œuf descend au fond.
Rentrez le vase dans la chambre ; vous verrez l’œuf remonter jusqu’au moment où la température de l’eau aura atteint 4° au-dessus de 0, et où l’eau aura atteint de nouveau son maximum de densité, puis, la température du liquide continuant à s’élever, vous voyez l’œuf redescendre au fond du vase, comme au début de l’expérience.
En résumé, vous avez constaté que, soit dans l’eau se refroidissant de 10° à 4°, soit dans l’eau s’échauffant de 0° à 4°, l’œuf monte par suite de l’augmentation de densité de l’eau, et que, dans l’eau ayant exactement 4°, l’œuf reste stationnaire.
Si nous n’opérions pas en hiver, nous abaisserions facilement la température de l’eau, au degré voulu, à l’aide d’un morceau de glace.
LE TIRE-PAVÉ – LA VENTOUSE
Le tire-pavé est, vous le savez, une rondelle de cuir traversée en son centre par une ficelle terminée par un nœud qui bouche exactement le trou, et que vous appliquez, bien humide, sur un pavé en la pressant fortement de façon à chasser tout l’air existant entre le pavé et la rondelle. Si vous tirez verticalement sur la ficelle, vous constatez que le cuir adhère au pavé par suite de la pression atmosphérique ; il est facile de soulever ainsi un pavé très lourd ; de là le nom de l’appareil. À table vous pouvez confectionner, à l’aide d’un modeste radis, un petit tire-pavé fonctionnant parfaitement. Coupez en travers le radis, évidez légèrement l’intérieur dans la partie située du côté de la queue effilée. Frottez-le sur votre assiette en y appliquant exactement cette partie qui forme ventouse (l’humidité naturelle du radis dispense de le mouiller auparavant), puis tirez verticalement sur la queue du radis ; vous enlèverez en même temps votre assiette, comme si les deux corps étaient fortement collés ensemble.
Prenez un verre à boire sans pied, remplissez-le d’eau aux trois quarts, couvrez-le d’un mouchoir en forte toile, dont vous rabattez les bords tout autour, le milieu du mouchoir pénétrant dans le verre de façon à atteindre la surface du liquide. Appliquez fortement la main gauche sur l’ouverture du verre, et retournez-le de la main droite qui le maintiendra en l’air ; les bords du mouchoir seront maintenus dans la main droite, et au-dessus d’une cuvette, pour éviter tout accident. En ôtant votre main gauche, vous constatez non seulement qu’aucune goutte du liquide ne tombe, mais encore que, par l’effet de la pression atmosphérique, le mouchoir conserve sa forme concave à l’intérieur du verre, ainsi que le montre la figure 1 de notre dessin. Si maintenant vous tirez sur les bords du mouchoir, de façon à tendre fortement la toile sur l’ouverture du verre, le liquide reprendra alors sa position horizontale, mais le vide se formera entre ce liquide et le fond du verre, comme le montre la figure n° 2. Or comme disaient les anciens, la nature a horreur du vide ; l’air extérieur se précipite à travers le mouchoir et le liquide, sous forme de bulles qui agitent l’eau pour venir crever à sa surface dans l’intérieur du verre, exactement comme le font les bulles de vapeur dans de l’eau bouillante. L’opérateur sentira les soubresauts imprimés à sa main par cette rentrée des bulles d’air, et les spectateurs entendront distinctement le bouillonnement tumultueux du liquide. Vous pourrez présenter cette expérience d’une façon amusante en annonçant que vous faites bouillir de l’eau froide par la seule chaleur de votre main.
On vous donne une carafe à moitié pleine d’eau, bouchée par un bouchon sous lequel est piquée l’extrémité d’une tige de fil de fer ou d’une aiguille à tricoter ; l’autre extrémité de la tige trempe dans l’eau et arrive à 5 centimètres environ du fond de la carafe. Un bouchon à moutarde, percé en son centre d’un très large trou circulaire, flotte sur le liquide, et la tige de fer passe par ce trou (voir la figure de droite du dessin).
On vous demande de faire sortir de la tige le bouchon qui flotte, et cela sans toucher au bouchon qui ferme la carafe.
La figure de gauche de notre dessin vous indique la solution : faites tourner vigoureusement la carafe en lui faisant décrire sur la table quatre ou cinq cercles, puis abandonnez la carafe à elle-même. Vous constatez que, par l’effet de la force centrifuge, le niveau du liquide cesse d’être horizontal et se creuse en un cône dont le sommet se trouve tout près du fond de la carafe. Le bouchon descend avec l’eau, le long de la tige, et s’en échappe dès qu’il est arrivé à la partie inférieure. Nous avons ainsi en petit l’image d’un navire aux prises avec un cyclone.
Prenez un œuf dur, et placez-le sur une assiette en maintenant son grand axe vertical au moyen de l’extrémité de l’index, appuyé légèrement contre la pointe.
Si vous avez au préalable enroulé quelques tours de ficelle autour de cet œuf et vers son milieu, et que vous tiriez subitement la ficelle, vous imprimez à l’œuf dur un mouvement de rotation analogue à celui d’une toupie, et vous le verrez tourner assez longtemps sur sa pointe dans le creux de l’assiette. Voici une façon nouvelle de faire tenir un œuf sur sa pointe ; vous pourrez l’ajouter à celles que nous avons déjà publiées.
Au lieu d’un œuf tournant tranquillement à la même place, vous pouvez avoir l’œuf sabot qui voyage à travers la chambre sous les coups d’un fouet en ficelle ou mieux en peau d’anguille. Mais ici, comme la coquille de votre œuf ne résisterait pas aux chocs inévitables, je conseille d’employer l’œuf en bois bien connu qui sert pour le raccommodage des bas, et qui voltigera rapidement à travers la chambre si vous le cinglez d’une main ferme.
Présentez au public un verre plein d’alcool et un chapeau haut de forme rempli d’ouate que vous aurez préalablement bien étirée entre vos doigts de manière à lui faire occuper le plus grand volume possible. Annoncez que vous allez faire entrer toute la ouate du chapeau dans le verre d’alcool sans qu’une goutte de liquide en déborde.
Il suffit, pour cela, de prendre la ouate par petits flocons et de l’introduire dans le liquide, dont elle s’imbibe rapidement. Tassez-la progressivement au fond du verre, et, à la grande surprise des spectateurs, vous exécuterez jusqu’au bout, sans faire déborder le verre, l’expérience annoncée, que vous pourrez appeler : un chapeau de ouate dans un verre d’alcool. Cette faculté d’absorption de la ouate pour l’alcool a été utilisée pour la fabrication de réchauds à esprit-de-vin qui peuvent être renversés sans laisser échapper une seule goutte de leur liquide. On évite ainsi toutes chances de brûlures ou d’incendie.
Vous opérez avec un encrier de grandes dimensions et à large ouverture.
Après avoir roulé une feuille de papier blanc en forme de cylindre, vous la plongez dans l’encrier et la retirez ensuite couverte d’encre. Vous posez sur une assiette le morceau ainsi taché, qui prouve que l’encrier est bien plein d’encre noire. Pour remplacer l’encre enlevée par ce papier et remplir l’encrier de nouveau, vous prenez la bouteille d’encre qui est sur la table et en versez le contenu dans votre encrier.
Il s’agit maintenant de tremper dans l’encre une feuille de papier semblable à la précédente, mais de la retirer aussi blanche après l’expérience qu’elle l’était avant. Et, prenant la feuille comme le fait l’opérateur sur notre dessin, vous la plongez bravement dans l’encrier, d’où elle ressort immaculée, au grand ébahissement des spectateurs. Il y a là, bien entendu, une petite supercherie que je vais vous dévoiler ici. L’encrier contient bien de l’encre, mais la bouteille n’en contient pas. C’est une ancienne bouteille d’encre, bien sèche à l’intérieur, dans laquelle vous avez introduit en secret de la colophane finement pulvérisée.
En feignant de verser de l’encre dans l’encrier, vous saupoudrez de colophane la surface de l’encre, et dès lors vous pouvez y introduire sans crainte la feuille de papier à laquelle la colophane forme un enduit protecteur, non mouillé par le noir liquide.
En retirant le papier, donnez-lui une petite secousse qui fera retomber la poudre dans l’encrier, et, si vous avez opéré habilement, personne ne soupçonnera la ruse que vous avez employée.
Nos lecteurs pourront rapprocher de cette expérience celle que nous avons publiée sur la manière de tremper sa main dans l’eau sans la mouiller, et qui est basée sur le même principe scientifique.





























