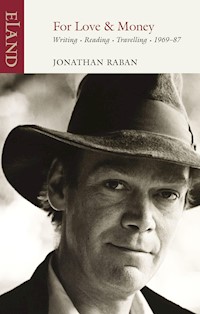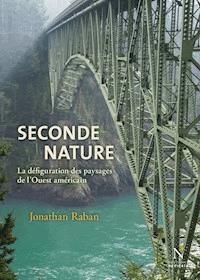
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Partez à la découverte des surprenants paysages de l'Ouest américain Dans ce court tableau, Jonathan Raban nous entraîne des profondes forêts du Pacifique à la vaste plaine du fleuve Columbia, à la recherche de ce que ces immenses paysages révèlent du rapport de l’homme à la nature.Lui, l’écrivain bercé par son enfance dans la douce campage anglaise, est frappé par le rapport qu’entretiennent les Américains avec la nature. « En dépit de l’élevage, des cultures, de l’exploitation forestière et minière, des barrages et des villes construites, la majeure partie de ce qui a défiguré ce coin de l’Amérique a toujours l’air d’être un projet récent, un chantier à ses débuts, qui pourrait encore être arrêté. »Dans ce coin d’Amérique perce le sentiment que si l’homme devait s’en aller, il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que la nature sauvage reprenne sa place… Un voyage au cœur de l’Ouest qui invite à une lecture nouvelle de notre rapport à la natureÀ PROPOS DE L'AUTEURJonatahn Raban (1942) est un écrivain et journaliste anglais, installé depuis une vingtaine d’années à Seattle (USA). Romancier et écrivain-voyageur, il collabore de longue date aux journaux The Guardian, The Independent et la prestigieuse New York Review of Books.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À propos de l’auteur
Jonathan Raban (1942) est un écrivain et journaliste anglais, installé depuis une vingtaine d’années à Seattle (USA).
Romancier et écrivain-voyageur, il collabore de longue date aux journaux The Guardian, The Independent et la prestigieuse New York Review of Books.
En 1959, j’avais alors dix-sept ans, le lac était l’endroit le plus sauvage de mon univers. Dès les premiers jours de l’été, mon ami Jeremy Hooker et moi y arrivions vers 4 heures du matin. Nous dissimulions nos vélos dans le fouillis de branches des rhododendrons et, emmitouflés dans des duffel-coats qui nous donnaient des allures d’existentialistes, nous empruntions l’étroit sentier à travers les taillis à la lueur de nos torches. Même à distance du lac nous marchions sur la pointe des pieds, comme des voleurs, car à nos yeux la carpe était particulièrement sagace et rusée. Nous imaginions le poisson animé d’une profonde aversion pour les humains, ces intrus qui violaient son habitat. Tassés sur nos genoux, nous montions nos cannes à pêche. Dans la nuit que ne troublait pas le moindre souffle de vent, les eaux noires comme l’ébène renfermaient autant de menaces que de promesses. Là, dans les profondeurs, veillait le Léviathan. Ou du moins son timide mais puissant cousin cyprinidé.
Nous pratiquions un style de pêche minimaliste : pas de plomb, pas de flotteur, rien qu’un hameçon dissimulé dans une boulette de mie de pain pétrie, de la taille d’une demi-couronne, au bout de quelque 140 mètres de fil de nylon de pêche. Bien que les poissons du lac pussent atteindre 10 kg, voire davantage, nos lignes n’étaient pas conçues pour résister à une traction de plus de 6 kg, car nous étions convaincus qu’avec son regard affûté, la carpe ne tomberait dans aucun piège tendu au bout d’un trop gros fil ; et encore fallait-il le tremper préalablement dans du thé fortement infusé afin qu’il se confonde avec le fond vaseux.
Avant les premières lueurs de l’aube et les premières roucoulades des ramiers dans les arbres (ils font rrroooo-rrroooo-rrroooo – ce son est comme celui qu’un enfant, le souffle court, tire d’une bouteille en propulsant de l’air dans le goulot), nous lancions au loin nos hameçons appâtés, posions nos cannes dans la fourche d’une branche et pressions une noisette de pâte de mie sur le fil, entre le moulinet en roue libre et le premier anneau de la canne. Si la noisette se mettait à vibrer, ce serait le signe qu’une carpe s’intéressait à l’appât. Le reste n’était qu’observation, attente, le plaisir d’une gorgée de café brûlant contenu dans notre thermos commun et les cigarettes Anchor. Avec des murmures de conspirés, nous causions de livres et de filles.
Lentement, le lac pâlissait. Des filets de brume montaient en spirale de la surface de l’eau et le soleil apparaissait à travers la futaie. C’est le moment que choisissait une grosse carpe pour faire un saut et replonger, pareille à un pavé tombé du ciel. Subsistait d’elle la réminiscence nette de l’or et de l’olive. Nous guettions les signes trahissant les mouvements d’un poisson – feuille d’un nénuphar qui ondule, chapelet de petites bulles remontant à la surface – et, tendus par l’attente, scrutions le moindre tremblement de la noisette de pain.
Le plus souvent, le lac était entièrement à nous. Il se trouvait sur le domaine d’un collège pour garçons – un manoir de style Queen Anne transformé – mais il leur était interdit. Nous considérions le lac, ainsi que la permission que le proviseur nous avait donné d’y pêcher, comme un privilège qui nous était exclusivement réservé. Il ne faisait pas plus d’un petit hectare tout au plus mais, peuplé de rats, de poules d’eau et de bergeronnettes, halte fréquente de hérons et de martins-pêcheurs, et surtout havre d’énormes et mystérieux poissons, il était pour nous un monde en soi, à heureuse distance – quelques kilomètres à l’ouest – de Lymington, dans le comté de Hants.
Le plus souvent, la carpe dédaignait notre appât et nous quittions le lac vers le milieu de la matinée, délestés de quelques Anchors. Les bons jours, généralement après des heures d’attente, la noisette de pain se mettait à vibrer, cessait puis recommençait. Le manège pouvait durer une demi-heure ou davantage. C’est que la carpe, avec sa grande bouche charnue et dépourvue de dents, est un mangeur paisible. Elle fouine les fonds, aspire la vase et s’en gargarise à la recherche de l’une ou l’autre délicatesse, puis expulse la boue dans l’eau, comme un goûteur au-dessus du crachoir.
La noisette de mie se hissait de quelques centimètres vers le premier anneau de la canne puis redescendait lentement. Après, soit il ne se passait plus rien, soit – enfin ! – la ligne se mettait à défiler par les anneaux, s’échappant du tambour fixe du moulinet. C’était le moment de ferrer : lever la cane, rabattre l’arceau sur le moulinet pour se retrouver accroché à ce qui nous semblait une locomotive allant à toute vapeur. La carpe fuyait vers les profondeurs, le fil décrivait un U et la ligne tendue tailladait la surface de l’eau.
La plupart des poissons ayant goûté à nos hameçons étaient perdus au premier saut, dès qu’ils faisaient demi-tour ou en se dissimulant dans les nénuphars. Il arrivait cependant qu’une lutte s’engage et se poursuive vingt exaltantes minutes. Nous n’apercevions la carpe qu’aux tout derniers moments, lorsqu’exténuée elle basculait par le bord de l’épuisette tendue. Arrachée à son élément naturel, la carpe avait un air préhistorique, un cœlacanthe ventripotent. Sa cotte d’écailles dorées, finement ajustées, scintillait au soleil. La capture imprimait à sa bouche un immense O d’effarement et d’indignation. Encore tendus par notre affrontement avec cette créature sortie d’un monde englouti, nous la libérions de son hameçon et la remettions à l’eau.
Plus tard, Jerry a rédigé un beau poème qui évoque ces expéditions. Le titre est Pêche à la tanche au lever du jour (il y avait également des tanches dans le lac, qui, de toute évidence, suscitaient bien plus d’intérêt chez lui que chez moi). L’œuvre finit sur ces mots : « Soudain, lançant la ligne, nous sommes en communion ». En communion, mais avec quoi ? À cette époque-là, nous aurions répondu la nature. Nous nous sentions en communion avec le monde sauvage.
Cependant, en Angleterre, la nature et la culture sont si intimement entrelacées qu’il serait faux de croire qu’on peut les distinguer en deux catégories. Au lac de Walhampton, les deux éléments fusionnaient. À l’origine, le fouillis de rhododendrons où nous dissimulions nos bicyclettes était composé d’espèces venues des Alpes, d’Amérique du Nord et de l’Himalaya, introduites en Angleterre entre le dix-septième et le dix-neuvième siècle. Les carpes furent importées pour la première fois d’Europe de l’Est au début du treizième siècle. Jusqu’à la fermeture du monastère en 1539, Walhampton était un des nombreux avant-postes du puissant prieuré de Christchurch, à Twineham. Le lac était sans aucun doute artificiel – l’étang à poisson des moines élargi à une époque ultérieure – et j’aime imaginer aujourd’hui que nos lourdes carpes n’étaient rien de moins que les descendantes en ligne directe des poissons exotiques de l’élevage des religieux. Les bois environnants avaient été dessinés par des forestiers à la fin du dix-huitième ou au début du dix-neuvième siècle. Nous pêchions dans les eaux profondes façonnées par plusieurs siècles d’ingénierie patiente, de défrichage, d’élevage de poissons et de création de paysage. Nous ne taquinions pas le poisson dans une nature première mais dans une seconde nature.
Comme l’implique le mot anglais landscape (paysage), un pays, un territoire est façonné par l’homme1. L’Angleterre dans son ensemble est un paysage façonné depuis l’âge de la pierre, lorsque les cultivateurs entamèrent sa déforestation. Les derniers arbres de la forêt vierge anglaise furent brûlés par les fabricants de charbon de bois, l’industrie productrice d’énergie, au seizième siècle. Autres exemples anglais : le réseau de lacs et de rivières des Norfolk Broads – menacé d’être rongé par la mer du Nord – n’est autre que les mines à ciel ouvert, aujourd’hui immergées, des tourbiers du Moyen Âge ; les principaux lieux de nidification des oiseaux sont les haies, souvent celles voulues par les Saxons qui plantaient des aubépines ; la moindre des collines anglaises a été consciencieusement tondue par des moutons domestiqués ; les clairières, les buissons et les taillis ne sont que des commodités subsidiées, à l’usage des équipages de chasse à courre. On ne trouve pour ainsi dire plus une parcelle qui n’ait été aménagée pour l’un ou l’autre usage humain.