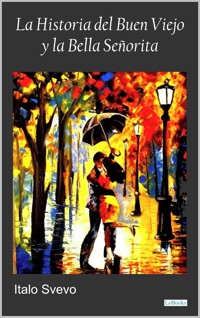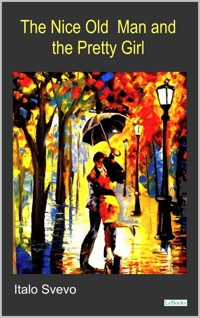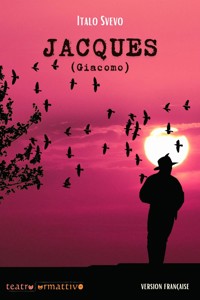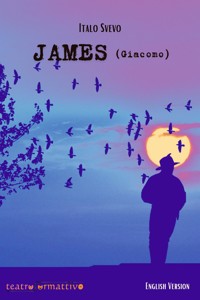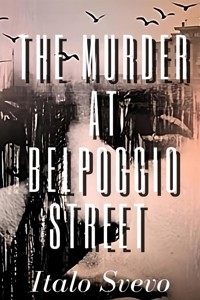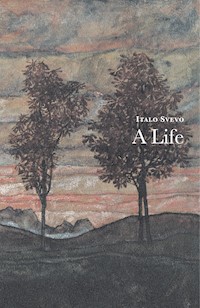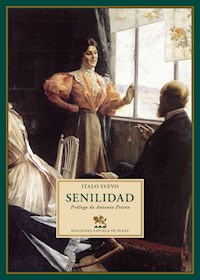Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Senilità", publié en 1898, est un roman d'Italo Svevo qui explore les complexités psychologiques et émotionnelles de son protagoniste, Emilio Brentani. Emilio est un homme de lettres vivant à Trieste, dont la vie est marquée par la routine et une certaine médiocrité. Sa rencontre avec Angiolina, une jeune femme séduisante et libre d'esprit, bouleverse son existence. Le roman suit les tourments intérieurs d'Emilio alors qu'il se débat entre son désir pour Angiolina et sa conscience de l'illusion que représente cette passion. Svevo dépeint avec finesse les contradictions et les incertitudes de son personnage, révélant une profonde introspection sur la nature de l'amour, du désir et de la vieillesse. À travers une écriture subtile et introspective, l'auteur met en lumière les tensions entre les aspirations intellectuelles et les réalités émotionnelles, offrant une analyse pénétrante de l'âme humaine. "Senilità" est considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature italienne, marquant un tournant dans la représentation des états d'âme et des conflits intérieurs. L'AUTEUR : Italo Svevo, de son vrai nom Ettore Schmitz, est né le 19 décembre 1861 à Trieste, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Issu d'une famille juive germanophone, il grandit dans un environnement multiculturel qui influencera son oeuvre. Après des études commerciales en Allemagne, Svevo retourne à Trieste où il travaille dans la banque de son père avant de se tourner vers l'écriture. Son premier roman, "Una vita", publié en 1892, passe inaperçu, tout comme "Senilità" en 1898. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, grâce à l'encouragement de son ami James Joyce, que Svevo reprend l'écriture et publie "La coscienza di Zeno" en 1923, qui lui apporte enfin la reconnaissance littéraire. Svevo est reconnu pour sa capacité à sonder la psyché humaine, adoptant souvent une approche introspective et analytique. Ses oeuvres, influencées par la psychanalyse et son amitié avec Joyce, sont aujourd'hui considérées comme précurseurs du roman moderne. Italo Svevo meurt le 13 septembre 1928, laissant derrière lui une contribution inestimable à la littérature du XXe siècle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
I
Tout de suite, par les premiers mots qu’il lui adressa, il tint à la prévenir qu’il ne voulait pas s’engager dans une liaison trop sérieuse. Voici à peu près ce qu’il lui dit : « Je t’aime beaucoup et, dans ton intérêt, je désire que nous nous mettions d’accord pour agir avec une extrême prudence. » Phrase si prudente en vérité qu’il était difficile de la croire inspirée par l’amour d’autrui. Avec un rien de franchise, elle fût devenue : « Tu me plais beaucoup, mais dans ma vie tu ne pourras jamais avoir d’autre importance que celle d’un jouet. J’ai des devoirs, moi ! J’ai ma carrière, j’ai ma famille… »
Sa famille ? Une unique sœur, aussi peu encombrante que possible, physiquement et moralement, petite et pâle, plus jeune que lui de quelques années, mais plus vieille par son caractère – ou peut-être par destin. Des deux, c’était lui l’égoïste, l’être jeune. Elle ne vivait que pour lui, avec l’abnégation d’une mère. Néanmoins, quand il parlait d’elle, on sentait qu’elle occupait une grande place dans sa vie, que son sort était lié au sien, pesait sur le sien. Les épaules chargées de cette lourde responsabilité, il traversait l’existence avec précaution, évitant les périls, mais laissant aussi de côté les joies. À trente-cinq ans son âme était en proie, encore, à l’amertume de n’y avoir pas goûté ; il éprouvait une grande peur de lui-même et de sa propre faiblesse – dont à vrai dire il avait plutôt conçu le soupçon qu’il n’en avait fait l’expérience.
Sa carrière était chose plus complexe : elle comportait deux ordres d’activités et tendait à deux fins bien distinctes. D’un modeste emploi dans une compagnie d’assurances, Émilio Brentani tirait tout juste l’argent nécessaire à l’entretien de son petit ménage. Quant à son second métier, celui d’écrivain, il ne lui rapportait d’autre bénéfice qu’un semblant de réputation, de quoi satisfaire non pas une ambition certes, mais une vanité. À vrai dire, il lui coûtait encore moins d’effort que le premier. Depuis le temps déjà lointain où il avait publié un roman que la presse locale avait couvert d’éloges, il n’avait plus rien produit. Non par défiance de soi ; par inertie plutôt. Le roman, imprimé sur mauvais papier, avait jauni en d’obscures librairies, mais, tandis que sa publication avait été saluée comme une « grande espérance », il valait maintenant, par lui-même, à son auteur une sorte de bon renom littéraire et figurait au bilan artistique de la ville. Le premier jugement n’avait pas été rapporté : il s’était modifié par une lente évolution.
La très claire conscience qu’avait Émilio de la nullité de son œuvre l’empêchait de se faire gloire du passé, mais l’artiste chez lui, tout ainsi que l’homme, croyait en être toujours à la période « préparatoire » ; au plus secret de son cœur, il se considérait comme un puissant mécanisme génial en construction, non encore en activité. Comme si le temps des belles énergies n’était pas, pour lui, révolu, il vivait dans l’attente impatiente de deux choses : l’une devait surgir de son cerveau, l’autre lui viendrait du dehors. L’art était la première et la seconde était le succès – la fortune.
Angiolina – une blonde aux yeux bleus, grande, forte, mais d’une taille élancée et flexible, le visage illuminé de vie, la peau ambrée, avec un fond de teint rose, signe d’une santé florissante – marchait à côté de lui la tête penchée sous le turban d’or de sa chevelure ; elle regardait le sol qu’elle frappait à chaque pas du bout de son ombrelle comme pour en faire jaillir un commentaire aux paroles qu’elle entendait. Quand elle crut avoir compris, elle dit avec un regard en dessous, un peu timide : « C’est étrange ! jamais personne ne m’a parlé ainsi. » Mais elle n’avait pas compris vraiment et elle se sentait flattée de voir Émilio assumer une tâche qui n’était pas la sienne : celle d’éloigner d’elle le péril. L’affection qu’il lui portait eut soudain à ses yeux un air de fraternelle douceur.
Ces principes une fois posés, l’autre se sentit tranquille et reprit un ton plus adapté à la circonstance. Il laissa tomber sur la tête d’Angiolina une pluie de déclarations lyriques – belles phrases mûries par son désir et affinées au cours des ans, mais qui, à les dire, lui semblaient aussi fraîches et neuves que si elles fussent nées en cet instant, sous le rayon de cet œil bleu. Il éprouva que depuis très longtemps il n’avait plus cherché à tirer de lui-même et à composer des idées et des mots. Quel soulagement que ce retour à une action créatrice ! Diversion dans sa morne existence ; étrange sentiment d’une halte, d’une paix retrouvée. La femme entrait dans sa vie. Rayonnante de beauté et de jeunesse, elle allait l’illuminer tout entière, plongeant dans l’oubli un triste passé de désirs et de solitude et ouvrant un avenir de joie. Certes non, elle ne compromettait pas son avenir !
Il s’était approché d’elle pensant trouver l’occasion d’une aventure facile et brève, pareille à tant d’autres dont il avait entendu le récit et dont il ne jugeait que par ouï-dire, car, ses aventures à lui, ce n’était pas la peine d’en parler. Mais celle-ci, réellement, s’annonçait facile et brève. L’ombrelle était tombée juste à temps pour lui fournir une entrée en matière, et même (cela semblait une malice du sort !) elle s’était si bien accrochée à tous ces volants à jours qu’il n’avait pu l’en détacher qu’au prix de contacts ostensibles. Ensuite, il est vrai, devant ce profil étrangement pur et cette santé magnifique – pour les rhéteurs de son espèce, dépravation et santé sont inconciliables – il avait mis un frein à son premier élan ; il avait eu peur de faire fausse route et, déjà satisfait, déjà heureux, il s’était attardé dans la contemplation de ce mystérieux visage aux lignes précises et douces.
Elle lui avait peu parlé d’elle-même cette première fois ; et le peu qu’elle avait dit, il ne l’avait pas entendu, absorbé qu’il était par son propre sentiment. Elle devait être pauvre, très pauvre ; mais pour le moment – elle l’avait déclaré avec un certain orgueil – elle n’avait pas besoin de travailler pour vivre. Tant mieux. L’aventure n’en serait que plus agréable : là où nous cherchons le plaisir nous n’aimons guère voir rôder la faim. Émilio ne poussa donc pas plus loin son enquête. N’en savait-il pas assez pour être rassuré pleinement ? Si l’enfant, comme le donnait à croire son œil limpide, était honnête, ce ne serait pas lui qui s’exposerait au péril de la corrompre ; si au contraire les apparences le trompaient, eh bien, il ne s’en plaindrait pas. Dans les deux cas il y avait du plaisir à prendre ; dans aucun des deux il n’y avait de danger à courir.
Angiolina n’avait pas entendu grand-chose aux prémisses du discours d’Émilio, mais elle n’avait visiblement pas besoin qu’on lui en expliquât les conclusions : les termes les plus difficiles étaient dits sur un ton qui leur ôtait tout caractère d’ambiguïté. Les couleurs de la vie reparurent sur son beau visage, et sa main, grande mais d’une forme pure, ne se refusa point à un très chaste baiser.
Ils s’arrêtèrent sur la terrasse de Sant’Andrea et, longuement, regardèrent vers la mer calme, colorée aux seuls feux des étoiles, par cette nuit claire et sans lune. Au-dessous d’eux, sur le boulevard, une charrette passa et, dans le grand silence qui les environnait, ils suivirent très longtemps le bruit des roues sur le sol inégal, bruit de plus en plus faible, qu’ils se firent un jeu d’écouter jusqu’au moment où il se résorba dans le silence universel. Ils constatèrent en souriant qu’ils avaient tous deux cessé juste en même temps de l’entendre. « Nos oreilles vont bien d’accord », dit Émilio.
Il s’était expliqué. Il n’éprouvait plus aucun besoin de parler et ne sortit plus de sa méditation muette que pour murmurer : « Qui sait si cette rencontre nous portera bonheur ?… » Il ne jouait pas la comédie. Quelque chose en lui le poussait à exprimer ce doute.
« Qui sait ? » dit-elle à son tour, en s’efforçant de rendre, dans sa propre voix, l’émotion qu’elle avait perçue dans celle d’Émilio.
Il sourit encore, mais d’un sourire, cette fois, qu’il crut bon de dissimuler. Après les conditions qu’il avait posées, comment diable leur rencontre pourrait-elle porter bonheur à la pauvre fille ?
Ils se dirent au revoir. Elle ne voulut pas qu’il l’accompagnât en ville et lui, incapable de se détacher d’elle tout à fait, la suivit à quelque distance. Oh ! la charmante silhouette ! Sur le pavé légèrement boueux et glissant, elle marchait, tranquille et d’un pas sûr, dans toute la force de son robuste organisme. Que de puissance et que de grâce unies dans ces mouvements de félin, justes et prompts !
Le hasard voulut que, dès le lendemain, il en apprît sur le compte d’Angiolina beaucoup plus qu’elle ne lui en avait confié.
Il la croisa sur le Corso, à midi. Bonheur imprévu qui lui inspira un salut plein d’emphase, un grand geste qui porta son chapeau à deux doigts du sol. Elle répondit par une légère inclination de la tête, accompagnée il est vrai d’une brillante, d’une magnifique œillade.
Un certain Sorniani, petit homme jaune et maigre, grand coureur de femmes, disait-on, toujours prêt d’ailleurs à s’en vanter et à nuire, par ses bavardages, à la bonne renommée d’autrui, sans parler de la sienne propre, s’accrocha au bras d’Émilio et lui demanda comment il avait fait la connaissance de cette fille. Les deux hommes, amis d’enfance, ne s’étaient pas adressé la parole depuis des années. Il avait fallu qu’une jolie femme passât entre eux pour que s’éveillât chez Sorniani le désir de renouer avec son ancien camarade.
— Je l’ai rencontrée chez des amis, répondit Émilio.
— Et que fait-elle maintenant ?
Le ton de cette question signifiait que Sorniani en savait long sur le passé d’Angiolina et qu’il était vraiment fâché d’être moins instruit du présent.
— Mais je n’en sais rien, dit Émilio. (Et il ajouta avec une indifférence bien jouée :) Elle m’a fait l’impression d’une honnête fille.
— Pas si vite ! jeta Sorniani résolument comme pour affirmer le contraire. (Il corrigea ensuite cette exclamation, mais après une courte pause :) Je n’en sais pas plus que toi. Quand je l’ai connue, tout le monde la considérait comme honnête, bien que déjà elle se fût trouvée dans une situation un peu équivoque.
Sans qu’Émilio eût besoin de le stimuler davantage, il raconta comment la pauvrette avait passé à côté de la fortune : une aventure qui promettait d’être très heureuse et qui était devenue, par sa faute ou par celle d’autrui, un vrai désastre. Dans sa jeunesse, elle avait inspiré un profond amour à un certain Merighi, très bel homme (Sorniani le reconnaissait, encore qu’il ne fût guère à son goût) et négociant aisé. Ce Merighi donc lui avait fait la cour dans les intentions les plus honnêtes ; il l’avait enlevée à sa famille qu’il tenait en médiocre estime et avait réussi à l’installer chez sa mère à lui. « Chez sa propre mère ! Quel imbécile ! » hurlait Sorniani, dont le plus pressant désir était de faire apparaître Merighi comme un sot et Angiolina comme une fille de rien. « Il lui était pourtant facile de satisfaire son caprice n’importe où, ailleurs que sous les yeux de sa mère… Quelques mois plus tard, Angiolina revint chez ses parents qu’elle n’aurait jamais dû abandonner, et Merighi, avec sa mère, quitta la ville en laissant croire que des spéculations hasardeuses l’avaient appauvri. D’autres donnèrent de son départ une explication un peu différente : Mme Merighi aurait été informée d’une aventure scandaleuse d’Angiolina et aurait chassé cette fille de sa maison. »
Toujours sans qu’on l’en priât, Sorniani improvisa quelques variations sur ce thème. Mais comme un tel sujet, manifestement, l’excitait et qu’il s’y complaisait d’une façon suspecte, Brentani ne voulut retenir de ses discours que ce qui lui parut vraiment digne de foi, c’est-à-dire l’exposé de faits qui devaient être notoires. Il avait connu de vue ce Merighi et il gardait le souvenir de sa haute stature d’athlète. C’était bien l’homme qu’il fallait à Angiolina. Il se rappelait aussi avoir entendu parler de lui, et sans indulgence, comme d’un idéaliste du commerce : un garçon trop audacieux qui se croyait capable de conquérir le monde. Enfin, par des personnes avec lesquelles son service le mettait quotidiennement en rapport, il avait su que cette audace avait coûté cher à Merighi et qu’il en était arrivé à devoir liquider son affaire dans des conditions désastreuses. Sorniani prêchait dans le désert, car Émilio était en mesure de reconstituer les événements avec exactitude : Merighi, à demi ruiné, avait perdu confiance ; le courage de fonder une famille lui avait manqué et Angiolina, dont il rêvait de faire une riche bourgeoise et une femme sérieuse, allait devenir un simple jouet entre les mains d’Émilio. Ce dernier en conçut une profonde compassion.
Sorniani avait été témoin de certaines manifestations de l’amour de Merighi. Souvent il l’avait vu, le dimanche, sous le porche de Saint-Antoine-le-Vieux, attendre longuement, absorbé dans la contemplation de cette tête blonde qui brillait dans la pénombre, qu’Angiolina, agenouillée devant l’autel, eût terminé ses prières.
— Deux adorations, murmura, tout ému, Brentani qui comprenait aisément quelle tendresse clouait ainsi Merighi sur le seuil de l’église.
Et Sorniani de conclure :
— Un imbécile.
Les révélations de Sorniani accrurent aux yeux d’Émilio l’importance de sa bonne fortune. Il attendit dans la fièvre le jeudi où il devait retrouver Angiolina, et l’impatience lui délia la langue.
Dès le lendemain, son ami le plus intime, un sculpteur du nom de Balli, fut au courant de tout.
— Et pourquoi, demandait Émilio, ne prendrais-je pas un peu de bon temps moi aussi, quand je puis le faire à si peu de frais ?
Balli l’écouta jusqu’au bout sans cacher son ahurissement. Depuis dix ans il connaissait Brentani et jamais il ne l’avait vu s’échauffer à propos d’une femme. Il mesura aussitôt le danger qui menaçait son ami et lui exprima son inquiétude.
L’autre protesta :
— En danger, moi ? À mon âge ? Avec mon expérience ?
Brentani parlait volontiers de son expérience, mais ce qu’il croyait en droit de nommer ainsi n’était qu’un sentiment, puisé aux livres, de grande méfiance et de grand mépris à l’égard de ses semblables.
Balli au contraire avait mieux employé ses quarante ans sonnés, et son expérience à lui le rendait plus apte à juger celle d’Émilio. Et Émilio, qui des deux était le plus cultivé, acceptait néanmoins et même voulait que Balli exerçât sur lui une sorte d’autorité paternelle, car, en dépit d’une destinée un peu grise mais sans orages et d’une vie sans imprévu, il avait besoin d’être étayé de toutes parts pour se sentir en sûreté.
Stefano Balli était un homme robuste et de haute taille. Les yeux bleus, le regard juvénile, la face bronzée : un de ces visages qui ne vieillissent pas. Des traits nets, un peu durs même. Une barbe en pointe, bien taillée. Seule marque de l’âge : ses cheveux châtains grisonnaient aux tempes. Chaque fois que l’animait la curiosité ou la compassion, son œil observateur se faisait très doux ; il devenait très dur, en revanche, dans la lutte et dans la discussion la plus futile.
Le succès ne lui avait pas souri à lui non plus. Maintes fois, en refusant ses ébauches, des jurys en avaient loué tels ou tels morceaux ; mais pas un de ses ouvrages n’avait eu l’honneur d’être érigé sur quelqu’un d’entre les innombrables places dont l’Italie est couverte. Jamais, pourtant, l’échec ne l’avait abattu. L’estime d’un petit groupe d’artistes lui suffisait ; il pensait que sa manière originale était le seul obstacle qui l’empêchât de conquérir la célébrité, d’atteindre les foules ; et il continuait à suivre sa voie, tendant à un certain idéal de spontanéité, de rudesse voulue, de simplicité ou encore, comme il disait lui-même, à une « clarté » propre à faire surgir son « moi » artistique épuré, dépouillé de toute idée et de toute forme étrangère. Enfin il n’admettait pas que le jugement des autres pût le diminuer à ses propres yeux. Mais toutes ces belles raisons ne l’auraient pas sauvé du découragement si un succès d’un autre genre, un succès personnel inouï ne lui avait donné des satisfactions qu’il dissimulait, qu’il niait au besoin, mais qui n’en contribuaient pas moins à lui faire tenir l’échine droite et mettre en valeur sa taille bien prise. Encore qu’en véritable ambitieux, il fût incapable d’aimer, l’amour des femmes était pour lui quelque chose de plus qu’une satisfaction de vanité. Il y trouvait le « succès » – ou quelque chose d’approchant : pour l’amour de l’artiste, les femmes s’éprenaient de l’œuvre, si peu faite qu’elle fût pour leur plaire. Ainsi, aimé, admiré, et profondément sûr de son génie, il gardait avec un parfait naturel son attitude d’homme supérieur. En art, il émettait des jugements sévères et imprudents ; en société, il avait des allures plutôt brusques. Il plaisait peu aux hommes et ne recherchait pas leur compagnie, exception faite pour ceux auxquels il avait su s’imposer.
Quelque dix ans plus tôt, il s’était trouvé dans les jambes Émilio Brentani, alors tout jeune – un égoïste lui aussi, mais un égoïste moins heureux – et s’était pris d’affection pour lui. D’abord, l’admiration d’Émilio le flatta ; l’habitude fit le reste. Une solide amitié fut nouée, amitié que Balli marqua de son empreinte et qui devint plus intime que le prudent Émilio ne l’eût souhaité. Le sculpteur, qui avait peu d’amis, ne concevait l’amitié que sous la forme d’une intimité étroite. Leur commerce intellectuel restait limité au domaine des arts plastiques. Un seul idéal était admis, celui de Balli : reconquête de la simplicité, de l’ingénuité perdues par la faute des prétendus « classiques ». Là-dessus les deux hommes s’étaient mis d’accord parfaitement et d’ailleurs facilement. L’un enseignait, l’autre n’était pas même en mesure d’apprendre. Jamais un mot entre eux des théories littéraires compliquées d’Émilio, pour cette bonne raison que Balli détestait tout ce qu’il ignorait. Émilio subissait jusque dans sa démarche, dans sa façon de parler, dans ses gestes, l’influence de son ami ; Balli, en vrai mâle, ne se laissait pas entamer et, auprès d’Émilio, il pouvait garder l’illusion d’avoir à ses côtés une des nombreuses femmes qu’il avait soumises.
— De fait, prononça-t-il, après avoir entendu le récit détaillé d’Émilio, je ne crois pas qu’il y ait grand risque. Une ombrelle qui tombe si à propos, un rendez-vous si vite accordé, voilà qui suffit à fixer le caractère de l’aventure.
— Très juste, acquiesça Émilio, sans avouer cependant qu’il n’avait attaché aucune importance à ces deux petits faits, lesquels, mis en relief par Balli, le surprenaient même comme des faits nouveaux. Tu crois donc que Sorniani avait raison ?
Il n’avait pas encore rapproché la chute de l’ombrelle et le rendez-vous des révélations de Sorniani !
— Tu me la présenteras, dit Balli sans se compromettre, et puis nous jugerons.
Brentani ne sut pas davantage se taire en présence de sa sœur.
Mlle Amélie n’avait jamais été belle. Longue, sèche, incolore – Balli disait qu’elle était née grise –, elle ne possédait d’autres grâces que deux mains admirables pour leur blancheur, leur finesse et leur galbe, auxquelles elle consacrait tous ses soins.
C’était la première fois qu’il lui parlait d’une femme et Amélie l’écoutait, les traits altérés par la surprise. Il lui tenait des discours qu’il croyait honnêtes et chastes mais qui, dans sa bouche, trahissaient le désir. Il n’avait pas dit trois mots que déjà elle répétait avec épouvante l’avertissement de Balli : « Attention ! Pas de folies au moins ! »
Puis elle voulut tout savoir et Émilio crut possible de lui confier quelle félicité il avait éprouvée en ce premier soir sans pour cela lui faire part de ses projets et de ses espérances. Il ne s’apercevait pas qu’il prononçait des paroles dangereuses. Elle tendait l’oreille tout en servant et desservant la table, muette et prompte, afin qu’il n’eût pas à interrompre son récit pour demander ceci ou cela. L’esprit pareillement avide, elle avait lu les quelques centaines de romans qui encombraient la vieille armoire transformée en bibliothèque, mais le charme qu’elle subissait à présent était d’une tout autre nature, et elle s’en rendait bien compte. Elle ne s’intéressait plus, lectrice passive, à un destin étranger. Son propre destin était en jeu. L’amour entrait chez elle avec son cortège de soucis et de douleurs. D’un souffle, il dissipait la pesante atmosphère de cette maison où, inconsciente, elle avait passé sa vie ; elle regardait en elle-même, se découvrait avec étonnement et se demandait pourquoi, étant ainsi faite, elle n’avait pas encore désiré les joies et les souffrances de la passion. Dans la même aventure, le frère et la sœur étaient emportés.
II
Malgré l’obscurité, il la reconnut tout de suite, au détour du Champ-de-Mars. Désormais, il l’eût reconnue rien qu’à voir son ombre s’avancer de ce mouvement sans heurts, et donc sans rythme, comparable au mouvement d’un objet porté d’une main sûre, avec une amoureuse précaution. Il courut à sa rencontre et, à l’aspect de son visage au teint si étrange, intensément et partout également coloré, il sentit s’élever du plus profond de son être un hymne de joie. Elle était venue, et, quand elle s’appuya à son bras, il lui sembla qu’elle se donnait tout entière.
Il la conduisit vers la mer, loin de l’avenue où erraient encore de rares passants. Sur la plage ils goûtèrent leur solitude. Sans plus attendre, il aurait voulu l’embrasser, mais il n’osait pas ; elle ne disait rien pourtant et souriait d’un engageant sourire. La seule pensée qu’avec un peu d’audace il pouvait poser ses lèvres sur cette bouche ou sur ces yeux l’émouvait au point de lui ôter le souffle.
— Oh ! pourquoi avez-vous tant tardé ? J’avais peur que vous ne veniez plus.
Il se plaignait, bien qu’il eût déjà oublié tout ressentiment. Certains animaux, en amour, éprouvent ainsi le besoin de se lamenter. Il voulut exposer ses griefs, mais ne put mieux faire que de proférer ces mots joyeux : « Je n’arrive pas à croire que vous êtes ici, à côté de moi. » La réflexion lui donnait le sentiment de son bonheur : « Je ne pensais pas qu’il fût possible de vivre une soirée plus belle que notre soirée de la semaine passée. » Et maintenant qu’il commençait à jouir de sa conquête, il ressentait une joie jusqu’alors inconnue.
Trop vite on en arriva au baiser, car, après l’élan de la première étreinte, il se serait contenté de rêver en la regardant. Mais elle comprenait encore moins les sentiments d’Émilio que lui ne comprenait les siens. Il avait osé une caresse timide sur les cheveux : « De l’or », murmurait-il. Et de l’or aussi sa chair, toute sa personne. Il estimait de la sorte avoir tout dit, mais Angiolina n’eut pas cette impression. Elle demeura un instant pensive, puis parla d’une dent qui lui faisait mal : « Ici ! » et elle présenta sa bouche très pure, ses gencives rouges, ses dents blanches et solides, écrin de pierres précieuses enchâssées et distribuées par un artisan inimitable : la santé. Il ne rit pas ; il baisa gravement la bouche offerte.
Cette vanité infinie, dès lors qu’il en profitait, ne l’inquiétait guère ; il ne s’en aperçut même point. Lui qui, pareil en cela à tous ceux qui ignorent la vie, s’était attribué la force du génie le plus altier et l’indifférence du pessimiste le plus convaincu, contemplait maintenant autour de lui le décor de ce grand acte.
Un décor passable. La lune n’était pas encore levée mais là, en face d’eux, la mer scintillait comme par un effet tardif de la lumière qu’elle avait reçue du soleil. À droite et à gauche, au contraire, l’azur des promontoires lointains plongeait dans la plus sombre nuit. Tout semblait énorme et sans mesure, et l’unique mouvement perceptible était la couleur de la mer. Émilio eut le sentiment qu’à cette heure, en ce vaste désert nocturne, il était le seul être qui agît et qui aimât.
Il parla de ce qu’il avait appris par Sorniani et finit par questionner Angiolina sur son passé. Elle se fit aussitôt une mine très sérieuse et raconta sur un ton dramatique sa liaison avec Merighi. Abandonnée ? L’expression n’était pas tout à fait juste, puisque c’était elle qui avait prononcé le mot décisif et libéré Merighi de ses engagements. Il est vrai qu’il l’avait tourmentée de toutes les manières, lui laissant entendre qu’on la considérait dans la famille comme un boulet à traîner. La mère de Merighi (oh ! cette vieille ronchonneuse, mauvaise et étouffée par la bile !) avait vidé sans phrases le fond du sac : « Tu es notre malheur ! Sans toi, qui sait quelle riche dot trouverait mon fils ! » Alors, de son propre chef, elle abandonna cette maison, elle retourna chez sa mère – ce dernier mot fut prononcé avec toute la douceur voulue – et, peu après, elle devint malade de chagrin. La maladie lui fut d’ailleurs un soulagement ; la fièvre apporte l’oubli.
Puis elle voulut savoir qui avait renseigné Émilio. « Sorniani. »
Ce nom, d’abord, ne lui dit rien, mais presque aussitôt elle s’exclama en riant : « Ah ! oui, cette vilaine face jaune qu’on voit toujours avec Leardi… »
Donc, elle connaissait aussi Leardi. Un garçon qui faisait ses premières armes mais qui y allait d’un tel cœur que toute la ville le considérait déjà comme un viveur de la grande espèce. Merighi le lui avait présenté il y avait des années de cela, quand tous trois étaient encore presque des enfants. Ils avaient joué ensemble. « Je l’aime beaucoup », conclut-elle avec une franchise qui donnait à ses propos un bel air de sincérité. Et Brentani, déjà inquiet de voir apparaître à l’horizon le redoutable Leardi, se rassura à ce simple aveu. « Pauvre enfant, pensa-t-il, honnête et sans malice ! »
Puis il eut une idée géniale : avec un peu d’honnêteté en moins et un peu de malice en plus, ce serait une femme accomplie. Pourquoi ne pas faire son éducation ? En échange de l’amour qu’elle lui donnerait, il lui apprendrait à jouir de l’existence. Précieux apprentissage car, à cette enfant, parée de tant de beautés et de grâces, il ne manquait que la direction d’un maître habile. Une fois instruite, comment ne sortirait-elle pas victorieuse de toutes les luttes ? Grâce à lui, elle saurait conquérir par ses propres forces la fortune qu’il ne pouvait lui donner. Il voulut sans retard lui confier une partie des projets qui lui passaient par la tête. Il interrompit ses baisers, suspendit ses cajoleries et, pour lui enseigner le vice, prit la mine sévère d’un professeur de vertu.
Il se mit à parler de lui-même avec ironie, suivant sa vieille habitude. Il la plaignit d’être tombée aux mains d’un homme de sa sorte, pauvre d’argent, non moins pauvre d’énergie et de courage. Car s’il avait eu du courage – à cette première déclaration d’amour sérieuse une profonde émotion altéra sa voix – il aurait pris la blonde Angiolina entre ses bras, l’aurait serrée sur sa poitrine et l’aurait emportée à travers l’existence. Mais non ! Il ne se sentait pas de force à tant oser. Oh ! la misère à deux ! Quelle chose horrible ! C’était le plus douloureux des esclavages. Il la redoutait, pour elle comme pour lui.
À ce mot elle l’arrêta :
— Moi, je n’aurais pas peur.
Il eut l’impression qu’elle voulait le prendre au collet et le jeter dans cette condition si affreuse.
— Aux côtés d’un homme que j’aimerais, je saurais supporter la pauvreté avec résignation.
— Eh bien, moi, je ne pourrais pas, dit-il après un court silence, feignant d’avoir un instant hésité. Je me connais. Dans la gêne, je ne serais même pas capable d’aimer.
Et après une deuxième pause, il ajouta d’une voix grave et profonde : « Non, jamais ! » tandis qu’elle le regardait, sérieuse, le menton appuyé au manche de l’ombrelle.
La question ainsi réglée, il remarqua (c’était là un moyen de commencer son éducation) qu’il eût été bien préférable pour elle qu’elle se fût liée avec un autre des cinq ou six jeunes gens qui, le jour de leur rencontre, l’avaient admirée comme lui : avec Carlini qui était riche, avec Bardi qui gaspillait, le sourire aux lèvres, les derniers restes de sa jeunesse et de sa grosse fortune, avec Nelli, homme d’affaires – et qui en faisait d’excellentes. Chacun d’eux, d’une manière ou de l’autre, valait plus que lui.
Pour le coup, elle trouva la note juste : elle se déclara offensée ! Sans doute on voyait trop que son courroux était voulu, et Émilio fut forcé de s’en apercevoir ; mais il ne lui tint pas rigueur de cette feinte. Par un trémoussement de toute sa personne, elle simulait un violent effort pour se détacher de lui, mais cette violence ne gagnait pas ses bras, par lesquels il la retenait et qui demeuraient inertes sous son étreinte. Il finit par les laisser libres, ne les enchaînant plus que par des baisers.
Il lui demanda pardon. Il s’était mal expliqué. Bonne raison pour redire en d’autres termes ce qu’il avait déjà dit. Elle ne releva pas cette nouvelle offense mais elle affecta quelques instants le ton du reproche :
— Je ne veux pas que vous pensiez qu’il m’aurait été indifférent d’être abordée par l’un ou l’autre de ces messieurs. Je ne leur aurais même pas permis, à eux, de m’adresser la parole.
Lors de leur premier entretien, ils s’étaient vaguement souvenus de s’être rencontrés une fois, en ville, l’année d’avant. Donc, concluait Angiolina, il n’était pas pour elle « le premier venu ».
— Moi, je vous méritais, fit Émilio d’un ton pénétré, et c’est tout ce que j’ai voulu dire.
Alors seulement il parvint à parler de ces choses qui devaient être si utiles à Angiolina. Il la trouvait trop désintéressée. Il l’en plaignit. Une fille de sa condition n’avait pas le droit de compter pour rien son intérêt. Qu’est-ce que l’honnêteté en ce monde ? C’est l’intérêt ! Les femmes honnêtes sont celles qui savent trouver acquéreur au plus haut prix, celles qui n’accordent leur amour que si elles y retrouvent leur compte. En discourant ainsi, il s’admirait. Il était bien l’esprit supérieur qui, par-delà toute morale, voit et veut les choses comme elles sont. La puissante machine à penser qu’il se flattait d’être sortait enfin de son inertie. Une onde d’orgueil gonflait sa poitrine.
Étonnée, attentive, Angiolina était suspendue à ses lèvres. Pour elle, elle avait toujours cru qu’honnête femme avait le même sens que femme riche : « Oh ! alors ces dames qui font tant les fières sont faites ainsi ? » Puis, le voyant étonné à son tour, elle se reprit, se rétracta. Mais s’il avait été aussi fin observateur qu’il le prétendait, il se serait aperçu que, maintenant, elle ne comprenait plus rien à l’objet de la conversation.
Il résuma ses idées et les commenta. L’honnête femme sait se mettre à haut prix : c’est là son secret. L’honnêteté est nécessaire – ou du moins les semblants de l’honnêteté. Il était déjà regrettable que Sorniani pût parler d’elle légèrement, très regrettable qu’elle déclarât « aimer beaucoup » Leardi – ici sa jalousie se donna libre cours –, ce coureur de femmes, compromettant comme pas un. Mieux valait mal faire que d’en avoir l’air.
Elle oublia aussitôt les idées générales qu’il développait pour se défendre vigoureusement contre ces attaques directes. Sorniani n’était pas à même de la diffamer ; quant à Leardi, c’était un gamin pas compromettant du tout.
Pour ce premier soir la leçon s’arrêta là, car il pensait qu’une médecine aussi énergique devait être ingurgitée par petites doses. Il estimait en outre avoir déjà fait un grand sacrifice en renonçant pour quelques instants à l’amour.
Le nom d’Angiolina choquait son oreille sensible d’homme de lettres. Il l’abrégea en Lina. Puis, mal satisfait de ce diminutif, il se rejeta sur la forme française Angèle qui, bien des fois, devenait simplement Ange. Il essaya de lui faire dire en français qu’elle l’aimait. Elle ne voulut pas, mais elle retint la formule et, à leur rendez-vous suivant, elle lui déclara avant qu’il le lui eût demandé : Che tèm bokou.
Il ne s’étonnait point d’avoir si vite atteint son but. La réalité répondait trop à son désir. Angiolina le trouvait si raisonnable qu’elle croyait pouvoir se fier à lui, et de fait, elle n’eut pas, de longtemps, l’occasion de lui refuser quoi que ce fût.
Ils se retrouvaient toujours dehors. Ils se parlèrent d’amour dans toutes les rues de la banlieue de Trieste. Après leurs premiers rendez-vous, ils renoncèrent à Sant’Andrea, trop fréquenté et donnèrent quelque temps la préférence à la rue d’Opicina – pente presque insensible, solitaire, large, bordée de marronniers touffus. Ils allaient jusqu’à un mur bas où, une fois, ils s’étaient assis et qui, dès lors, devint le but de leurs promenades. Ils s’embrassaient longuement. La ville s’étendait à leurs pieds, muette et morte comme la mer. De là-haut ils ne découvraient qu’une grande étendue aux couleurs mystérieuses et indistinctes ; dans l’immobilité et le silence, ville, mer et collines semblaient ne faire qu’un bloc bizarrement taillé dans la même matière, coupé de lignes droites et ocellé de points jaunes : les lumières des rues.
La lune, à son lever, n’altérait pas la couleur du paysage. Les objets, aux contours devenus plus précis, ne s’illuminaient pas, mais se voilaient de lumière. Sur toutes choses se répandait une blancheur immobile, mais au-dessous la couleur sommeillait, torpide et sombre, et jusque dans la mer qui laissait percevoir son éternel mouvement, la couleur assoupie se taisait. Le vert des collines, toutes les couleurs des maisons demeuraient cachés et la lumière d’en haut, inaccueillie, distincte – effluve saturant l’atmosphère – restait incorruptible et blanche. Rien ne se fondait en elle.
Dans le visage tout proche de la jeune fille, cette lumière s’incarnait, se substituait au rose enfantin sans éteindre le jaune diffus qu’Émilio croyait goûter par les lèvres ; toute la face devenait austère et Émilio, en la baisant, se sentait plus que jamais une âme de séducteur. Il tenait sous son baiser la chaste, la blanche lumière.
Puis ils préférèrent les bosquets du col du Chasseur. Ils éprouvaient toujours davantage le besoin de la solitude. Ils s’asseyaient au pied d’un arbre, mangeaient, buvaient, et s’embrassaient. Les fleurs, premiers attributs de leur amour, avaient bien vite disparu pour céder la place aux pâtisseries. Ensuite elle refusa les gâteaux : elle craignait de s’abîmer les dents. Ce fut alors le tour des fromages, des mortadelles, des bouteilles de vin et de liqueur, toutes choses déjà fort coûteuses pour la bourse d’Émilio.
Mais il était très disposé à sacrifier à Angiolina les petites économies qu’il avait faites au cours de ses longues années de vie régulière ; sa réserve épuisée, il restreindrait ses dépenses, voilà tout. Certaines questions l’inquiétaient bien davantage : qui avait enseigné à Angiolina l’art de donner un baiser ? Il ne se souvenait pas des premiers qu’il avait reçus d’elle ; il était trop occupé alors de celui qu’il donnait, lui ; le baiser d’Angiolina n’était que le doux et nécessaire complément du sien. Pourtant, si cette bouche avait été animée à ce point, cela l’aurait frappé. Était-ce donc lui, novice lui-même, qui avait été en cela son éducateur ?
Elle fit des aveux ! Merighi l’avait beaucoup embrassée. Elle en parla en riant. Bien sûr, Émilio lui semblait ridicule : croyait-il donc que Merighi n’avait pas profité de sa qualité de fiancé au moins pour l’embrasser tout son saoul ?
Brentani n’était nullement jaloux du souvenir qu’elle gardait de Merighi, qui avait eu tellement plus de droits qu’il n’en avait. Il souffrait même quand elle en parlait légèrement. N’aurait-elle pas dû pleurer à ce seul nom ? Quand il exprimait son propre regret de ne pas la voir plus heureuse, elle, comme pour venir à son secours, donnait à son beau visage un air de tristesse, et pour se défendre du reproche qu’elle devinait, ne manquait pas de rappeler que l’abandon de Merighi l’avait rendue malade : « Oh ! si j’étais morte à ce moment-là, je serais partie sans regrets ! » L’instant d’après, elle riait bruyamment entre les bras qu’il lui avait ouverts pour la consoler.
Elle ne regrettait rien et lui s’en étonnait comme il s’étonnait de sa propre compassion. Un tel amour n’était-il fait vraiment que de sa gratitude envers cette douce créature qui, en tout, se comportait comme si elle eût été créée pour lui, complaisante, sans exigences, maîtresse parfaite ?
Tard dans la soirée, quand il rentrait à la maison, et que la pâle Amélie quittait son ouvrage pour lui tenir compagnie pendant qu’il dînait, lui, vibrant encore d’émotion, non seulement ne pouvait parler d’autre chose, mais ne réussissait même pas à feindre de s’intéresser aux petites affaires domestiques où se réduisaient la vie et les propos de sa pauvre sœur.
Un soir, elle le regarda longuement sans qu’il s’en aperçût, puis, souriant avec effort, lui demanda :
— Tu es resté jusqu’à maintenant auprès d’elle ?
— Qui, elle ? fit-il dans un rire soudain.
Et il avoua, car il avait besoin de s’épancher. Oh ! Ç’avait été une soirée inoubliable. Il avait aimé à la clarté de la lune, dans l’air tiède, devant un paysage infini et riant, créé pour eux, pour leur amour. Hélas ! il ne savait pas s’exprimer. Et comment donner à sa sœur une idée de ce qu’il avait ressenti sans lui parler des baisers d’Angiolina.
Mais tandis qu’il répétait : « Quelle lumière ! Quelle atmosphère ! » elle devinait sur ses lèvres et dans son souvenir la trace de ces baisers. Elle haïssait sans la connaître la femme qui lui avait dérobé son compagnon et l’avait privée de son réconfort. Maintenant qu’elle le voyait aimer comme tous les autres, elle ne trouvait plus un seul exemple de résignation volontaire à un destin aussi triste que le sien propre. Si triste en vérité ! Elle se mit à pleurer. Ses larmes, qu’elle cachait en travaillant, tombèrent d’abord, silencieuses, sur son ouvrage. Il les aperçut néanmoins et aussitôt elles firent place à d’impétueux sanglots qu’elle s’efforçait vainement de réprimer.
Elle essaya d’expliquer ses pleurs : toute la journée elle avait été indisposée. Elle n’avait pas dormi la nuit précédente. Elle n’avait rien mangé ; elle se sentait très faible.
Il la crut tout de suite :
— Demain, si tu ne vas pas mieux, j’appelle le docteur.
Alors au chagrin d’Amélie s’ajouta de la colère contre son frère qui, vraiment, avait cru trop vite à son excuse ; c’était la preuve d’une complète indifférence. Aussi elle ne se contint plus et elle lui dit de laisser là le docteur, car, pour la vie qu’elle menait, ce n’était pas la peine de se soigner. Pour qui vivait-elle ? Et pourquoi ? Et comme il se refusait encore à comprendre et la regardait hébété, elle lui cria toute sa douleur :
— Toi-même, tu n’as plus besoin de moi !
Il comprenait de moins en moins, c’est sûr, car au lieu de s’émouvoir il se fâcha : il avait passé une jeunesse solitaire et triste ; il était trop juste que de temps à autre il s’accordât quelque plaisir. Angiolina n’avait aucune importance dans sa vie : une aventure qui durerait quelques mois, voilà tout.
— Tu es vraiment mauvaise de m’en faire un reproche !
Mais, voyant qu’elle continuait à pleurer, sans un mot, inerte et désolée, il s’émut enfin. Il promit qu’il viendrait plus souvent lui tenir compagnie. Ils liraient, ils travailleraient ensemble, comme autrefois. Il faudrait seulement qu’elle se forçât un peu à être gaie : il n’aimait pas les gens tristes. Sa pensée vola vers Angèle ! Comme elle savait rire longuement, et de quel rire contagieux ! Il ne put s’empêcher de sourire à la seule pensée des échos qu’eussent éveillés, dans sa mélancolique demeure, les éclats de cette gaieté.
III
Un soir, il avait rendez-vous avec elle à huit heures, mais à sept heures et demie il reçut un mot de Balli : il l’attendait à Chiozza et avait des communications très importantes à lui faire. Plusieurs fois déjà Émilio avait reçu des invitations de ce genre. Il s’en moquait. Il savait que leur seul but était de l’arracher à Angiolina. Cette fois pourtant, il se dit que ce serait un bon prétexte pour pénétrer dans la maison de la jeune fille. Cet être si important dans sa vie, il l’étudierait dans son milieu, parmi ses proches… Il conservait encore, dans son aveuglement, l’attitude d’un homme qui voit clair.
La maison d’Angiolina se dressait à quelques pas en retrait de la via Fabio Severo. Haute et large, au milieu des champs, elle avait l’aspect d’une caserne. La loge du concierge était fermée et Émilio, un peu incertain de l’accueil qu’il allait recevoir, grimpa au second étage. « Certes, ce ne sont point là les dehors de la richesse », murmura-t-il comme pour fixer ses impressions. L’escalier paraissait avoir été construit à la hâte : pierres mal équarries, rampe de fer brut, murs blanchis à la chaux ; le tout propre, mais misérable.
Une petite fille d’environ dix ans lui ouvrit la porte. Blonde comme Angiolina, mais avec des yeux éteints, une face jaunâtre et anémique, elle portait un vêtement ridiculement long pour elle et mince comme une toile d’araignée. Elle ne sembla pas surprise à la vue d’un visage nouveau ; elle se contenta de croiser sur sa poitrine les deux côtés de sa camisole sans boutons.
— Bonjour, monsieur. Vous désirez ?…
Sa politesse cérémonieuse s’accordait mal à sa petite personne puérile.
— Mlle Angiolina est-elle ici ?
— Angiolina ! cria une femme qui, dans l’intervalle, s’était avancée du fond du corridor, un monsieur te demande.
C’était probablement cette douce mère auprès de laquelle Angiolina avait tant désiré se réfugier après l’abandon de Merighi. Une vieille femme du peuple vêtue de couleurs vives mais un peu défraîchies, un grand tablier bleu à la taille et, sur la tête, un mouchoir bleu noué à la frioulane. Le visage gardait bien quelques traces d’une beauté passée et même le profil rappelait celui d’Angiolina, mais l’ossature était forte et les traits immobiles, à l’exception de deux petits yeux noirs, inquiets comme ceux d’une bête attentive à se garer des coups de bâton.
— Angiolina ! cria-t-elle pour la seconde fois. Elle vient tout de suite, dit-elle à Émilio très poliment. (Puis, sans jamais le regarder en face, elle répéta à plusieurs reprises :) En attendant, asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous.
Sa voix nasale n’était guère agréable. Au début de chaque phrase, elle hésitait, balbutiait, jusqu’au moment où, au contraire, une enfilade de mots sortaient de sa bouche dans un seul souffle sans chaleur.
Mais déjà accourait Angiolina, habillée comme pour sortir. Apercevant Émilio elle se mit à rire et le salua avec cordialité.
— Oh ! monsieur Brentani ! Quelle bonne surprise !
Et, très à son aise, elle fit ces présentations : « Ma mère ; ma sœur. »