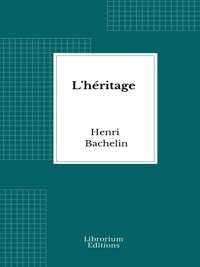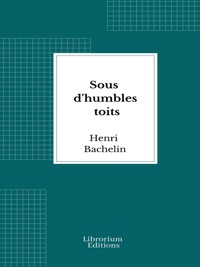
1,29 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Si de toi, jadis, il n’y a pas longtemps encore, j’ai pu médire, que je le regrette ! Mais je sais que tu me le pardonnes, toi qui jamais n’as dit « un mot plus haut que l’autre, » toi, le doux, le pacifique qui te réservais tes dernières années de souffrances muettes, et ta dernière heure avec ton cri :
— Mon Dieu, je vous donne ma vie pour qu’Henri devienne bon !
Tu me posais des questions, auxquelles je ne répondais que par monosyllabes, sur ma vie, mes occupations, mes repas. Tu n’as jamais su combien j’étais ému, à voir les efforts que tu faisais pour me montrer que tu t’intéressais à mon travail. Mais vivre à Paris nous rend autres que nous ne sommes : nous en venons avec ce que nous croyons être des idées sur notre supériorité intellectuelle et morale. C’était plus fort que moi : je ne pouvais te donner ces détails qui t’auraient fait si grand plaisir. Et tu es parti — qu’il en est souvent ainsi ! — sans me bien connaître, sans savoir ce qu’il y avait au fond de moi-même, puisque tu as demandé que je devienne bon. Mais ce n’est pas du tout ta faute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
HENRI BACHELIN
Sous d’humbles toits
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385742218
à Romain Rolland qui aime « respirer le souffle des héros », ces âmes de résignés, qui sont, à leur manière, des héros.
H. B.
A MON PÈRE.
I
Si de toi, jadis, il n’y a pas longtemps encore, j’ai pu médire, que je le regrette ! Mais je sais que tu me le pardonnes, toi qui jamais n’as dit « un mot plus haut que l’autre, » toi, le doux, le pacifique qui te réservais tes dernières années de souffrances muettes, et ta dernière heure avec ton cri :
— Mon Dieu, je vous donne ma vie pour qu’Henri devienne bon !
Tu me posais des questions, auxquelles je ne répondais que par monosyllabes, sur ma vie, mes occupations, mes repas. Tu n’as jamais su combien j’étais ému, à voir les efforts que tu faisais pour me montrer que tu t’intéressais à mon travail. Mais vivre à Paris nous rend autres que nous ne sommes : nous en venons avec ce que nous croyons être des idées sur notre supériorité intellectuelle et morale. C’était plus fort que moi : je ne pouvais te donner ces détails qui t’auraient fait si grand plaisir. Et tu es parti — qu’il en est souvent ainsi ! — sans me bien connaître, sans savoir ce qu’il y avait au fond de moi-même, puisque tu as demandé que je devienne bon. Mais ce n’est pas du tout ta faute.
Tu te tenais au coin du feu, dans un de ces vieux fauteuils en osier que ne vendent pas cher ces marchands ambulants que l’on appelle chez nous tantôt « bohémiens » tantôt « pacants ». Tu ne les aimais pas, ces hommes qui ne se fatiguent guère, toi l’acharné au rude travail, ces errants qui vont d’un bout à l’autre du monde, toi qui, de trente années, ne sortis point de ce bourg de trois mille âmes, où tu es encore maintenant. Mais tu ne les injuriais, ne les repoussais point. Tu ne me grondais pas lorsque tu apprenais qu’à une femme qui paraissait malheureuse j’avais donné deux sous.
Des jeunes gens traversent les salons, habiles à ne pas glisser sur le parquet luisant, précédés du renom de toute une race. D’avoir souvent regardé les portraits de leurs aïeux, peints à l’huile et accrochés dans les galeries des châteaux, ils auront toujours sur le front et dans les yeux comme le rayonnement d’une gloire impersonnelle. D’autres ont eu pour pères ces héros au sourire si doux, qui n’étaient suivis que d’un seul houzard. Mais c’est déjà beaucoup, de n’être, à la distance réglementaire, suivi que d’un serviteur. Tu n’étais pas accompagné, toi, respectueusement : tu fus de ceux qui suivent.
Que l’on ne s’y méprenne pas ! Ce n’est point par une espèce de forfanterie à rebours que je me réclame de toi. Les pauvres ne sont pas tout, et tu serais surpris, le premier, que je songe à m’en glorifier. Je dis seulement qui tu fus, qui je pourrais être : je ne le crie point par-dessus les toits. Pourtant je ne voudrais ni le cacher, ni le murmurer à voix basse. Mais on est allé si loin chercher des modèles de vie, — jusque chez ces héros d’exception dont l’âme ne pouvait se déployer que sur l’immensité du monde transformé en champ de bataille, — que je ne puis point ne pas penser à toi, héros obscur que n’environnent ni le fracas de l’artillerie ni les éclats des trompettes, saint qui jamais ne seras canonisé.
Tu devinais, tu savais que nous devons connaître chacun nos limites, que ce n’est point se résigner à la médiocrité que d’être satisfait de cultiver seulement son propre jardin, sans convoiter celui du voisin, ceux de la petite ville, ceux de la terre. Il suffit qu’il y pousse des légumes sains, que les arbres fruitiers ne soient pas improductifs, et que les rosiers, — même dans un humble jardin il y a place pour les fleurs, — soient, vers le mois de mai, si jolis avec leurs roses. Tu savais que les riches ont des raisons d’être ce qu’ils sont. Tu ne connaissais point la jalousie. Tu n’enviais ni ceux qui vivent de leurs rentes, ni ceux qui gagnaient beaucoup plus d’argent que toi en se fatiguant moins, dans des ateliers, dans des boutiques. C’est ainsi qu’un cercueil, que l’on fait en une nuit, coûte cinquante francs. Pour gagner ces cinquante francs il t’a fallu travailler plus d’un jour. C’était tout naturel.
Tu ne réclamais ni le partage des biens, ni le bouleversement de la société. Si tous les ouvriers devenaient riches du jour au lendemain, ce serait du joli ! Il y en a quatre-vingt-dix-neuf sur cent qui ne voudraient plus rien faire, car nous les connaissons bien : ils ne vont au travail qu’en rechignant. Nous connaissons aussi Lavocat, qui ne fait œuvre de ses dix doigts, et dont les gamins vont voler, la nuit, dans les champs et dans les toits les légumes qui se laissent toujours arracher et les poules qui, parfois, effarées, résistent en gloussant. Cela ne vit que de rapine. Lavocat n’aura rien de plus pressé, lorsqu’il possèdera de l’argent, que de « faire » tous les marchands de vins d’ici, de l’Étang du Goulot à la route d’Avallon. Aussi bien Lavocat est-il un de ceux qui ne connaissent pas leurs limites.
Tu étais poli avec tout le monde. C’est toi qui saluais, toujours le premier, les commerçants et les rentiers.
Tu passais dans les petites rues, poussant une brouette ou les bras ballants, avec des chaussons de laine dans une paire de sabots que tu ne trouvais pas lourds. Il n’y a rien de tel que de ne pas prendre l’habitude des bottines vernies. Et j’ai beau faire, beau tâcher, quelquefois, de me répandre, de devenir quelque chose comme un jeune homme du monde, c’est toujours de toi que je viens, c’est toi qui me précèdes partout. Mes yeux, toute mon enfance, ne se sont reposés que sur ton front soucieux, sur tes mains déformées, à la longue, par le manche de la pioche, de la bêche, de la cognée. Si je songeais à mes aïeux, c’étaient d’autres fronts pareils au tien, d’autres mains pareilles aux tiennes, que je voyais, dans une pauvre ferme d’un pays de rochers et de bruyères.
Je t’ai vu rire quelquefois : je ne t’ai jamais vu sourire.
Dans les jardins des riches, les après-midi d’été tu portais le poids de la chaleur, sans te plaindre, puisque chaque heure de travail t’était payée cinq sous ; il te fallait rester penché douze minutes sur la terre pour gagner cinq centimes. Car tu n’étais pas de ceux qui flânent, s’en vont de droite et de gauche, bavardent avec les servantes, se dérangent même dix minutes pour boire un verre à l’auberge d’en face. Tu voulais en donner aux riches pour leur argent. Tu n’ignorais pas que gagner cinq sous par heure de travail oblige à ne pas se reposer une minute. Tu n’entrais ni dans les auberges ni dans les cafés, parce que tu savais le prix de l’argent, et que ni les cafetiers ni les aubergistes ne font cadeau de leur « marchandise ». Tu ne fumais pas : le tabac donne mal à la tête ; il empoisonne ; il faut travailler deux heures durant pour en gagner un paquet de cinquante centimes. C’est une grande force d’avoir, comme étalon, le prix d’une heure de travail. On n’a pas besoin de distractions : il faut que toujours la volonté soit tendue, qu’à pas un seul endroit elle ne fléchisse.
C’est surtout dans les petites villes que chacun devrait connaître son bonheur. Il n’y a guère, en elles, de ces arrogants, de ces moqueurs qui vous bousculent dans les rues, pas beaucoup de ces jalousies, de ces rivalités qui, dans les grandes villes encombrées d’ateliers et de bureaux, vous dressent l’un en face de l’autre, l’injure sur les lèvres, la menace dans les poings. Notre maison où tu rentrais chaque soir était le lieu de ta distraction en même temps que le lieu de ton repos, et le complément du bonheur qui consistait à consacrer au travail toutes les minutes de ta vie. Il n’y a rien de plus terrible, disais-tu, que de rester à ne savoir que faire de ses mains.
Beaucoup de ceux qui t’ont fait travailler ne t’ont pas connu. Tu étais pour eux un jardinier pareil aux autres. Quand la fin de ta journée venait avec le crépuscule, il leur arrivait de te dire :
— Pierre, donnez donc un coup de main pour rentrer le bois dans la cuisine.
Cela aussi te semblait si naturel que souvent, de toi-même, tu t’offrais avec tes deux bras pourtant fatigués. Je ne veux pas dire que tu ne te rendais pas compte de ta vie. Car tu étais heureux que j’aie trouvé une place à Paris, dans ce que l’on appelle un bureau. Tu me disais :
— Certainement, je vois bien que tu ne gagnes pas des mille et des cent. Mais, là, tu es toujours assis. Été comme hiver, tu es à l’abri du soleil, de la pluie et de la neige. Moi, il y a des fois où je ne suis plus qu’une eau, et des fois où j’ai les pieds glacés, les mains gelées, avec des crevasses qui me font mal.
Mais c’était notre vie. Maman aussi, de laver dans l’eau couverte de glace qu’il fallait casser à coups de pioche, ses mains n’étaient plus, comme tu disais, « qu’une crevasse ». C’était la vie de ceux à chaque jour de qui suffit sa peine, parce que le lendemain vient, lui aussi, avec sa peine.
Tu n’aimais pas les jours de réjouissances publiques. Le lundi de la Pentecôte ramenait sur les Promenades, — dont les tilleuls étaient à vingt pas de notre maison, — les baraques, les « ramées » sous lesquelles on boit de la bière, de la limonade et du vin, et les parquets sur lesquels danse, au son des violons et quelquefois d’une vielle, la jeunesse du pays. Tu disais :
— Ce n’est pas moi qui ferai seulement un pas pour voir ça !
Ce premier pas tu ne le faisais point. Tu n’aurais pas pu. Les dix-neuf autres t’eussent coûté bien plus encore.
L’hiver, on ne peut tout de même guère se coucher avant sept heures du soir. De la plume dont tu venais de te servir pour inscrire les heures de ta journée, sur les marges d’un journal tu me dessinais des oies que je trouvais jolies. Lorsque j’en avais à ma disposition tout un troupeau, tu te mettais à lire, avant de te coucher, des vies de Saints.
Car il ne suffit pas d’aimer son travail, ni d’aller avec une résignation joyeuse au-devant de la tâche de chaque jour. Il ne suffit pas de thésauriser pour la vie présente : il faut aussi mériter le ciel. Sans doute tu espérais en cette récompense, mais sans que cela te diminuât, bien au contraire, puisque ta douceur n’en était que plus grande.
Tu ne pouvais pas, tout de suite, t’efforcer d’imiter la vie de Dieu descendu, par son Fils, au milieu des hommes, mais tu pouvais te proposer en exemple ceux des hommes qui voulurent se rapprocher de Dieu, les Saints. Il y en a dont la condition ici-bas fut semblable à la nôtre. Tu pénétrais dans leur intimité. Tu les connaissais tous, depuis les exilés parmi les sables du désert, dans des cavernes faites d’un trou entre deux roches brûlantes, qui n’avaient pas tous les jours de l’eau à boire, jusques à ceux qui, dans des forêts sombres, sous des branchages arrangés en toit de cabane, estimaient que, pas plus que le Fils de l’Homme, ils n’avaient besoin d’une pierre où poser leur tête. Tu les connus tous pour les admirer, pour tâcher de te modeler sur eux, mais dans la mesure où tu sentais que Dieu te le permettait. Que serions-nous devenus, si tu étais parti dans ces bois où l’on finit toujours par rencontrer quelque silencieux monastère à la porte duquel il suffit de sonner ?
Le ciel est un beau pays, beaucoup plus grand que la terre, où tu serais heureux de vivre dans la société de Saint-Joseph qui n’avait pas, lui non plus, de temps à perdre avec son métier de charpentier, et de la Vierge-Marie qui s’occupait de son ménage. Tu la voyais, filant au rouet dans l’embrasure d’une fenêtre cintrée : et, tandis que l’Ange du Seigneur lui annonçait qu’elle serait la mère du Christ, le lys des champs n’avait pas un frisson.
L’église était pour toi beaucoup plus qu’un endroit où tu travaillais encore : tu n’y entrais jamais que comme dans la maison de Dieu. Ce n’était pas surtout pour gagner un peu d’argent que, chaque samedi, tu balayais les nefs et le chœur, secouais les tapis, rangeais les chaises, préparais les bougies, mais parce que la maison de Dieu doit être nette, et qu’on ne doit pas trouver un grain de poussière sur les autels, sur les dalles. Si, trois fois par jour, trente années durant, tu sonnas l’Angelus, ce fut pour rappeler à notre petite ville que l’heure était venue de songer à la prière. Tu partais, l’hiver, à six heures du matin, avec une lanterne, dans la neige que les rafales accumulent au tournant des chemins contre les murs.
Tu ne te contentais pas de sonner l’Angelus : tu le récitais en même temps.
Les dimanches étaient pour toi de beaux jours de repos et de prière. Tu te tenais dans le chœur, près de l’autel, et tu suivais les offices dans un petit livre. Je sais que tu aimais les paraboles des Évangiles, lorsqu’il est question du méchant homme qui part semer l’ivraie, et des ouvriers de la dernière heure, et de Lazare le pauvre qui repose dans le sein d’Abraham.
Tu connaissais aussi l’Apocalypse. Je n’étais guère rassuré lorsque tu prédisais l’avènement prochain de l’Antéchrist. Tu répétais que, venu le jour du Jugement dernier, tous les morts, nous tous, nous nous lèverons au son de la grande trompette de l’ange porté sur les nuées. Nous rejetterons les pierres de nos sépulcres pour attendre la sentence du Souverain Juge. Heureux alors ceux qui pourront suivre l’Agneau !
Tu n’étais point de ces apôtres brûlants qui vont confessant leur foi à tous les carrefours de la cité. Tu te résignais à ce qu’il y eût des hommes à ne pas penser comme toi, mais je suis sûr que tu ne les oubliais pas dans tes prières. Tu n’en voulais à personne ; tu implorais la miséricorde du Très-Haut pour toute la chrétienté. La rosée du ciel tombe sur le pré du méchant comme sur le pré du juste. Tu estimais qu’il était bon de vivre, puisque la vie tu la devais à Dieu, et telle que te l’avaient faite, non le besoin, non les nécessités quotidiennes, mais ses mystérieux desseins. Tu pensais que lui seul est la source de la vérité, et que tu ne risquais point de t’égarer en suivant la route qu’il t’indiquait. Tu savais qu’il intervient dans les affaires des hommes, qu’il a le droit de les punir ou de les récompenser, qu’il a à sa disposition le vent, le tonnerre, la grêle et la gelée, et le soleil et les pluies opportunes. Tu trouvais naturel que les saints fussent châtiés en même temps que les pécheurs. Car, si la rosée du ciel tombe aussi sur le pré du méchant, la foudre peut ne pas épargner la maison du juste. Cela ne te déconcertait point. Tu disais souvent :
— C’est tout de même le bon Dieu qui aura le dernier mot.
Plus d’une âme incertaine cherche sa raison d’être, qu’elle ne trouve pas toujours, dans un de ces héros glorieux qu’elle voudrait comme modèle, ou comme complément absolu d’elle-même. Tu avais trouvé Dieu. Tu as choisi la meilleure part : qu’elle ne te soit pas enlevée !
D’abord tu avais dû cesser de travailler dehors, et tu te morfondais au coin du feu. Tu ne te reconnaissais plus. Tes forces, peu à peu, s’en étaient allées. Puis tu avais dû cesser de t’occuper de l’église. Tu ne marchais plus qu’avec de grandes difficultés. Mais tu pouvais encore aller à la messe, le dimanche, jusqu’au jour où tu m’écrivis :
— Cette fois-ci, ça ne va plus du tout. C’est de pire en pire. Je suis allé à la messe le jour de la Toussaint, mais j’ai bien manqué y rester. J’ai cru que j’allais étouffer complètement. Aussi je n’y suis pas retourné depuis.
Jusqu’au jour où, te couchant, tu ne sus pas que tu ne te lèverais jamais plus. Je ne parlerai point de tes souffrances : là encore tu fus un résigné.
Mais tu es retourné à l’église. Devant le chœur ils t’ont posé. J’ai revu les tentures noires, et les têtes de morts. Toi qui avais assisté à tant d’enterrements, il me semblait te revoir aller et venir. Ma pauvre mère pleurait silencieusement. Et, comme lorsque j’étais enfant de chœur et que, moi aussi, j’assistais à des enterrements qui me déchiraient l’âme, je faisais effort pour ne pas fondre en larmes.
Tu étais là, tourné vers l’autel d’où montaient les prières, vers le chœur où les chantres imploraient pour toi la suprême pitié. Toi qui t’effaçais devant tout le monde, qui semblais toujours douter de toi-même, n’était-ce pas encore toi que j’entendais dire :
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit :
Nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus ?
Quem patronum rogaturus
Cum vix justus sit securus ?
Ah ! C’est maintenant que je te voyais, les mains jointes, avec ton chapelet sur la poitrine, les pieds l’un près de l’autre, les yeux fermés, et tes trente années de vie exemplaire dont chacun des jours se tenait près de toi, riche de travail et de prières, disant :
— Celui-ci est un Juste, Seigneur ! Il a mérité d’entrer au Paradis.
Et c’était comme si je t’avais entendu protester :
— Non ! Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne !
Ils t’ont descendu dans la terre, non loin de notre ancien jardin où j’avais planté un marronnier qui est perdu pour moi, mais qui, dans dix ans, aurait eu des branches assez longues avec assez de feuilles pour que, sur un banc, tu puisses t’asseoir, te reposer à son ombre. Tu en es séparé par toute la largeur de l’étroit sentier qui rampe entre le mur du cimetière et la haie du jardin. Mais non loin de ta tombe se dresse une haute croix à l’ombre de laquelle tu dormiras longtemps.
II
Aujourd’hui me voici de retour. Mais je ne t’ai pas vu m’attendant, comme les autres années, à la barrière de la petite gare. Tu regardais si j’étais sur la plate-forme du wagon. Lorsque tu m’avais aperçu, tes yeux clignotaient un peu. Nous nous en allions par la route de l’Étang du Goulot. Des gens, que nous croisions, te disaient :
— Eh bien, vous voilà heureux que votre fils soit revenu ?
Tu te contentais de rire en hochant la tête. Tu voulais même porter ma valise, mais la dernière fois elle aurait été trop lourde pour toi qui t’étais habitué cependant aux fardeaux.
Je suis arrivé à la maison : tu n’y étais pas non plus. Je savais que tu n’y serais pas ; mais j’ai été ému, plus que je ne pourrais dire, de ne pas t’y trouver. Ce n’est plus celle où j’avais l’habitude de te voir, la maison aux deux grandes pièces carrées où tu étais heureux comme un roi dans son palais. C’en est une autre, plus petite, où tu n’as vécu que deux mois. Elle aurait fait plus que te suffire pendant des années, car tu étais content de l’avoir.
— C’est tant qu’il en faut pour nous, m’écrivais-tu.
Oui : c’était « tant qu’il vous en fallait ». Mais, maintenant que tu n’y es plus, la petite maison s’est tout-à-coup agrandie. Ton fauteuil est encore au coin de la cheminée, mais il tend les bras vers l’éternité.
Pour te voir il faut aujourd’hui aller plus loin que la gare, plus loin que la maison. Il faut suivre le sentier qui, entre des haies et des murs de jardins, monte au cimetière. J’ai dû attendre que la nuit fût venue, puisqu’il faut d’abord s’occuper de soi et des vivants, tout en pensant aux autres, je veux dire : à toi, et à ceux parmi lesquels tu es descendu. Les portes du cimetière étaient fermées, mais j’ai l’habitude d’escalader son mur bas. J’ai marché entre les tombes.
Un clair de lune admirable s’étendait sur le cimetière, sur la ville, sur les bois, sur les montagnes et sur la plaine ; un de ces clairs de lune comme on en voit en septembre, par les étés chauds, qui font croire que les champs moissonnés à ras de terre sont couverts de neige.
C’était une de ces nuits où la pensée ne peut que s’éparpiller en rêves. Il suffisait d’écouter un grillon dans une touffe d’herbe, un chien aboyer, au lointain, à l’entrée d’une cour de ferme.
Comme il était enfoui dans le passé, le jour de décembre où les talons de ceux qui te portaient enfonçaient dans la terre détrempée par les pluies d’hiver, où le vent emmenait jusqu’aux villages les plus reculés du canton le glas que sonnaient pour toi ces cloches que tant de fois tu avais sonnées !
Alors je t’ai retrouvé. Comme les tiens quand tu m’apercevais sur la plate-forme du wagon, mes yeux se sont mis à clignoter.
Un grand écrivain a dit d’un de ses maîtres, dans le château natal duquel il avait passé toute une nuit sans dormir :