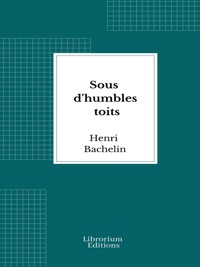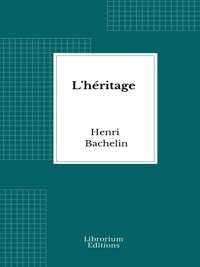
1,29 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Il apprend tout ce qu’il veut ! » disait-on, sans se rendre compte que pour lui c’était peut-être un malheur. C’est bien d’être toujours le premier à l’école, d’avoir beaucoup de prix à la fin de l’année et de descendre de l’estrade avec une couronne verte ; mais plus tard sera-t-il le premier dans la vie ? Aura-t-il le front ceint de lauriers ? Les vieux certificats d’études, couverts de signatures, jaunissent sous verre. Personne ne peut les emporter avec soi, collés sur sa poitrine, comme font les aveugles, les victimes d’accidents. Personne ne peut dire : « Et puis j’ai eu mon certificat d’études à onze ans, l’année d’avant ma première communion ».
Il doit exister des gens que cela ferait éclater de rire.
Dans la cour il jouait avec les autres, sans se souvenir qu’il était le seul à n’avoir pas fait une faute dans la dictée de tout à l’heure. Mais il n’était pas le plus habile aux barres ; il lui arrivait de se laisser prendre, vexé lorsque ceux de son camp ne se pressaient pas de le délivrer, comme s’il leur eût été inutile. Il n’était pas le plus fort aux billes, où il perdait plus souvent qu’à son tour, ni au jeu de saute-mouton où plus d’une fois il lui fallait tendre l’échine. Il aurait préféré se tenir à l’écart, mais il était obligé de jouer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
HENRI BACHELIN
L’HÉRITAGE
ROMAN
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385745851
A JÉROME ET JEAN THARAUD
Mes chers amis,
Avec nos sympathies instinctives et nos répugnances irraisonnées ne jouons-nous pas un peu comme au boomerang ? Je crains qu’elles ne nous reviennent avant d’avoir touché ceux qu’elles pensent atteindre, et je ne me flatterai point de forcer votre amitié. Mais depuis le jour où j’ai lu La Maîtresse Servante, l’estime consciente et — si le mot ne vous offusque pas, — admirative que j’ai pour vous n’a point varié, et il n’y a que cela qui importe. Je devine dès maintenant que nous ne suivrons point la même route. Je n’ai réalisé jusqu’à présent, au point de vue de l’expression de mes sentiments personnels, que la partie négative de mon œuvre, si ce mot ne vous semble pas trop ambitieux. Tenterais-je de le faire directement que j’écrirais en polémiste des romans de revendication sociale de valeur esthétique nulle, ou peu s’en faudrait. J’attends de me sentir mûr pour les écrire en artiste. Et je vous sais trop intelligents et trop artistes, vous, pour conclure à l’identité des sentiments de mes personnages et particulièrement de Vaneau résigné, et des miens. Mais je souhaiterais que tout le monde vous ressemblât.
L’HÉRITAGE
Il faut que tu renonces à cette vie extraordinaire qui n’est pleine que de soucis : il n’y a de bonheur que dans les voies communes.
René.
PREMIÈRE PARTIE
I
« Il apprend tout ce qu’il veut ! » disait-on, sans se rendre compte que pour lui c’était peut-être un malheur. C’est bien d’être toujours le premier à l’école, d’avoir beaucoup de prix à la fin de l’année et de descendre de l’estrade avec une couronne verte ; mais plus tard sera-t-il le premier dans la vie ? Aura-t-il le front ceint de lauriers ? Les vieux certificats d’études, couverts de signatures, jaunissent sous verre. Personne ne peut les emporter avec soi, collés sur sa poitrine, comme font les aveugles, les victimes d’accidents. Personne ne peut dire : « Et puis j’ai eu mon certificat d’études à onze ans, l’année d’avant ma première communion ».
Il doit exister des gens que cela ferait éclater de rire.
Dans la cour il jouait avec les autres, sans se souvenir qu’il était le seul à n’avoir pas fait une faute dans la dictée de tout à l’heure. Mais il n’était pas le plus habile aux barres ; il lui arrivait de se laisser prendre, vexé lorsque ceux de son camp ne se pressaient pas de le délivrer, comme s’il leur eût été inutile. Il n’était pas le plus fort aux billes, où il perdait plus souvent qu’à son tour, ni au jeu de saute-mouton où plus d’une fois il lui fallait tendre l’échine. Il aurait préféré se tenir à l’écart, mais il était obligé de jouer.
Même avec sa cour où les marrons à la rentrée rebondissent sur le sol dur, même avec son hangar ouvert à tous les vents et sous lequel les jours de pluie ils s’entassaient en se heurtant, en poussant des cris, l’école lui plaisait. Elle lui plaisait davantage encore avec ses salles décorées de cartes où l’eau bleue épouse si exactement les terres multicolores, pourtant déchiquetées, qu’il ne reste pas un vide. Les tables se suivaient, violettes de coulées d’encre. Ils y étaient bien, l’hiver, toutes les fenêtres fermées. Il fallait allumer les lampes à trois heures de l’après-midi. Dehors, à cause de la neige, aucun bruit ; ici la respiration du poêle ronflant tout rouge. Ils y étaient bien, l’été. Par les fenêtres grandes ouvertes le jour entrait, vert à cause des feuilles des hauts platanes ; ils entendaient sur le colombier roucouler les pigeons, et dans une maison proche trotter une machine à coudre et rire des couturières. Parfois, lorsque de jeunes hommes passaient en sifflotant, les rires ressemblaient aux roucoulements. Parfois aussi, cédant à la torpeur de l’après-midi, le cher frère s’inclinant sur son bureau ronflait, congestionné, rouge comme le poêle en hiver. Des coqs s’interrogeaient, se répondaient. Il les reconnaissait. Le coq des Bide avait une voix enrouée ; le coq des Dumas chantait net. Celui de Mme Leprun était un peu ridicule avec son filet de voix : il fallait qu’il fît un grand effort et qu’il se dressât sur ses ergots. Il entendait encore d’autres coqs, inconnus, dispersés dans les villages d’alentour, dont il devinait plutôt le chant, comme en un rêve d’été, quand on s’imagine voir un homme velu, aux pieds de bouc, qui joue d’une flûte bizarre, assis à l’ombre près d’une source, en regardant la plaine blanche de soleil.
L’école était un monde à part. Aussitôt qu’il avait poussé la porte de la cour il respirait un autre air. Par les livres il y était en contact avec toute la terre.
En Afrique les lions dorment sous des palmiers, et les chameaux ont l’air de collines qui marchent. L’Australie est habitée par les ornithorynques, les émeus. Au pôle Nord les ours blancs voyagent sur des glaçons qu’ils rayent de leurs griffes. Les tigres miaulent dans les jungles de l’Inde. Un condor plane au-dessus de l’Amérique.
Tout cela n’est rien à côté de la France. Des cinq parties du monde une vue d’ensemble suffit. La France mérite qu’on la connaisse dans ses détails. Les ruisseaux font les fleuves qui tout de suite partent pour la mer, bleus comme l’eau quand il n’y a point de nuages : en géographie le ciel est toujours pur. Les lignes de chemins de fer sont noires de la fumée des locomotives, des poussières du charbon. La Bresse est peuplée de poulets. On rencontre beaucoup de poulardes par les rues du Mans. Des chevaux galopent dans le Perche ; des bœufs ruminent dans les pâturages du Nivernais. La Beauce est jaune de blé, le Midi bleu de raisins, les Alpes blanches de neige, les Ardennes vertes de forêts.
L’histoire de la terre est si compliquée qu’il n’essaie pas de s’y retrouver. Depuis que l’épée de l’Ange les a tenus hors du Paradis terrestre, les hommes sont partis dans tous les sens, chacun à la recherche de son paradis. Des rois les ont menés, poussés. Ils se sont battus, blessés, tués, à coups d’épieux, de massues, de catapultes, de francisques, de couleuvrines, d’arquebuses. Des trônes se sont effondrés dans les flammes. D’autres, vermoulus, se sont affaissés d’eux-mêmes, mais comme de vieux saules dont l’écorce ne meurt jamais sans transmettre sa force à quelque vivace bourgeon. Le bonheur cependant, effrayé, fuyait à tire-d’aile sous les nuages, comme une colombe qui cherche un coin paisible où se poser, et que l’on ne verra peut-être jamais revenir avec le brin d’olivier.
Il y était en contact par les autres avec ce que la vie a de familier dans un rayon de six kilomètres. Les gamins des villages arrivaient avec des carniers de toile bise à l’intérieur des quels se trouvaient un morceau de pain dur, un chaudron plein de soupe froide, des noix sèches. Il y en avait de si malheureux que même les jours de soupe étaient pour eux des dates dans une semaine. Ils apportaient de l’odeur sauvage des bois qu’ils traversaient et que fréquentaient les renards, les chevreuils et les sangliers. Ils disaient que lors des grandes neiges ils rencontraient des loups dont ils n’avaient pas peur. Car ils s’en retournaient à la tombée de la nuit, petites formes grises qui se mouvaient sur les grandes routes pendant que la bise gémissait entre les arbres dépouillés. Ils parlaient des champs et des prés, des semailles et des moissons. A dix ans ils étaient rudes et portaient déjà de gros sabots ferrés.
Parce qu’il ne travaillait pas la terre et qu’il vivait dans ce bourg de trois mille âmes, il avait l’air à côté d’eux distingué, délicat comme une demoiselle. Il avait l’air d’un petit riche. Pourtant plusieurs d’entre eux plus tard posséderaient les fermes, les champs et les prés de leurs pères. Lui il n’hériterait jamais de rien, parce que son père ne possédait que ses deux bras.
Sa maison était proche de l’école. Tandis que ceux des villages restaient sous le hangar, les pieds dans la poussière, à manger sur leurs genoux, en deux minutes il arrivait. Le repas attendait sur la table. Presque en même temps que lui son père s’asseyait. Le repas de midi était le point culminant de la journée. Ce n’était pas en vain que toute une matinée ils avaient l’un et l’autre travaillé, puisqu’ils trouvaient sur la table lui la récompense, son père le fruit de sa peine. Le repas n’était guère varié : ils mangeaient du bœuf une grande partie de la semaine ; c’est la viande qui coûte le moins cher et l’on commence par vivre sur le pot-au-feu deux jours entiers, le dimanche et le lundi. Ce n’en était pas moins délicieux. Ils ne faisaient pas que manger, ni que boire un peu de vin : ils savouraient le calme, faisaient provision de courage pour l’après-midi qu’ils envisageaient avec plus de sérénité. Puisque la matinée avait eu sa raison d’être, il en serait de même de l’après-midi.
Pourtant le repas du soir ne ressemblait pas à celui de midi. D’ailleurs ce n’était point un repas : c’était « la soupe ». Qu’elle fût à l’oignon, aux pommes de terre, à l’oseille, elle ne coûtait pas cher. Il y avait plus d’eau que de beurre, que de lait. Elle durait un quart d’heure à peine. En été il fallait profiter de ce qu’il restait de lumière dans le ciel pour s’occuper du jardin où il y avait plus de légumes que de fleurs, du carré de champ où il n’y avait pas un centimètre de terre qui ne fût ensemencé. En hiver ils se couchaient de bonne heure, parce que le pétrole coûte cher et qu’il ne faut pas brûler trop de bois. La soupe n’était point comme le repas de midi une halte en pleine marche. Elle était le commencement d’un repos qu’ils avaient sous la main, du repos de toute une nuit. La chaise n’était rien, à côté du lit.
Pour lui, que ce fût sur le pas de la porte quand les pierres étaient encore chaudes du soleil de toute une journée, à la table à peine desservie quand le poêle qu’on laissait s’éteindre commençait à se refroidir, il apprenait ses leçons ou lisait de merveilleuses histoires.
Il y avait des animaux assez intelligents pour écrire de délicieux mémoires, d’autres, terribles, à qui les chasseurs dans les Indes dressaient des pièges. Des enfants quittaient leur chaumière bretonne pour tenter la fortune à Paris, et ne manquaient pas de rencontrer, chemin faisant, toutes sortes de bons génies ; d’autres dormaient au bord d’une route sous un chêne. « Il faisait froid, il faisait sombre ; la pluie tombait fine et serrée. » Ils auraient pu mourir ; mais passait, retour de Sébastopol, un brave sergent accompagné de son chien Capitaine. Hommes, femmes et bêtes, ah ! qu’ils étaient donc tous de braves gens, généraux russes et soldats français, honnêtes chemineaux, douces et distinguées comtesses, paysannes délicates ! Et il fallait avoir huit ans pour trembler quand Bournier enferme Dourakhine pour le tuer ! Ce n’étaient plus les menus incidents dont se tissait la trame de sa vie. Toute préoccupation mesquine était écartée. Les papas et les mamans savaient réprimander selon la juste mesure, et les enfants même, lorsqu’ils désobéissaient, ne le faisaient que d’accord avec une volonté supérieure.
Puis il lia connaissance avec un monde différent. Son imagination se posa sur les cimes de l’espace et du temps. Elle allait des Flandres où luttait Jacques Artevelde aux montagnes de l’Est où « Le Taureau des Vosges » tentait d’arrêter à lui seul l’invasion allemande. Il s’enthousiasmait tour à tour pour les chevaliers bretons qui la lance au poing galopaient sur les landes, et pour les hardis ingénieurs qui pouvaient faire vingt mille lieues sous les mers. Il descendait jusqu’au centre de la terre où il rencontrait, avec quel fantastique effroi, un géant pasteur de mammouths. Ce n’étaient plus les indications sèches de la géographie, ni les dates mortes de l’histoire. Tout était vivifié par le vent du large et des siècles ressuscités. Il ne rapetissait point les héros à sa taille : il rêvait de les égaler en force, en sagesse et en loyauté.
Le jeudi par des chemins détournés il s’en allait, quelquefois avec un ou deux camarades, presque toujours seul, jusqu’à l’entrée des bois qui encerclent la petite ville. Au printemps, les talus étaient fleuris de violettes et les prés de marguerites. L’été des libellules grésillaient au-dessus des étangs, et le chèvrefeuille parfumait les haies où les prunelles bleuissaient aux approches de l’automne. L’hiver le sol des routes sonnait creux comme la dalle d’un tombeau : dessous la terre était morte de froid. Tantôt, assis au pied d’un hêtre centenaire, dont les racines apparentes ressemblaient à de grosses veines de vieillard, il écoutait gémir le vent d’Octobre et regardait se disperser la fumée qui monte des tas enflammés de mauvaises herbes, d’épines et de bois de pommes de terre ; un petit oiseau sautillait en poussant de faibles cris, et le chant du grillon était triste comme un gémissement. Tantôt il allumait lui-même un feu de branches sèches, rêvant d’être perdu dans une île déserte où il lui aurait fallu subvenir à tous ses besoins et s’occuper de sa propre cuisine : ce ravin au fond duquel coulait la cascade n’était-il pas à une infinie distance de toute habitation ? On n’y sentait que l’odeur du buis, du houx et du sureau. Il y avait des fourrés inextricables de ronces, de lierre et de longues plantes enchevêtrées, qui faisaient penser aux lianes des forêts de l’Amérique. Un énorme serpent n’était-il pas enroulé là-bas autour du fût lisse de ce bouleau ? Tantôt il entendait meugler des bœufs qui paissaient dans les prés voisins ; tantôt au crépuscule des voix mystérieuses se répondaient dans la vaste plaine qu’il savait peuplée de fermes et de villages et dont il reprenait conscience. La nuit entrait dans le bois plus vite qu’ailleurs. Il grimpait le long des sentiers abrupts, retrouvant un peu plus de lumière à mesure qu’il atteignait les rochers les plus hauts.
Chaque saison revenait avec ses joies et ses ennuis invariables. Les rudes hivers lui valaient des heures exquises au coin du feu. S’il étouffait les après-midi d’été, que les matins étaient beaux et claires les nuits !
II
Sa maison ne ressemblait pas aux chaumières des villages avec leurs toits de paille qui descendent jusque devant les fenêtres comme s’ils voulaient voir ce qui se passe au-dessous du grenier. Elle pouvait paraître riche à cause de ses tuiles, de sa porte, de ses volets peints en blanc, de son armoire luisante, de sa table ronde recouverte d’un tapis et de sa cheminée garnie de bibelots sur lesquels à huit heures du matin il ne restait plus un grain de poussière. Mais elle ne leur appartenait pas. Il y en avait sur les seuils desquelles il eût été dangereux de s’essuyer les pieds parce qu’on se les serait salis, d’autres dont les carreaux n’avaient jamais été cirés ni même lavés, avec des tables encombrées de bols à moitié pleins de lait, avec des lits sans rideaux et des fenêtres à rideaux qu’on ne changeait pas tous les ans. Mais des hommes et des femmes y vivaient qui, possédant des biens au soleil, n’avaient qu’à travailler pour leur compte ; ils n’étaient pas à la merci des riches puisqu’ils récoltaient plus de blé, de légumes qu’il n’en avaient besoin, et qu’ils ne pouvaient boire avec la meilleure volonté du monde tout le vin de leurs vignes. Ils connaissaient les solides repas qui commencent en hiver à six heures du soir pour se terminer le lendemain matin. C’étaient de bons vivants à qui l’avenir ne faisait pas baisser les yeux. Ils n’avaient pas besoin de chercher à économiser, puisque leurs terres ne s’en iraient pas pendant la nuit.
Il avait l’air encore d’un petit riche parce que sa mère le tenait propre. La propreté ne coûte rien ; elle est même une économie. Puis il y avait chez elle une pointe d’orgueil à ce que son petit eût le moins possible de taches, de poussière, pour qu’on lui dît :
— Ah ! madame ! comment faites-vous donc pour qu’il soit toujours si propre ? Moi avec le mien je ne peux pas y arriver. Et puis c’est un brise-tout.
Ses sabots étaient toujours luisants, ses souliers du dimanche aussi parce que le cirage conserve le cuir et le bois.
Mais elle l’empêchait de courir avec les autres l’été, parce qu’on a vite fait de ramasser un chaud et froid et que les visites du médecin se payent ; de glisser avec eux l’hiver sur ces interminables glissoires qui usent en une après-midi de jeudi des paires de sabots. Autour du vieux puits dont le treuil grinçait et dont se descellait la grille, gamins et gamines dansaient la ronde en chantant :
Il court, il court, le furet,
Le furet du bois mesdames.
Et il se demandait en quel pays peut être situé ce bois qui s’appelle « mesdames ».
Mais il n’avait pas beaucoup de fois dans une année deux sous à lui. Il ne manque pas de choses plus indispensables qu’un bâton de sucre d’orge, qu’un tour de chevaux de bois, les jours où c’était fête, le premier dimanche de Mai, le lundi de la Pentecôte. Il enviait les autres qui sortaient avec des pièces de vingt sous. Il s’arrêtait devant toutes les baraques. Aux approches du crépuscule il errait encore, la gorge serrée, ses deux sous dans son poing fermé. Il y avait trop à choisir : il ne pouvait se décider. Il lui semblait qu’avec vingt sous il aurait pu se payer toute la fête. Les autres profitaient de tout, criant, essayant même de fumer des cigarettes. La vie était simple et naturelle pour eux. Leurs parents savaient que les jours de fêtes sont rares et qu’ils sont faits pour tout le monde. Leurs pères allaient dans les auberges et dans les cafés où sont installés des billards.
Du moins les fêtes religieuses étaient à la portée de tout le monde. L’entrée de l’église était gratuite ; les chantres avaient des voix assez puissantes pour que tout le monde les entendît. Surtout chacun de ces jours de fête était entouré d’une auréole lumineuse. Si la Toussaint s’appuyait mélancoliquement sur un bâton pour visiter les bois jonchés de feuilles jaunes et tout gris de brouillard, si Noël se chauffait dans une chaumière entourée de neige, Pâques s’annonçait majestueux par les voix de ses cloches assez puissantes pour que la terre toute entière les entendît. Il venait des profondeurs du ciel d’où il tirait le soleil qui étincelait dans l’azur comme la face même du Christ ressuscité. C’était une grande fête pour tout le monde, pour les enfants surtout, parce que c’est le dimanche de Pâques qu’ils mettent un beau costume neuf qui servira tout l’été, avec des souliers vernis qu’ils ne craindront plus de salir dans la neige. Ils étaient heureux aussi à cause des œufs de Pâques, si beaux que l’on dirait qu’ils n’ont pas été pondus par des poules ordinaires. Ils sont de toutes les couleurs. Il y en a de rouges comme des pantalons de soldats, de plus bleus que le ciel d’aujourd’hui, de violets comme des violettes qui sentent bon, de verts comme les feuilles nouvelles des tilleuls. Il n’avait ni costume neuf ni souliers vernis. On sait ce que coûtent les couleurs chez l’épicier. Alors on lui teignait ses œufs dans du marc de café. C’étaient de pauvres œufs qui roulaient timides, grisâtres, au milieu des autres qui lui semblaient prodigieux. Il n’osait pas les lancer trop fort, parce qu’on lui avait dit de les rapporter, parce qu’on en avait besoin pour le repas du soir.
Il savait trop, pour l’entendre répéter, que les travailleurs n’ont que le pouvoir d’économiser, puisqu’il est juste qu’ils ne gagnent que ce qu’on veut leur donner. Il paraît que dans des villes d’usines toutes noires de fumée, que même à Paris ou pourtant les maisons doivent être bâties en pierres rares, les ouvriers mécontents réclament des augmentations de salaires. Ici ceux qui lisent cela dans les journaux se contentent de hausser les épaules.
Au-dessus des maisons, des jardinets, des tilleuls et des sapins, le ciel est tendu comme une grande toile bleue solidement clouée aux bords de l’horizon et retenue très haut en son centre. L’automne et l’hiver, ses attaches faiblissant de partout elle se salit soudain, se transforme en une multitude de petits torchons grisâtres qui viennent frôler à certaines heures ce paysage d’arbres et de maisons. De ce ciel clair ou sombre toujours le même calme tombe. Torpeur des après-midi, apaisement des nuits de Juillet quand on fume sa pipe sur un banc de pierre jusqu’à onze heures du soir en regardant les étoiles. Ensevelissement des jours d’automne quand il pleut, des jours d’hiver quand il neige. Mais c’est en été que les jours contiennent le plus d’heures de travail. Le tabac ? De l’argent qui se dissipe en fumée. Les cafés ? Des abîmes où s’engloutissent en une heure les économies de toute une semaine. Rien n’est plus sain comme nourriture que les légumes que l’on récolte dans son propre jardin. Il faut aller le moins souvent possible dans les boucheries. Nous sommes tous appelés à vivre très longtemps : mettons pour notre vieillesse de l’argent de côté. Des mines d’argent à certains endroits se cachent sous le sol. Ici le moindre coin de terre recèle de gros sous qu’il faut arracher un à un à la fatigue de ses bras. Quand on les tient on les garde.
Dans cette atmosphère de contrainte son enfance montait comme rabougrie. On avait beau le tenir propre : il avait l’air quand même d’un petit malheureux. Il avait beau les jours de distribution de prix s’en aller chargé de livres : il n’en était pas moins le gamin des Vaneau, celui dont le père était à la disposition des bourgeois, dont la mère n’entrait jamais dans les salons des « dames », les belles dames encore jeunes qui sortent avec des chapeaux, des ombrelles, des jupons bruissants. Leurs fils, du même âge que lui, n’allaient pas tarder à partir pour le collège. Ils avaient moins de prix que lui. Ils ne connaissaient pas bien l’orthographe, rataient des problèmes, mais ils n’avaient peur de personne. Ils faisaient du tapage dans les rues, occupaient leurs vacances à des voyages qui les menaient hors du canton, hors du département, quelquefois jusqu’à Paris. Personne ne doutait que, parce qu’ils étaient riches, ils ne fussent destinés à accomplir de grandes choses. Il aurait dû rester ici comme les fils d’ouvriers. Mais à l’école il apprenait tout ce qu’il voulait : il partit comme les fils des riches.
III
C’est son premier voyage, qui n’en finira peut-être jamais. Après le train, une voiture, non plus la bonne diligence où l’on est assis entre des gens du pays, mais un char-à-bancs où l’on se serre, qui ressemble à une voiture de boucher. Il suit des rues, puis une longue route plantée d’arbres.
C’est une après-midi d’Octobre où les rayons du soleil n’ont point la force de venir jusque sur la terre : ils s’arrêtent très haut dans l’air, au-dessus du vent qui a le champ libre. Il n’aura plus pour se moquer du vent le coin du feu. La cheminée ne lui offrira plus, pour l’abriter, son manteau.
Sur le même banc, sur le banc d’en face, d’autres enfants sont assis qui portent déjà l’uniforme : casquette à visière vernie, veste à boutons dorés. Ils sont heureux de se retrouver.
Pour lui, ce n’est pas « la rentrée » qu’il faut dire, mais « l’entrée ». Il avance dans l’inconnu dont il a peur. Comme un croisé sur la route de Jérusalem, il tressaille dès qu’il aperçoit entre les arbres une grande maison couverte d’ardoises. S’il n’était pas si hésitant il demanderait : « Est-ce que nous arrivons ? » avec la crainte que ce fût déjà la pension.
Il faut pourtant que les chevaux s’arrêtent.
Jetés pêle-mêle à l’entrée de la cour, jusque sous le trapèze, des malles, des caisses, des colis de toutes formes. Ici un édredon que l’on devine, là une paire de sabots ficelés sur le couvercle d’une malle. Cela vient de tous les coins du département. Il se promène entre ces caisses et ces malles, cherchant les siennes du coin de l’œil. Si elles étaient perdues ? Il les découvre au pied d’un arbre. Il s’assoit. La tête lui tourne. Il se rappelle ; c’est comme s’il voyait tout ce que sa malle contient de menus objets que sa mère a voulu qu’il emporte.
Voici deux caisses qui renferment l’une des provisions, l’autre une partie de l’humble trousseau ; voici dans un sac de calicot le petit édredon fait exprès pour lui. Il voudrait pouvoir fermer les yeux, s’endormir là pour longtemps au milieu de tout ce qu’il lui reste de son pays, de sa maison. Mais il faut qu’il voie auprès de lui dans la cour, qu’il entende traversant avec bruit les couloirs et montant des escaliers, d’autres enfants, des élèves qui seront peut-être méchants. Il faut qu’il voie beaucoup de fenêtres dont aucune n’a de rideaux : dans les villages c’est seulement chez les misérables que les fenêtres sont sans rideaux. Par delà la cour que limite une terrasse les cimes des arbres d’un bosquet qui dévale vers une plaine immense, vers un horizon où fument de noires usines.
C’est un soir d’Octobre, un soir de fin de vacances où, lorsqu’il était encore « là-bas », il rentrait à la maison. Un feu clair pétillait entre les chenets. L’angélus tintait dans la brume. Il se recroquevillait heureux, parcouru d’un frisson à penser à ceux qui s’en allaient sur les routes parmi le brouillard et le vent, à ces petits qui fatigués s’assoient sur des talus en pleurant. Plusieurs ne rentraient pas chez eux, parce qu’ils n’avaient pas de maison, ou bien ils en étaient partis depuis tant de jours qu’il leur faudrait marcher beaucoup avant de la retrouver. Aujourd’hui c’est lui qui, comme un enfant égaré, songe douloureusement.
Ensuite que s’est-il passé ? Quelqu’un a dû venir lui frapper sur l’épaule et lui demander :
— Qu’est-ce que vous faites là, mon ami ?
Il a dû se lever, s’en aller au hasard, suivant l’un, suivant l’autre, de l’étude où vaille que vaille il a rangé ses quelques livres, à la lingerie où il a donné son trousseau. Il a dû monter au dortoir faire son lit, redescendre au réfectoire où bien qu’il n’ait pas faim il a été forcé de manger au milieu du bruit que font cent cinquante voix. Après la prière à la chapelle, il s’est couché, juste sous une veilleuse qui lui fait mal aux yeux. Il se sent malade et ne se plaint pas. Est-ce qu’on a le droit d’être malade en pension ? Les autres se moqueraient de lui. Il se cache du mieux qu’il peut la tête dans le traversin ; isolé, dans ce lit que sa mère n’a pas arrangé il pleure sans bruit, sans oser chercher son mouchoir, parce que le surveillant qui fait sa ronde le punirait certainement : on ne doit pas avoir en pension le droit de pleurer.
C’était une maison où les dortoirs sont perchés tout en haut des murs, comme des nids au faîte des arbres que le vent secoue. Huit jours durant, aux heures des récréations, il erra de corridor en corridor parce qu’il ne voulait pas jouer dans la cour avec les autres. Ils verraient tout de suite qu’il était timide, qu’il portait une culotte rapiécée. Ils se moqueraient de lui, le feraient souffrir.
Les soirs, dans la salle d’étude, à l’heure où les lampes à pétrole charbonnent, il se tenait immobile devant son pupitre, la tête brûlante.