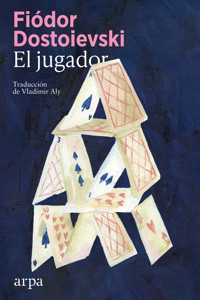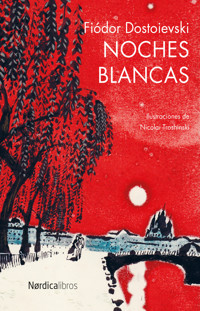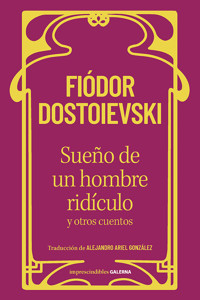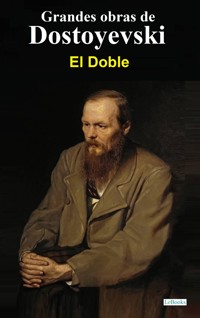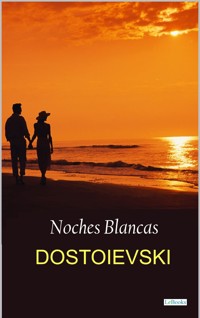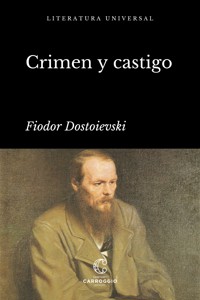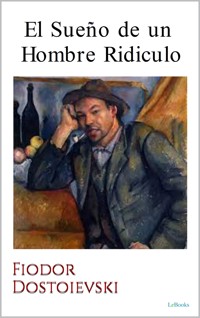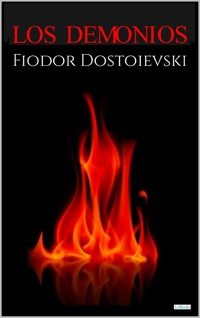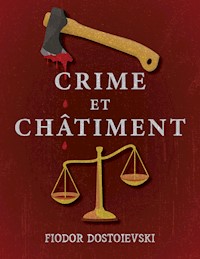Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Accusé de subversion politique, Dostoïevski fut à l’âge de vingt-huit ans condamné aux travaux forcés dans un bagne de Sibérie. Il fit dans ces
Souvenirs le récit de cette terrible expérience dans la maison des morts qui allait transformer sa vision du monde et du peuple russe et le « ressusciter ».
« Je me sentais un peu souffrant ces jours-ci, et je lisais la Maison des morts. Je n’en avais gardé qu’un souvenir incertain et j’ai relu le roman : je ne connais pas de meilleur livre dans toute la littérature moderne, y compris Pouchkine. » (Léon Tolstoï)
« Dostoïevski a fait de sa description de la vie dans une prison de Sibérie une fresque dans l’esprit de Michel-Ange. » (Alexandre Herzen)
Traduction intégrale d'Henri Mongault, 1956.
EXTRAIT
Notre bagne se trouvait à l’extrémité de la forteresse, au bord du rempart. Quand, à travers les fentes de la palissade, nous cherchions à entrevoir le monde, nous apercevions seulement un pan de ciel étroit et un haut remblai de terre, envahi par les grandes herbes, que nuit et jour des sentinelles arpentaient. Et nous nous disions aussitôt que les années auraient beau passer, nous verrions toujours, en regardant par les fentes de la palissade, le même rempart, le même factionnaire, le même pan de ciel, pas le ciel de la forteresse, mais un autre, un ciel plus lointain, un ciel libre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 (11 novembre 1821 dans le calendrier grégorien) et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881 (9 février 1881 dans le calendrier grégorien). Considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains et philosophes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf: