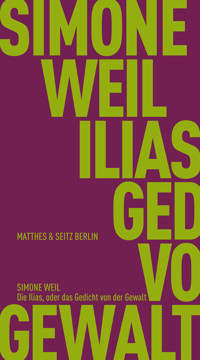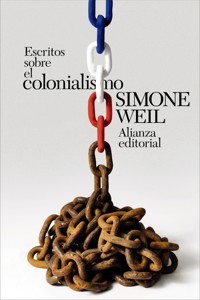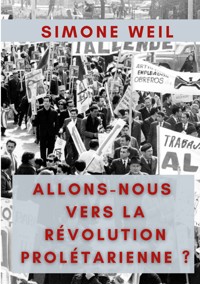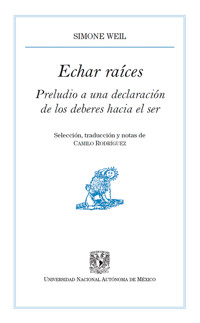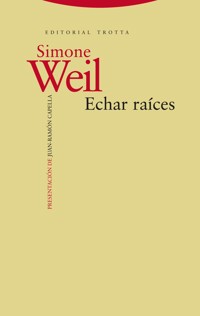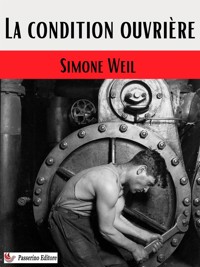0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L’humanité a commencé, comme chaque homme commence, par ne posséder aucune connaissance, hors la conscience de soi et la perception du monde. Cela lui suffisait, comme cela suffit encore aux peuples sauvages, ou, parmi nous, aux travailleurs ignorants, pour savoir se diriger dans la nature et parmi les hommes autant qu’il était nécessaire pour vivre. Pourquoi désirer plus ? Il semble que l’humanité n’aurait jamais dû sortir de cette heureuse ignorance, ni, pour citer Jean-Jacques, se dépraver au point de se mettre à méditer. Mais cette ignorance, c’est un fait qu’autant que nous pouvons savoir jamais l’humanité n’a eu proprement à en sortir, car jamais elle ne s’y est renfermée. Ce qui explique que la recherche de la vérité ait pu et puisse présenter quelque intérêt, c’est que l’homme commence, non pas par l’ignorance, mais par l’erreur. C’est ainsi que les hommes, bornés à l’interprétation immédiate des sensations, ne s’en sont jamais contentés ; toujours ils ont pressenti une connaissance plus haute, plus sûre, privilège de quelques initiés.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sur la science
Simone Weil
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385749842
NOTE DE L’ÉDITEUR
SCIENCE ET PERCEPTION DANS DESCARTES (1929-1930)
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE
DEUXIÈME PARTIE
CONCLUSION
(1932-1942)
LETTRE À UN CAMARADE
L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
RÉPONSE À UNE LETTRE D’ALAIN
FRAGMENT D’UNE LETTRE À UN ÉTUDIANT (Paris, 1937)
LA SCIENCE ET NOUS
L’AVENIR DE LA SCIENCE
RÉFLEXIONS À PROPOS DE LA THÉORIE DES QUANTA[1]
EXTRAITS DE LETTRES ET DE BROUILLONS DE LETTRES À A. W. (Janvier-avril 1940)
EXTRAITS DE LETTRES À A. W. (Marseille, 1941-1942)
FRAGMENTS (Sciences)
RÊVERIE À PROPOS DE LA SCIENCE GRECQUE[1]
À PROPOS DE LA MÉCANIQUE ONDULATOIRE
FRAGMENT
DU FONDEMENT D’UNE SCIENCE NOUVELLE
DU FONDEMENT D’UNE SCIENCE NOUVELLE
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ce premier volume des Essais, lettres et fragments contient des écrits de Simone Weil qui se rapportent plus spécialement aux sciences.
On y trouvera d’abord sa thèse de diplôme d’études supérieures, écrite en 1929-1930 et intitulée : Science et perception dans Descartes.
Les deux textes suivants, une ébauche de lettre et une ébauche d’article, ont été retrouvés parmi ses papiers. Ils concernent l’un et l’autre l’enseignement historique des sciences, particulièrement des mathématiques. Le contenu de ces deux textes montre qu’ils furent écrits en 1932, quand elle était professeur au Puy, ou pendant les vacances d’été qui ont suivi cette première année d’enseignement.
On trouvera ensuite une autre ébauche de lettre, également retrouvée parmi les papiers de Simone Weil. C’est probablement l’esquisse d’une réponse à une lettre d’Alain, comme on le voit par le passage où sont mentionnés les Entretiens au bord de la mer et par celui où il est question d’un plan de travail. Alain avait écrit à Simone Weil, en janvier 1935, après avoir lu les Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, une lettre où il lui disait entre autres : « Pourrez-vous former un plan de travail ? » Un large extrait de cette lettre d’Alain est cité dans la « Note de l’éditeur » quise trouve en tête du recueil Oppression et liberté (Gallimard, 1995).
Le fragment suivant est tiré d’une lettre écrite à un étudiant en 1937.
Vient ensuite un texte long et important, intitulé : La Science et nous. Il fut écrit à Marseille, dans les premiers mois de 1941, comme le montre un passage d’une lettre de Simone Weil à un ami, datée du 30 mai 1941 : « J’ai commencé un long travail sur la science contemporaine, classique (de la Renaissance à 1900), et grecque ; mais après avoir écrit là-dessus un peu plus de trente grandes pages, j’ai été interrompue par d’autres préoccupations. »
L’article concernant l’ouvrage collectif L’Avenir de la science a été publié à Marseille, dans les Cahiers du Sud, no 245, avril 1942, sous le pseudonyme anagrammatique d’Émile Novis. Il ne peut être antérieur à novembre 1941, l’impression de l’Avenir de la science n’ayant été achevée que le 28 octobre 1941.
Il est suivi d’un autre article, Réflexions à propos de la théorie des quanta, qui fut publié dans la même revue, no 51, décembre 1942, sous le même pseudonyme. Il concerne le livre de Max Planck, Initiations à la physique, qui avait paru en traduction française en février 1941.
Des passages concernant les sciences ont été extraits des lettres et des brouillons de lettres de Simone Weil à son frère André Weil. Ces textes ont été écrits, les uns à Paris, de janvier à avril 1940, les autres à Marseille, en 1941-1942.
On a groupé à la fin plusieurs fragments de date incertaine : Rêverie à propos de la science grecque, À propos de la mécanique ondulatoire, un fragment sans titre et Du Fondement d’une science nouvelle. Les pages intitulées Rêverie à propos de la science grecque sont parallèles à certaines pages de La Science et nous, dont elles constituent une variante.
SCIENCE ET PERCEPTION DANS DESCARTES (1929-1930)
Ἀεὶ ὁ θεὸς γεωμετρεῖ[1].
INTRODUCTION
L’humanité a commencé, comme chaque homme commence, par ne posséder aucune connaissance, hors la conscience de soi et la perception du monde. Cela lui suffisait, comme cela suffit encore aux peuples sauvages, ou, parmi nous, aux travailleurs ignorants, pour savoir se diriger dans la nature et parmi les hommes autant qu’il était nécessaire pour vivre. Pourquoi désirer plus ? Il semble que l’humanité n’aurait jamais dû sortir de cette heureuse ignorance, ni, pour citer Jean-Jacques, se dépraver au point de se mettre à méditer. Mais cette ignorance, c’est un fait qu’autant que nous pouvons savoir jamais l’humanité n’a eu proprement à en sortir, car jamais elle ne s’y est renfermée. Ce qui explique que la recherche de la vérité ait pu et puisse présenter quelque intérêt, c’est que l’homme commence, non pas par l’ignorance, mais par l’erreur. C’est ainsi que les hommes, bornés à l’interprétation immédiate des sensations, ne s’en sont jamais contentés ; toujours ils ont pressenti une connaissance plus haute, plus sûre, privilège de quelques initiés. Ils ont cru que la pensée errante, livrée aux impressions des sens et des passions, n’était pas la pensée véritable ; ils ont cru trouver la pensée supérieure en quelques hommes qui leur semblèrent divins, et dont ils firent leurs prêtres et leurs rois. Mais n’ayant aucune idée de ce que pouvait être cette manière de penser supérieure à la leur, comme en effet ils n’auraient pu la concevoir que s’ils l’avaient possédée, ils divinisèrent en leurs prêtres, sous le nom de religion, les plus fantastiques croyances. Ainsi ce juste pressentiment d’une connaissance plus sûre et plus élevée que celle qui dépend des sens fit qu’ils renoncèrent chacun à soi, se soumirent à une autorité, et reconnurent pour supérieurs ceux qui n’avaient d’autre avantage sur eux que de remplacer une pensée incertaine par une pensée folle.
Ce fut le plus grand moment de l’histoire, comme c’est un grand moment dans chaque vie, que l’apparition du géomètre Thalès, qui renaît pour chaque génération d’écoliers. L’humanité n’avait fait jusque là qu’éprouver et conjecturer ; du moment où Thalès, étant resté, selon la parole de Hugo, quatre ans immobile, inventa la géométrie, elle sut. Cette révolution, la première des révolutions, la seule, détruisit l’empire des prêtres. Mais comment le détruisit-elle ? Que nous a-t-elle apporté à la place ? Nous a-t-elle donné cet autre monde, ce royaume de la pensée véritable, que les hommes ont toujours pressenti à travers tant de superstitions insensées ? A-t-elle remplacé les prêtres tyranniques, qui régnaient au moyen des prestiges de la religion, par de vrais prêtres, exerçant une autorité légitime parce qu’ils ont véritablement entrée dans le monde intelligible ? Devons-nous nous soumettre aveuglément à ces savants qui voient pour nous, comme nous nous soumettions aveuglément à des prêtres eux-mêmes aveugles, si le manque de talent ou de loisir nous empêche d’entrer dans leurs rangs ? Ou cette révolution a-t-elle au contraire remplacé l’inégalité par l’égalité, en nous apprenant que le royaume de la pensée pure est le monde sensible lui-même, que cette connaissance quasi divine qu’ont pressentie les religions n’est qu’une chimère, ou plutôt qu’elle n’est autre que la pensée commune ? Rien n’est plus difficile, et en même temps rien n’est plus important à savoir pour tout homme. Car il ne s’agit de rien de moins que de savoir si je dois soumettre la conduite de ma vie à l’autorité des savants, ou aux seules lumières de ma propre raison ; ou plutôt, car cette question-là, ce n’est qu’à moi qu’il appartient de la décider, si la science m’apportera la liberté, ou des chaînes légitimes. C’est ce que le miracle géométrique, considéré en sa source, permet difficilement de dire. La légende veut que Thalès ait trouvé le théorème fondamental de la mathématique en comparant, pour mesurer les pyramides, le rapport des pyramides à l’ombre des pyramides, de l’homme à l’ombre de l’homme. Ici la science semblerait n’être qu’une perception plus attentive. Mais ce n’est pas ainsi qu’en ont jugé les Grecs. Platon sut bien dire que, si le géomètre s’aide de figures, ces figures ne sont pourtant pas l’objet de la géométrie, mais seulement l’occasion de raisonner sur la droite en soi, le triangle en soi, le cercle en soi. Comme ivres de géométrie, les philosophes de cette école rabattirent, par opposition à cet univers des idées dont un miracle leur donnait l’entrée, l’ensemble des perceptions à un tissu d’apparences, et défendirent la recherche de la sagesse à quiconque n’était pas géomètre. La science grecque nous laisse donc incertains. Aussi bien vaut-il mieux consulter la science moderne ; car, si l’on excepte une astronomie assez rudimentaire, c’est à la science moderne qu’il a été réservé d’amener la découverte de Thalès, par la physique, sur le terrain où elle rivalise avec la perception, autrement dit jusqu’au monde sensible.
Ici il n’y a plus aucune incertitude ; c’est bien un autre domaine de la pensée que nous apporte la science. Thalès lui-même, s’il ressuscitait pour voir jusqu’où les hommes ont mené ses réflexions, se sentirait, en comparaison de nos savants, un fils de la terre. Veut-il feuilleter un livre d’astronomie ? Il n’y sera pour ainsi dire pas question d’astres. Ce dont parlera le moins un traité de la capillarité ou de la chaleur, c’est de tubes étroits et de liquides, ou de la question de savoir ce qu’est la chaleur ou par quel moyen elle se propage. Ceux qui veulent donner un modèle mécanique des phénomènes physiques, comme les premiers astronomes ont représenté par des machines le cours des astres, sont à présent méprisés. Thalès, dans nos livres concernant la nature, espérerait trouver, à défaut des choses ou des modèles mécaniques qui les imitent, des figures géométriques ; il serait encore déçu. Il croirait son invention oubliée, il ne verrait pas qu’elle est reine, mais sous forme d’algèbre. La science, qui était au temps des Grecs la science des nombres, des figures et des machines, ne semble plus consister qu’en la science des purs rapports. La pensée commune sur laquelle il semble que Thalès, s’il ne s’y bornait pas, du moins s’appuyait, est à présent clairement méprisée. Les notions de sens commun, telles que l’espace à trois dimensions, les postulats de la géométrie euclidienne, sont laissées de côté ; certaines théories ne craignent même pas de parler d’espace courbe, ou d’assimiler une vitesse mesurable à une vitesse infinie. Les spéculations concernant la nature de la matière se donnent libre cours, essayant d’interpréter tel ou tel résultat de notre physique sans s’inquiéter le moins du monde de ce que peut être pour les hommes du commun cette matière qu’ils sentent sous leurs mains. Bref tout ce qui est intuition est banni par les savants autant qu’il leur est possible, ils n’admettent plus dans la science que la forme abstraite du raisonnement, exprimée dans un langage convenable au moyen des signes algébriques. Comme le raisonnement ne se produit au contraire chez le vulgaire qu’étroitement lié à l’intuition, un abîme sépare le savant de l’ignorant. Les savants ont donc bien succédé aux prêtres des anciennes théocraties, avec cette différence qu’une domination usurpée est remplacée par une autorité légitime.
Sans se révolter contre cette autorité, on peut cependant l’examiner. L’on remarque aussitôt des contradictions surprenantes. Voyons, par exemple, quelles sont les conséquences de cet empire absolu exercé par la plus abstraite mathématique sur la science. La science s’est purifiée de ce qu’elle avait d’intuitif, nous l’avons remarqué, jusqu’à ne plus concerner que des combinaisons de purs rapports. Mais il faut bien que ces rapports aient un contenu, et où le trouver, sinon dans l’expérience ? Aussi la physique ne fait-elle autre chose que d’exprimer, par des signes convenables, les rapports qui se trouvent entre les données de l’expérience. Autrement dit la physique peut être considérée comme consistant essentiellement en une expression mathématique des faits. Au lieu d’être reine de la science, la mathématique n’est plus qu’un langage ; à force de dominer, elle est réduite à un rôle servile. C’est pourquoi Poincaré a pu dire, par exemple, que les géométries euclidienne et non euclidienne ne diffèrent que comme un système de mesure d’un autre. « Que doit-on penser, dit-il dans La Science etl’Hypothèse, de cette question : la géométrie euclidienne est-elle vraie ? Elle n’a aucun sens. Autant demander si le système métrique est vrai et si les anciennes mesures sont fausses ; si les coordonnées cartésiennes sont vraies et si les coordonnées polaires sont fausses. Une géométrie ne peut être plus vraie qu’une autre, elle peut seulement être plus commode. » Ainsi, selon le témoignage du plus grand mathématicien de notre siècle, la mathématique n’est qu’un langage commode. Elle joue toujours, sous une forme ou sous une autre, le même rôle que nous lui voyons jouer dans les lois élémentaires de la physique, représentées par des courbes. L’expérience donne les points qui, sur le papier, représentent les mesures réellement faites ; le mathématicien fournit seulement la courbe la plus simple qui comprenne tous ces points, de manière que les diverses expériences puissent être ramenées à une seule loi. Et c’est ce qu’a aussi reconnu Poincaré. « Toutes les lois, dit-il dans La Valeur de la Science, sont tirées de l’expérience ; mais pour les énoncer, il faut une langue spéciale… Les mathématiques fournissent au physicien la seule langue qu’il puisse parler. » À cette fonction, et à celle d’indiquer au physicien des analogies entre les phénomènes par la ressemblance des formules qui les expriment, se borne, selon Poincaré, le rôle de l’analyse. C’est au point qu’à en croire ceux qui sont compétents en la matière, les savants sont arrivés à traduire l’expérience par des équations différentielles qu’ils se trouvent incapables de rapporter à l’énergie ou à la force, ou à l’espace, ou à n’importe quelle notion proprement physique. Ainsi cette science qui méprisait superbement l’intuition se trouve ramenée à traduire l’expérience dans le langage le plus général possible. Une autre contradiction concerne le rapport de la science et des applications. Les savants modernes, considérant, comme, semble-t-il, il leur convient de le faire, la connaissance comme le plus noble but qu’ils puissent se proposer, refusent de méditer en vue des applications industrielles, et proclament bien haut, avec Poincaré, que, s’il ne peut y avoir de Science pour la Science, il ne saurait y avoir de Science. Mais c’est à quoi semble mal convenir cette autre idée, que la question de savoir si telle théorie scientifique est vraie n’a aucun sens, et qu’elle n’est que plus ou moins commode. Au reste, la distance qui semblait se trouver entre le savant et l’ignorant se réduit ainsi à une différence de degré, car la science se trouve être, non plus vraie, mais plus commode que la perception.
Ces contradictions ne sont-elles insolubles qu’en apparence ? Ou sont-elles un signe que les savants, en séparant comme ils font la pensée scientifique de la pensée commune, se règlent sur leurs propres préjugés plutôt que sur la nature de la science ? Le meilleur moyen de le savoir est de prendre la science à sa source et de chercher selon quels principes elle s’est constituée ; mais plutôt qu’à Thalès, c’est, pour les raisons données plus haut, à l’origine de la science moderne qu’il nous faut remonter, à la double révolution par laquelle la physique est devenue une application de la mathématique et la géométrie est devenue algèbre, autrement dit à Descartes.
↑
« Dieu est toujours géomètre. » (Parole attribuée à Platon.)
PREMIÈRE PARTIE
S’il a pu y avoir pour nous incertitude touchant la question de savoir si, dans sa source même, la science a comme substitué au monde sensible un monde intelligible, cette incertitude ne semble pas devoir être longue à dissiper. Car si nous ouvrons les Méditations, nous lisons tout d’abord : « Tout ce que j’ai reçu jusqu’à présent pour le plus vrai et le plus assuré, je l’ai appris des sens, ou par les sens ; or j’ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. » En conséquence de quoi, lorsque Descartes veut chercher la vérité, il ferme les yeux, il bouche ses oreilles, il efface même de sa pensée toutes les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu’à peine cela se peut-il faire, il les réfute comme vaines et comme fausses. Il est vrai que ceci concerne une recherche métaphysique, et non mathématique ; mais l’on sait que Descartes considérait sa doctrine métaphysique comme le fondement de toutes ses pensées. Ainsi la première démarche de Descartes pensant est de faire abstraction des sensations. Il est vrai que ce n’est là qu’une forme de son doute hyperbolique, et l’on pourrait croire que cette défiance à l’égard des sens n’est que provisoire, conformément à la comparaison par laquelle Descartes explique ce qu’est pour lui le doute dans sa réponse aux septièmes objections : « Si forte haberet corbem pomis plenam, et vereretur ne aliquaex pomis istis essent putrida, velletque ipsa auferre, ne reliqua corrumperent, quo pacto id faceret ? An non in primis omnia omnimo ex corbe rejiceret ? Ac deinde singula ordine perlustrans, ea sola qua agnosceret non esse corrupta, resumeret, atque in corbem reponeret, aliis relictis[1] ? » (VIII, p. 481.) De fait la croyance aux témoignages des sens n’est pas au nombre des pensées que Descartes, après les avoir rejetées, reprend comme saines. L’objet de la physique cartésienne est au contraire de remplacer les choses que nous sentons par des choses que nous ne faisons que comprendre, au point de supposer, comme source des rayons solaires, un simple tourbillon. Le soleil même est privé de sa lumière par l’esprit. Et voici en effet le début du Monde autrement intitulé Traitéde la Lumière : « Me proposant de traiter ici de la Lumière, la première chose dont je veux vous avertir est qu’il peut y avoir de la différence entre le sentiment que nous en avons, c’est-à-dire l’idée qui s’en forme en notre imagination par l’entremise de nos yeux, et ce qui est dans les objets qui produit en nous ce sentiment, c’est-à-dire ce qui est dans la flamme ou dans le soleil, qui s’appelle du nom de lumière. » (IX, p. 3.) Ce qu’il montre par un exemple tiré de l’expérience même. « L’attouchement est celui de tous nos sens que l’on estime le moins trompeur et le plus assuré ; de sorte que, si je vous montre que l’attouchement même nous fait concevoir plusieurs idées, qui ne ressemblent en aucune façon aux objets qui les produisent, je ne pense pas que vous deviez trouver étrange, si je dis que la vue peut faire le semblable… Un gendarme revient d’une mêlée : pendant la chaleur du combat, il aurait pu être blessé sans s’en apercevoir ; mais maintenant qu’il commence à se refroidir, il sent de la douleur, il croit être blessé : on appelle un chirurgien, on le visite, et l’on trouve enfin que ce qu’il sentait n’était autre chose qu’une boucle ou une courroie qui, s’étant engagée sous ses armes, le pressait et l’incommodait. Si son attouchement, en lui faisant sentir cette courroie, en eût imprimé l’image en sa pensée, il n’aurait pas eu besoin d’un chirurgien pour l’avertir de ce qu’il sentait. » (XI, p. 5.)
Refusant donc de croire aux sens, c’est à la seule raison que Descartes se fie, et l’on sait que son système du monde est le triomphe de ce qu’on nomme la méthode a priori ; et cette méthode, il l’a appliquée avec une audace qui n’a eu, selon une parole connue, ni exemple ni imitateur ; car il va jusqu’à déduire l’existence du ciel, de la terre et des éléments. « L’ordre que j’ai tenu en ceci, écrit-il dans le Discours de la Méthode, a été tel. Premièrement j’ai tâché de trouver en général les Principes ou Premières Causes de tout ce qui est, ou qui peut être dans le monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu seul qui l’a créé, ni les tirer d’ailleurs que de certaines semences de vérité qui sont naturellement en nos âmes. Après cela j’ai examiné quels étaient les premiers et les plus ordinaires effets qu’on pouvait déduire de ces causes : et il me semble que par là j’ai trouvé des Cieux, des Astres, une Terre et même, sur la terre, de l’eau, de l’air, du feu, des minéraux, et quelques autres telles choses qui sont les plus communes de toutes et les plus simples. » (VI, p. 63.) Programme qui est rempli par les Principes avec ce commentaire presque insolent, qui se retrouve aussi dans la Correspondance : « Les démonstrations de tout ceci sont si certaines qu’encore que l’expérience nous semblerait faire voir le contraire, nous serions néanmoins obligés d’ajouter plus de foi à notre raison qu’à nos sens. » (Principes, (II, 52.) De quoi l’on peut rapprocher ce passage d’une lettre à Mersenne : « Je me moque du Sr Petit, et de ses paroles, et on n’a, ce me semble, pas plus sujet de s’écouter, lorsqu’il promet de réfuter mes réfractions par l’expérience, que s’il voulait faire voir, avec quelque mauvaise équerre, que les trois angles d’un triangle ne seraient pas égaux à deux droits. » ((II, p. 497.)
Ainsi la physique cartésienne est géométrique ; mais la géométrie cartésienne, à son tour, est bien loin de cette géométrie classique que Comte a si bien nommée spéciale parce qu’elle est attachée aux formes particulières. Ici, puisque nous considérons Descartes historiquement, il peut être utile de considérer quelle forme ont prise ses idées chez les philosophes qui sont plus ou moins ses disciples. Or, à la suite de la Géométrie de 1637, Malebranche et Spinoza se sont accordés à distinguer, quoique différemment, l’étendue intelligible de cette étendue qui est jetée comme un manteau sur les choses et ne parle qu’à l’imagination. Quoique Descartes n’ait pas été explicitement jusque-là, c’est à lui qu’il faut faire honneur de cette vigoureuse idée. Non qu’il n’ait semblé la sous-entendre par endroits, comme dans le célèbre passage du morceau de cire où Descartes dépouille l’étendue de ses vêtements de couleurs, d’odeurs, de sons, mais plus encore dans les lignes suivantes, adressées à Morus, où l’étendue semble déjà, comme elle sera dans Spinoza, conçue, non encore il est vrai comme indivisible, mais indépendamment des parties : Tangibilitas et impenetrabilitas in corpore est tantum ut in homine risibilitas, proprium quarto modo, juxta vulgares logicae leges, non vera et essentialis differentia, quam in exten sione consistere contendo ; atque idcirco, ut homo non definitur animal risibile, sed rationale, ita corpus non definiri per impenetrabilitatem, sed per extensionem. Quod confirmatur ex eo quod tangibilitas et impenetrabilitas habeant relationem ad partes, et praesupponant conceptum divisionis vel terminationis, possumus autem concipere corpus continuum indeterminatae magnitudinis, sive indefinitum, in quo nihil praeter extensionem consideretur[2].
Néanmoins c’est dans la révolution que fut, pour les mathématiques, la Géométrie de 1637 qu’éclate surtout cette idée de la pure étendue, de l’étendue en soi, pour parler un langage platonicien. Les géomètres anciens raisonnaient, il est vrai, non pas sur le triangle ou le cercle qu’ils avaient devant les yeux, mais sur le triangle ou le cercle en général ; ils restaient pourtant comme collés au triangle ou au cercle. Comme leurs démonstrations s’appuyaient sur l’intuition, elles gardaient toujours quelque chose de propre à l’espèce de figure qu’elles avaient pour objet. Quand Archimède eut mesuré l’espace enfermé par un segment de parabole, cette admirable découverte ne fut pourtant d’aucun secours pour les recherches analogues concernant, par exemple, l’ellipse ; car c’étaient les propriétés particulières de la parabole qui, au moyen d’une construction impraticable ou inutile pour toute autre figure, rendaient cette mesure possible. Descartes a compris le premier que l’unique objet de la science, ce sont des quantités à mesurer, ou plutôt les rapports qui déterminent cette mesure, rapports qui, dans la géométrie, se trouvent seulement comme enveloppés dans les figures, de même qu’ils peuvent l’être, par exemple, dans les mouvements. C’est après cette intuition de génie qu’à partir de Descartes les géomètres cessèrent de se condamner, comme avaient fait les géomètres grecs, à ne faire correspondre une expression ayant un degré quelconque qu’à une étendue ayant un nombre de dimensions correspondant, lignes pour les quantités simples, surfaces pour les produits de deux facteurs, volumes pour les produits de trois. En effet : Omnia eodem se habent modo, si considerentur tantum sub ratione dimensionis, ut bic et in Mathematicis disciplinis est faciendum… Cujus rei anidmadversio magnam Geometriae adfert lucem, quoniam in illa fere omnes male concipiunt tres species quantitatis : lineam, superficiem et corpus. Jam enim ante relatum est, lineam et superficiem non cadere sub conceptum ut vere distinctasa corpore, vel ab invicem ; si vero considerentur simpliciter, ut per intellectum abstractae, tunc non magis diversae sunt species quantitatis, quam animal et vivens in homine sunt diversae species substantiae[3]. (X, p. 448.) Les mathématiques étaient ainsi délivrées de la superstition par laquelle chaque figure avait comme sa quantité propre. Les figures ne furent plus dès lors que des données qui posaient des rapports de quantité ; il ne fallait plus qu’adapter les signes arithmétiques à cette nouvelle espèce de rapports ; mais déjà Viète, en créant l’algèbre, les avait adaptés à tous les rapports possibles. Les courbes elles-mêmes furent définies par la loi, c’est-à-dire par la formule, qui les rapprochait ou les éloignait, à mesure qu’elles étaient tracées, d’une droite arbitrairement choisie. Bref, à partir de 1637, l’essence du cercle, selon l’expression que devait employer Spinoza, n’était plus circulaire. Toutes les figures furent comme dissoutes, la droite subsista seule et les géomètres cessèrent, à l’exemple de Descartes, de considérer « d’autres théorèmes, sinon que les côtés des triangles semblables ont semblable proportion entre eux, et que dans les triangles rectangles le carré de la base est égal aux deux carrés des côtés… Car… si l’on tire d’autres lignes et qu’on se serve d’autres théorèmes… on ne voit point si bien ce qu’on fait, si ce n’est qu’on ait la démonstration du théorème fort présente à l’esprit ; et en ce cas on trouve, quasi toujours, qu’il dépend de la considération de quelques triangles, qui sont ou rectangles ou semblables entre eux, et ainsi on retombe dans mon chemin » (IV, p. 38).
Au reste il est clair que l’initiative hardie, et après quelque temps presque universellement imitée, par laquelle Fourier, dans ses célèbres études sur la chaleur, négligea l’intermédiaire de la mécanique pour appliquer directement l’analyse à la physique, ne faisait que répéter, sur une autre matière, la Géométrie de 1637. Ou plutôt, cette Géométrie n’était qu’une des applications de ce principe général, appliqué aujourd’hui dans toutes les études qui le comportent, que les rapports entre les quantités sont le seul objet du savant. L’on peut même penser que Descartes aurait devancé la science moderne en se servant de l’analyse pour la physique comme pour la géométrie, s’il avait eu entre les mains un instrument assez élaboré. Il ne faut pas s’étonner que l’inventeur de cette vue hardie n’ait eu, comme nous l’avons remarqué, que mépris pour ce que Spinoza appellera la connaissance du premier genre. Pas plus que Spinoza il ne croit qu’on puisse être sage sans philosopher, et nul n’a employé à ce sujet des expressions plus fortes. « C’est proprement avoir les yeux fermés, dit-il dans la préface des Principes, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher… et enfin cette étude est plus nécessaire pour régler nos mœurs, et nous conduire en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux pour conduire nos pas. » Enfin l’on ne s’étonnera pas que celui qui écarte résolument les idées « qui se forment dans l’imagination par l’entremise de nos yeux », et délivre la mathématique du joug de l’intuition, ait, comme Spinoza, rabaissé l’imagination à ne consister qu’en des mouvements du corps humain. C’est ce que montre un texte des Regulae :Concipiendum est… phantasiam esse veram partem corporis, et plus loin : ex his intelligere licet, quomodo fieri possint omnes aliorum animalium motus, quamvis in illis nulla prorsus rerum cognitio sed phantasia tantum pure corporea admittatur[4] (X, p. 414).
Ainsi la science est comme purifiée de la boue natale, si l’on peut ainsi parler, dont Thalès et ses successeurs ne l’avaient pas entièrement nettoyée. Elle est ce que Platon avait pressenti : un ensemble d’idées. Et c’est ici l’occasion de saisir un autre aspect de la pensée cartésienne à l’aide d’un autre disciple de Descartes. Leibniz ; car si Leibniz a voulu bâtir, non seulement la connaissance humaine, mais même la connaissance divine, qui, selon son système, est la même chose que le monde, avec des idées, c’est Descartes, encore qui doit être considéré comme l’inspirateur de cette doctrine. Dans les Méditations il se contentait, il est vrai, de remarquer l’existence en son esprit d’idées qui, disait-il, ne peuvent être estimées un pur néant, et ne sont pas feintes par lui, mais ont leurs natures vraies et immuables. Mais dans les Regulae, œuvre dont Leibniz possédait une copie, Descartes va bien plus loin en sa doctrine des idées simples, qu’il définit ainsi : Absolutum voco, quidquid in se continet naturam puram et simplicem, de qua est quaestio : ut omne id quod consideratur quasi independens, causa, simplex,universale, unum, aequale, simile, rectum, vel alia hujusmodi ; atque idem primum voco simplicissimum et facillimum, ut illo utamur in quaestionibus resolvendis[5]. (X, p. 381.) Et comment doit-on s’en servir ? C’est ce qu’on voit plus loin. Notandum paucas esse dumtaxat naturas puras et simplices, quas primo et per se, non dependenter ab aliis ullis, sed vel in ipsis experimentis, vel lumine quodam in nobis insito, licet intueri ; atque has dicimus diligenter esse observandas : sunt enim eaedem quas in unaquaque serie maxime simplices appellamus. Caeterae autem omnes non aliter percipi possunt, quam si ex istis deducantur, idque vel immediate et proxime, vel non nisiper duas, aut tres aut plures conclusiones diversas[6]. (X, p. 383.) Et plus loin ce texte plus significatif encore : Colligitur tertio, omnem humanam scientiam in hoc uno consistere, ut distincte videamus, quomodo naturae istae simplices ad compositionem aliarum rerum simul concurrant[7]. (X, p. 427.) Il suffit de pousser l’idée jusqu’à ses dernières conséquences pour retrouver Leibniz. Car si ces édifices transparents faits d’idées simples arrivent, en s’élevant, à approcher de plus en plus la complication des choses existantes, devons-nous croire que l’abîme qui sépare malgré tout nos raisonnements du monde n’est pas dû à notre esprit borné, plutôt qu’à la nature des idées ? D’où l’on arrive à se représenter qu’en un entendement infini il doit être vrai que César a passé le Rubicon, exactement comme il est vrai pour nous que deux et deux font quatre. S’il n’en est pas ainsi pour nous, c’est qu’il est besoin, pour connaître à proprement parler un événement, d’une analyse infinie. « Quoiqu’il soit aisé, dit Leibniz, de juger que le nombre de pieds du diamètre n’est pas enfermé dans la notion de la sphère en général, il n’est pas si aisé de juger si le voyage que j’ai dessein de faire est enfermé dans ma notion ; autrement il nous serait aussi aisé d’être prophètes que d’être géomètres. »
L’idée que nous pouvons nous faire de Descartes comme fondateur de la science moderne semble ainsi complète. La géométrie classique était encore comme collée à la terre ; il l’en a détachée, il a été comme un second Thalès par rapport à Thalès. Il a transporté la connaissance de la nature du domaine des sens au domaine de la raison. Il a donc purifié notre pensée d’imagination, et les savants modernes, qui ont appliqué l’analyse directement à tous les objets susceptibles d’être ainsi étudiés, sont ses vrais successeurs. Poincaré, en substituant aux preuves intuitives concernant l’addition et la multiplication des preuves analytiques, a fait preuve d’esprit cartésien. Ceux qui, après Leibniz, espèrent bâtir pour ainsi dire l’univers avec des idées, ou pensent du moins que l’univers en Dieu, ou bien, pour parler autrement, en soi, n’est pas bâti autrement, ceux-là aussi procèdent de Descartes. Il n’est pas jusqu’à l’opposition, remarquée plus haut, entre la commodité prise comme règle de la science et le mépris des applications que l’on ne retrouve en Descartes. Car si dans sa jeunesse, lorsqu’il pense que les sciences ne servent qu’aux arts mécaniques, il juge que des fondements si fermes n’ont servi à rien de bien relevé, d’autre part il ne semble pas plus que Poincaré exiger des théories scientifiques qu’elles soient vraies, mais seulement qu’elles soient commodes. C’est ainsi qu’il compare souvent ses théories aux idées des astronomes concernant l’équateur et l’écliptique, qui, bien que fausses, ont fondé l’astronomie. C’est qu’il veut que l’ordre, essence de la science cartésienne, ne se conforme pas servilement à la nature des choses, mais s’applique « même aux choses qui ne se suivent pas naturellement les unes les autres ». Bref, la science moderne a été dès l’origine, quoique moins développée, ce qu’elle est actuellement. La question que nous nous posions tout à l’heure est résolue. Il faut accepter la science telle qu’elle est, ou y renoncer. Il n’y aurait qu’à en rester là, et il n’y aurait plus aucune question à poser, si une lecture quelque peu attentive de Descartes ne suffisait pas pour rencontrer une foule de textes difficilement conciliables, semble-t-il, avec l’esquisse de la philosophie cartésienne précédemment tracée ; aussi allons nous passer en revue quelques-uns de ces textes, que nous grouperons par ordre autant qu’il est possible, nous réservant de les commenter par la suite.