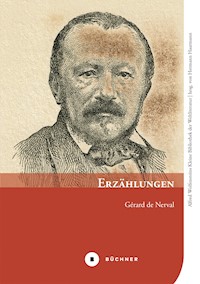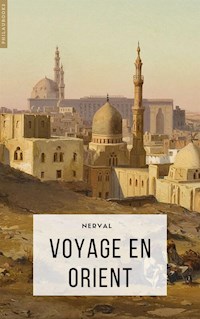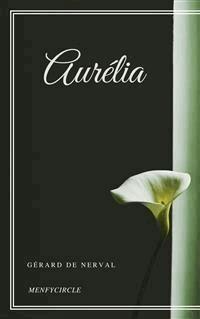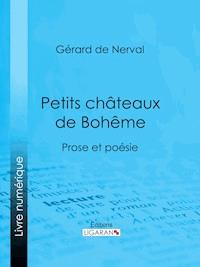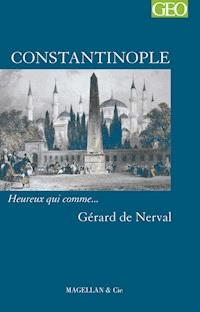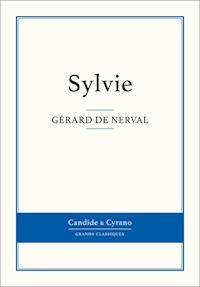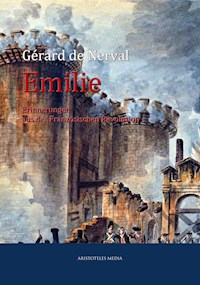Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Si un écrivain a cherché à éclairer les lois profondes presque insaisissables de l'âme humaine, c'est Gérard de Nerval dans Sylvie. Cette histoire que l'on a qualifiée de peinture naïve, c'est le rêve d'un rêve. Gérard essaie de se souvenir d'une femme qu'il aimait en même temps qu'une autre. En évoquant ce temps dans un tableau de rêve, il est pris du désir de partir. Il arrive... dans un pays qui est plutôt pour lui un passé et ce qu'il voit alors, pour ainsi dire détaché par une nuit d'insomnie, est entremêlé si étroitement aux souvenirs qu'on est obligé à tout moment de tourner les pages qui précèdent pour voir où on se trouve... présent ou rappel du passé. La couleur de Sylvie est une couleur pourpre d'un rose pourpre en velours pourpre ou violacé, et nullement les tons aquarellés d'une France modérée. Gérard a trouvé le moyen de donner à son tableau les couleurs de son rêve.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sylvie
SylvieI. NUIT PERDUE.II. ADRIENNE.III. RÉSOLUTION.IV. UN VOYAGE À CYTHÈRE.V. LE VILLAGE.VI. OTHYS.VII. CHÂALIS.VIII. LE BAL DE LOISY.IX. ERMENONVILLE.X. LE GRAND FRISÉ.XI. RETOUR.XII. LE PÈRE DODU.XIII. AURÉLIE.XIV. DERNIER FEUILLET.CHANSONS ET LÉGENDES DU VALOISPage de copyrightSylvie
Gérard de Nerval
I. NUIT PERDUE.
Je sortais d’un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupirant. Quelquefois tout était plein, quelquefois tout était vide. Peu m’importait d’arrêter mes regards sur un parterre peuplé seulement d’une trentaine d’amateurs forcés, sur des loges garnies de bonnets ou de toilettes surannées, — ou bien de faire partie d’une salle animée et frémissante couronnée à tous ses étages de toilettes fleuries, de bijoux étincelants et de visages radieux. Indifférent au spectacle de la salle, celui du théâtre ne m’arrêtait guère, — excepté lorsqu’à la seconde ou à la troisième scène d’un maussade chef-d’œuvre d’alors, une apparition bien connue illuminait l’espace vide, rendant la vie d’un souffle et d’un mot à ces vaines figures qui m’entouraient.
Je me sentais vivre en elle, et elle vivait pour moi seul. Son sourire me remplissait d’une béatitude infinie ; la vibration de sa voix si douce et cependant fortement timbrée me faisait tressaillir de joie et d’amour. Elle avait pour moi toutes les perfections, elle répondait à tous mes enthousiasmes, à tous mes caprices, — belle comme le jour aux feux de la rampe qui l’éclairait d’en bas, pâle comme la nuit, quand la rampe baissée la laissait éclairée d’en haut sous les rayons du lustre et la montrait plus naturelle, brillant dans l’ombre de sa seule beauté, comme les Heures divines qui se découpent, avec une étoile au front, sur les fonds bruns des fresques d’Herculanum !
Depuis un an, je n’avais pas encore songé à m’informer de ce qu’elle pouvait être d’ailleurs ; je craignais de troubler le miroir magique qui me renvoyait son image, — et tout au plus avais-je prêté l’oreille à quelques propos concernant non plus l’actrice, mais la femme. Je m’en informais aussi peu que des bruits qui ont pu courir sur la princesse d’Élide ou sur la reine de Trébizonde, — un de mes oncles, qui avait vécu dans les avant-dernières années du dix-huitième siècle comme il fallait y vivre pour le bien connaître, m’ayant prévenu de bonne heure que les actrices n’étaient pas des femmes, et que la nature avait oublié de leur faire un cœur. Il parlait de celles de ce temps-là sans doute ; mais il m’avait raconté tant d’histoires de ses illusions, de ses déceptions, et montré tant de portraits sur ivoire, médaillons charmants qu’il utilisait depuis à parer des tabatières, tant de billets jaunis, tant de faveurs fanées, en m’en faisant l’histoire et le compte définitif, que je m’étais habitué à penser mal de toutes sans tenir compte de l’ordre des temps. Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n’était plus la galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice élégant et paré comme sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies du Directoire ; c’était un mélange d’activité, d’hésitation et de paresse, d’utopies brillantes, d’aspirations philosophiques ou religieuses, d’enthousiasmes vagues, mêlés de certains instincts de renaissance ; d’ennuis des discordes passées, d’espoirs incertains, — quelque chose comme l’époque de Pérégrinus et d’Apulée. L’homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis ; la déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait dans les nuits, et nous faisait honte de nos heures de jour perdues. L’ambition n’était cependant pas de notre âge, et l’avide curée qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d’activité possibles. Il ne nous restait pour asile que cette tour d’ivoire des poètes, où nous montions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l’air pur des solitudes, nous buvions l’oubli dans la coupe d’or des légendes, nous étions ivres de poésie et d’amour. Amour, hélas ! des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques ! Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité ; il fallait qu’elle apparût reine ou déesse, et surtout n’en pas approcher.
Quelques-uns d’entre nous néanmoins prisaient peu ces paradoxes platoniques, et à travers nos rêves renouvelés d’Alexandre agitaient parfois la torche des dieux souterrains, qui éclaire l’ombre un instant de ses traînées d’étincelles. — C’est ainsi que, sortant du théâtre avec l’amère tristesse que laisse un songe évanoui, j’allais volontiers me joindre à la société d’un cercle où l’on soupait en grand nombre, et où toute mélancolie cédait devant la verve intarissable de quelques esprits éclatants, vifs, orageux, sublimes parfois, — tels qu’il s’en est trouvé toujours dans les époques de rénovation ou de décadence, et dont les discussions se haussaient à ce point que les plus timides d’entre nous allaient voir parfois aux fenêtres si les Huns, les Turcomans ou les Cosaques n’arrivaient pas enfin pour couper court à ces arguments de rhéteurs et de sophistes.
« Buvons, aimons, c’est la sagesse ! » Telle était la seule opinion des plus jeunes. Un de ceux-là me dit : « Voici bien longtemps que je te rencontre dans le même théâtre, et chaque fois que j’y vais. Pour laquelle y viens-tu ? »
Pour laquelle ?… Il ne me semblait pas que l’on pût aller là pour une autre. Cependant j’avouai un nom. — « Eh bien ! dit mon ami avec indulgence, tu vois là-bas l’homme heureux qui vient de la reconduire, et qui, fidèle aux lois de notre cercle, n’ira la retrouver peut-être qu’après la nuit. »
Sans trop d’émotion, je tournai les yeux vers le personnage indiqué. C’était un jeune homme correctement vêtu, d’une figure pâle et nerveuse, ayant des manières convenables et des yeux empreints de mélancolie et de douceur. Il jetait de l’or sur une table de whist et le perdait avec indifférence. — Que m’importe, dis-je, lui ou tout autre ? Il fallait qu’il y en eût un, et celui-là me paraît digne d’avoir été choisi. — Et toi ? — Moi ? C’est une image que je poursuis, rien de plus.
En sortant, je passai par la salle de lecture, et machinalement je regardai un journal. C’était, je crois, pour y voir le cours de la Bourse. Dans les débris de mon opulence se trouvait une somme assez forte en titres étrangers. Le bruit avait couru que, négligés longtemps, ils allaient être reconnus ; — ce qui venait d’avoir lieu à la suite d’un changement de ministère. Les fonds se trouvaient déjà cotés très-haut ; je redevenais riche.
Une seule pensée résulta de ce changement de situation, celle que la femme aimée si longtemps était à moi si je voulais. — Je touchais du doigt mon idéal. N’était-ce pas une illusion encore, une faute d’impression railleuse ? Mais les autres feuilles parlaient de même. — La somme gagnée se dressa devant moi comme la statue d’or de Moloch. « Que dirait maintenant, pensais-je, le jeune homme de tout à l’heure si j’allais prendre sa place près de la femme qu’il a laissée seule ?… » Je frémis de cette pensée, et mon orgueil se révolta.
Non ! ce n’est pas ainsi, ce n’est pas à mon âge que l’on tue l’amour avec de l’or : je ne serai pas un corrupteur. D’ailleurs ceci est une idée d’un autre temps. Qui me dit aussi que cette femme soit vénale ? — Mon regard parcourait vaguement le journal que je tenais encore, et j’y lus ces deux lignes : « Fête du Bouquet provincial. — Demain, les archers de Senlis doivent rendre le bouquet à ceux de Loisy. » Ces mots, fort simples, réveillèrent en moi toute une nouvelle série d’impressions : c’était un souvenir de la province depuis longtemps oubliée, un écho lointain des fêtes naïves de la jeunesse. — Le cor et le tambour résonnaient au loin dans les hameaux et dans les bois ; les jeunes filles tressaient des guirlandes et assortissaient, en chantant, des bouquets ornés de rubans. — Un lourd chariot, traîné par des bœufs, recevait ces présents sur son passage, et nous, enfants de ces contrées, nous formions le cortège avec nos arcs et nos flèches, nous décorant du titre de chevaliers, — sans savoir alors que nous ne faisions que répéter d’âge en âge une fête druidique, survivant aux monarchies et aux religions nouvelles.
II. ADRIENNE.
Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l’esprit résiste encore aux bizarres combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les plus saillants d’une longue période de la vie.
Je me représentais un château du temps de Henri IV avec ses toits pointus couverts d’ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de pierres jaunies, une grande place verte encadrée d’ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d’un français si naturellement pur que l’on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France.