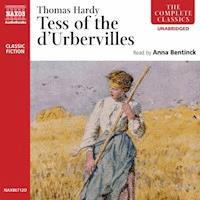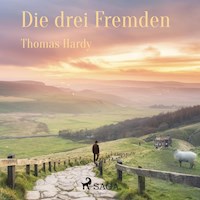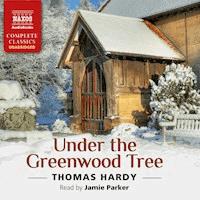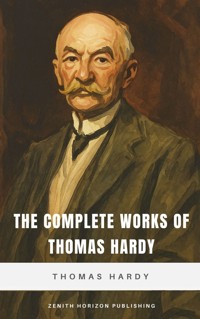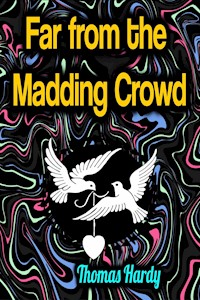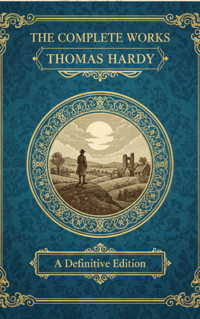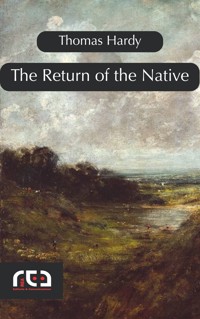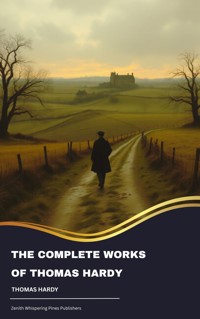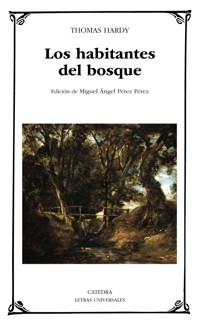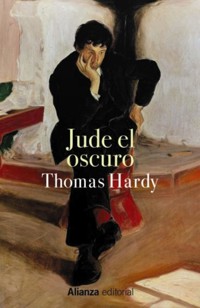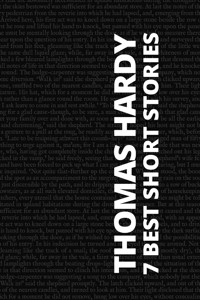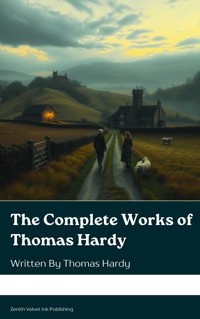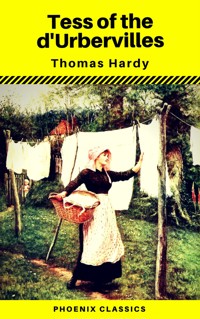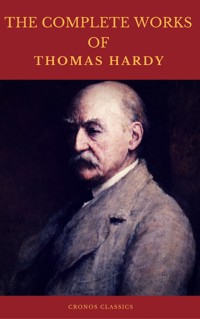Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "Tess d'Urberville" est un roman poignant de Thomas Hardy qui explore les thèmes de l'innocence, de la fatalité et des injustices sociales. L'histoire suit Tess Durbeyfield, une jeune femme issue d'une famille paysanne, dont la vie bascule lorsqu'elle découvre qu'elle est liée à la noble lignée des d'Urberville. Envoyée par ses parents pour réclamer leur prétendu héritage, Tess rencontre Alec d'Urberville, un homme qui abuse de sa position pour la séduire, laissant Tess déshonorée et enceinte. De retour chez elle, Tess tente de reconstruire sa vie, mais la mort de son enfant et le poids du secret continuent de la hanter. Elle trouve un nouvel espoir en Angel Clare, un jeune homme idéaliste qui tombe amoureux d'elle, ignorant son passé. Pourtant, la révélation de son histoire à Angel provoque une rupture qui la pousse à des actes désespérés. Hardy dépeint avec une grande sensibilité les luttes internes de Tess, tout en critiquant la rigidité morale et les hypocrisies de la société victorienne. Le roman interroge la notion de pureté et de culpabilité, tout en soulignant la cruauté du destin qui s'acharne sur une héroïne dont la seule faute est de vouloir vivre librement dans un monde qui ne lui en laisse pas la possibilité. À travers un récit riche en émotions et en rebondissements, Hardy offre une réflexion intemporelle sur la condition féminine et les injustices sociales. L'AUTEUR : Thomas Hardy, né le 2 juin 1840 à Higher Bockhampton, Dorset, est un écrivain et poète britannique, célèbre pour ses romans qui dépeignent avec une grande acuité les moeurs et les luttes sociales de l'Angleterre rurale du XIXe siècle. Issu d'une famille modeste, Hardy a d'abord travaillé comme architecte avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Son oeuvre est marquée par une profonde sensibilité aux injustices sociales et une critique acerbe des conventions victoriennes. Parmi ses romans les plus connus figurent "Loin de la foule déchaînée", "Jude l'Obscur" et "Tess d'Urberville", ce dernier étant souvent considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature anglaise. Hardy a également écrit de nombreux poèmes, dans lesquels il explore des thèmes similaires à ceux de ses romans, tels que le destin, l'amour et la nature. Bien que ses oeuvres aient parfois suscité la controverse de son vivant, notamment en raison de leur pessimisme et de leur critique sociale, Hardy est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands écrivains de son époque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Première phase : Jeune fille
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Deuxième phase : Femme
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Troisième phase : Le réveil de la vie
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
Quatrième phase : La conséquence
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
Chapitre XXIX
Chapitre XXX
Chapitre XXXI
Chapitre XXXII
Chapitre XXXIII
Chapitre XXXIV
Cinquième phase : La femme paie
Chapitre XXXV
Chapitre XXXVI
Chapitre XXXVII
Chapitre XXXVIII
ChapitreXXXIX
Chapitre XL
Chapitre XLI
Chapitre XLII
Chapitre XLIII
Chapitre XLIV
Sixième phase : Le converti
Chapitre XLV
Chapitre XLVI
Chapitre XLVII
Chapitre XLVIII
Chapitre XLIX
Chapitre L
Chapitre LI
Chapitre LII
Septième phase : L’achèvement
Chapitre LIII
Chapitre LIV
Chapitre LV
Chapitre LVI
Chapitre LVII
Chapitre LVIII
Chapitre LIX
Première phase
Jeune fille
I
Un soir de la fin de mai, un homme d’un certain âge s’en retournait à pied de Shaston au village de Marlott, dans le val voisin de Blackmoor. Ses jambes vacillantes le faisaient obliquer légèrement vers la gauche. De temps en temps il semblait, par un vigoureux hochement de tête, confirmer une opinion, bien qu’il ne pensât à rien en particulier. Un panier à œufs vide était suspendu à son bras ; le poil de son chapeau était tout hérissé et la marque du pouce se voyait sur le bord.
Il croisa un prêtre âgé, à califourchon sur une jument grise, qui, tout en chevauchant, fredonnait d’un air distrait.
– Bien le bonsoir, dit l’homme au panier.
– Bonsoir, sir John, dit le prêtre.
Le piéton fit un ou deux pas, s’arrêta, puis se retournant :
– Faites excuse, monsieur : mais au dernier jour de marché nous nous sommes rencontrés sur cette route, à peu près à cette heure-ci, et j’ai dit : Bonsoir, et vous m’avez répondu : Bonsoir, sir John, comme aujourd’hui.
– Oui, dit le prêtre.
– Et une autre fois, avant, il y a près d’un mois.
– Cela se peut.
– Alors, pourquoi donc que vous m’appeliez tout le temps sir John, quand je suis tout bonnement Jack Durbeyfield, le revendeur ?
Le prêtre approcha son cheval.
– C’était une simple lubie, dit-il ; puis, après un moment d’hésitation : – C’est une découverte que j’ai faite il y a peu de temps, en étudiant les généalogies pour la nouvelle histoire du comté. Je suis le pasteur Tringham, l’antiquaire de Stagfoot-Lane. Ignorez-vous vraiment, Durbeyfield, que vous êtes le représentant en ligne directe de la vieille famille des chevaliers D’Urberville, descendant du célèbre chevalier, sir Païen D’Urberville qui, d’après les archives de Battle-Abbey, vint de Normandie avec Guillaume le Conquérant ?
– C’est bien la première fois qu’on me le dit, monsieur !
– Mais, c’est vrai... Levez un instant le menton que je puisse mieux saisir votre profil. Oui, voilà le nez et le menton D’Urberville... un peu dégénérés. Votre ancêtre était un des douze chevaliers qui aidèrent le seigneur normand d’Estremavilla à conquérir le comté de Glamorgan. Plusieurs branches de votre famille ont possédé des manoirs dans toute cette région-ci. Leurs noms se trouvent dans les Rôles du Trésor, au temps du roi Étienne. Sous le règne du roi Jean, l’un deux était assez riche pour faire don d’une seigneurie aux Chevaliers Hospitaliers, et, au temps d’Édouard II, votre aïeul Brian fut convoqué à Westminster pour y assister au Grand Conseil. Après avoir un peu décliné à l’époque d’Oliver Cromwell, mais pas de façon sérieuse, sous le règne de Charles II vous fûtes nommés Chevaliers du Chêne-Royal pour votre loyalisme. Oui, il y eut parmi vous des générations de sir John, et si le titre de chevalier, comme celui de baronnet, était héréditaire, ainsi qu’au temps jadis où les chevaliers se succédaient de père en fils, vous aussi, vous seriez maintenant sir John.
– Pas possible !
– En un mot, conclut le prêtre, se cinglant la jambe d’un coup de cravache décisif, il n’y a peut-être pas de famille pareille dans toute l’Angleterre.
– Nom de nom ! c’est-il bien vrai ? dit Durbeyfield, et voilà-t-il pas que je roule depuis des années, que je mange de la vache enragée, comme si je valais pas plus que le dernier de la paroisse !... Et depuis combien de temps sait-on ces choses-là sur moi, pasteur Tringham ?
Le prêtre lui expliqua qu’elles étaient, à sa connaissance, tombées dans l’oubli et que tout le monde, probablement, les ignorait ; lui-même avait commencé ses recherches au printemps dernier, quand, après s’être occupé de suivre les vicissitudes de la famille D’Urberville, il avait un jour remarqué le nom de Durbeyfield sur la voiture du revendeur. Alors, il s’était mis à faire une enquête sur le père et le grand-père de Durbeyfield et avait fini par n’avoir plus aucun doute.
– J’étais d’abord résolu à ne pas vous troubler avec ces renseignements inutiles, dit-il. Mais nos impulsions l’emportent parfois sur notre jugement. Je croyais que vous en saviez peut-être quelque chose ?
– Ah ! c’est vrai, j’ai entendu dire une ou deux fois que ma famille avait vu de meilleurs jours avant de venir à Blackmoor. Mais j’y avais pas fait attention, croyant que ça signifiait que nous avions eu autrefois deux chevaux, tandis que maintenant nous n’en avons plus qu’un... J’ai aussi une vieille cuiller d’argent et un vieux cachet gravé, à la maison ; mais bon Dieu ! qu’est-ce que c’est qu’une cuiller et un cachet ?... Et penser que nous étions de la même chair, tout ce temps, moi et ces nobles D’Urberville ! On disait que mon arrière-grand-père avait des secrets et ne se souciait pas de raconter d’où qu’il venait... Et, pasteur, sauf votre respect, où nous chauffons-nous maintenant ? Je veux dire où est-ce que nous demeurons, nous autres D’Urberville ?...
– Nulle part. Vous vous êtes éteints... comme grande famille.
– C’est malheureux !
– Oui, comme disent les chroniques mensongères, la branche masculine s’est éteinte, c’est-à-dire qu’elle a décliné, disparu.
– Alors, où sommes-nous enterrés ?
– À Kingsbere-sub-Greenhill. Vous êtes en rangées dans vos caveaux, et vos effigies reposent sous des baldaquins de marbre.
– Et où sont nos châteaux et nos domaines de famille ?
– Vous n’en avez pas.
– Et pas de terre non plus ?
– Aucune ; autrefois vous en possédiez en abondance, comme je vous l’ai dit ; votre famille se composait de branches nombreuses. Vous aviez, dans ce comté, une résidence à Kingsbere, une autre à Sherton, une autre à Millpond, une autre à Lullstead, une autre à Wellbridge.
– Et rentrerons-nous jamais dans ce qui est à nous ?
– Ah ! cela, je ne puis le dire.
– Et qu’ai-je de mieux à faire à ce propos, monsieur ? demanda Durbeyfield après un silence.
– Oh ! rien... rien. Si ce n’est vous humilier en songeant « Combien les puissants sont tombés ! ». C’est un fait de quelque intérêt pour l’historien et le généalogiste local, rien de plus. Il y a parmi les villageois de ce comté plusieurs familles d’un lustre presque égal. Bonsoir.
– Mais il faut retourner sur vos pas et prendre avec moi une pinte de bière, pasteur Tringham ; ils en ont de très passable à la Bonne Rasade, même si elle ne vaut pas celle de Rolliver.
– Non, merci ; pas ce soir, Durbeyfield ; vous en avez déjà votre compte !
Là-dessus, le pasteur continua son chemin, se demandant s’il avait été sage de colporter cette curieuse bribe de science.
Quand il fut parti, Durbeyfield fit quelques pas dans une rêverie profonde, puis, déposant son panier devant lui, s’assit sur le talus qui bordait la route.
Quelques minutes après, un jeune homme parut au loin ; Durbeyfield, en le voyant, leva la main, et l’autre pressa le pas et s’approcha de lui.
– Petit, prenez ce panier, vous allez me faire une commission.
Le grêle adolescent fronça le sourcil.
– Qui êtes-vous donc, John Durbeyfield, pour me commander et m’appeler petit ? Vous savez mon nom aussi bien que je sais le vôtre !
– Hé, hé ! C’est le secret ! Maintenant, obéissez à mes ordres et prenez le message dont je vais vous charger... Et donc, Fred, je veux bien vous dire le secret : c’est que je suis d’une noble race. Ça vient d’être découvert par moi cet après-midi !
Et, en faisant cette déclaration, Durbeyfield s’étendit voluptueusement sur le talus, parmi les pâquerettes.
Le jeune garçon, debout devant Durbeyfield, le contemplait dans toute sa longueur, de la tête aux pieds.
– Sir John D’Urberville, voilà qui je suis ! continuait l’homme étendu... c’est-à-dire, si les chevaliers étaient des baronnets, ce qu’ils sont. Tout ce qui se rapporte à moi est raconté dans l’histoire. Gamin, connais-tu l’endroit qui s’appelle Kingsbere-sub-Greenhill ?
– Oui, j’y suis été pour la foire de Greenhill.
– Eh bien, sous l’église de cette cité reposent...
– C’est pas une cité, l’endroit que je veux dire ; ou ça ne l’était pas quand j’y étais. C’était une espèce de petit endroit borgne.
– N’importe l’endroit, enfant, ce n’est pas la question. Sous l’église de cette commune-là donc reposent mes ancêtres, des centaines, en cottes de mailles et avec des bijoux, dans des grands cercueils de plomb pesant des kilos et des kilos. Y a pas dans tout le comté de South Wessex un homme avec, dans sa famille, des plus grands et des plus nobles esquelettes que moi !
– Oh !
– Maintenant, prenez ce panier et allez-vous-en à Marlott ; et quand vous serez arrivé à la Bonne Rasade, dites-leur de m’envoyer tout de suite un cheval ou une voiture pour me conduire à la maison. Et qu’ils mettent au fond de la voiture une mesure de rhum dans une petite bouteille, et qu’ils la marquent sur l’ardoise à mon compte. Et ensuite, allez chez moi dire à ma femme de laisser là son savonnage parce que c’est pas la peine de le terminer ; qu’elle attende que je revienne, j’ai des nouvelles à lui dire.
Comme le jeune garçon restait indécis, Durbeyfield mit la main dans sa poche et tira un shilling, un des rares qu’il eût en sa possession.
– Voici pour votre peine, petit.
Ceci changea l’opinion du jeune homme.
– Oui, sir John, merci. Rien d’autre que je puisse faire pour vous, sir John ?
– Dites-leur à la maison que j’aimerais pour le souper, voyons... un fricot d’agneau s’ils peuvent en avoir, sinon du boudin, et s’ils en peuvent pas trouver, des andouilles feront l’affaire.
– Oui, sir John.
Le jeune garçon prit le panier et au moment où il allait partir, des sons d’instruments de cuivre se firent entendre du côté du village.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? dit Durbeyfield. C’est pas pour moi ?
– C’est la promenade du club des femmes, sir John. Voyons. Votre fille est membre ?
– Parbleu ! Je l’avais tout à fait oublié en pensant à de plus grandes choses ! Eh bien, filez sur Marlott, n’est-ce pas, et commandez-moi cette voiture, et peut-être que je passerai faire l’inspection du club.
Le jeune garçon partit et Durbeyfield demeura couché sur l’herbe et les pâquerettes au soleil du soir. La route resta déserte et les sons affaiblis des instruments furent les seuls bruits humains perceptibles dans l’enceinte des collines bleues.
II
Le village de Marlott est situé au milieu des ondulations nord-est du beau val de Blackmoor, région enserrée et solitaire dont la plus grande partie est encore ignorée du touriste ou du paysagiste, bien qu’elle soit à quatre heures de Londres.
La meilleure façon de connaître la vallée est de la contempler du sommet des collines qui l’environnent, sauf peut-être durant les sécheresses de l’été, car ses chemins étroits, tortueux et bourbeux sont peu agréables pour le piéton qui, sans guide, en explore les recoins par le mauvais temps. Ce pays fertile et abrité où les champs ne sont jamais roussis et les sources jamais à sec, est limité au sud par une abrupte arête calcaire qui renferme plusieurs éminences. Le voyageur qui vient de la mer, après avoir fait péniblement une trentaine de kilomètres par des coteaux crayeux et des terres à blé, est surpris et charmé, en arrivant soudain au bord de l’un de ces escarpements, de voir à ses pieds s’étaler comme une carte une contrée toute différente de celle qu’il a traversée. Par-derrière, les collines sont découvertes, le soleil flamboie sur des champs assez larges pour donner au paysage l’air d’être à ciel libre, les chemins sont blancs, les haies basses sont formées de branches entrelacées, l’atmosphère est incolore. Dans la vallée, le monde paraît fait sur une échelle plus menue et plus délicate ; les champs sont de simples enclos, si réduits que, de cette hauteur, les haies semblent un réseau de fils vert sombre s’étendant sur le vert plus pâle de l’herbe. En bas, l’atmosphère est pleine de langueur et si colorée d’azur que le second plan participe de cette teinte tandis qu’au-delà, l’horizon est de l’outremer le plus foncé. Les terres labourables sont rares et restreintes. À de légères exceptions près, l’ensemble est une vaste masse luxuriante de verdure et d’arbres, où disparaissent les collines et les vallées de moindre importance qu’elle enveloppe comme d’un manteau. Tel est le val de Blackmoor.
L’intérêt de la région est historique autant que topographique. Le val était connu jadis sous le nom de Forêt du Cerf Blanc ; une légende relatait comment un certain Thomas de la Lynd ayant tué un beau cerf blanc, forcé mais épargné par le roi Henri III, s’était vu condamner de ce fait à une lourde amende. Jusqu’à une époque relativement récente, le pays était couvert de bois épais. Encore maintenant, on en peut retrouver les traces dans les vieux taillis de chênes et les bandes irrégulières de hautes futaies qui survivent sur les pentes, et dans les arbres au tronc creux qui bordent maint pâturage. Les forêts ont disparu mais quelques vieilles coutumes de leurs ombrages existent encore, souvent déguisées ou transformées. Par exemple, cet après-midi-là, l’antique danse du Premier Mai se pouvait reconnaître dans la fête du club, ou, comme on disait, la promenade du club.
C’était un événement plein d’intérêt pour les jeunes habitants de Marlott, bien que l’intérêt véritable fût ignoré de ceux qui y prenaient part. La curiosité principale du club ne consistait pas dans l’antique coutume de s’en aller en procession danser sur l’herbe à chaque anniversaire, mais dans sa composition exclusivement féminine.
Dans les clubs d’hommes, ces fêtes étaient moins rares, tout en disparaissant peu à peu ; mais la timidité naturelle au sexe faible ou l’attitude sarcastique prise par les membres masculins de la famille avaient privé les derniers clubs de femmes (s’il en existait encore d’autres) de ce qui était leur gloire et leur fin. Seul celui de Marlott maintenait la Cerealia locale. Ce n’était pas un cercle proprement dit, mais une sorte de confrérie, restée fidèle à sa promenade processionnelle depuis des siècles.
Toute la bande était vêtue de robes blanches, gaie survivance des jours d’autrefois où la joie et le mois de mai étaient synonymes, de ces jours où trop de prévoyance n’avait pas encore réduit les émotions à une médiocrité monotone. Les jeunes femmes se donnaient d’abord en spectacle en faisant deux par deux une procession autour de la commune. L’idéal et le réel se heurtaient un peu quand le soleil découpait leurs silhouettes sur les haies vertes et les façades des maisons à la broderie de plantes grimpantes, car, si la troupe tout entière était habillée de blanc, il n’y avait pas deux teintes pareilles. Quelques robes étaient d’un blanc presque franc ; d’autres d’une pâleur bleuâtre ; d’autres encore (depuis longtemps sans doute pliées dans les armoires et appartenant aux plus âgées) tiraient sur le livide et rappelaient le temps du roi George. En outre, toutes les femmes et toutes les jeunes filles tenaient dans la main droite une baguette, et, dans la gauche, un bouquet de fleurs blanches. Chacune s’était chargée de cueillir l’un et d’écorcer l’autre.
On remarquait dans le cortège quelques femmes mûres, voire quelques vieilles femmes dont les cheveux aux fils d’argent et les visages ridés paraissaient quasi grotesques, certainement pathétiques, en si pimpant attirail. À les bien regarder cependant, ces créatures soucieuses que l’expérience avait instruites et pour qui s’approchait l’heure résignée du détachement total, vous en auraient plus appris que leurs compagnes juvéniles. Mais laissons-les pour celles chez qui palpite l’ardeur de la vie.
Les jeunes filles formaient la majorité de la bande et leurs cheveux opulents reflétaient au soleil tous les tons d’or, de noir et de brun. Quelques-unes avaient de beaux yeux, d’autres un joli nez, d’autres une jolie bouche et une jolie taille, peu d’entre elles avaient tout réuni ; peut-être même aucune. C’étaient de vraies paysannes, gênées par cette exhibition en public ; elles ne savaient que faire de leurs lèvres et tâchaient en vain de bien poser la tête et de se donner un air indifférent.
Et de même que toutes étaient réchauffées au-dehors par le soleil, de même chacune avait son petit soleil intérieur aux rayons duquel son âme s’épanouissait : quelque rêve, quelque affection, quelque marotte, au moins quelque espérance faible et lointaine qui, dépérissant faute d’aliment, continuait cependant à vivre selon l’habitude des espérances. Aussi toutes étaient de bonne humeur et beaucoup étaient gaies.
Elles firent le tour en passant près de l’auberge de la Bonne Rasade et quittèrent la grand-route pour entrer dans les prés par une petite barrière quand l’une des femmes dit :
– Seigneur Dieu ! Tess Durbeyfield, voilà-t-il pas ton père qui rentre chez lui en voiture !
Une jeune femme de la bande tourna la tête à cette exclamation. C’était une belle fille, bien faite, pas mieux que d’autres peut-être, mais sa bouche mobile d’un rouge de pivoine et ses grands yeux innocents donnaient de l’éloquence à la couleur et à la forme. Elle portait un ruban rouge dans les cheveux et elle était la seule du blanc cortège qui pût se vanter d’une si éclatante parure.
Au moment où elle se retourna, Durbeyfield passait sur la route dans un cabriolet de la Bonne Rasade conduit par une vigoureuse donzelle à tête frisée, les manches retroussées jusqu’aux coudes. C’était la joyeuse servante de l’établissement qui, jouant le rôle de factotum, devenait parfois palefrenier et valet d’écurie. Durbeyfield, étendu dans le fond de la voiture, les yeux voluptueusement fermés, agitait la main au-dessus de sa tête et chantait en un long récitatif :
« J’ai – un grand – caveau – de – famille – à – Kings – bere – et – des – ancêtres – chevaliers – dans – des – cercueils – de – plomb ! »
Les membres du club furent prises de rires étouffés, sauf la jeune fille nommée Tess, chez qui semblait monter une lente colère à la pensée que son père se rendait ridicule.
– Il est fatigué, voilà tout, dit-elle vivement, et il a pris la voiture pour rentrer parce que notre cheval doit se reposer aujourd’hui.
– Dieu te bénisse, Tess, que tu es simple ! dirent ses compagnes... Il a son pompon des jours de marché. Ah ! ah !
– Écoutez, je n’avancerai pas d’une ligne avec vous si vous continuez à rire de lui ! cria Tess dont la figure et le cou prirent la même teinte que ses joues.
Un instant après, ses yeux se mouillèrent et son regard s’abaissa. Voyant qu’elles lui avaient vraiment fait de la peine, les autres se turent et l’ordre régna de nouveau. L’orgueil de Tess ne lui permit pas de tourner la tête pour savoir quelle était l’intention de son père, s’il en avait une, et elle se dirigea avec toute la bande vers l’enclos où l’on devait danser sur l’herbe. Quand on y fut arrivé, elle avait retrouvé sa bonne humeur, donnait de petits coups de baguette à sa voisine et causait comme d’habitude.
À cette époque de sa vie, Tess Durbeyfield n’était qu’émotion pure, dépourvue de toute expérience. Malgré l’école du village, sa langue subissait encore l’influence du patois et de l’accent du terroir où les r se prolongent en une intonation savoureuse. Sa bouche d’un rouge foncé à la jolie petite moue avait pris à peine sa forme définitive et la lèvre inférieure faisait remonter le milieu de la lèvre supérieure quand elles se fermaient après avoir parlé. L’enfant apparaissait encore à demi chez elle. Ce jour-là, tandis qu’elle s’avançait dans sa robuste beauté de femme, ses douze ans se lisaient sur ses joues, ses neuf ans étincelaient dans ses yeux, et même de temps à autre sur la courbe de ses lèvres voltigeaient ses cinq ans.
Cependant peu de gens le voyaient et moins encore y prenaient garde. Un petit nombre, surtout des étrangers, la regardaient longuement en passant, se laissaient momentanément fasciner par sa fraîcheur et se demandaient avec regret s’ils la reverraient, mais elle n’était pour la plupart qu’une belle et pittoresque paysanne, rien d’autre.
Personne n’entendit plus parler de Durbeyfield dans son char triomphal et, le club ayant atteint l’endroit fixé, la danse commença. Puisqu’il n’y avait pas d’hommes dans la troupe, les jeunes filles dansèrent d’abord entre elles, mais, quand approcha la fin de la journée de travail, les habitants du village ainsi que des oisifs et des piétons se réunirent tout autour et parurent disposés à demander une danseuse.
Parmi les assistants se trouvaient trois jeunes gens d’une classe supérieure ; ils portaient de petits havresacs au dos et de fortes cannes à la main. D’après leur ressemblance générale et leur âge on pouvait supposer qu’ils étaient frères, et ils l’étaient en effet. L’aîné avait la cravate blanche, le gilet montant et le chapeau à bord mince du clergyman classique ; le second était l’étudiant ordinaire ; il eût été assez difficile de caractériser le troisième et le plus jeune d’après son apparence ; son regard et son costume étaient ceux d’un homme qui ne s’est pas encore pris dans l’engrenage d’une carrière. Ce qu’on pouvait affirmer, c’est qu’il devait être prêt à essayer un peu de tout, à étudier un peu de tout à son aise et à son heure.
Les trois frères racontaient à une connaissance du moment qu’ils profitaient de leurs vacances de Pentecôte pour faire une excursion dans le val de Blackmoor. Ils s’accoudèrent contre la barrière, le long de la grand-route, et demandèrent ce que signifiaient la danse et les jeunes filles en robes blanches. Il était évident que les deux aînés n’avaient pas l’intention de s’attarder plus d’un instant, mais le troisième paraissait diverti par le spectacle d’un essaim de jeunes filles dansant sans cavaliers, et nullement pressé de se mettre en marche. Il déboucla son havresac, le posa avec sa canne sur le bord de la haie et ouvrit la barrière.
– Que vas-tu faire, Angel ? demanda l’aîné.
– J’ai envie d’aller m’amuser un peu avec elles. Pourquoi pas nous tous ?... Juste une ou deux minutes, cela ne nous retiendra pas longtemps !
– Non, non ! Quelle sottise ! Danser en public avec une bande de petites villageoises ! Suppose qu’on nous voie ! Viens donc, ou il fera nuit avant d’arriver à Stourcastle, et il n’y a pas d’endroit plus proche où l’on puisse coucher. Puis, il faut que nous achevions un autre chapitre de la Riposte à l’Agnosticisme avant de nous reposer, puisque j’ai pris la peine d’emporter le volume.
– Très bien, je vous rejoindrai, Cuthbert et toi, dans cinq minutes ; ne vous arrêtez pas. Je te le promets, Félix.
Les deux aînés le laissèrent à regret et partirent, emportant le havresac de leur frère pour qu’il pût les rejoindre plus facilement, et le jeune homme entra dans le pré.
– N’est-ce pas mille fois dommage, mes amies ? dit-il galamment aux deux ou trois jeunes filles qui étaient le plus rapprochées de lui, aussitôt qu’un arrêt se produisit dans la danse... Où sont donc vos cavaliers ?
– Ils n’ont pas encore fini leur travail, dit l’une des plus hardies, ils seront ici tout à l’heure. Jusque-là voulez-vous en être, monsieur ?
– Certainement ; mais qu’est-ce qu’un seul pour tant de danseuses ?
– Mieux que rien. C’est pas drôle de se faire vis-à-vis avec quelqu’un de son espèce sans personne pour vous pincer la taille. Maintenant faites votre choix.
– Chut ! Sois pas si osée ! dit une autre plus timide.
Le jeune homme ainsi convié jeta sur elles un coup d’œil et tâcha de choisir ; mais comme il n’en connaissait aucune, ce n’était pas chose facile. Il prit la première qui lui tomba sous la main et ce ne fut pas celle qui avait parlé, comme elle s’y attendait ; pas plus d’ailleurs Tess Durbeyfield. Une généalogie, des squelettes d’ancêtres, des monuments commémoratifs, les traits D’Urberville, jusqu’à présent ne servaient guère à Tess dans la bataille de la vie, ne la faisaient même pas préférer par un danseur aux plus vulgaires paysannes. Voilà donc ce que vaut le sang aristocratique quand le lucre moderne ne vient pas le rehausser !
Le nom de celle qui les éclipsa, quel qu’il fût, n’a pas été transmis, mais toutes l’envièrent pour avoir la première, ce soir-là, joui du luxe d’un cavalier. Cependant, telle est la force de l’exemple que les jeunes gens du village, peu pressés de passer la barrière tant qu’il n’y avait pas d’intrus, se glissèrent alors assez vite dans l’enceinte, et l’élément masculin s’introduisit dans tous les couples, tant et si bien que la plus laide du club ne fut plus obligée de remplir le rôle de cavalier.
Tout à coup, l’horloge de l’église ayant sonné, l’étudiant déclara qu’il lui fallait partir ; il avait à rejoindre ses compagnons. Comme il quittait la danse, son regard tomba sur Tess Durbeyfield dont les grands yeux semblaient lui reprocher faiblement de ne pas l’avoir choisie. Lui aussi regretta que la timidité de la jeune fille l’eût empêché de la remarquer, et tout en y songeant, il quitta le pâturage.
Pour regagner le temps perdu, il descendit au pas de course le sentier, eut bientôt traversé le creux et atteint le sommet de l’autre montée. Il n’avait point encore rejoint ses frères, mais il s’arrêta pour reprendre haleine et regarder derrière lui. Il pouvait voir dans l’enclos vert les silhouettes blanches des jeunes filles tournoyant encore. Elles semblaient l’avoir déjà oublié. Toutes, sauf une, peut-être. Cette forme blanche restait seule à l’écart, près de la haie ; il la reconnut pour être la jolie fille avec qui il n’avait pas dansé. Quoique ce fût chose insignifiante, il sentait instinctivement qu’elle était blessée de son oubli. Il aurait voulu l’avoir invitée, il aurait voulu savoir son nom. Sa physionomie était si modeste, si expressive, elle avait paru si douce dans sa robe blanche qu’il se trouvait stupide d’avoir agi de cette façon.
En tout cas, il n’y pouvait rien ; se retournant, il se pencha en avant pour reprendre sa course et n’y pensa plus.
III
Quant à Tess Durbeyfield, elle n’oublia pas si vite cet incident. Elle resta longtemps sans entrain pour danser ; elle pouvait avoir quantité de cavaliers, sans doute ; mais ils ne parlaient pas si bien que le jeune étranger. Elle se décida seulement à secouer sa tristesse et à accepter une danse, lorsque la silhouette du jeune homme s’éloignant toujours sur la colline se fut perdue dans les rayons du soleil.
Elle demeura jusqu’à la brune avec ses camarades et prit part à la fête avec un certain entrain ; comme son cœur jusqu’ici était libre, elle recherchait la danse pour la danse et ne devinait guère, devant « les tendres tourments, les amères douceurs, les peines charmantes et l’exquise détresse » des filles amoureuses, ce qu’elle-même était capable de ressentir. Elle se divertissait de voir les gars se bousculer pour se disputer sa main dans une gigue, mais voilà tout, et quand ils devenaient violents, elle se fâchait.
Elle serait restée davantage si elle ne s’était rappelé l’apparition et les manières bizarres de son père ; un peu inquiète de ce qu’il était devenu, elle s’écarta des danseurs et se dirigea vers l’extrémité du village où se trouvait sa chaumière.
À quarante ou cinquante mètres de là, elle perçut des sons rythmés autres que ceux dont elle s’éloignait, des sons qu’elle connaissait bien, si bien ! C’était une suite régulière de gros coups produits par le balancement violent d’un berceau sur la pierre, tandis qu’une voix féminine chantait en mesure sur un galop énergique la ballade favorite de la Vache tachetée.
– Je l’ai vu cou-ou-chée là-bas dans le ve-ert bocage. Viens, mon amour, et je vais te dire où.
Le mouvement du berceau et la chanson cessaient en même temps et les plus bruyantes exclamations remplaçaient la mélodie.
– Dieu bénisse tes yeux de diamant et tes joues de cire et ta bouche de cerise et tes petites cuisses de chérubin et tout ton cher petit corps !
Après cette invocation le bercement et la chanson reprenaient et la Vache tachetée recommençait de plus belle. C’est alors que Tess ouvrit la porte ; elle s’arrêta un moment sur le paillasson.
Malgré la mélodie, la jeune fille fut prise à la vue de son intérieur d’une indicible sensation de tristesse. Venir des gaietés de fête en plein champ : robes blanches, bouquets de fleurs, baguettes de saule, tourbillonnement sur la verdure, éclair de tendre sentiment pour l’étranger, et tomber dans la mélancolie de ce spectacle, vu à la lueur jaunâtre d’une chandelle, quel changement ! Outre ce contraste discordant, un regret pénible l’accablait de ne pas être revenue plus tôt pour aider sa mère dans les travaux du ménage au lieu de s’amuser au-dehors. Tess la retrouvait ainsi qu’elle l’avait quittée, au milieu des enfants, penchée sur la lessive du lundi qui avait traîné comme toujours jusqu’à la fin de la semaine. Elle éprouva un terrible mouvement de remords en pensant que, de ce baquet, était sortie la veille la robe blanche qu’elle avait sur le dos, cette robe tordue et repassée par les propres mains de sa mère et dont elle avait si négligemment verdi la jupe sur l’herbe humide.
Mme Durbeyfield se tenait comme d’habitude en équilibre sur un pied près du baquet, berçant de l’autre son plus jeune enfant. Les bascules du berceau avaient été mises à si rude épreuve depuis tant d’années sur le sol carrelé, elles avaient supporté le poids de tant d’enfants qu’elles étaient aplaties par l’usure ; aussi chaque oscillation du petit lit était-elle accompagnée d’une forte secousse qui jetait le bébé tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, comme la navette d’un tisserand, tandis que Mme Durbeyfield, excitée par sa chanson, poussait du pied la bascule avec tout l’entrain que lui avait laissé un long jour de savonnage.
Le berceau se balançait : nic-noc nic-noc, la flamme de la bougie s’allongeait et commençait à danser une gigue, l’eau tombait goutte à goutte des coudes de la ménagère et la chanson galopait sans que Mme Durbeyfield quittât un instant des yeux sa fille. Joan Durbeyfield, malgré le fardeau de sa jeune famille, aimait passionnément les chansons ; nulle ne s’échappait du monde extérieur pour flotter jusqu’au val de Blackmoor sans que la mère de Tess en retînt la mélodie en moins d’une semaine.
Les traits de cette femme avaient encore un reflet de la fraîcheur et même du charme de sa jeunesse ; il était bien probable que les attraits dont Tess pouvait se vanter étaient surtout un héritage maternel et n’avaient par conséquent rien d’aristocratique ou d’historique.
– Je vais remuer le berceau pour vous, mère, dit gentiment la fille, – ou bien je vais enlever ma belle robe et vous aider à tordre le linge ? Je croyais que vous aviez fini depuis longtemps !
La mère de Tess ne lui en voulait pas de l’avoir laissée si longtemps seule à faire l’ouvrage de la maison ; d’ailleurs, elle lui adressait rarement des reproches à ce sujet et l’aide de Tess lui manquait peu, car son plan instinctif pour se débarrasser de ses travaux était de les ajourner indéfiniment. En tout cas, elle était cette nuit d’humeur encore plus gaie que de coutume. Son regard maternel avait quelque chose de rêveur, de préoccupé, d’exalté que la jeune fille ne pouvait comprendre.
– Eh bien, je suis contente que tu sois revenue ! dit Joan, aussitôt après avoir lancé la dernière note... Il faut que j’aille chercher ton père ; mais il y a bien autre chose ! Il faut que je te dise ce qui lui est arrivé. Tu seras fière, mon bichon, quand tu le sauras !
– Depuis que je suis partie ? dit Tess.
– Oui-da !
– C’est-il pour ça que père a fait cette mascarade en voiture cet après-midi ? Pourquoi ? J’aurais voulu rentrer sous terre de honte !
– Tout cela tenait à l’histoire !... On a découvert que nous sommes la plus grande famille noble de tout le comté, venant de très loin, d’avant Olivier Grombel, au temps des Turcs païens... avec des monuments, des caveaux, des armoiries, des écussons et Dieu sait quoi encore !... Et au temps de saint Charles, nous sommes été faits Chevaliers du Chêne-Royal et notre vrai nom c’est D’Urberville !... Est-ce que tu n’en es pas toute glorieuse ? C’est pour ça que ton père est revenu en voiture ; c’est pas parce qu’il avait bu, comme on croyait...
– Tant mieux. Cela nous fera-t-il du bien, mère ?
– Oh ! oui. On pense qu’il peut en sortir de grandes choses. Pour sûr, une masse de gens de notre rang vont venir ici dans leurs carrosses sitôt qu’on le saura. Ton père l’a appris en revenant de Stourcastle et il m’a raconté toute la généalogie de l’affaire.
– Où est père, maintenant ? demanda Tess soudain.
La mère ne répondit pas directement à la question.
– Il est allé voir le docteur à Stourcastle. Ça n’est pas du tout la poitrine qui est malade, paraît-il. Y a de la graisse autour du cœur, qu’il dit. Là, comme ceci.
Joan Durbeyfield, en parlant, formait la lettre C avec un pouce et un index ridés par l’eau de savon, et se servait de l’autre index comme indicateur.
– Maintenant, qu’il dit à ton père, votre cœur est entouré tout par là et tout par là ; cet endroit est encore ouvert, qu’il dit, sitôt que ça se fermera comme ceci, – Mme Durbeyfield rapprocha les doigts et forma le cercle – Pfuitt ! plus rien, vous vous en irez comme une chandelle, monsieur Durbeyfield, qu’il dit ; vous pouvez durer dix ans, vous pouvez passer dans dix mois ou dans dix jours.
Tess parut alarmée ; son père pouvait disparaître si tôt derrière le nuage de l’éternité, malgré cette grandeur soudaine !
– Mais où est donc père ? demanda-t-elle encore.
Sa mère prit un air suppliant.
– Maintenant faut pas te mettre en colère !... Le pauvre homme a été si tant agité, après sa joie des bonnes nouvelles que le pasteur lui avait apprises, qu’il est allé chez Rolliver, il y a une demi-heure... Il a besoin de prendre des forces pour son trajet de demain avec cette charge de ruches qu’il lui faut livrer, grande famille ou non ; il faut qu’il parte tôt après minuit ; c’est si loin !
– Prendre des forces ! cria Tess avec impétuosité, et les larmes lui jaillissaient des yeux... Ô mon Dieu ! aller au cabaret pour prendre des forces ! Et vous d’accord avec lui, mère !
Ses reproches et son humeur semblaient remplir la chambre et donner un air honteux et abattu au mobilier, à la bougie, aux enfants qui jouaient et à la figure de la mère.
– Non, fit celle-ci d’un ton piqué. Je ne suis pas d’accord avec lui. Je t’attendais pour garder la maison pendant que je vas le chercher.
– J’irai, moi.
– Oh ! non, Tess. Vois-tu, ça ne servirait à rien.
Tess n’insista pas, elle savait ce que cela voulait dire. Le manteau et le chapeau de Mme Durbeyfield étaient déjà sournoisement accrochés à une chaise, à côté d’elle, tout prêts pour cette petite excursion dont la ménagère déplorait plus la cause que la nécessité.
– Et porte donc le Vrai diseur de bonne aventure sous le hangar, continua Joan en s’essuyant vite les mains et en s’habillant.
Le Vrai diseur de bonne aventure était un vieux et gros volume placé sur la table tout près d’elle et si usé à force d’être mis dans les poches que les marges avaient disparu. Tess l’enleva et sa mère partit.
C’était un des plus grands plaisirs de Mme Durbeyfield, au milieu de la saleté et du tracas d’enfants à élever, que de s’en aller à l’auberge chercher son incapable mari. Elle était heureuse de le découvrir chez Rolliver, d’y rester assise près de lui une heure ou deux et d’écarter toute pensée et tout souci d’enfants. La vie se couvrait alors d’une sorte de gloire lumineuse, d’une splendeur de soleil couchant. Les ennuis et les autres réalités fâcheuses devenaient comme impalpables, métaphysiques, se présentaient sous forme de purs phénomènes intellectuels à la sereine contemplation ; ce n’étaient pas des choses concrètes et harcelantes qui irritaient le corps et l’âme. Les petits, une fois qu’ils n’étaient plus tout près d’elle, paraissaient des accessoires plutôt charmants et désirables ; les incidents de la vie journalière ne laissaient pas d’avoir un côté humoristique et jovial. Mme Durbeyfield se sentait un peu comme autrefois quand, assise à la même place, auprès de celui qui était maintenant son mari, il lui faisait la cour et qu’elle fermait les yeux sur ses défauts de caractère, lui prêtant la forme idéale de l’amoureux.
Tess, restée seule avec les jeunes enfants, s’en alla d’abord dans le hangar porter le livre de bonne aventure et le fourrer sous la toiture de chaume. Une crainte fétichiste qu’inspirait à sa mère ce volume barbouillé l’empêchait de le laisser dans la maison toute la nuit, et c’était là qu’on le serrait chaque fois qu’on l’avait consulté.
Entre la mère, avec son fatras de superstitions, de traditions populaires, de patois, de vieilles ballades transmises oralement, toutes choses en train de disparaître, et la fille, avec son instruction scolaire et ses connaissances classiques d’après les derniers programmes, il y avait en réalité un écart de deux cents ans. Quand elles étaient ensemble, l’époque du roi Jacques et celle de Victoria se trouvaient juxtaposées.
En revenant par l’allée du jardin, Tess se demanda ce que sa mère avait bien pu chercher dans le livre, ce jour-là en particulier. Elle devinait que la récente découverte des ancêtres s’y rapportait, mais ne se doutait pas qu’elle seule y était intéressée.
D’ailleurs, écartant ces idées, elle se mit à asperger d’eau le linge séché dans la journée, en compagnie de son frère Abraham, garçon de neuf ans, et d’une sœur de douze ans et demi, Élisa Louise, qu’on appelait Liza Lou ; les plus petits étaient couchés. Il y avait au moins quatre ans de différence entre Tess et sa sœur, car les deux enfants qui se trouvaient dans l’intervalle étaient morts en bas âge, ce qui lui donnait une attitude quasi maternelle quand elle était seule avec ses cadets. Après Abraham venaient deux autres filles, Espérance et Modestie ; puis un garçon de trois ans, et enfin le bébé qui avait atteint sa première année.
Tous ces petits êtres étaient passagers à bord du vaisseau Durbeyfield ; ils dépendaient entièrement pour leurs plaisirs, leurs besoins, leur existence même, du jugement de leurs aînés. Si les chefs de famille voulaient faire voile vers la gêne, le désastre, la famine, la maladie, le déshonneur, la mort, cette demi-douzaine de petits captifs sous le pont se trouvaient obligés de voguer avec eux : six créatures sans défense à qui l’on n’avait jamais demandé si elles désiraient la vie à des conditions quelconques, encore moins si elles la désiraient à d’aussi dures conditions que celles de l’imprévoyante maison Durbeyfield. Certains aimeraient à savoir sur quelle autorité se fonde le poète dont la philosophie passe aujourd’hui pour aussi sûre et aussi profonde que son chant est pur et frais, quand il parle du Plan divin de la Nature.
Il se faisait tard ; ni père ni mère ne revenaient. Tess regarda dehors et fit par la pensée un voyage à travers Marlott. Le village fermait les yeux ; lampes et bougies partout disparaissaient ; elle croyait voir l’éteignoir et la main étendue.
Si la mère s’en était allée à la recherche du mari, cela voulait dire tout simplement qu’il en faudrait chercher un de plus. Tess commençait à songer qu’un homme de médiocre santé, ayant l’intention de se mettre en route un peu après minuit, ne devrait pas être à cette heure tardive au cabaret, en train de célébrer sa haute naissance.
– Abraham, dit-elle à son petit frère, mets ton chapeau,... tu n’as pas peur ?... et va chez Rolliver voir ce qui arrive à père et à maman.
L’enfant sauta vivement de son siège, ouvrit la porte et s’engloutit dans la nuit. Une autre demi-heure se passa ; homme, femme, enfant, personne ne revenait. Abraham semblait, comme ses parents, pris et englué dans le piège de l’auberge.
– Il faut que j’y aille moi-même, se dit-elle.
Liza Lou partit se coucher et Tess, les enfermant tous sous clef, se mit à gravir la ruelle sombre et tortueuse, peu faite pour une course précipitée, rue tracée au temps où les pouces de terrain n’avaient pas encore de valeur et où les horloges à aiguille unique suffisaient à partager le jour.
IV
L’auberge Rolliver, le seul cabaret qui se trouvât à cette extrémité du long village éparpillé, n’avait pas de licence suffisante pour donner à boire dans l’établissement ; aussi tous les préparatifs visibles pour les consommateurs se limitaient-ils strictement à une petite planche d’environ six pouces de large sur deux mètres de long, fixée par des fils de fer aux palissades du jardin, de façon à former un rebord. Sur cette planche, les étrangers altérés déposaient leurs gobelets quand ils buvaient debout, et ils jetaient le fond de leur verre sur le sol poudreux de la route, à la mode de Polynésie, en souhaitant de pouvoir être paisiblement assis à l’intérieur.
Voilà pour les étrangers. Mais les clients du pays éprouvaient aussi le même désir, et vouloir c’est pouvoir.
Ce soir-là, dans une vaste chambre du haut, dont la fenêtre était couverte d’un épais rideau fait d’un grand châle de laine que l’hôtesse, Mme Rolliver, avait dernièrement renoncé à porter, une douzaine de personnes étaient réunies, toutes cherchant la béatitude, toutes habitant de longue date cette extrémité de Marlott et coutumières de cette retraite. La Bonne Rasade, le cabaret dûment patenté à l’autre bout de ce village dégingandé, était à une trop grande distance, malgré sa confortable installation, pour être fréquentée par elles, et, chose bien plus importante, la qualité médiocre de la boisson confirmait l’opinion courante, selon laquelle mieux valait boire avec Rolliver dans un coin du grenier qu’avec l’autre dans une belle maison.
Un maigre lit à colonnes, placé dans la chambre, servait sur trois côtés de siège à plusieurs personnes. Deux hommes s’étaient hissés sur une commode ; un autre s’appuyait sur le coffre en chêne sculpté, deux étaient sur le lavabo, un autre sur le tabouret, et ainsi tout le monde était assis et content. Ils étaient arrivés à ce degré de bien-être où leur âme se dilatait, s’échappait de son enveloppe et se répandait généreusement au-dehors. Alors, la chambre et son mobilier prenaient une dignité et un luxe nouveaux, le châle pendu à la fenêtre se parait des teintes somptueuses d’une tapisserie ; les poignées de cuivre de la commode devenaient des heurtoirs en or, et les colonnes sculptées du lit semblaient avoir quelque parenté avec les piliers magnifiques du temple de Salomon.
Mme Durbeyfield, qui s’était rapidement dirigée de ce côté après avoir quitté sa fille, entra dans la pièce du bas, la traversa dans une profonde obscurité, puis ouvrit la porte de l’escalier comme quelqu’un dont les doigts sont familiers avec les habitudes des loquets. Elle monta plus lentement l’escalier tortueux, et son visage, en arrivant en pleine lumière à la dernière marche, rencontra les regards de toute la société réunie dans la chambre.
– Nous sommes quelques amis que j’ai invités à célébrer la fête du club à mes frais !... cria l’hôtesse au bruit des pas avec la volubilité d’un enfant qui récite son catéchisme, tandis qu’elle cherchait à voir dans l’escalier.
– Oh ! c’est vous, madame Durbeyfield ? Seigneur, que vous m’avez fait peur ! Je croyais que c’était un compère du gouvernement !
Le reste du conclave accueillit Mme Durbeyfield par coups d’œils et signes de tête et elle se dirigea vers le siège de son mari. À mi-voix, il se chantonnait distraitement :
– Ah ! j’en vaux bien d’ici et de là ! J’ai un grand caveau de famille à Kingsbere, et les plus beaux esquelettes de tout le Wessex !
– J’ai quelque chose à vous dire, qui m’est venu à ce propos ! Un grand projet ! lui murmura sa joyeuse épouse. Allons, John, vous ne me voyez donc pas ?
Elle le poussa du coude, tandis qu’il continuait son récitatif en la regardant comme on regarde à travers une vitre.
– Chut ! Chantez donc pas si fort, mon brave homme ! dit l’hôtesse, au cas où un membre du gouvernement passerait, pour me faire supprimer ma licence !
– Il vous a dit ce qui nous est arrivé, je suppose ? demanda Mme Durbeyfield.
– Oui, comme ça. Pensez-vous que ça vous rapporte de l’argent ?
– Ah ! ça, c’est un secret, répliqua sagement Joan Durbeyfield. En tout cas, c’est bon d’être parent à un carrosse, même si vous roulez pas dedans.
Elle baissa la voix qu’elle avait élevée pour le public, et dit tout bas à son mari :
– J’ai réfléchi, depuis que vous m’avez apporté la nouvelle, qu’y a une grande et riche dame du nom de D’Urberville, là-bas, près de Trantridge, sur la lisière de la forêt de La Chasse.
– Hé ? Quoi ? dit sir John.
Elle répéta :
– Cette dame doit être notre parente et mon projet est d’envoyer Tess pour se réclamer d’elle.
– Oui, maintenant que vous m’en parlez, y a une dame de ce nom-là, dit Durbeyfield ; le pasteur Tringham n’y a pas pensé ; mais elle n’est rien à côté de nous ; sans doute, une branche cadette à nous, qui ne va pas si haut que le Roi Normand !...
Tandis que le couple discutait, il n’avait pas, dans sa préoccupation, remarqué le petit Abraham qui s’était glissé dans la chambre et attendait une occasion pour les prier de rentrer.
– Elle est riche et bien sûr qu’elle remarquerait la petite, continuait Mme Durbeyfield, et ça serait une bonne chose. Pourquoi que deux branches d’une famille ne se feraient pas visite ?
– Oui, et nous ferons tous connaissance ! s’écria d’un ton animé Abraham, qui s’était mis sous le lit... et nous irons tous la voir quand Tess sera partie demeurer avec elle, et nous nous promènerons dans son carrosse et nous porterons des habits tout noirs !
– Comment es-tu ici, petit ? Quelles sottises dis-tu là ? Va-t’en jouer sur l’escalier jusqu’à ce que papa et maman soient prêts !... Oui, Tess devrait aller chez cet autre membre de notre famille. Pour sûr elle gagnerait la dame ; sûr que oui. Et c’est plus que probable qu’un riche monsieur la demanderait en mariage : bref, je le sais.
– Comment ?
– J’ai cherché son sort dans le Diseur de bonne aventure et c’est sûr qu’il a annoncé la chose !... Si vous aviez vu comme elle était jolie aujourd’hui ! Sa peau est aussi fine que celle d’une duchesse !...
– Qu’en dit-elle, la petite ?
– Je ne lui ai rien demandé. Elle ne sait pas encore que nous avons une grande dame comme parente. Mais ça la mettrait certainement sur la voie d’un grand mariage et elle ne dira pas non pour y aller.
– Tess est bizarre.
– Mais elle est maniable, au fond. Laissez-la-moi.
Bien que cette conversation eût été confidentielle, l’intelligence de ceux qui les entouraient en avait saisi suffisamment le sens pour deviner que les Durbeyfield avaient maintenant à parler d’affaires plus importantes que les gens du commun et que Tess, leur jolie fille, avait de belles espérances en perspective.
– Tess est un beau brin de fille ; je me disais ça aujourd’hui en la voyant trotter autour de la paroisse avec les autres, remarqua à demi-voix un des vieux buveurs. Mais Joan Durbeyfield fera bien de veiller à ce qu’elle n’engrange pas du malt vert.
C’était une locution du pays d’un sens spécial et à laquelle personne ne répliqua.
La conversation devenait générale quand bientôt on entendit des pas traverser la chambre du bas.
– Nous sommes quelques amis que j’ai invités à célébrer la fête du club à mes frais !...
L’hôtesse avait répété rapidement la formule toute prête pour les intrus, avant de reconnaître Tess dans le nouvel arrivant.
Le jeune visage de Tess parut, même à sa mère, tristement déplacé dans ce milieu où flottaient des fumées d’alcool qui convenaient mieux aux rides de l’âge mûr. Tess eut à peine besoin d’un éclair plein de reproches de ses beaux yeux sombres ; son père et sa mère se levèrent, finirent à la hâte leur bière et descendirent l’escalier derrière elle, poursuivis par les recommandations de Mme Rolliver :
– Pas de bruit, si vous plaît, ayez cette bonté, mes amis, ou bien je perdrais ma licence et je serais assignée, et Dieu sait quoi encore... Bonne nuit !
Ils revinrent ensemble chez eux, Tess et Mme Durbeyfield tenant chacune le père par le bras. Il avait bu vraiment fort peu ; pas le quart de ce qu’un ivrogne de profession peut porter à l’église un dimanche matin, sans faire une anicroche dans ses saluts et ses génuflexions ; mais la faible constitution de sir John transformait en montagnes les peccadilles de ce genre. Arrivé à l’air frais, il chancelait assez pour les faire incliner tous les trois, tantôt du côté de Londres, tantôt du côté de Bath, ce qui produisait un effet comique assez fréquent dans ces retours nocturnes de famille, et, comme la plupart des effets comiques, pas si comiques après tout. Les deux femmes, autant que possible, cachaient vaillamment ces excursions et ces contremarches forcées à Durbeyfield qui en était la cause, à Abraham et à elles-mêmes. Elles approchèrent ainsi graduellement de leur porte et, au moment d’arriver, le chef de famille reprit tout à coup son ancien refrain comme pour fortifier son âme devant la petitesse de sa présente demeure :
– J’ai un caveau de famille à Kingsbere !
– Chut ! soyez donc pas si sot, Jacky ! Votre famille n’est pas la seule à compter, dans le temps. Voyez les Anktell, les Horsey, et même les Tringham... ils sont montés en graine, presque autant que vous... bien que vous soyez été de plus grosses gens qu’eux, c’est vrai ! Dieu merci ! Je suis jamais été de grande famille, et j’ai pas de honte de ce côté-là !
– C’est pas si sûr que ça. Avec votre caractère, j’ai idée que vous vous êtes déshonorés plus que nous et que vous étiez pour de bon des rois et des reines dans le temps.
Tess détourna la conversation en parlant de ce qui était alors bien plus important pour elle que tous les ancêtres.
– J’ai peur que père ne puisse partir si tôt demain avec les ruches.
– Moi ? J’irai très bien dans une heure ou deux ! dit Durbeyfield.
Il était onze heures avant que toute la famille fût couchée et il fallait se mettre en route à deux heures du matin au plus tard si l’on voulait livrer les ruches aux détaillants de Casterbridge, avant l’ouverture du marché du samedi, car la distance était de trente à quarante kilomètres par de mauvaises routes et le cheval et la voiture étaient des plus lents.
À une heure et demie, Mme Durbeyfield entra dans la vaste chambre où dormaient Tess et tous ses petits frères et sœurs.
– Le pauvre homme ne peut pas partir, dit-elle à sa fille aînée, dont les grands yeux s’étaient ouverts au moment même où la main de sa mère avait touché la porte.
Tess s’assit dans le lit, son esprit flottant encore à demi dans le rêve.
– Mais il faut que quelqu’un y aille, répliqua-t-elle. L’époque est déjà avancée pour les ruches. L’essaimage va être bientôt fini pour l’année et, si nous les remettons au marché de la semaine prochaine, on n’en aura plus besoin et elles nous resteront sur les bras.
Mme Durbeyfield ne parut pas à la hauteur de la situation.
– Peut-être bien que quelque jeune gars irait ? Un de ceux qui désiraient tant danser avec toi hier, suggéra-t-elle alors.
– Oh ! non, je ne le voudrais pour rien au monde ! dit Tess fièrement... Et laisser chacun savoir pourquoi ! Une chose dont on devrait être honteux ! Je crois que moi, je pourrais y aller si Abraham pouvait me tenir compagnie.
À la fin, sa mère consentit à cet arrangement. On réveilla le petit Abraham qui dormait d’un profond sommeil dans un coin de la pièce, on le fit habiller tandis qu’il était encore par la pensée dans un autre monde. Pendant ce temps, Tess s’était vêtue à la hâte, et tous les deux, ayant allumé une lanterne, s’en allèrent à l’écurie. La petite voiture branlante était déjà chargée et la jeune fille fit sortir Prince, le cheval à peine moins branlant que le véhicule. Le pauvre animal étonné regardait tout autour de lui l’obscurité, la lanterne, leurs deux silhouettes, comme s’il ne pouvait croire qu’à cette heure où tout être vivant doit se trouver à l’abri et au repos, il était obligé de travailler. Ils mirent dans la lanterne une provision de bouts de bougie, la suspendirent à droite et firent avancer le cheval, près duquel ils marchèrent d’abord pendant la montée afin de ne pas trop charger un animal aussi peu vigoureux.
Pour se secouer un peu et suppléer au matin encore bien loin, ils causèrent en mangeant une tartine de beurre à la lueur de la lanterne. Comme Abraham se réveillait (car jusqu’ici il avait marché dans une sorte de léthargie), il se mit à parler des formes étranges que prenaient les divers objets, se profilant ténébreux sur le ciel, de cet arbre qui avait l’air d’un tigre furieux bondissant de sa tanière, de cet autre qui ressemblait à la tête d’un géant. Après avoir passé la petite ville de Stourcastle, somnolente et muette sous ses épais toits de chaume brun, ils atteignirent un lieu plus élevé ; à leur gauche, plus haut encore, Bulbarrow, le sommet principal du South Wessex, dressait sur le ciel sa masse encerclée d’anciens retranchements romains.
De cet endroit, la route s’allongeait en pente douce sur une grande distance. Ils montèrent sur le devant du chariot et Abraham devint pensif.
– Tess, dit-il après un silence, pour entrer en conversation.
– Oui, Abraham.
– Es-tu pas contente que nous sommes devenus des gens nobles ?
– Pas particulièrement.
– Mais tu es contente parce que tu vas épouser un monsieur ?
– Quoi ? dit Tess levant la tête.
– Parce que notre riche parente te mariera avec un monsieur ?
– Moi ? Notre riche parente ? Nous n’en avons pas. Qui t’a mis ça dans la tête ?
– Je les ai entendus en parler chez Rolliver, quand j’ai été chercher papa ; à Trantridge, il y a une dame de notre famille, très riche, et mère dit que, si tu te réclamais d’elle, elle te marierait avec un monsieur.
Sa sœur se tut brusquement et tomba dans un silence méditatif. Abraham continua à causer plutôt pour le plaisir de parler que pour se faire entendre, de sorte que la distraction de sa sœur lui était indifférente. Il s’adossa contre les ruches et, le nez en l’air, se mit à faire des remarques sur les étoiles qui palpitaient froidement dans les noirs abîmes, sereines et étrangères à ces deux pauvres petits feux follets humains. Il demandait à quelle distance se trouvaient ces lumières et si Dieu était de l’autre côté. Mais, de temps à autre, son bavardage enfantin revenait à ce qui frappait son imagination plus profondément que les merveilles mêmes de la création. Si Tess devenait riche en épousant un monsieur, pourrait-elle acheter une longue-vue assez grande pour rapprocher les étoiles autant que Nettlecombe ? La réapparition de ce sujet dont toute la famille semblait imprégnée remplit Tess d’impatience.
– Laisse donc cela tranquille ! s’écria-t-elle.
– As-tu pas dit que les étoiles étaient des mondes, Tess ?
– Oui.
– Tous pareils au nôtre ?
– Je ne sais pas ; mais je le pense. Elles ont l’air quelquefois de ressembler aux pommes de notre vieil arbre du jardin : la plupart saines et splendides ; quelques-unes tachées.
– Sur laquelle est-ce que nous vivons : une belle ou une tachée ?
– Une tachée.
– C’est très malheureux que nous soyons pas tombés sur une bonne, quand il y en avait tant d’autres !
– Oui.
– C’est-il vraiment comme ça, Tess ? dit Abraham, se tournant vers elle très impressionné, après avoir de nouveau réfléchi à cette curieuse explication... Comment est-ce que ce serait si nous étions tombés sur une bonne ?
– Eh bien, père ne tousserait pas, et ne traînerait pas comme il le fait, et il ne serait pas trop grisé pour faire ce voyage, et mère ne serait pas toujours à faire la lessive et à ne jamais la finir.
– Et tu serais une dame riche du coup et tu n’aurais pas à épouser un monsieur pour devenir riche !
– Oh ! Aby, assez là-dessus !
Abraham, laissé à ses réflexions, ne tarda pas à s’assoupir. Tess n’était pas habile à gouverner un cheval, mais elle crut pouvoir prendre sur elle l’entière direction et laisser dormir Abraham, s’il le désirait. Elle lui fit une sorte de nid devant les ruches de manière qu’il ne pût tomber et, prenant les rênes, continua cahin-caha comme avant. Prince manquant d’énergie pour faire des mouvements superflus, elle n’avait guère besoin de le surveiller. Tess, que ne distrayait plus un compagnon, s’enfonça plus que jamais dans la rêverie, le dos appuyé contre les ruches. La muette procession d’arbres et de haies qui défilait près d’elle se rattacha bientôt à des scènes fantastiques et irréelles ; le souffle du vent qui s’élevait parfois devint le soupir de quelque âme immense et affligée, enfermée par l’univers dans l’espace et par l’histoire dans le temps. Puis, examinant le réseau des événements de sa propre vie, il lui sembla voir la vanité de l’orgueil de son père, le noble prétendant qui l’attendait dans l’imagination de sa mère : il lui apparaissait comme un personnage grimaçant, qui se riait de sa pauvreté et des chevaliers ses ancêtres dans leurs suaires. Tout devint de plus en plus extravagant et elle finit par ne plus savoir comment le temps s’écoulait. Une brusque secousse la fit chanceler sur son siège et Tess s’éveilla du sommeil où elle aussi était tombée.
Ils avaient fait beaucoup de chemin depuis qu’elle avait perdu conscience des choses et le chariot s’était arrêté. Par-devant s’élevait un gémissement sourd comme elle n’en avait jamais entendu de pareil dans sa vie ; puis ce fut le cri de : Ohé là-bas !
La lanterne suspendue à sa voiture s’était éteinte, mais l’éclat bien plus vif d’une autre lanterne lui frappait le visage, quelque chose de terrible était arrivé ; le harnais était pris dans un objet qui barrait le chemin. Tess, consternée, sauta à terre et découvrit l’affreuse vérité : le gémissement venait du pauvre Prince, le cheval de son père.
La malle-poste du matin, qui filait comme une flèche, selon son habitude, le long des chemins étroits, sur ses roues silencieuses, s’était jetée sur le lent équipage non éclairé. Le timon pointu de la carriole était entré comme une épée dans le poitrail du malheureux Prince et le sang jaillissait à flots de la blessure et tombait en sifflant sur la route. Tess, dans son désespoir, s’élança et mit la main sur le trou, se faisant ainsi éclabousser de gouttes cramoisies des pieds jusqu’à la tête. Alors elle resta debout, spectatrice impuissante. Prince lui aussi resta debout, ferme et immobile aussi longtemps qu’il le put, puis tout à coup il s’affaissa comme une masse. L’homme de la poste s’était joint à elle maintenant et commençait à tirer et dételer le cheval encore chaud, mais déjà mort. Voyant qu’il n’y avait rien à faire pour le moment, le postier revint à sa propre bête qui n’avait aucun mal.
– Vous étiez du mauvais côté, dit-il. Je suis obligé de continuer avec les sacs de dépêches, de sorte que le mieux pour vous est d’attendre ici avec votre charge. Je vous enverrai quelqu’un pour vous aider aussitôt que possible. Il va bientôt faire jour et vous n’avez rien à craindre.