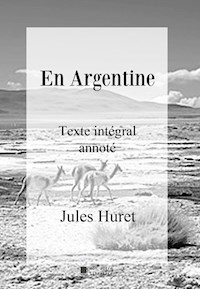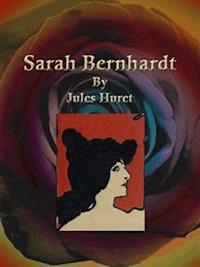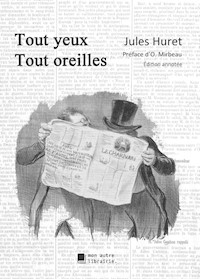
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
L'auteur démontre ici sa maîtrise de la facette qu'il préfère de son métier de journaliste : l'art de l'entretien. De ses rencontres avec de nombreux personnages de l'époque, qu'ils soient aujourd'hui encore célèbres ou complètement tombés dans l'oubli, il a fait un ouvrage composite, inclassable, et passionnant. Depuis l'actualité littéraire, politique, sociale, de haut niveau, jusqu'au fait divers le plus sordide, il nous ouvre sur le XIXe siècle un aperçu tout à fait inhabituel, un vrai régal pour le lecteur curieux d'insolite. (Édition annotée.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tout yeux tout oreilles
Jules Huret
Préface d’Octave Mirbeau
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Eugène Fasquelle, Paris, 1901.
Les notes entre crochets ont été ajoutées pour la présente édition.
Couverture : Honoré Daumier
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2020, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-491445-74-4
Table des matières
Préface
Lendemain de première.
Les deux lutteurs : Zola et Brunetière.
L’Ortografe : chez M. Louis Havet. – À l’Académie.
Le bachot : un grand « recalé ».
Chez les mineurs : à Saint-Étienne.
Le mal d’aimer.
Galvanoplastie macabre.
Un prêtre réfractaire.
Une grande découverte ? Le planeur
Capazza.
Wagner et les « patriotes ».
Le faiseur d’or.
Un revenant : M. Numa Gilly.
Pour voir Arton.
La dernière absinthe.
À la frontière.
Yvan Tourguénieff : Daudet, Goncourt, Zola.
À propos de l’Attaque du Moulin.
La femme de l’anarchiste.
Au Maroc.
L’artiste et le baronet.
L’incendie du Bazar de la Charité.
Gabriel d’Annunzio à Paris.
Le lion et le taureau.
Un drame en mer.
L’affaire Dreyfus
Poing contre pied.
Journée d’hiver au Bois.
En Belgique : expulsion de
MM. Déroulède et Buffet.
Retiré de la vie : chez
Joris-Karl Huysmans.
Préface
Voici un livre où il y a de tout et même davantage : du passé, du présent, de l’avenir, des fantoches littéraires, des fantômes politiques... de la comédie et du drame, et du vaudeville aussi, et encore de l’opérette... de la célébrité en pantoufles... si triste ! – des grands personnages en chemise... si ridicules ! – et des voyages à travers des pays et des âmes, toutes sortes d’âmes et toutes sortes de pays... des choses vues, des choses écoutées, des choses confessées... de tout ce avec quoi on reconstitue, plus tard, des physionomies et des époques, on fait de l’histoire. Et cela ne pouvait pas s’appeler autrement que Tout yeux, tout oreilles. Car c’est ainsi que, dans son désir infini de voir et d’écouter, M. Jules Huret va, cheminant, le regard sans cesse tendu aux grimaces et aux gestes, l’oreille toujours dressée aux bruits de la vie.
J’ai un goût très vif pour le talent clair, robuste, substantiel, vulgarisateur de M. Jules Huret. M. Jules Huret est un grand journaliste, comme il en existe seulement en Angleterre et en Amérique. De plus, il est, dans toute la beauté artistique du mot, écrivain. Par malheur, en France, où le journal appartient presque exclusivement à de pauvres petits boutiquiers sans initiative qui tremblent de mécontenter, à propos de tout et de rien, ce qu’ils appellent leur clientèle, ou à des financiers de vol court qui ne cherchent que les basses rapines et les chantages vulgaires, on ne sait pas se servir de cette sorte d’hommes instruits, clairvoyants, renseignés, amoureux des aventures et des découvertes, d’une forte santé physique et intellectuelle, et capables d’entreprendre, à travers le monde, ces vastes enquêtes qui illustrèrent le journalisme américain. Non seulement on ne sait pas s’en servir, mais on fait tout ce qu’on peut pour les décourager.
Il est très regrettable que personne n’ait songé à employer dans ce sens les facultés exceptionnelles de M. Jules Huret. Je suis convaincu qu’il y eût accompli de grandes choses, et qu’il eût contribué puissamment à faire sortir le journalisme de l’ornière de ses potins. Comme M. Kennan,1 il était de taille, dans une expédition dont les péripéties tiennent du prodige, à pénétrer au fond de tous les bagnes sibériens, à nous révéler l’hallucinante horreur de ces enfers en des pages plus durables et plus belles. De sa hardiesse, de son ingéniosité, de son endurance, de l’abondance et de la qualité de ses notations, nous avons les plus sûres garanties en cette rapide et brillante incursion qu’il fit au Maroc, et qu’il raconte, ici même, avec une précision de détails, un éclat de style, une bonne humeur incomparables. M. Jules Huret a aussi cette supériorité, dans un milieu livré à toutes les superstitions, à tous les préjugés, à toutes les jobardises du boulevard, d’être resté un solide esprit, affranchi de tous les genres de fétichisme, même du fétichisme parisien. Pour comprendre les phénomènes de la vie, il ne demande conseil qu’à la raison et à la science. Il a horreur des métaphysiques, de leurs ténèbres épaisses et poisseuses.
Un jour que je reprochais amicalement à l’un de ses anciens collaborateurs de ne pas se servir de cette force qu’il avait là, sans cesse, sous la main :
– Huret ?... me répondit-il. Mais c’est un très mauvais esprit, et qui se permet d’avoir des idées !... Allons donc ! Je vais lui jouer un bon tour... Dès demain je vais le mettre aux échos de théâtre... Ah ! ah !... Il en aura là, des idées, s’il veut !... Elle est bonne, n’est-ce pas ?
Et ce brave homme fit comme il avait dit... Il « eût mis » Saint-Simon aux échos de théâtre et eût fait rédiger la température par Ernest Renan... de mauvais esprits !... Le pauvre diable ! Il appelait cela diriger l’opinion.
M. Jules Huret me pardonnera d’avoir rappelé cette mélancolique anecdote, qu’il ignore peut-être. Elle montre, par son raccourci à la Daumier, mieux que par un long commentaire, ce que c’est aujourd’hui que le journalisme français, les douloureuses sottises qu’il sert, à quelles détestables préoccupations il obéit, et ce qu’il gaspille stupidement, criminellement de forces réelles et de réels talents qu’il se complaît à égarer ou à immobiliser en des besognes viles, souvent, inutiles toujours. Au moment où j’écris, je prends sur ma table un journal, le plus important journal de France, et voici ce que j’y vois : Le premier article est consacré à M. Le Bargy et à la manière qu’il a de s’habiller... Un peu plus loin, trois longues colonnes nous renseignent, heure par heure, sur les vacances – troublées de triomphes – de Madame Réjane. Nous assistons à un spectacle palpitant : le bésigue familial que, le soir, après dîner, surveille M. Porel,2 l’œil mouillé de bonheur intime et de joie scénique. À la seconde page, nous avons des aperçus philosophiques de M. Coquelin3 et des confidences impériales de M. Febvre... Ah ! c’est beau, la presse !...
Avec M. Jules Huret on a toutes les sécurités, et l’on sait, tout de suite, que l’on ne dérive pas à l’aventure. Je ne connais personne pour avoir, comme il l’a, la passion ardente et si rare et, je pourrais dire, le tourment de la vérité. Le mensonge, de quelque ornement précieux dont on le pare, lui semble une chose laide ou sans intérêt. Dans le portrait d’un homme, ou dans la description d’un paysage, ou dans l’explication d’un événement, il est impossible de mettre plus de netteté aiguë, plus de précision scrupuleuse qu’il n’en met. Et cela, plus encore par règle particulière d’esthétique que par conscience. En général, les écrivains qui ont le don du pittoresque se laissent facilement aller au charme décoratif des exagérations. C’est une manière d’expression très séduisante, parfois très puissante, mais qui a ses dangers. Ce don, M. Jules Huret l’a merveilleusement discipliné. Il ne l’emploie que pour rendre plus visible, plus sensible, plus strictement exact le caractère vrai des êtres et des choses qu’il nous dépeint. Car il voit juste, et il exprime avec sobriété et avec force. Il a aussi une vertu peu banale et effrayante. C’est, en quelque sorte, de faire suer aux personnages, même aux grands personnages qu’il a charge de nous montrer, ce qu’il y a en eux de nature secrète et cachée, de comique intime, d’humanité foncière, pour tout dire. C’est un grand curieux, un grand passionné d’humanité. Or, les hommes, si variés qu’ils soient, par l’éducation, le rang social, l’intelligence, ont entre eux ce lien commun d’être des hommes, c’est-à-dire de parfaits comiques et qui ne font pas toujours rire. Cela dépend du plus ou moins de responsabilités qu’ils assument, du plus ou moins d’action, de pouvoir qu’ils exercent sur les autres. M. Jules Huret excelle à dégager des êtres humains cet auto-comique qui tantôt fait rire et tantôt fait pleurer. Il y a trouvé de véritables chefs-d’œuvre.
Lisez, au chapitre intitulé : Wagner et les patriotes, la conversation que l’auteur eut jadis avec M. Francis Laur... Francis Laur ! Comme c’est loin déjà ! Et comme c’est proche aussi, car n’est-ce point des parcelles éparses de M. Laur que s’est reconstitué le Conseil municipal de Paris ? Toute la burlesque farce actuelle du nationalisme, la voilà, dans la voix déjà ancienne de M. Francis Laur ! Et c’est beau comme du Molière !...
Je me suis toujours demandé quelle sorte d’étrange faculté possède M. Jules Huret pour obliger les gens à se démasquer aussi complètement devant lui, à lui montrer leurs tares intimes, leurs bosses morales, leurs plaies intellectuelles, toutes ces difformités honteuses ou cocasses que, dans l’ordinaire de la vie, ils recouvrent d’un si épais manteau d’hypocrisie, de vanité et de mensonge... Les ruses, si habiles soient-elles, les questions insidieuses, les appels discrets et profonds à l’orgueil, ne me paraissent pas des raisons suffisantes et qui puissent justifier l’inconcevable et pourtant véridique énormité de ces confidences, de ces aveux... Non. Je crois bien, outre la parfaite connaissance qu’il a de la machine humaine, que M. Jules Huret est doué d’une force hypnotique considérable et dont il ignore lui-même l’influence dominatrice...
Sa fameuse Enquête littéraire, sa non moins fameuse Enquête sociale, sont, au point de vue du démasquage, du déshabillage humain, des œuvres hors de pair, sans parler des documents très précieux qu’elles contiennent, et qui en font des livres de psychologie historique et sociale, des dictionnaires d’humanité indispensables à toutes les bibliothèques.
Octave Mirbeau
Veneux-Nadon, août 1901.
Lendemain de première.
Chez M. Alphonse Daudet.
Avant-hier soir, à la grande première de la Lutte pour la vie, les opinions les plus diverses s’échangeaient dans les couloirs du Gymnase.
D’un côté :
– C’est un four noir !
De l’autre :
– C’est diablement crâne !
La lecture des journaux d’hier matin n’était pas faite pour diminuer cette perplexité et les demi-mots des critiques et les classiques échappatoires de la plupart des comptes-rendus peignaient bien l’indécision générale de la veille.
Mais qu’en pensait l’auteur lui-même ? Comment M. Alphonse Daudet, d’ordinaire si bon juge et si impartial en ces matières, si au courant des mille menus potins des clans littéraires, comment résumait-il les impressions recueillies au sein même de la lutte par ses nombreux fidèles ?
Très accueillant toujours, même aux lendemains énervés des batailles, M. Daudet répond immédiatement à ma première question : « Êtes-vous content de votre soirée d’hier ? »
– Enchanté, absolument enchanté ! Je croyais à un écrasement. Je craignais qu’on ne laissât pas les artistes finir le premier acte...
Et comme mon regard l’interrogeait :
– Mais tout ce premier acte dépasse en hardiesse tout ce qu’on a représenté au théâtre depuis Tartufe, le cynisme des théories aussi bien que l’audace des expressions ! Je ne me suis pas dissimulé que je risquais une grosse partie...
– Gagnée... alors, à présent ?
– Oui. Pourtant il a fallu, en vérité, que ce public fût bien vivement frappé de la sincérité douloureuse mais impeccable de mes personnages pour ne pas s’abandonner à son penchant réactionnaire... ce public gavé depuis si longtemps, aux théâtres des boulevards, de fadaises sentimentales et de drôleries, de belles-mères insupportables et de beaux-pères ridicules !
– Cette salle pourtant vous était sympathique ?
– Oh ! ne dites pas cela ! A-t-on jamais une salle de première à soi ! Koning vous donne dix-huit billets, ce qui vous permet de faire quarante mécontents. Et du reste, vous me savez trop fier pour tenter près de n’importe qui la moindre démarche avant la représentation.
« La salle a été ce qu’elle est toujours : composée par moitié de « gadoues » et de « maquereaux », et d’une autre moitié de gens qui viennent là essayer leurs effets de profil, de face et de trois quart ; de gens de qui faut qu’on dise : un tel était là. Vous la connaissez comme moi cette ineffable théorie de types, les gouailleurs, les impeccables, les sceptiques, les sévères, les ennuyés, combien d’autres ! Est-ce qu’ils écoutent la pièce, ces gens-là ? Est-ce qu’ils regardent les acteurs ? À quoi bon ? Pour eux, c’est dans la salle qu’est le spectacle, et, ma foi, ils ont peut-être raison, c’est pour d’autres que les pièces sont faites. Si ce n’était pas si triste, ce serait à mourir de rire ! Une première me rappelle toujours cette troupe de singes qui devaient se livrer à toutes sortes d’exercices sur la scène des Folies-Bergères. On lève le rideau. Les singes regardent ce public d’élite de tous leurs yeux. Pas un singe ne bouge : pour eux aussi le spectacle était dans la salle...
Comme M. Daudet me voyait rire :
– Oh ! vous savez, continua-t-il, je dis ce que je pense. Et, à part quelques sentiments naturels, je respecte fort peu les choses consacrées, qu’on les appelle Académie française, Comédie-Française – ou salle de première !
– L’interprétation vous contente-t-elle ?
– Voici : Mme Pasca est admirable. M. Marais, à qui on ne peut retirer son merveilleux talent et d’étonnants moyens physique, ne me donne pas le Paul Astier que j’ai rêvé, que j’ai composé, que j’ai fait. Paul Astier est le struggleforlifer moderne, sobre de ton et de manières, sans aucun de ces emballements mélodramatiques qui compromettraient un homme dans sa situation. Il y a toujours quelqu’un à côté, Astier le sait bien, et il parle plutôt bas que haut. Et cette retenue de son organe redouble les effets qu’il recherche ; sa passion, qui ne se manifeste pas par des éclats de voix, s’exalte dans la mimique et se décuple par la profondeur de l’accent. Marais ne voit pas Paul Astier ainsi ; il le voit « trompette » et il le rend comme il le voit ; je ne peux pourtant pas demander à un artiste de changer son embouchure ! surtout quand c’est son embouchure qui fit sa réputation ! Au point de vue du public, il a peut-être raison, d’ailleurs, quoique pourtant le petit Burguet, qui remplit le rôle d’Antonin, se soit taillé un véritable triomphe dans la petite « panne » du fiancé de Lydie, et cela par des moyens d’une simplicité primitive, grâce à un jeu d’un naturel parfait. Rappelé deux fois, le jeune et intelligent artiste, les larmes aux yeux, disait à ses camarades :
« J’ai dit comme j’avais entendu dire M. Daudet à la lecture, tout simplement. » Et en effet, j’avais voulu faire bien entendre à toute la troupe que mon drame se passait dans le monde, et que c’était surtout par le naturel, la simplicité, l’émotion profonde mais contenue que la pièce eût été à la scène ce que je rêvais qu’elle fût. L’ensemble est excellent, au surplus. Et il a fallu bien du courage à M. Marais pour mener, sans un applaudissement, jusqu’au coup de pistolet de la fin, le rôle ingrat de Paul Astier.
– La presse ?...
– Elle est fort bienveillante, à part des feuilles comme celles que vous devinez, et dont je n’ai jamais retiré que des choses désagréables... Naturellement, il y a des critiques. Quand vous sortez une idée, que vous l’exposez publiquement, sans voile, avec toutes ses conséquences humaines, brutales, ce serait bien le diable qu’elle fût l’idée de tout le monde et qu’elle ne choquât personne ! Au contraire, racontez que la petite Frétillon, rencontrée hier, vous a montré ses cuisses, tout le monde rira de bon cœur, et chacun sera d’accord « qu’elle est bien bonne ».
C’est évident !
2 novembre 1889.
Les deux lutteurs : Zola et Brunetière.
Le fauteuil d’Émile Augier à l’Académie française sera ardemment disputé – cela se sent. Un immortel de la rive droite me disait hier : « J’ai reçu officieusement l’avis de quatre visites, et la menace d’au moins cinq autres... »
Les noms d’Henry Becque, d’Émile Zola, d’André Theuriet, d’Henri de Bornier, de Pierre Loti et de Fernand Fabre, de M. Brunetière et de M. Thureau-Dangin ont été mis en avant, sans compter les autres. Si, dans ce nombre, il est des candidatures plus sympathiques, il n’en est certes pas de plus intéressante, de plus curieuse, que celles d’Émile Zola et de M. Brunetière, dans leur rencontre.
L’événement est, en effet, typique. On en glose, paraît-il, beaucoup, dans les salons académiques, et on en sourit comme d’une malice de la maison Buloz ; dans les chapelles littéraires on s’en réjouit comme d’une mauvaise farce du hasard, et on renifle déjà l’odeur du sang...
Brunetière contre Zola !
Où s’arrêtera cette vendetta ? Comment finira-t-elle ?
Mais, d’abord, y a-t-il vendetta ? M. Brunetière a-t-il réellement voulu couronner ses quinze années de pertinace et impitoyable critique de l’œuvre de M. Zola par ce suprême et quelque peu ambitieux défi ? Et M. Brunetière l’avouerait-il ?
Je suis allé le lui demander : il est de ces naïvetés que le devoir impose.
Chez M. Brunetière.
À la Revue des Deux Mondes, dans l’antique hôtel de la rue de l’Université. Un concierge poli, sous un porche monumental.
L’immeuble respire cet air calme et reposé du vieux Faubourg tranquille ; aucun bruit, aucune fièvre ; de l’ordre, de la propreté, du silence.
M. Brunetière a son bureau de rédacteur au premier, sur la cour. Des tapis, du feu, des livres. Connaissez-vous le vigoureux adversaire de M. Émile Zola ? Trente-huit ans, de taille moyenne, un corps chétif que virilise une tête étonnamment expressive, une tête osseuse de bénédictin maladif, encadrée d’un collier de barbe noire, une moustache courte et clairsemée sous un nez puissant que chevauche le binocle coutumier, derrière lequel pétille un regard perçant et hardi. Le front est ample, élargi aux tempes, tandis que le reste de la figure, aux joues rentrées, va en s’amincissant jusqu’aux maxillaires énergiques et au menton volontaire.
Le critique est d’une circonspection rare.
Voici, néanmoins, aussi exactement que possible, la conversation que nous avons eue avec M. Brunetière.
– Le bruit de votre candidature à l’Académie est-il exact ?
– Il le sera jeudi. Je n’ai pas de raisons pour le cacher, ma lettre est entre les mains de M. Camille Doucet.
– On souligne déjà, sous le manteau, la signification de votre candidature...
– Quelle signification ? Elle n’en a pas d’autre que celle de la bienveillance de quelques-uns de mes amis qui m’ont engagé à la poser.
– On aime à se rappeler, pourtant, que vous avez été, monsieur, le plus ardent des adversaires de M. Émile Zola... C’est la première fois qu’il frappe à la porte de l’Académie, c’est aussi votre première tentative ; on voit là une coïncidence qui doit avoir des complices ; pour tout dire, votre candidature serait une candidature d’antagonisme littéraire ?...
M. Brunetière roulait lentement une cigarette de scaferlati supérieur.
– Mais non, me répond-il assez faiblement. La coïncidence est toute fortuite. Devant l’Académie, d’ailleurs, on est des rivaux et non des adversaires. Je n’ai pas l’honneur de connaître M. Zola, je ne l’ai jamais vu. Il est vrai que pendant dix ans je me suis appliqué à dire de son œuvre tout ce que j’en pensais ; mais je n’ai rien dit que je ne sois prêt à répéter devant lui, rien qui puisse blesser... l’homme. Pourquoi deviendrais-je son antagoniste aujourd’hui ?
M. Brunetière regardait sa cigarette, à présent roulée, en souriant imperceptiblement. Il reprit :
– Quand on est plusieurs à courir le même lièvre, comme on ne peut pas le tuer deux fois, il n’y a forcément qu’un heureux chasseur...
– À quand remontent vos dernières études sur M. Zola et le naturalisme ?
– Oh ! il y a quatre ou cinq ans, à l’époque de sa mort... car vous savez qu’il est mort, le naturalisme ! Ce qu’il a pu donner de bon ou de mauvais est acquis à présent à la littérature. Son rôle est fini. Et si cette vieille école produit encore, c’est de même qu’après 1850 le romantisme a encore produit les Contemplations et la Légende desSiècles. Mais son action est éteinte ; l’école est entrée dans le domaine de l’histoire...
M. Brunetière alluma sa cigarette.
J’avais bien envie de lui demander :
– Et ne pensez-vous pas que cette littérature... historique mériterait bien d’être représentée à l’Académie ?
Mais je dis seulement :
– Avez-vous eu l’occasion de donner votre opinion sur le théâtre d’Émile Augier ? Et qu’en pensez-vous ?
– Non, monsieur, me répondit poliment M. Brunetière. Il y a onze ans, quand Augier fit représenter sa dernière pièce, les Fourchambault, je ne m’occupais pas encore de théâtre. Je ne puis pas dire que je n’en pense que du mal – ce serait faux – ni que du bien – ce ne serait pas plus vrai...
Après avoir été ainsi fixé par M. Brunetière, je n’avais plus qu’une hâte, c’était d’aller demander à M. Zola où en était sa candidature, et, naturellement, ce qu’il pensait de M. Ferdinand Brunetière.
Chez M. Zola.
M. Zola a quitté la rue Ballu et demeure à présent dans un appartement plus vaste que l’ancien, rue de Bruxelles, 21bis.
– Maître, lui dis-je, je viens...
– Vous venez à propos de la fameuse affiche, n’est-ce pas ?
Cet empressement à causer d’un sujet que je ne lui indiquais pas me fit sentir qu’il lui tenait à cœur avant tout, et qu’il fallait commencer par là. Je lui répondis :
– Justement.
– Eh bien ! Tout le tapage qu’on mène autour de cette affaire est du pur enfantillage. D’abord, je ne m’occupe jamais, quand je cède à un journal ou à une revue un de mes romans, du genre de publicité qu’adoptera l’acquéreur. Le Voltaire, à qui j’ai cédé Nana, le Gaulois, le Gil Blas, et d’autres, peuvent tous en témoigner : je mettais dans ma poche le montant de mes droits et je ne m’occupais plus de rien. Pour la Bête humaine, on m’a demandé ce que je pensais d’une affiche ; j’ai laissé absolument libre l’éditeur d’agir comme il l’entendait. Je lui ai indiqué bénévolement les trois premiers chapitres de mon roman où il pourrait aisément trouver le sujet d’une composition d’affiche : un mari qui veut tuer sa femme et un assassinat ; puis je n’ai plus entendu parler de rien, jusqu’au jour où, sorti en voiture – c’était, paraît-il, cinq jours après l’apposition des affiches – j’aperçois vaguement, à distance, l’annonce de la Bête humaine avec, au-dessus, l’homme et la femme qui paraissaient lutter ; je vois même un couteau ; je me dis : « Bon, c’est le mari qui veut tuer sa femme ! » Et je fais la réflexion : « Ça n’est pas très artistique. »
« Mais le lendemain, un de mes amis arrive, avec un air apitoyé, qui me lance :
« ‘Mon cher, on dit que votre affiche est scandaleuse, que votre candidature est compromise, etc. etc.’ Je vais la voir alors. Elle n’est pas fameuse, non ; et son principal défaut, à mes yeux, est de n’être pas de Chéret, voilà tout. Autrement, qu’y a-t-il ? Un mari qui veut posséder sa femme après un bon déjeuner, est-ce que ça n’arrive pas tous les jours dans la vie ? Dans les chemins de fer surtout, comme dans les mines, où l’homme travaille souvent la nuit... On a dit que les personnages étaient débraillés ; c’est faux : ils sont corrects comme des mannequins de la Belle Jardinière ! Dans tous les cas, je le répète, je n’en suis pas responsable. Et je n’ai même pas demandé qu’on la retire. Quant à me l’imputer à crime, c’est affaire à mes ennemis. Juger un ouvrage sur une affiche et sur un chapitre, c’est puéril, c’est enfantin. Oh ! ma candidature me paraît fort compromise par cette affiche et par les malentendus qui en ont été la conséquence. Et je ne me dissimule pas que si l’Académie votait demain, toutes les chances que je puis avoir s’envoleraient. Mais l’élection n’aura lieu que dans cinq mois, et d’ici là... nous pouvons tous mourir. Et puis l’Académie est assez grande, il me semble, et assez sage, pour ne pas juger un candidat d’après les potins d’un petit clan d’intéressés. Elle me jugera, j’en ai la confiance, non sur un placard dont je ne suis pas responsable, non pas même sur mon dernier ouvrage, mais sur l’ensemble de mes œuvres, sur ma situation dans la littérature. C’est ainsi qu’elle a toujours fait, je crois, écartant de ses jugements les passions du moment qui pouvaient la troubler, et appréciant en bloc les mérites de ceux qui se présentaient à ses suffrages ; et c’est ainsi qu’elle fera, j’en demeure persuadé.
– Voici, maître, que les candidatures continuent de pulluler.
– Oh ! je crois qu’il en est qui s’essouffleront avant l’élection, et qu’il en restera, en somme, très peu sur les rangs.
– M. Brunetière, lui, a du souffle...
– Et il a même des chances, des chances réelles. C’est la grisaille, ni chair ni poisson, à laquelle s’arrêtera peut-être, en fin de compte, l’Académie dans l’embarras.
– Le connaissez-vous, M. Brunetière ?
– Non. Et je n’ai jamais eu l’occasion de parler de lui ; mes dernières polémiques datent de dix ans ; à cette époque, M. Brunetière était encore dans les limbes, et, depuis, je n’ai jamais répondu à ses attaques.
– Vous les connaissez, pourtant ?
– Oh ! très bien. Je crois que j’ai lu tout ce qu’il a écrit. C’est un esprit curieux, renseigné sur la littérature classique, ayant beaucoup de lecture, connaissant bien ses matières ; il m’intéresse même, quand il parle du dix-septième et du dix-huitième siècle, mais dès qu’il aborde la littérature contemporaine, je le trouve rempli d’injustice, d’outrance, d’un parti pris extraordinaire. Quand je lis de M. Brunetière les critiques sur Flaubert, Goncourt et Daudet, qu’il discute, à qui il dénie les principales de leurs qualités, j’en arrive à me demander s’il est de bonne foi, ou si c’est une attitude ? Surtout quand je le vois, par moments, porter aux nues de petits romanciers de carton, et célébrer des bonshommes de rien du tout qui ont moins de talent dans tout leur corps que Goncourt n’en a dans son petit doigt ! Pour ma part, je ne peux tenir compte d’aucune de ses critiques ; la lecture m’en reste sans bénéfice aucun.
« Si j’avais eu à parler de lui – continue M. Zola – j’aurais dit : Assez souvent j’ai cru qu’il louait ou blâmait selon qu’on était ou qu’on n’était pas de la Revue des DeuxMondes. J’ai vu de jeunes romanciers qu’il critiquait avec la dernière amertume dans une étude de la Revue, et qu’il accablait d’éloges dans une suivante : « Oui, me disait un jour l’un d’eux que j’interrogeais sur ce mystère, l’éreintement était pour me décider à entrer à la Revue. J’y suis, à présent. » Eh bien ! si M. Brunetière n’est qu’un marchand de prose à la solde des Buloz, je cesse de le trouver intéressant. S’il existe, c’est par la conscience qu’on lui suppose, et, s’il n’a pas de conscience, il n’existe plus.
– Puisque vous voilà en verve, maître, qu’auriez-vous dit de son talent d’écrivain ?
– Oh ! sur son talent... j’aurais expliqué que les langues marchent et changent comme les costumes ; et de même qu’il ne s’habille pas en Louis XIV avec un chapeau à trois cornes, une perruque et un justaucorps, de même il est ridicule, en 1889, d’écrire comme au dix-septième siècle et de jongler avec les qui, les que, les dont de Bossuet et de Descartes. M. Brunetière, c’est un chienlit de la langue, un déguisé ! Et les symbolistes qui vont en avant ne sont pas plus grotesques que lui, qui rétrograde !
– Pour finir pensez-vous que M. Brunetière ait voulu se présenter spécialement contre vous ?
– Il m’est assez difficile de répondre à cette question – à laquelle je n’avais pas songé. A-t-il espéré passer plus aisément à la faveur d’une protestation qui se ferait sur mon nom ? Compte-t-il sur les voix qui me seront de parti pris hostile ? Je n’en sais rien. Dans tous les cas, son nom peut servir les passions qu’on suppose à certains membres de l’Académie...
J’objecte :
– M. Brunetière m’a assuré qu’il n’y avait dans sa candidature, posée en même temps que la vôtre, qu’une simple coïncidence...
– Que ne le disiez-vous plus tôt ! Si M. Brunetière l’affirme, je le crois. Voyez-vous des raisons d’en douter ?
– Au contraire !
2 décembre 1889.
L’Ortografe : chez M. Louis Havet. – À l’Académie.
La note suivante vient d’être insérée dans les feuilles :
« La pétition pour la réforme orthographique a été communiquée officiellement à l’Académie dans une de ses dernières séances. Cette pétition, revêtue d’un nombre considérable de signatures, a été renvoyée à la commission du Dictionnaire. »
On a mené trop grand bruit dans toute la presse, depuis un an, autour de cette campagne de réforme, pour que le public, qui s’intéresse à toutes les luttes, ne s’intéresse pas à ce tournoi original entre les démolisseurs et les défenseurs du vieux dictionnaire français.
D’autant que les champions des deux camps ont une égale part d’autorité en la matière, et qu’on peut voir, d’un côté comme de l’autre, des professeurs du Collège de France et des membres de l’Institut.
Or, la petite note qu’on vient de lire nous signale que le débat se resserre et que les adversaires se trouvent dès maintenant en présence.
Il était tout indiqué de demander, ici, comment on s’était préparé à la lutte, là, comment on entendait se défendre.
J’ai vu M. Louis Havet, l’un des partisans les plus résolus et les plus actifs de la réforme. M. Louis Havet est professeur au Collège de France et à la Sorbonne. Son nom jouit dans le monde des lettres d’une grande considération, et la valeur de ses travaux philologiques donne un grand poids aux objurgations des pétitionnaires.
Chez M. Louis Havet.
– Notre pétition a eu un véritable succès d’enthousiasme, me dit-il. Elle compte 289 noms de l’enseignement supérieur, plus de 50 membres de différentes Académies, des inspecteurs généraux, d’Académie et des inspecteurs primaires ; l’École des chartes, l’École des hautes études, l’École normale supérieure, les Facultés s’y sont inscrites ; ajoutez à cela 1800 professeurs de l’enseignement secondaire, près de 3000 membres de l’enseignement primaire, des hommes de lettres, des publicistes, des archivistes, des bibliothécaires, plus de cinq cents professeurs suisses, belges, anglais, allemands, espagnols, suédois, vous arriverez au total imposant de plus de 6500 signatures.
– Et vous pensez obtenir gain de cause près de l’Académie ?
– J’estime que devant le nombre et la notoriété des pétitionnaires l’Académie ne pourra pas se dérober... Elle peut, d’ailleurs, se montrer hardie, très hardie, car il y a des précédents. Sur les 20.000 mots du Dictionnaire de 1740, 5000 ont été simplifiés, surtout les mots contenant des h et des y : depuis lors, à chaque édition, des modifications ont été apportées dans l’orthographe de certaines catégories de mots. Ce que nous demandons, à l’heure qu’il est, n’est donc pas exorbitant. Il s’agit de rompre avec un préjugé tenace autant que peu fondé, celui de l’orthographe étymologique. Les gens du métier savent très bien que l’orthographe actuelle n’est pas étymologique du tout, et que l’orthographe simplifiée le serait davantage par le fait même de la simplification.
– En effet, le préjugé est tenace, et bien des gens chercheront vainement à concilier leur respect pour la science officielle, que vous représentez en qualité de professeur en Sorbonne, et votre dédain des traditions. Que leur dire, à ces non-initiés ?
– Eh bien ! dites-leur que les prétendues étymologies ne signifient absolument rien : qu’elles sont presque autant d’erreurs ; que la plupart des mots tels qu’on les écrit à présent sont le résultat de réformes à rebours faites au XVe et au XVIe siècle par des pédants qui y ont ajouté une foule de lettres parasites, par erreur, ou peut-être exprès, pour compliquer l’orthographe ! Dans les Chansons de Gestes, c’est-à-dire avant ces réformes imbéciles, l’orthographe est bien plus près de notre prononciation que celle d’à présent. Nos pères, au temps de saint Louis, écrivaient très logiquement amer, du latin amarus, et de même cler, du latin clarus. Pourquoi écrivons-nous amer par e et clair par ai ? Ils écrivent ele, du latin ala, et pele, du latin pala. Pourquoi, nous, écrivons-nous aile et pelle ? Pourquoi pas aussi bien elle et pelle, ou aile et paile ? Une foule de gens sont persuadés que ce jeu de casse-tête est quelque chose de scientifique ; ils se figurent, sans savoir pourquoi, que cette collection de règles capricieuses contient la quintessence de la linguistique et de l’étymologie. Qu’il soit permis à quelqu’un qui n’est pas dupe de s’expliquer là-dessus. Non, il n’y a rien de commun entre l’étymologie et notre bizarre orthographe. Non, réformer l’orthographe n’est pas sacrifier la véritable étymologie. Puisqu’on écrit déjà frénétique par un f, il n’y a aucune raison étymologique pour écrire néphrétique par un ph. Puisque déjà on a supprimé l’h dans throsne, charactère, rhythmé, on peut l’ôter dans théorie. Il n’y a rien d’anti-étymologique à écrire fameus plutôt que fameux ; rien d’étymologique ne justifie x au lieu d’s dans les faus bijous, les beaus cheveus, etc. etc. Je pourrais vous citer ainsi des exemples à l’infini. Beaucoup d’adversaires aussi nous représentent la langue actuelle comme l’héritage de nos pères, que les siècles ont rendu vénérable et sacré ! Or, nous avons une orthographe qui n’est ni celle du Moyen-âge, ni celle de Villon, ni celle de Marot, ni celle de Rabelais, ni celle de Corneille, ni celle de Voltaire ! Mieux encore ! Dans la carrière d’un même écrivain, Victor Hugo, il y a eu trois orthographes officielles selon lesquelles il a fallu rectifier les éditions successives des mêmes œuvres : l’orthographe d’avant 1835, celle de 1835, et celle de 1878 ! Voilà ce qu’on veut nous donner comme le monument de la tradition des siècles !
– En résumé, que demandez-vous à l’Académie ?
– Pour l’instant, peu de chose, en somme : suppression d’accents muets (où, là, gîte, qu’il fût), suppression des traits d’union inutiles, abolition des lettres muettes ou superflues, les h, les y, le ph, le rh, les consonnes doubles, les x de certains pluriels, de façon à simplifier et à uniformiser l’orthographe, qui sera d’autant plus approuvée des doctes qu’elle sera plus près d’être enfantine.
– Vous avez dit : pour l’instant. Vous avez alors des ambitions plus radicales ?
– Oh oui ! Le phonétisme, le phonétisme absolu. Mais... je ne le verrai pas, nos enfants non plus. Et j’admets, d’ailleurs, qu’il n’est pas possible d’y arriver d’un seul coup ; l’œil ne s’habituerait pas aisément à une transformation complète de l’orthographe des mots, et on lirait avec difficulté. Mais, dans cinq cents ans, dans mille ans, que sais-je ! on écrira kelke ou kelk ou lieu de quelque. C’est sûr. Je suis convaincu qu’on arrivera, par étapes, à la simplification absolue, au phonétisme. D’ailleurs, quand on écrira avec le phonographe – car on y arrivera dans un temps donné, à l’aide d’artifices de transmission – on sera inévitablement amené à adopter cette règle : un signe par son... Et ce sera le dernier triomphe des réformistes !
Avec cette théorie du principal pétitionnaire, il était intéressant de connaître le sort probable de la pétition et l’opinion qu’en ont dès maintenant les membres les plus autorisés de la commission du Dictionnaire, dont l’avis fait loi au Palais Mazarin : MM. Camille Doucet et Renan.
Chez M. Camille Doucet.
– Mais de quel droit viendrions-nous demain bouleverser de fond en comble la langue française ? L’orthographe n’est la propriété de personne, elle est ce que l’usage l’a faite. Pourquoi, par exemple, écrit-on frapper avec deux p ? Il serait plus commode de n’en mettre qu’un. Mais l’usage n’a-t-il pas raison ? Et ne vous paraît-il pas, en effet, que le doublement de la consonne ajoute à la signification et à la force de l’idée qu’exprime le verbe frap-per ? Il faut bien en convenir, l’orthographe très souvent est arbitraire. Mais à qui appartient-il de la révolutionner ? Pourquoi ? À quel titre ? Et, je le répète, comment ? Que le gouvernement en prenne l’initiative, lui, s’il le trouve bon ; il a des inspecteurs, il dispose des examens scolaires, il peut décréter que tels et tels mots subiront telle ou telle modification. Quand l’usage en sera pris, nous verrons ce qu’il nous restera à faire. C’est bien simple.
J’insinue :
– Les radicaux du parti réformateur soutiennent que les étymologies ne signifient rien, et ils demandent qu’on inaugure une orthographe simplifiée qui n’aurait d’autre base que la prononciation ?
M. Camille Doucet s’anime alors :
– Mais est-ce que tout le monde parle de la même façon ? Est-ce que le Midi accentue comme le Nord ? À l’Ouest parle-t-on comme à l’Est ? Où sera la règle ? Plus de règle, alors ! Chacun écrirait comme il parle : oui, ce serait, en effet, très joli !
« Au surplus, monsieur, ce qu’on nous demande là, ce n’est plus une réforme, c’est une révolution ! Il en est, d’ailleurs, toujours ainsi : le 24 février 1848, à onze du matin, on criait dans les rues : la réforme ! la réforme ! Et à midi on avait la Révolution.
« Et puis, ces messieurs ont une façon d’agir inexplicable. Ils ont l’air de vouloir nous effrayer avec leur pétition monstre ! Les signatures, on sait comment cela s’obtient : on les donne souvent pour se débarrasser d’une importunité, ça n’engage à rien. Mais pourquoi pas des canons aussi ? Pourquoi ne pas envoyer à l’Institut la manifestation du 1er mai ? L’Académie n’a peur de rien, monsieur ; elle ne craint ni les réformes, ni les révolutions.
« Pour moi, conclut M. Camille Doucet, je continuerai à écrire comme j’ai toujours écrit, tant bien que mal. »
Chez M. Renan.
– Ce que prouve la pétition, me dit M. Renan, et ce qu’il y a de vrai, voyez-vous, c’est que l’on attache trop d’importance à l’orthographe des mots. J’ai souvent dit cela au Conseil supérieur de l’instruction publique, au grand scandale de plusieurs collègues. Il y a cent ans, on ne mettait pas l’orthographe. Ni Napoléon, ni Voltaire ne la connaissaient ; elle existait, pourtant, mais dans les livres seulement ; c’étaient les typographes qui la mettaient ; ils en étaient les maîtres. Dans les ouvrages du quinzième et du seizième siècle, on trouve, à la même page, le même mot écrit de deux ou trois façons différentes. Les protes, que cela finissait par gêner, ont, petit à petit, unifié l’orthographe des mots pour leur plus grande commodité. On peut donc le dire, ce sont eux qui ont créé l’orthographe, et vous voyez comment.
« Mais puisque c’est fait, pourquoi le défaire ? On dit que l’orthographe sera plus facile ? Mais pourquoi la rendre plus facile ? Je ne suis pas pour la simplification à outrance ; elle écrase de belles et bonnes choses.
« Est-ce qu’on ne lit pas aussi bien une lettre pleine de fautes qu’une autre absolument correcte ? Et, je vous le demande, qu’est-ce que cela peut bien nous faire que les femmes criblent leurs lettres de fautes d’orthographe, si elles savent y mettre des choses charmantes ?
« Ah ! je ne dis pas que puisqu’on va réviser le dictionnaire, il n’y ait quelque rectification à y apporter. Par exemple, dans les h, ces maudites h, qui font tant de désespoirs ! On en a supprimé une à « rythme », on pourrait étalement supprimer, par occasion, celle de « posthume », qui fait un horrible barbarisme dans le Dictionnaire de l’Académie. Notre savant collègue, M. Havet, leur en veut personnellement : mon Dieu, nous lui ferons une hécatombe d’h ! Il étend sa vindication jusqu’aux accents et aux traits-d’union. Je lui en fais volontiers aussi le sacrifice. Moi, je les mettrai toujours, je trouve cela plus commode, je ne sais pas pourquoi...
Je glisse ici le mot d’orthographe phonétique :
– Oh ! c’est sauvage, s’exclame M. Renan. C’est une plaisanterie sauvage. Cela vaut-il vraiment la peine de discuter ? Je ne crois pas. L’orthographe est une convention, soit, mais elle est fixée. C’est une langue, c’est notre langue. Qu’est-ce que ce serait que cette orthographe d’oreille ? Chacun écrirait comme il entendrait – c’est le mot – et on ne se comprendrait plus.
« Et puis, que deviendrait – avec les bouleversements qu’on nous demande – toute la littérature écrite en vrai français ? Les enfants, à qui l’on enseignerait ce nouveau dictionnaire, ne comprendraient plus ni Racine ni Chateaubriand : ce serait deux éducations à faire. Non, c’est de la sauvagerie. Sans contredit.
– Il paraît pourtant, maître, que dans mille ans on écrira kelk pour quelque ?
M. Renan rit de bon cœur.
– Espérons alors, conclut-il avec l’ironie d’un sourire, que dans mille ans le temps nous aura apporté des compensations qui nous aideront à supporter ces horreurs...
5 avril 1890.
Le bachot : un grand « recalé ».
Chez M. Émile Zola.
Les distributions de prix et les examens scolaires sont à peu près terminés et la France s’est enrichie de quelques centaines de bacheliers ; l’Université a lauré ses forts en thème, et, dans tous les lycées de France, le professeur de corvée a lu, avec des gestes gauches, son discours contourné et glacial.
À cette actualité périodique d’été s’ajoute, cette année, un gros bruit de réformes : l’ancien bachot agoniserait, et les programmes seraient à la veille d’être démantelés. Une conversation sur ce vieux débris du classicisme avec Émile Zola, grand révolutionnaire et recalé célèbre, m’avait paru au moins intéressante. Et je ne m’étais pas trompé, ce que m’a dit M. Zola sur le fond même de la question étant justement tout le contraire de ce que j’en attendais...
Il me raconte d’abord l’histoire de ses deux échecs, qui ne manque pas d’intérêt pour les biographies à venir. La voici :
– Non, je ne suis pas bachelier, me dit-il. Et j’ai même été recalé deux fois dans des circonstances peut-être curieuses.
À huit ans je ne savais pas lire : j’avais été élevé en enfant extrêmement gâté par un père et une mère qui m’aimaient beaucoup, et je ne faisais absolument que mes quatre volontés ; j’étais donc très en retard, et pour me piquer et stimuler mon amour-propre, mes tantes, au nouvel an, au lieu de jouets, m’offraient des livres en étrennes. Je comprenais ces allusions répétées, et j’y devins sensible. Je finis par consentir à entrer dans un collège privé à Aix, et je me rappelle très bien que, pour m’apprendre à lire, le directeur du collège me prenait à part et m’enseignait à moi seul la lecture dans une superbe édition illustrée des fables de La Fontaine, imprimée en très gros caractères.
Je fis des progrès rapides, et je fus bientôt ce qu’on appelle un brillant élève, extraordinaire même ; j’avais tous les premiers prix de ma classe, et j’enlevais surtout haut la main ceux de narration française. J’ai encore là-haut des palmarès de ces années lointaines et mon nom y fourmille.
Je continuai mes études à Aix jusqu’en seconde ; à ce moment, mon père mourut, et ma mère, restée sans fortune, m’amena à Paris. Un ami de ma famille me fit obtenir, par l’intermédiaire de Désiré Nisard, alors directeur de l’École Normale, une bourse au lycée Saint-Louis. Mais une fois là, je travaillai aussi mal que j’avais bien travaillé à Aix. J’écrivais des romans et des vers, je m’étais mis à lire Rabelais et Montaigne avec passion ; j’avais dix-huit ans, j’étais un grand garçon déjà barbu, et, en dehors des classes, je ne pensais qu’à composer et à lire ; même, on avait lié connaissance avec quelques jeunesses du quartier, et, naturellement, on folâtrait un peu.
C’est ainsi que j’atteignis l’époque du baccalauréat. Cela me préoccupait peu. J’avais déjà la tête pleine de projets révolutionnaires, et le bachot me paraissait inutile et ridicule ; pourtant, puisque ma mère y tenait, je m’étais résolu à tenter ma chance. Je me présentai donc ! Je fus reçu, à l’écrit, le deuxième. Je ne me rappelle plus les sujets des épreuves, mais je dus accoucher d’une dissertation effroyablement romantique. À l’oral, j’eus des notes superbes pour les sciences ; je n’avais rien fait à Paris, mais, comme je vous le disais tout à l’heure, j’avais réellement potassé mes matières à Aix.
Et puis, le hasard me servit sans doute. Toujours est-il qu’après avoir été reçu le second à l’écrit, décroché des boules blanches pour les sciences, je fus piteusement recalé à l’oral pour l’allemand, l’histoire... et la littérature ! Oui, c’est ainsi. J’avais dix-neuf ans. C’était en 1855,4 à la session de juillet ; un examinateur me demanda d’expliquer une fable de La Fontaine et, sur mes explications, me donna à entendre que je n’étais qu’un idiot et un cancre, que jamais de ma vie je ne saurais seulement comprendre ce que c’est que la littérature. J’avais affaire à un de ces vieux types d’universitaires pour qui, dans ce temps-là encore, les sciences n’existaient pas, et, comme j’avais d’excellentes notes pour toute la partie scientifique, il jugeait que je ne pouvais pas expliquer congrûment ma fable de La Fontaine. Je ramassai ainsi trois boules noires, une pour l’allemand, que je ne savais même pas lire, une pour l’histoire, parce que je répondis une énormité : je dus placer Charlemagne en 1515, ou quelque chose d’approchant, et enfin pour l’explication des textes de littérature française. Aujourd’hui cela me récrée, mais à ce moment, j’étais furieux, non pas de mon échec, mais, vous le concevez, de ses circonstances. De plus, un de mes amis se trouvait dans la salle d’examen, qui, après mon interrogatoire sur les sciences, était si sûr que je passerais qu’il courut trouver ma mère et l’assura que j’étais reçu ; vous voyez leur consternation et ma figure quand j’arrivai à mon tour à la maison et que je leur dis : « Eh bien ! non, ce n’est pas ça, je suis recalé, recalé pour ma fable de La Fontaine ! »
Depuis notre arrivée à Paris je souffrais d’être si loin d’Aix ; j’avais la nostalgie de ce Midi où j’avais été élevé, et j’attendais impatiemment l’occasion d’y retourner ; c’étaient les vacances : vite nous filâmes à Aix. Une fois là-bas je me dis : « Ils m’ont recalé à Paris, c’est bien ; je reste ici, et à la session de novembre, je passerai à Marseille. » Ce que je fis. Je subis là mon deuxième et dernier échec. Mais cette fois, ce ne fut la faute de personne, ni des examinateurs, ni de moi : je fus pris d’un besoin très douloureux, une heure après être entré dans la salle d’examen, et comme on n’avait pas le droit de sortir, je ne sais pas ce que j’ai écrit, je ne me rappelle rien, sinon que j’ai souffert et que le lendemain, j’étais recalé de nouveau.
C’était tout. Je ne voulus plus jamais me représenter à cette loterie, où – me disais-je – on a contre soi le hasard des épreuves, des examinateurs... et de la nature.
– Et cela ne vous a jamais manqué ?
– Ma foi non, parce que je n’ai pas suivi les voies tracées ; mais je me rends très bien compte qu’à beaucoup de points de vue, et dans beaucoup de cas, le bachot est utile, indispensable même.
– Mais quel genre d’estime lui accordez-vous ?
– Attendez ! Il faut s’entendre. Le diplôme par lui-même ne prouve pas, il est vrai, que celui qui le possède est un être intelligent ; il arrive évidemment que des bacheliers sont des buses, tandis qu’au contraire, n’est-ce pas, il peut se trouver, dans la foule des « recalés », des esprits estimables. Mais si je n’attache pas d’importance au parchemin, je trouve très intéressants le genre et la somme d’efforts qu’il représente ; aussi, ce que je vante en ce moment, est-ce plutôt la préparation que le résultat. Ce que je dis donc du bachelier est également vrai pour celui qui, ayant mené ses études jusqu’au bachot, n’aurait pas passé son examen pour un motif ou pour un autre, ou y aurait échoué. Cela va de soi.
J’ai observé que, même dans un cercle d’esprits cultivés, il est toujours facile à un observateur de distinguer ceux qui ont fait leurs humanités de ceux qui n’ont fréquenté que l’école primaire ; ceux qui ont décliné « rosa, la rose » sur les bancs du collège de ceux qui se sont faits eux-mêmes, ayant grandi.
Il s’agit là de choses très ténues et de nuances assez subtiles. Comprenez-moi bien : je veux vous dire que, de même que dans une foule vous mettez le doigt sur la redingote de l’ouvrier endimanché, qui n’en est pas moins une redingote, de même vous discernerez aisément au contact celui qui n’a pas fait ses études de celui qui les a faites. Je ne sais trop à quoi cela tient, si c’est à l’atmosphère de meilleure qualité respirée dans la jeunesse, au frottement d’individus plus choisis, au vernis un peu plus riche que laisse, même aux inférieurs, la culture classique, ou même si cela ne tient pas seulement au dédain naturel qu’on affiche pour ce qu’on a obtenu facilement ; toujours est-il que celui qui a son bachot, ou qui pourrait l’avoir, a un langage, des idées, dans certains cas une désinvolture d’esprit qui contrastent toujours, suivant les natures, soit avec l’hésitation instinctive, soit avec la pédanterie apparente ou occulte, mais sensible, de celui qui n’a pas copié des vers latins en pensums.
Et puis, le baccalauréat est bon, parce qu’il crée une sorte de parenté d’esprit et d’éducation entre tous les membres d’une classe sociale ; parce qu’il unifie son éducation, rapproche, fond, harmonise ; mettez dans un salon un fils de bourgeois, de commerçants, d’aristocrates, qui ont fait leurs humanités ; mêlez-y des gens sortis de l’école des frères ou de la mutuelle, même polis, même cultivés, vous verrez les deux catégories se reconnaître et se séparer très rapidement et très naturellement. Et si l’on émet des aphorismes latins, cherchez bien d’où ils sortent : soyez sûr que ce ne sera pas du côté que vous pouvez croire... »
Durant cette intéressante dissertation, d’une observation et d’une logique si humaines et si serrées, j’avais bien envie d’opposer à M. Zola des exemples contraires aux siens, et de soulever quelques doutes sur l’absolu de théories qui me paraissaient controversables ; mais j’étais à Médan, les trains y sont rares et la station éloignée... Je laisserai donc le lecteur qui ne pense pas comme M. Zola faire lui-même ses restrictions et en tirer des conséquences révolutionnaires et démocratiques...
Avant de partir, je demandai au maître de Médan s’il connaissait d’autres écrivains contemporains dans son cas :
– Il y a, répondit-il, Henri Becque, avec qui je plaisantais de notre commune infortune quand nous nous rencontrâmes dernièrement devant les sonnettes académiques.
16 août 1890.
Chez les mineurs : à Saint-Étienne.
Une terrible explosion de grisou eut lieu à Saint-Étienne en août 1890.5 J’avais accompagné la commission parlementaire, que la Chambre envoya sur les lieux pour faire une enquête. Nous étions tous ensemble descendus dans le puits, pour voir... Il s’agissait de vérifier si la compagnie avait bien pris toutes ses précautions, si elle était ou non responsable de la catastrophe : les barrages étaient-ils bien conditionnés, les boisages solides ? Avait-on laissé subsister dans les plafonds des mines ces trous dangereux où se réfugie le grisou et où, un beau jour, éclate irrésistiblement le fléau ?
Or, les délégués du syndicat, qui nous guidaient dans la mine où les députés avaient bien voulu nous admettre à leurs investigations, nous avaient mis le doigt sur toutes ces choses, les unes plus effrayantes que les autres... Un long bâton à la main, l’un de ces hommes, complètement nus, qui se promenaient dans ce labyrinthe de ténèbres comme dans les allées d’un jardin anglais, nous faisait arrêter de temps à autre devant ce qu’ils appellent des « poches à grisou ». Ce sont d’énormes vides dissimulés par des boisages et où le gaz meurtrier, plus léger que l’air, va se tapir : il nous expliquait que ces poches, multipliées sur le plafond des galeries, se remplissaient lentement, à l’abri de la ventilation, et n’attendaient que la flamme propice pour porter à travers la mine l’horreur des catastrophes.
On parle de la ventilation des mines ; je m’étais figuré des courants d’air sain, circulant en abondance dans tous les sens, jusqu’au fond des moindres galeries. Quelle déception devant la réalité ! Dans une galerie centrale, l’air circule en effet, mais, perpendiculairement à ce chemin de roulage où passent les bennes traînées par des chevaux sur des rails, ou poussées par des hommes, s’amorcent d’autres galeries plus étroites, plus basses, où sont les chantiers d’abatage de charbon, où se font des remblayages, des réparations. Là, à deux mètres à peine de l’entrée, on ne trouve plus qu’un air lourd et brûlant qui ne se renouvelle pas et que les poumons refusent.
Quand, sortant de ces étuves où nous marchions courbés en deux ou en trois, nous arrivions dans une galerie aérée, c’était une invasion d’air frais caressant l’intérieur de la poitrine ; je n’ai jamais goûté l’air comme à ce moment-là : il évoquait, en coulant dans la gorge, la sensation d’une liqueur savoureuse.
Et nous laissions dans ces trous d’enfer les mineurs absolument nus, noirs, atténuant leur nudité de leur vêtement de poussière dont le lavis se zébrait de coulées de sueur.
Un député avait demandé à côté de moi à l’un de ces malheureux :
– Combien de temps pouvez-vous travailler là sans venir respirer ?
– Dix minutes au plus, répondit-il.
Un peu plus loin, un délégué avait crié :
– Par ici, Messieurs ! Par ici ! Voulez-vous voir le grisou ? Tenez, regardez.
Et, au-dessus d’un cadre de boisage qu’il venait de découvrir défectueux, il élevait sa lampe de mineur, répétant :
– Vous allez le voir, le grisou, ce cochon de grisou !
Et, en effet, au bout de quelques secondes, une petite flamme bleue, jolie, séduisante à l’œil comme une fleur mortelle, vint voltiger autour du verre de la lampe, l’enveloppa lentement comme d’une caresse, dansa. Les vers de Jouy6 me revenaient :
Le voilà, le grisou,
Le joli grisou des mines !