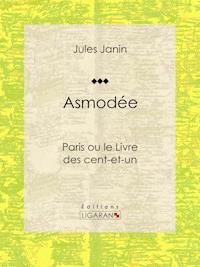Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Un hiver à Paris, écrit par Jules Janin, est un roman captivant qui nous plonge au cœur de la Ville Lumière pendant la saison la plus froide de l'année. Publié en 1846, ce livre nous transporte dans un Paris pittoresque et enchanteur, où les rues pavées sont recouvertes d'un manteau de neige étincelant.
L'histoire se déroule autour de deux personnages principaux, Édouard et Louise, qui se rencontrent par hasard lors d'une soirée mondaine. Édouard, un jeune homme ambitieux et rêveur, est fasciné par la beauté et le charme de Louise, une jeune femme mystérieuse et élégante. Leur rencontre fortuite va bouleverser leurs vies et les entraîner dans une aventure passionnante.
Au fil des pages, Jules Janin nous dépeint avec finesse et poésie les différents quartiers de Paris, des boulevards animés aux ruelles romantiques de Montmartre. Il nous fait découvrir les monuments emblématiques de la capitale, tels que la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame, qui prennent une dimension encore plus magique sous la neige.
Mais au-delà de la beauté des décors parisiens, Un hiver à Paris explore également les sentiments et les émotions des personnages. Jules Janin nous plonge dans les tourments de l'amour naissant entre Édouard et Louise, nous faisant ressentir leur passion, leurs doutes et leurs espoirs. L'auteur nous offre ainsi une véritable immersion dans les méandres du cœur humain.
Avec une plume délicate et envoûtante, Jules Janin nous transporte dans un Paris hivernal, où l'amour et la beauté se mêlent harmonieusement. Un hiver à Paris est un livre qui ravira les amateurs de romans historiques et les amoureux de la capitale française. Une lecture captivante qui nous fait voyager dans le temps et l'espace, pour nous offrir un véritable enchantement littéraire.
Extrait : ""Si, par une belle soirée du printemps ou de l'hiver, vous entrez dans cette ville immense - abime étourdissant- et surtout si vous entrez par la belle porte, (...) vous vous trouvez saisi de je ne sais quel espoir d'un grand et magnifique spectacle, espoir qui s'empare à votre insu de toute votre âme."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016659
©Ligaran 2015
J’ai traduit le présent livre d’un récit très exact et très véridique qui nous est venu du pays de Cooper et de Washington-Irving. Paris est le sujet de ce thème varié à l’infini, et si vous me demandez : À quoi bon un pareil livre ? je vous demanderai, à vous, ma belle dame, qui me lisez : À quoi bon un miroir ? Ce livre est écrit pour que Paris puisse y découvrir, en souriant d’un air fin, comme il sourit à toutes choses, ses plus beaux monuments, ses plus riches demeures, ses plaisirs de chaque jour, ses fêtes de chaque soir. – Et d’ailleurs, l’auteur original de ce récit, qui est un homme très versé dans les beaux-arts, un observateur bienveillant et cependant subtil, et moi son très humble traducteur, tout comme j’ai eu l’honneur d’être le traducteur de Sterne, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes dans cette histoire écrite en courant. – Non, Dieu merci ! lui et moi nous ne serons pas livrés à nos propres forces pour saisir cette image changeante et mobile du monde parisien. D’autres descripteurs plus experts que nous deux, d’autres historiens plus fidèles, les plus habiles graveurs de Londres et un très ingénieux dessinateur de Paris, se sont mis à l’œuvre afin que nous puissions rencontrer plus facilement le fidèle reflet que nous cherchons. Donc, soyez favorables à ce livre écrit au-delà des mers, gravé à Londres, traduit et dessiné à Paris.
Je vous dirai peu de choses de l’écrivain original, car il a mis dans son voyage beaucoup de sa bonne humeur, de son esprit, de sa bienveillance naturelle. Il était jeune encore lorsqu’il vint à Paris, pour y laisser le trop-plein de sa fougue et de sa jeunesse. La chose ne fut pas si facile qu’il l’avait cru d’abord ; mais enfin, à force de zèle et de persévérance, et de nuits passées au bal de l’Opéra‚ et de jours consacrés à l’éternelle fête parisienne, à force d’argent jeté çà et là, au hasard, comme il faut jeter l’argent pour qu’il vous rapporte quelque peu de variété d’intérêt et de plaisir, notre jeune homme eut bientôt revêtu le vieil homme. Il était arrivé à Paris un Parisien évaporé, tout disposé aux plus vives folies ; il en sortit un grave Américain, tout préparé aux calmes et tranquilles honneurs que la mère patrie tient en réserve pour les fils de sa prédilection. – Ce que nous pouvons vous dire de plus net sur notre voyageur, c’est que son observation était calme, sa volonté ferme, son étude pleine de sens ; c’est qu’il avait en lui-même l’instinct des observateurs habiles ; c’est qu’enfin il avait laissé à la porte même de la cité parisienne la froideur nationale, pour obéir à l’enthousiasme passionné des grandes choses et des beaux-arts. – Mais quoi ! je suis bien bon de me perdre dans tous ces préliminaires, comme si, à la page suivante, vous n’alliez pas en savoir autant que moi sur notre auteur !
Si, par une belle soirée du printemps ou de l’hiver, vous entrez dans cette ville immense – abîme étourdissant – et surtout si vous entrez par la belle porte, – car nous ne comptons pas toutes sortes de portes dérobées qui sembleraient plutôt vous précipiter dans un cloaque que vous introduire dans la reine des capitales de l’Europe, vous vous trouvez saisi de je ne sais quel espoir d’un grand et magnifique spectacle, espoir qui s’empare à votre insu de toute votre âme. Une allée sablée doucement vous conduit, par une pente irrésistible, du village de Neuilly, résidence royale, au bois de Boulogne, l’élégant rendez-vous de tous les riches, – et du bois à l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile, une masse de pierres chargées de gloire ; – et de l’Arc-de-Triomphe sur la place de la Concorde, où se tient debout, calme et solennel, l’Obélisque, entre deux fontaines monumentales. Cette place, qui a porté tant de noms différents, place Louis XV, place de la Révolution, place de la Concorde, elle se montre à vous ornée de bronzes dorés, de statues colossales, toute remplie de bruit et de lumière ; à proprement dire, c’est là, dans cet espace brillant, entre le Garde-Meuble de la couronne et la Chambre des Députés, que le vaste Paris commence. Donc, entrez au pas, lentement, regardez, admirez, rêvez.
Ne restons pas pourtant sur la place de la Concorde ; parcourons de nouveau, à la hâte, la longue allée des Champs-Élysées, et revenons au palais de Neuilly. Juste ciel ! voilà Paris dans toute sa gloire ! Cette maison là-bas, modestement couchée sur le rivage, entre deux îles flottantes, c’est la maison de plaisance du roi des Français. Dans ces murs si modestes, dans ces jardins cachés et sans bruit, vous chercheriez en vain S.M. le roi des Français ; vous ne trouvez que le père de famille qui vient se reposer des fatigues de la journée et se préparer au travail du lendemain.
Il y a encore quelques années, quand la royauté avait toute confiance dans le peuple, on voyait souvent passer dans les allées des Champs-Élysées un grand omnibus royal, tout à fait semblable à ces voitures populaires dans lesquelles tous les Français sont égaux comme devant la loi. Dans cette longue et bourgeoise voiture, s’entassaient, pressés au hasard, le roi et sa femme, et sa sœur, et ses quatre fils, et ses trois belles filles, et son gendre et quelques amis ; c’était une cohue royale, toute remplie d’une douce joie. La voiture s’en allait au petit trot, du château des Tuileries à la maison de Neuilly. Pas de gardes, pas d’escorte ; saluait qui voulait la fortune de la France. Seulement, à la bonne humeur du roi, à son visage épanoui et riant, on voyait qu’il était heureux et fier de cet incognito bourgeois.
D’autres fois, à côté du chemin qui mène à Neuilly, une jolie barque pavoisée et remplie d’enfants et de jeunes femmes remontait la Seine à force de rames ; c’étaient dans cette barque mille cris joyeux, mille vivat ! fièrement accentués ; l’étranger, qui regardait couler l’eau et passer le bateau, ne se serait jamais douté que toute la famille royale était portée dans cette barque plus fragile que la barque de César. –Tu portes César et sa fortune !
Un autre jour, au milieu des maçons et des gravats dont sont encombrées les demeures royales, vous rencontriez un gros homme d’une belle et intelligente figure. Il allait, il venait, il avait la toise à la main, il consultait les plans et les corrigeait, il grimpait lestement à l’échelle ; vous demandiez si ce n’était pas là M. Fontaine, l’architecte du roi ; on vous répondait que c’était le roi en personne, le plus entreprenant architecte de son royaume. Bien qu’à le voir distribuant l’éloge ou le blâme, donnant des encouragements et des conseils aux manœuvres émerveillés, il était facile, en effet, de reconnaître le sauveur du château de Versailles, le restaurateur du château de Fontainebleau, le propriétaire du château d’Eu et du palais de Neuilly. Le roi est peut-être en France le seul homme qui ait poussé à ce point-là la passion pour les grands édifices qu’il faut achever, pour les nobles ruines qu’il faut sauver ; il est le protecteur naturel de ces masses de pierres que chaque gouvernement commence sans jamais rien finir, comme si la gloire de la main imprudente qui pose la première pierre valait jamais la gloire de la main sage et modeste qui pose le couronnement de l’édifice ! C’étaient là les heures tranquilles du roi Louis-Philippe, s’il eut jamais des heures tranquilles. Évidemment, il était né tout exprès pour vivre ainsi de la double vie qui lui convient, la vie royale et la vie bourgeoise ; c’étaient là ses plaisirs ; les balles de l’abominable Fieschi et des autres y ont mis bon ordre ; s’ils n’ont pas tué le roi, ils ont blessé la royauté. Surtout, ils ont attristé, bien avant le terrible accident du 13 juillet 1842, cette route facile qui conduit du château des Tuileries à la maison de Neuilly ; ils l’ont encombrée de soldats qui veillent et de gardes qui passent. Pauvres insensés ! qui n’ont pas deviné que c’est la plus mauvaise heure de toutes pour attaquer un roi, l’heure où il n’est plus que le père de ses enfants !
S’il vous plaît, dans ce voyage plein de douces fantaisies que nous allons faire ensemble, nous irons quelque peu au hasard. Nous voyageons dans des pays trop connus pour que nous soyons dominés par une méthode bien rigoureuse. Nos excellents pères les Anglais ont en ce genre un chef-d’œuvre que je me garderai bien d’imiter, le Voyage sentimental. Jamais le Paris du siècle passé n’a été mieux étudié et d’une façon plus complète que par ce bonhomme de Sterne, qui est bien de la famille de La Fontaine. Il prêchait toutes les vertus qu’il n’avait pas d’un air si calme et si câlin ! Il faisait, comme on dit en France, la sainte-nitouche ; mais cependant ne vous fiez pas à sa contrition, à ses yeux baissés, à sa joue qui rougit pudiquement parce qu’une autre joue l’a touchée de son feu palpable ! Certes, nous nous donnerons bien de garde d’aller à la suite de ce bon apôtre, qui connaissait Paris beaucoup mieux que tous les Parisiens de son temps. Nous ferons mieux, nous autres‚ nous suivrons notre propre sentier, – nous arrêtant çà et là pour tout voir, pour tout entendre, pour tout redire. D’ailleurs nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, nous avons avec nous un peintre, un dessinateur, un graveur, un traducteur que voici, qui sait fort peu la langue que nous parlons, et pour qui nous demandons toute votre indulgence. Vous pensiez que nous étions déjà arrivés au palais des Tuileries ; nous étions au pont de Neuilly, tout au plus.
C’est un pont hardiment jeté sur la Seine, entre les îles qui entourent les jardins du roi. Là, Biaise Pascal fut un jour emporté par les six chevaux de sa voiture, et il vit la mort de si près qu’il devint tout d’un coup le terrible chrétien des Pensées et des Provinciales. Quand vous avez franchi le pont, vous trouvez que déjà s’amoindrissent les maisons de plaisance. À ce moment commencent les grands parcs d’un demi-arpent, les vastes jardins composés de quatre ou cinq pots de fleurs ; tel qui possède un cep de vigne quitte Paris le samedi soir en disant fièrement : –Je vais à ma vigne. Le Parisien est un grand amateur des plaisirs champêtres ; il s’en fait de toutes sortes, pourvu qu’ils soient à sa portée. Depuis qu’il a vu tant de révolutions accomplies en vingt-quatre heures, il n’aime guère à s’absenter de sa ville, tant il a peur de ne pas trouver, au retour, le gouvernement qu’il y a laissé. Après quelques tours de roue, vous avez bientôt atteint la grille du bois de Boulogne. Là, par un accident dont je me loue, ma voiture fatiguée se brisa, comme fait le navire qui perd son mât en arrivant au port. Je fus bien vite dégagé, et pendant que le postillon, aidé de mon domestique, réparait la voiture, je vis passer, dans son élégant attirail de chaque jour, tout le beau Paris qui venait se voir lui-même et se montrer au bois de Boulogne. Si vous saviez quelle infinie variété de voitures, de chevaux, d’équipages, de costumes et même de visages ! Toutes les femmes, jeunes et vieilles, du grand monde parisien, étaient, ce jour-là, à la promenade du soir ; tous les hommes, jeunes gens que dévore l’usure, ministres en herbe que dévore la politique, les illustrations dans tous les genres, étaient au bois de Boulogne. Ils passaient‚ ils repassaient devant moi, à cheval, en voiture, au galop, au pas ; ils couraient comme l’oiseau vole. Et moi, le nouveau-venu dans ce beau monde, je m’efforçais déjà d’en deviner les passions cachées, les désirs mystérieux. J’aurais voulu me faire le suivant de toutes ces oisivetés si occupées, de toutes ces ambitions si oisives ; j’aurais voulu monter en croupe derrière elles, et là, caché sous la livrée, les entendre plaisanter ou rire, espérer ou craindre, bénir ou maudire. Mais le moyen de courir après ce monde qui vole dans l’espace et qui se perd dans l’infini ?
Cependant, le léger accident qui m’arrêtait à cette place, devant cette grille où je voyais passer au galop toutes les puis-sauces parisiennes, fut réparé bien vite. Nul ne pensait à me jeter un coup d’œil, ni les hommes, très occupés de leurs chevaux, ni les femmes, très occupées de l’effet de leur toilette et de leur sourire. – Ils passent ainsi leur vie, les uns les autres, à se donner en spectacle, à se regarder venir, à se dire tout bas toutes sortes de mystères que le premier venu peut expliquer tout haut après un mois de séjour dans cette ville bruyante. – De cet endroit à l’Arc-de-Triomphe la distance est peu considérable ; l’Arc-de-Triomphe n’est pas loin. C’est le plus grand arc qui soit au monde, mais aussi il a été placé là pour célébrer les plus grands triomphes ; il lève sa tête, toute blanche de jeunesse, aussi haut que le ferait la plus vieille montagne chargée de tempêtes et d’orages. Tout à l’entour du vaste monument, des remparts sortent de terre, des fossés se creusent, des citadelles s’élèvent, mais le Parisien n’en sait rien encore ; il ne croira aux fossés que lorsqu’il les aura franchis à deux pieds, il ne croira aux citadelles que lorsqu’il les aura entendues gronder en jetant le feu et la flamme ; alors seulement il se mettra en peine de ce bruit formidable.
L’entrée est facile, la porte de la ville est ouverte la nuit, et le jour. L’assassin, le faussaire, la grande coquette, peuvent entrer fièrement et la tête haute, pourvu cependant qu’il n’y ait rien de prohibé dans leur voiture ou dans leurs poches. Entrez, entrez tout à l’aise, vous qui apportez dans ces murs le jeu, l’usure, le vol, l’adultère, toutes les passions mauvaises ! Entrez, les portes vous sont ouvertes, on ne demande pas même quel est votre signalement, quel nom vous portez, et si vous avez un passeport ! L’octroi municipal n’a rien à faire avec les hommes, il ne s’occupe que des choses. L’octroi ne reconnaît ni hommes ni femmes de contrebande. Que lui importe que l’homme qui entre dans ces murs soit un vil pamphlétaire, un faussaire, un voleur ? il n’est pas chargé de la morale publique ; ce n’est pas à lui que la société s’adresse pour châtier les coupables. Pour peu que la recette soit bonne aux portes de la ville, l’octroi est content, la ville est satisfaite. Le grand crime envers cette cité, qui a besoin de tant d’argent pour vivre, c’est de fumer du tabac qui n’ait pas passé par les mains de la Régie, c’est de boire du vin qui n’ait pas payé son droit d’entrée à l’octroi municipal. L’octroi se tient à cette porte la nuit et le jour ; il est vêtu de vert ; il est armé d’une épée équivoque, épée sans garde et sans pointe ; mais cette épée sait découvrir l’objet le mieux caché. Pas une voiture n’est exceptée du droit de visite ; la calèche fringante, où se tient la danseuse qu’attend l’Opéra, le coupé de l’agent de change, la berline du pair de France à moitié endormi, la voiture du Roi lui-même, qui plus d’une fois a subi la visite de l’octroi, tout doit obéissance et respect à l’octroi municipal. On se fie au pair de France pour faire les lois du royaume, on ne s’y fie pas pour la viande de boucherie, qu’il pourrait cacher dans sa voiture. Grande leçon d’égalité !
Véritablement, cette entrée d’une si grande ville est magnifique, et elle annonce dignement les merveilles qui vont venir. Déjà vous ne savez plus de quel côté vous devez tourner votre admiration et vos regards. De cette place vous entendez comme un bruit tout-puissant et inspirateur qui s’en va grandissant toujours. Je le crois bien, juste ciel ! ce bruit de fournaise ardente, c’est le bruit que fait Paris tout le jour ; la croyance et le doute, la philosophie et la morale, la poésie et l’industrie, l’ambition et l’amour, la démocratie et la royauté, tous ces éléments si divers bouillonnent tous à la fois. Bruit solennel ! étrange concert au milieu duquel l’esprit français jette les cent mille éclats de sa voix puissante. Mais aussi, si vous pouviez savoir combien, à cet instant du voyage, vous êtes rempli de craintes, de terreurs, d’espérances ; si vous pouviez savoir ce qui s’agite en vous-même, en écoutant ces bruits précurseurs ! Ainsi s’annonce, bien longtemps à l’avance, la cataracte du Niagara : on la reconnaît d’abord à son bruit, à son écume bondissante, bien avant que l’on puisse juger de ce fleuve immense qui semble se précipiter du haut du ciel. Et, de bonne foi, n’est-il pas bien permis d’être inquiet et de trembler quand on se dit à soi-même : Voilà le gouffre ! et quand on songe que l’on va se précipiter tout vivant dans ce bruit, dans ce tumulte, dans cette épouvante, dans cette écume ? Dieu, cependant, nous donne du sang-froid et du courage. Pour peu que nous ayons quelque bon sens et que nous ayons un bon guide, peut-être saurons-nous nous tirer victorieusement de ce grand péril du cœur, de la tête et des sens.
Ainsi je pris tout d’abord ma première leçon de patience. J’attendis, tant qu’on voulut me faire attendre à cette porte ; chacun de ces Parisiens passait devant moi, à mon tour, en se disant tout bas : Voilà un étranger qui est une bonne dupe s’il attend pour passer qu’il n’y ait plus personne devant lui ! Moi, cependant, je mettais à profit cette heure d’attente pour étudier tout à mon aise l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile, depuis sa base, qui se perd dans la terre, jusqu’à son faite, qui se perd dans les cieux.
En général, les illustres habitants de ce plaisant pays de France, comme disait Marie Stuart, qui ont été longtemps des Grecs et des Romains, et qui auront bien de la peine à redevenir tout simplement des Français, professent un grand amour pour les arcs de triomphe. L’Arc-de-Triomphe de Trajan, et les monuments de la même sorte dont l’Italie est chargée encore, ont longtemps empêché les Français de dormir. Nous autres Américains, peuple d’hier, ainsi qu’ils nous appellent, ces frivoles vieillards, nous n’avons pas encore appris à estimer pour leur seule beauté ces masses de pierre, vaines décorations d’une grandeur fastueuse. En France, tout au rebours : plus un monument paraît inutile et mieux on lui fait fête. Le Français aime l’éclat, la majesté, la gloire ; son plus grand plaisir, dans les fêtes publiques, c’est de voir briller et se dissiper dans les airs un beau feu d’artifice, éclair de quelques minutes dont la moindre étincelle sauverait une famille misérable. Mais non ! les plus pauvres gens qui n’ont pas même un morceau de pain pour le repas du soir, accourent à cette joie du salpêtre enflammé‚ sans songer à tout cet argent qui se perd en étoiles éphémères ; au contraire, plus le feu a coûté d’argent, et plus sa majesté le peuple français est contente et satisfaite. Il y a certainement beaucoup plus du François Ier que du Francklin dans ce peuple-là.
L’Arc-de-Triomphe de l’Étoile est, depuis peu d’années qu’on l’a achevé, le plus grand orgueil du Parisien. Le Parisien est plus fier de son Arc-de-Triomphemème que de la Révolution de Juillet, cette œuvre d’enfant et de géant tout à la fois. Il y a juste trente-six ans que l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile a été commencé. Ô France ! que de révolutions inattendues vous contemplent de ces hauteurs ! C’était un grand peuple ce peuple de 1806‚ gouverné par ce grand homme que le monde appelle l’Empereur ! Le dix-neuvième siècle français, qui commençait à peine, était déjà chargé de palmes et de triomphes ; 1806 ! c’est l’année d’Austerlitz‚ cette victoire qui devait décider de l’Empire. Quand donc elle se vit un pied sur la Russie, l’autre pied sur l’Autriche, la France imagina de se donner le hochet glorieux d’un arc de triomphe. Elle voulut surtout que ce fût le plus grand arc du monde entier, comme Austerlitz était la plus grande des victoires. La première pierre de cette montagne fut posée le 15 août 1806. Depuis le commencement de la monarchie, le jour du 15 août avait été consacré à la fête de la Vierge ; mais il était devenu le jour de la Saint-Napoléon, tant la mère de notre Seigneur Jésus-Christ avait mis de bonne grâce à céder son jour de fête à celui qui était l’Empereur.
Et maintenant que me voilà à le contempler du haut en bas, ce monument gigantesque où sont écrites tant de victoires dont il ne reste que le nom‚ où sont représentés tant de héros morts depuis longtemps, enveloppe impérissable d’une gloire passagère, pierre funéraire élevée sur le cercueil de tant d’armées qui ont passé comme passent l’orage et la tempête, il me semble que je vois l’illustre monument peu à peu sortir de terre, et, tantôt joyeux, tantôt voilé de deuil, élever sa tête tour à tour glorieuse et humiliée. Laissez-le s’élever cependant au bruit du canon qui gronde au loin, et pour le reste soyez tranquilles : Austerlitz a posé la première pierre de ce triomphe de pierre, Iéna posera la seconde, Wagram, achèvera cette base indestructible. Mais qu’il aurait fallu de batailles comme Austerlitz‚ comme Iéna et Wagram pour l’achever sans interruption, ce monument dressé par la victoire et que la paix seule put achever ! À peine, en effet, était-il sorti de terre, que voilà quelque chose qui se dérange dans la fortune de la France. Une secousse violente arrive, qui ne renverse pas le monument commencé, mais qui l’arrête. Le vent qui souffle de Waterloo ne veut pas qu’on pose une pierre de plus. À peine le monument est-il assez élevé pour que le vieux soldat qui veille à son sommet puisse voir, les yeux obscurcis par les larmes, de quel côté l’ennemi doit venir !
Alors s’écroule l’Empire. Il tombe, emportant avec lui cet avenir qu’on disait éternel. De cette monarchie fondée pour les siècles, rien ne reste, excepté le souvenir qui s’est relevé plus puissant et plus fort après avoir dormi si longtemps sous le saule de Sainte-Hélène. De l’idée impériale couchée-là, c’est à peine si l’on s’occupe en France, sinon pour s’écrier que cet homme, si grand qu’il était, avait confisqué toutes les libertés de la France. Ainsi les deux colosses qui foulaient le monde de la hauteur où ils étaient placés, l’Empereur et la statue de la Colonne, tombèrent en même temps, celui-ci de son trône, celui-là de l’airain qui lui servait de base ; alors on vit en France (ô calamité des défaites, qui brise même le courage civil, qui fait oublier toutes choses, même la gloire nationale !), alors on vit des Français, attelés comme des bêtes de somme avec des chevaux autrichiens, renverser de sa base immortelle la statue de l’Empereur ! Qui donc empêchait ce bronze terrible de tomber sur ces hommes et sur ces chevaux et de les écraser ? Mais la noble statue en eut pitié sans doute, elle descendit de sa base comme un Empereur détrôné ; elle se coucha dans son linceul triomphal ; elle fut patiente parce qu’elle se sentait éternelle, éternelle comme le drapeau aux trois glorieuses couleurs. Quinze ans elle est restée dans son ombre comme le drapeau tricolore est resté dans sa poussière : mais voilà que par un jour de grand soleil et d’omnipotence populaire, tous deux ont reparu à la lumière plus brillants, plus puissants, plus glorieux que jamais !
Que disons-nous, et qu’arrive-t-il ? D’où vient ce long cri de triomphe ? Pourquoi donc tout ce peuple sort-il en toute hâte de ses maisons ? Certes la bise est dure et violente ; le ciel est noir ; l’hiver a jeté sa glace sur la terre, sur le ciel, partout ! Dites-moi, mon ami, quel est donc le héros si impatiemment attendu dans ces murailles ? Eh ! qui donc peut venir, sinon S.M. elle-même l’Empereur et Roi qui revient dans Paris ? Qui donc peut être attendu avec cette impatience fiévreuse, sinon le hardi soldat que le peuple appelait le Petit Caporal ? Entendez-vous le canon qui gronde ? voyez-vous ces enseignes déployées ? savez-vous que tous les grands hommes de la vieille France se sont levés pour aller au-devant du grand homme qui revient de l’exil ? Vivat ! vivat ! c’est lui, c’est l’empereur Napoléon ! Il revient de ce rocher perdu dans la mer, contre lequel s’est brisée sa fortune. Vive l’Empereur ! Non, il n’était pas mort ; il ramène à la France enthousiaste et passionnée, à la France qui le pleure comme on pleure la gloire, les émotions de la bataille, l’enivrement du triomphe, les joies du combat, les transes infinies de la guerre, tout ce qu’elle aime avec passion, avec délire. Vivat et triomphe !
Et, en effet, c’était bien l’Empereur qui était de retour : non pas tout à fait l’Empereur vivant et tout prêt à reprendre le tronçon de son épée ; mais c’était sa dépouille mortelle, ce noble et impérial trophée auquel la France de 1830 devait penser avant tout autre. C’en est fait, le rocher de Sainte-Hélène a lâché sa proie ; le saule pleureur a jeté ses dernières feuilles sur le cercueil de Sainte-Hélène. Ô destinée ! Charles X, le roi tout-puissant, le roi bien-aimé, celui-là que son peuple entourait de tant d’hommages, que l’Europe proclamait le roi de son choix et de son alliance, Charles X est enterré dans quelque obscur caveau d’une obscure église de l’Allemagne, et voici que le captif de sir Hudson-Lowe est attendu dans les caveaux des Invalides, à côté de Turenne ! L’Empereur ! c’est l’Empereur ! Il revient aux acclamations universelles. Les populations se pressent sur son passage et le reçoivent à genoux. Un prince du sang royal, un noble et beau jeune homme, est allé chercher au-delà des mers cette illustre dépouille, et il la rapporte en véritable chevalier errant dont l’œuvre est accomplie. Sonnez, trompettes ! battez, tambours ! abaisse-toi, arche de gloire ! flottez dans les airs, drapeaux aux trois couleurs reconquis en trois jours ! – Et nous tous d’applaudir, nous, les hommes venus de là-bas, les voyageurs blonds, les flegmatiques, comme on dit en France. À tout prendre, mes frères de New-York, c’est une si bonne chose l’enthousiasme ! L’enthousiasme jette l’auréole sur vos fronts, la chaleur à votre cœur, la pensée à votre tête, l’espérance dans votre âme. L’enthousiasme anime et réchauffe, éclaire et réjouit ; il fait de la France votre patrie ; de cet homme qui passe porté dans sa bière, il fait votre souverain pour l’instant où il passe. Immense et glorieux cortège ! On avait ramassé çà et là, comme on avait pu, les débris glorieux des anciennes armées ; on avait appelé autour du cercueil tous les camarades de l’Empereur qui vivaient encore ; on avait fabriqué d’énormes instruments de cuivre qui jetaient des éclats de triomphe ; à ce noble cortège on voyait le mameluck et le cheval de l’Empereur, deux serviteurs de ses batailles ; à chaque instant c’était une nouvelle surprise, un homme nouveau : dans une voiture, l’homme de Dieu, celui qui avait béni les cendres de ce grand homme que la gloire avait baptisé presque aussitôt que la religion ; dans une autre voiture, deux ou trois maréchaux de France, soldats jadis, princes aujourd’hui. Et enfin venaient, en ordre rangés, les marins de la Belle-Poule, hardis soldats, tout fiers de leur illustre fardeau ; on battait des mains à leur passage ; on se disait leurs travaux, leurs œuvres, leur patience, leur courage ; car au milieu de la mer ils avaient cru que la France et l’Angleterre s’étaient déclaré la guerre, et au premier signal ils étaient tout prêts à s’abîmer dans le gouffre avec leur impériale dépouille. Après ceux-là venait leur digne capitaine, S.A. le prince de Joinville, fier marin, brave soldat, intrépide et fier ; son nom se rattache désormais à cette grande aventure du retour de l’Empereur ! – Et enfin, enfin, quel silence ! que de larmes dans tous les regards ! Voici dans ce triple cercueil, dans ce char couvert de tentures violettes et de drapeaux flottants, au-dessous de ces aigles dont l’aile se déploie d’une façon triomphante, au-dessous de ces trophées d’armes, de cette triple couronne, voici l’Empereur… ou du moins celui qui fut l’empereur Napoléon ! – Cette marche funèbre, que dis-je ? ce cortège triomphal traversa toute la ville au milieu des plus grands témoignages de sympathie et de respect. La ville s’en souvient encore ; les Champs-Élysées et surtout l’Arc-de-Triomphe s’en souviendront toujours.
Mais revenons à notre histoire de tout à l’heure ; c’est l’histoire d’un siècle tout entier.
Quand la Restauration fut venue apporter à la France le repos et la paix, un repos d’un jour, une paix remplie de révolutions et d’émeutes à venir, l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile resta longtemps abandonné et désert ; ruine d’un monument à peine commencé, débris d’une gloire mal éteinte, reliques dédaignées des plus grandes victoires. Mais l’Empire vivait dans ces ruines, mais les clameurs de la Grande Armée se faisaient entendre dans ces arceaux gigantesques ; mais l’aigle, blessé à mort, était venu s’abattre sur ces corniches interrompues ; mais Austerlitz, Iéna, Wagram, murmuraient tout bas, dans ces fondations dont elles étaient la base, leur complainte inarticulée. Il était dangereux de toucher à ces sacrés vestiges. Il était aussi dangereux d’élever le monument de l’Empereur que de l’abattre. D’ailleurs, une fois dressée dans les airs, quel nom inscrire au sommet de cette montagne inutile ? quels symboles placer sur ces pendentifs ? quelles victoires proclamer sur ces pierres éloquentes ? Il n’y avait qu’un nom pour ce monument, il n’y avait qu’une armée pour ces pierres, il n’y avait qu’un drapeau pour couronner dignement ces majestueuses hauteurs : c’était le grand nom impérial, c’était la Grande Armée, c’était le grand drapeau tricolore ! Mais la Restauration tremblait d’horreur et pâlissait d’effroi, rien qu’à entendre parler de ce terrible et redoutable passé.
Si la Restauration avait été assez hardie et assez brave pour ne pas trembler devant la gloire française ; si le roi légitime avait été assez sage pour se mettre à l’abri du manteau impérial de celui-là qui s’était fait Empereur de par le peuple et de par la gloire ; si la fleur-de-lis avait laissé pénétrer dans son innocent calice l’abeille d’or ; si le drapeau blanc avait permis aux deux couleurs, ses sœurs cadettes, de le protéger du double reflet devant lequel a tremblé l’Europe, nul doute qu’aux jours de révolutions cette prudence de la royauté de droit divin n’eût porté des fruits impérissables. L’Empereur, debout sur sa colonne, aurait crié au peuple en fureur : – Respectez la majesté royale qui a respecté ma majesté vaincue ! L’abeille, cachée dans le calice du lis, aurait menacé de l’aiguillon les mains imprudentes qui auraient menacé la noble fleur, pendant que les deux couleurs nationales, unissant leurs efforts, auraient enveloppé le drapeau de saint Louis dans leur draperie de sang et d’azur. Mais non ! le temps présent ne sait pas respecter le passé : le roi qui arrive n’a rien de plus pressé que d’insulter le roi qui s’en va ; le drapeau triomphant écrase de son mépris le drapeau qui tombe. Ces peuples de l’Europe sont ainsi faits : ils se figurent qu’on peut briser l’histoire comme on brise une statue de marbre, qu’on peut abolir le passé comme on efface un tableau à la détrempe. Les gouvernements sont comme les peuples ; ils brisent, ils effacent, ils renversent ; ils ne voient pas, les imprudents, qu’agir ainsi, c’est apprendre aux peuples comment on brise, comment on efface, comment on renverse, et comment l’autorité est la chose du monde la plus passagère, après la gloire.
Ce ne fut donc qu’après s’être affermie autant qu’elle pouvait s’affermir que la Restauration s’enhardit à reprendre en sous-œuvre ce monument commencé par l’Empereur. Avant que la monarchie de Louis XVIII et de Charles X en vint à cet excès d’audace, il fallait certes qu’elle eût fait de grandes conquêtes ; aussi en avait-elle fait de grandes : elle avait rétabli le dogme de la légitimité ; elle avait fait plus, elle avait fait respecter la royauté ; elle avait arrangé trois ou quatre fois, et toujours à son avantage, la Charte qu’elle avait donnée, parlons mieux, qu’elle avait octroyée ; elle avait touché même au droit d’aînesse, ce complément du droit divin, et elle ne désespérait pas de venir un jour à bout de cette loi, qui eût refait un peu de noblesse et beaucoup de clergé ; enfin et bien plus, quand la Restauration osa toucher à l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile, même pour l’achever, elle avait fait de la gloire un hochet, elle avait joué à la bataille, elle avait relevé la royauté chancelante de l’Espagne, elle avait fait de S.A.R. le duc d’Angoulême une manière de Napoléon légitime à la cocarde blanche. Voilà pourtant par quelles illusions et par quels plagiats se perdent les monarchies les mieux établies et les plus bienveillantes !
C’est ainsi que l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile, après avoir été fondé par Napoléon et par la bataille d’Austerlitz, fut continué par le duc d’Angoulême et par la prise du Trocadéro. Les pierres s’élevaient sur les pierres par obéissance, sans plaisir et sans amour. Les maçons obéissaient à l’architecte, l’architecte obéissait au ministre de l’intérieur, rien de plus. Le monument s’élevait simplement, sans façon, sans enthousiasme, et surtout sans orgueil, tout comme s’élèverait une maison bourgeoise. Aucun de ceux qui travaillaient à cette œuvre n’avait foi en son œuvre. On allait au jour le jour, on avançait lentement quand il y avait de l’argent de trop. Ce n’est pas ainsi que construit la victoire ou que construit la croyance religieuse, cette autre victoire. Si les monuments catholiques dont l’Europe est couverte, ces hautes cathédrales qui se perdent dans le ciel et qui sont brodées du haut en bas comme un voile de mariée, avaient été construites par des manœuvres ordinaires, par des maçons à la journée, pas une de ces cathédrales ne serait achevée à l’heure qu’il est ; elles seraient restées interrompues comme la cathédrale de Cologne, ce chef-d’œuvre que toute la puissance catholique ne saurait achever dans ces siècles voltairiens. Mais les ouvriers sublimes qui ont travaillé à ces monuments qu’on disait construits par des anges, n’étaient pas en effet des ouvriers de la terre : c’étaient des manœuvres chrétiens. Leur salaire n’était pas de ce monde ; ils savaient que le père de famille les attendait là-haut après leur journée, pour payer lui-même ceux qui avaient travaillé à sa vigne. Dans les temps de croyance, une cathédrale à élever ce n’était pas un monument de pierre à bâtir : c’était une prière à accomplir. Chaque ouvrier s’attachait, sa vie durant, à un pan de muraille ; et là, sublime anachorète, sublime rêveur, il inscrivait jour par jour sa prière et sa pensée. Il n’obéissait qu’à lui-même et à son génie, son travail était isolé comme sa prière. Tantôt grotesque, tantôt sérieux, aujourd’hui plus haut que le ciel, demain plus bas que l’enfer, plein d’espérances ou de désespoirs, heureux ou malheureux, il laissait sur la pierre les traces vivantes de ses pensées les plus cachées, les mystères les plus voilés de son cœur. Après quoi il mourait un beau jour, heureux et fier d’être enterré au pied de la muraille qu’il avait burinée en l’honneur de Jésus-Christ. Le lendemain, un autre maçon, je veux dire un autre chrétien, prenait la place de ce grand artiste qui était mort. Cette œuvre se transmettait ainsi de génération en génération, comme se transmet un de ces poèmes sans fin auxquels la gloire humaine a toujours un chant nouveau à ajouter.
Or, je ne comprends guère qu’il s’élève un arc de triomphe sans enthousiasme, pas plus que je ne comprends une cathédrale bâtie sans croyance. Quel est le peuple catholique qui élève des cathédrales aujourd’hui ?
Et pourtant, si la Restauration avait pu se douter de ce qui allait venir ! Si elle avait jamais pensé qu’à cet Arc-de-Triomphe étaient attachées les destinées de la royauté suprême de Charles X, et qu’à peine achevé par ses soins, le monument impérial secouerait bien vite toutes ces traces de royauté, et que son front dédaignerait de porter une cocarde blanche, sans doute elle eût cherché quelque remède à ces menaces de l’avenir. En effet, l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile, fidèle à son maître et à son drapeau, à force de patience, cette patience qui appartient à l’éternité, devait finir par atteindre le point du ciel où il voulait cacher sa tête ; mais arrivé à ces hauteurs, il n’a plus voulu d’autre nom que le nom de l’Empereur, d’autre drapeau que le drapeau de l’Empereur. Du haut de ce couronnement de pierres, l’idée impériale s’est relevée et elle a applaudi aux colères des Trois Jours. Cette fois l’heure du réveil était venue, et l’heure du retour avait sonné ; on eût dit que l’Empereur se tenait là-haut comme la sœur Anne du conte des fées, qui regarde de tous ses yeux pour savoir si elle ne verra rien venir. Depuis le jour où la Restauration fut forcée de reprendre le chemin de l’exil, ce qu’on appelait alors le triomphe du Trocadéro est redevenu tout à fait le triomphe d’Austerlitz : prodigieux colosse de gloire, non seulement élevé au grand homme, mais à un grand peuple ; non seulement au grand capitaine, mais à la grande armée. En le considérant avec tout le respect qu’il mérite, en l’analysant avec l’enthousiasme qu’il inspire, en pénétrant son sens sublime, on comprend à la fin son utilité et sa signification : c’est un monument religieux tout comme la vieille cathédrale parisienne ; c’est l’autel de la gloire, tout comme Notre-Dame est l’autel du Tout-Puissant. Et comme il faut toujours qu’en France les œuvres les plus complètes restent inachevées par un certain côté, vous remarquerez, je vous prie, que l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile attend encore à son sommet quelque chef-d’œuvre de marbre, de pierre ou de bronze qui le couronne dignement. Une belle statue, de soixante pieds de hauteur, conviendrait à merveille à ce monument digne des géants. Mais quelle statue placer si haut ? À quel homme est réservé un pareil honneur ? Si vous y mettez l’empereur Napoléon, n’est-ce pas, à la fin du compte, pousser trop loin cette admiration posthume ? Si vous y placez quelque figure allégorique, la France, par exemple, ou la Victoire, n’est-il pas à craindre que l’allégorie ne paraisse froide et incomplète ? Ou bien, attendrez-vous que l’avenir vous envoie tout exprès un héros digne de ce rare honneur ? Grandes questions auxquelles on ne songe guère dans ce pays, où tout se fait au jour le jour. Certes, si l’idée chrétienne était vivante encore dans ce peuple de France, il n’irait pas chercher si loin ses images ; il placerait sur cette base immortelle quelque belle figure de la Jérusalem céleste, et ainsi seraient calmées toutes les ambitions et toutes les flatteries qui s’agitent, pour y prendre leur place d’un siècle, autour de cet admirable piédestal.
Vous dire toute la beauté et toute la nouveauté de cette première soirée parisienne, je ne saurais vous le dire. J’étais étranger, et il me semblait que je rentrais dans ma patrie. J’étais un nouveau venu, et il me semblait que je n’avais jamais quitté cette noble ville qui passait devant moi dans tout son éclat, dans tous ses mystères et dans tous ses bonheurs. L’air était pur et vif ; les voitures roulaient doucement sur un sable fin et doux comme le gazon. Ceux qui étaient à pied n’avaient pas l’air moins heureux et moins calmes que ceux qui étaient en voiture. C’était une longue fête dans cette longue avenue. Autrefois l’avenue était déserte, aujourd’hui elle est couverte de jolies petites maisons toutes neuves, palais d’hier bâtis entre quatre pieds de jardin. À ma droite s’élevait l’ancien jardin du fermier-général Beaujon. Beaujon était un de ces financiers fabuleux du siècle passé, hommes sans talent et sans coup d’œil, enrichis par quelque hasard d’antichambre, ruinés par un autre hasard ; sangsues du peuple que dévoraient à leur tour les grands seigneurs ; voleurs ici, volés là-bas ; gens sans autre industrie que l’usure et le prêt sur gages ; mais le gage qu’on leur prêtait, c’était le pain du pauvre, c’était la sueur du misérable ; et sur de pareils gages, ils prêtaient des millions.
Ce vaste jardin où s’élevait un hôtel de marbre et d’or, il a pourtant appartenu à cet esclave des fermes et gabelles ! Ce Beaujon est mort insolvable et presque aussi pauvre que le grand Corneille ; mais avant de se ruiner comme il s’était enrichi, avant de mourir seul et abandonné, il avait fondé l’hôpital qui porte son nom : belle et sainte expiation de sa scandaleuse fortune. Une fois disparu de ce monde où il avait fait tant de bruit, les jardins du fermier-général Beaujon furent longtemps le rendez-vous du peuple, qui y venait prendre ses ébats, sans songer par quelles tortures le peuple précédent les avait payés. Après le peuple sont venus d’autres spéculateurs moins innocents qui ont coupé ces arbres, détruit ces fleurs, ravagé ces gazons, dispersé les oiseaux qui chantaient, et ils ont bâti une ville sur toutes ces ruines ! La ville se peuple peu à peu, elle est charmante ; jetez-y quelques beaux noms contemporains, envoyez-y quelques belles et jeunes femmes, l’honneur et l’esprit de la conversation parisienne, et la fortune de cette ville ne sera plus à faire. En attendant, les Amphions qui ont bâti ces maisons ont inscrit en tête de la principale avenue le grand nom poétique de cet âge : – Châteaubriand.
Tout au bout de l’avenue, au rond-point des Champs-Élysées, après avoir dépassé plusieurs théâtres en plein vent où des joueurs de cor, des chanteurs, des singes, des comédiens ambulants, chargent l’air de leurs modulations vagabondes et de leurs gambades infatigables, vous rencontrez, caché sous les arbres, un théâtre tout orné de sculptures élégantes. Ce théâtre est placé entre deux jets d’eau qui ne se taisent qu’à minuit. De nombreux candélabres projettent une vive clarté sur ces murailles. Quoi ! un théâtre sous ces beaux arbres, à cette belle place de la promenade de chaque soir ! Rien n’est plus vrai. Quand le Parisien veut occuper dignement quelque bel emplacement de sa ville bien-aimée, aussitôt il vous y construit un théâtre. Le Parisien n’a jamais assez de théâtres, tout comme l’Italie n’a jamais assez d’églises et de chapelles. Rassurez-vous cependant, le théâtre des Champs-Élysées est la plus innocente de toutes les entreprises dramatiques : là, point de couplets grivois, point d’allusions hasardées, point de dialogues obscènes, point de ces grands crimes si chers aux amateurs de la grosse terreur ; mais tout simplement des chevaux qui courent au galop, des écuyers agiles, des écuyères alertes qui dansent sur le dos du coursier écumant, tout comme dansait mademoiselle Taglioni sur ce fil d’or et de soie invisible à tous les yeux profanes : tel est donc ce théâtre innocent où se passent en été de belles soirées presque en plein air, dans une enceinte splendide, aux bruits d’une musique qui n’est pas sans mélodie, pendant que Franconi, le roi détrôné de ses domaines de l’équitation, préside encore à ces rudes et périlleux exercices dont il a été le Molière et le Pierre Corneille tout à la fois.
Maintenant que vous avez laissé le Cirque à votre droite, arrêtez-vous, s’il vous plaît, devant un roi détrôné, mais détrôné après un règne de trois mille années ; arrêtez-vous devant cet étranger superbe qui a dominé de toute sa hauteur les plaines du passé, conquête orientale, victoire superbe, mais aussi superbe défaite. Voilà comment il faut tomber lorsqu’on tombe, voilà comment il faut se rendre quand on se rend, voilà comment il faut mourir quand on meurt. Mais quelle chute noble et glorieuse ! Tomber là-bas quand son royaume n’est plus qu’un désert, pour se relever ici sur la tête de trente-deux millions d’hommes ! Se rendre et s’avouer vaincu, il est vrai, mais ne se rendre qu’à la France, qui va vous chercher en triomphe à travers mille périls et mille fatigues ; mourir après une vie de trois mille ans, la vie des Pyramides, mais pour renaître d’une vie de trois mille années encore dans la grande Babylone moderne, et pour voir passer et mourir à ses pieds, comme des nuées de fourmis, tant de générations victorieuses et éloquentes, c’est beau, cela ! C’est beau, c’est être plus grand qu’Alexandre, plus heureux que Napoléon.
Que si vous demandez quel est le nom de ce héros ainsi tombé, quelle fut la fortune de ce noble exilé, de quel trône il est descendu, ce modèle à jamais digne d’envie de tous les rois détrônés ; je vous répondrai : c’est l’obélisque de Luxor.
Méhémet-Ali, le régénérateur viager, ou, si vous aimez mieux, le premier homme d’affaires de l’Égypte, cet homme fabuleux qui, dernièrement encore, a pensé allumer l’incendie universel, ce Barbare qui a tous les instincts des grands politiques, dans un jour de ces générosités peu coûteuses si naturelles aux maîtres de l’Orient, avait donné au roi de France les deux charmants obélisques de Luxor, Luxor, ce faubourg de Thèbes, tout comme les obélisques ne sont que les sentinelles avancées des Pyramides Le roi Charles X, de son côté, pour répondre convenablement à la politesse du pacha, envoya un vaisseau qui devait ramener au roi de France, en temps et lieu, ce singulier présent. Il y a un proverbe français qui dit : Les petits présents entretiennent l’amitié ; le pacha savait le proverbe, et il avait traité les Français en conséquence. Pourtant le présent n’était pas à dédaigner.
Figurez-vous, en effet, un admirable bloc de pierre, d’une charmante couleur rouge, de quatre-vingts pieds de haut et tout d’une pièce. Cette pierre est effilée, et si légère et si fine, que les anciens, qui avaient de l’esprit presque autant que les Français, l’appelaient l’Aiguille de Cléopâtre. On dirait que cette jolie pierre est transparente ; elle brille, elle éclate ; elle est chargée de cent mille caractères hiéroglyphiques qui feront longtemps le tourment des Champollions présents et à venir. Cette longue pierre, il a fallu la chercher dans le désert, il a fallu la descendre de sa base presque éternelle ; là elle se tenait debout par son propre poids, là elle était restée immobile trois mille ans. Une fois tombée, il fallut creuser un canal qui menât le Luxor à la mer ; mais une fois à la mer, que de soins, que de peines, que d’efforts, que de périls ! Si le vaisseau avait sombré, l’obélisque était perdu à jamais !
Contrairement à un autre proverbe français : Les hommes se rencontrent et non les montagnes, la montagne de l’Orient est arrivée enfin dans les murs de Paris étonné. Longtemps Paris attendit l’obélisque avec cette avide curiosité d’enfant qui fait le bonheur de la grande ville. Tout d’un coup, un beau jour, on vit arriver dans la Seine un long vaisseau, ou plutôt une longue bière d’une couleur lugubre. C’était l’obélisque dans son enveloppe mortelle. À cette vue l’étonnement fut général ; qui est celui-là et d’où vient-il ? Les Parisiens descendirent en foule dans cette carène démâtée, et, à travers les planches disjointes‚ ils regardèrent cet étranger immobile et muet. Après le peuple, les savants accoururent ; même il y en eut un des plus savants qui tomba dans la rivière et qui se fût noyé sans l’assistance d’un brave marin de la mer, qui était venu d’Égypte dans ces eaux douces et peu profondes, et qui s’y trouvait presque aussi étranger que l’obélisque. Hélas ! après avoir sauvé un savant qui ne savait pas nager, et le même soir, ce malheureux marin tombe du haut de son canot dans cette mare qu’on appelle la Seine, et, chose horrible à dire, il se noie dans cette boue aquatique ! Venir de si loin, arracher l’aiguille de Cléopâtre de sa base, l’amener là dans ce trou, et mourir dans ce verre d’eau : quelle mort !
Pour remettre l’obélisque de ses fatigues, on le coucha mollement dans la vase de la rivière de Seine. Là, il passa l’hiver sous la glace, regrettant sans doute ses sables et son soleil ; à la fin parut le soleil. On avait attendu le soleil français pour que la noble pierre pût rêver qu’enfin elle allait revoir l’ombre affaiblie des déserts de l’Orient. Dès le matin, le bon peuple de France était sur pied, fort empêché de savoir comment donc serait placée sur sa base de granit, cette frêle et fine montagne !
À Paris, tout ce qui est un spectacle gratis attire et fascine la multitude. Cette condition : pour rien, vaut tout au moins : le sans dot !