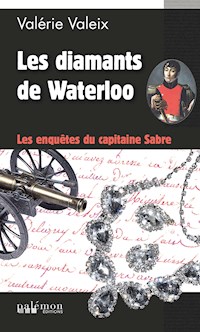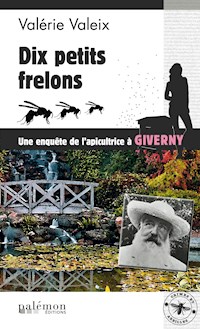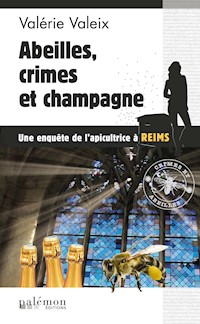6,99 €
Mehr erfahren.
Cap Sizun, été 1974 : Rozen Le Bihan quitte la ferme familiale au volant de sa coccinelle bleue et disparaît. Printemps 2017 : Audrey et Antoine sont en vacances à La Quincaillerie d’Audierne. Ils se rendent chez Gabriel Le Bihan, apiculteur et photographe renommé, connu sous le pseudonyme de Gargamiel, qui souhaite vendre la ferme parentale et propose à Audrey ses colonies « Noires du Cap Sizun ». Tandis que celle-ci visite le rucher, un mur de bois s’effondre dans la grande étable, révélant une Coccinelle bleue, dont le coffre recèle un squelette de femme. Serait-ce celui de Rozen Le Bihan ? Alors qu’Antoine est nommé directeur d’enquête de ce « cold case », Audrey se lance dans des investigations psycho-généalogiques au côté de Jean Failler, célèbre auteur breton de romans policiers et ami du fidèle Lebel. À eux trois, ils feront ressortir bien des fantômes transgénérationnels…
Dans cette enquête originale, Valérie Valeix intègre avec malice Jean Failler comme personnage à part entière. Elle mêle habilement intrigue passionnante, histoire, âme bretonne et paysages à couper le souffle, parsemant le tout d’humour et d’un zeste de romance. Les amateurs de la série Mary Lester apprécieront sans aucun doute !
À PROPOS DE L'AUTEURE
Intéressée depuis toujours par les abeilles (son arrière-grand-père était apiculteur en Auvergne),
Valérie Valeix, née en 1971 dans les Yvelines, fonde les Ruchers d’Audrey lors d’un déménagement en Normandie. Elle s’engage alors dans le combat contre l’effondrement des colonies, la malbouffe et dans l’apithérapie. Son amie et romancière favorite Juliette Benzoni, reine du roman historique malheureusement décédée en 2016, a encouragé ses premiers pas dans l’écriture. Auteure de deux séries policières, l’une apicole, l’autre historique, Valérie a reçu en 2021 le Prix du Roman Napoléon Ier pour son ouvrage
Les diamants de Waterloo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.
Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
Remerciements
Je remercie Alain Cerri alias Grand Correcteur impérial qui a gentiment accepté de s’engager sur un champ de bataille éloigné de l’Histoire, celui de la défense de l’environnement.
Mes remerciements vont aussi à :
Jean Failler, des éditions du Palémon, pour sa préface et pour son accord d’entrer dans ce roman afin de donner la réplique à l’apicultrice la plus célèbre de France !
Patrick Mothes, colonel de gendarmerie à la retraite.
Véronique Vogt et Jean-Christophe Lagarde de laQuincaillerie.
Andrée Chapalain, pour sa grande connaissance l’histoire d’Audierne et de ses environs.
Thierry Gorce, dentiste à la retraite.
Danielle Thiery, pour sa « lecture judicaire et judicieuse » ! Merci mon amie.
Pour toi, Audrey, ma fille chérie.
PRÉFACE
La vie est décidément pleine d’imprévu et c’est ce qui en fait le charme. Un événement en entraîne un autre qui, lui-même, mène à un second puis à un troisième, la chaîne paraissant sans fin.
Ainsi suis-je devenu successivement chômeur, puis écrivain, puis éditeur de mes ouvrages et enfin de ceux d’autres auteurs venus me rejoindre aux éditions du Palémon.
Je ne me doutais pas qu’un jour j’éditerais les œuvres d’une apicultrice, en l’occurrence, Valérie Valeix.
Après tout, il y eut des précédents illustres car on dit que le grand Sherlock Holmes se serait retiré dans sa campagne pour y vivre sereinement avec ses abeilles.
Valérie, elle, se lança dans ce beau métier par tradition familiale, puisque son arrière-grand-père le pratiquait en Auvergne. Elle transporta ses ruches en Normandie.
Il lui fallut alors combattre les ennemis de ses petites ouvrières ailées, le méchant frelon asiatique et surtout, plus insidieux, les traitements agressifs de l’agriculture intensive.
Mais Valérie avait une autre passion, l’écriture, ce qui l’amena à contacter les éditions du Palémon. Heureuse surprise, nous découvrîmes alors avec bonheur que l’apicultrice possédait un joli brin de plume et que les intrigues policières n’avaient pas de secret pour elle, qu’elle connaissait aussi l’Histoire et que l’épopée napoléonienne l’inspirait tout particulièrement, ce qui lui valut le très convoité Prix du Roman Napoléon Ier (au passage, on notera que l’Empereur avait choisi l’abeille comme un symbole de ses armoiries… il n’y a pas de hasard).
Comme Valérie est dotée de nombreux talents et d’une capacité de travail peu commune (peut-être transmise par ses vaillantes petites ouvrières ailées), elle nous entraîne aujourd’hui pour une enquête dans le Cap Sizun où son héroïne Audrey est venue récupérer quelques ruches de « Noires », une variété propre au Cap.
C’est en visitant ce rucher qu’elle va faire, par le plus grand des hasards, une macabre découverte. A-t-elle mis la main sur le cadavre de Rozenn Le Bihan, jeune femme de Lervily, en Audierne, disparue depuis quarante ans ? Comment ce corps s’est-il trouvé dans le coffre d’une coccinelle dissimulée derrière un tas de bois de cette vieille ferme ?
Valérie m’a fait le très grand honneur de m’impliquer dans cette enquête en tant qu’auteur de romans policiers qui va apporter son point de vue à Audrey dans ses investigations. Je me suis prêté au jeu avec grand plaisir ! Enquête ardue s’il en est, au cœur des merveilleux paysages du Cap Sizun… Merci à elle pour cette belle collaboration !
JEAN FAILLER
Première partie : intrigue au Cap-Sizun
Chapitre 1 : « Rien qu’une larme dans mes yeux »
Audierne, lundi 15 juillet 1974.
Une minuscule bulle verte naquit entre les lèvres vermillon. Puis elle enfla jusqu’à prendre la taille d’une balle de ping-pong avant d’éclater et de répandre ses lambeaux de gomme au parfum de chlorophylle artificielle sur le nez et les joues de la jeune femme. Elle haussa son visage au niveau du rétroviseur intérieur de sa Volkswagen Coccinelle bleu ciel récemment achetée par son père. Le permis, la voiture et la majorité avancée, ah ! que la vie allait être douce… Enfin…
D’un index à l’ongle carminé, elle ramena les bribes de chewing-gum dans sa bouche. Tout en poursuivant bruyamment sa mastication, elle vérifia que son rimmel n’avait pas coulé, fit des grimaces pour ôter une minuscule trace de crayon au bas de sa paupière droite. Tout devait être parfait pour retrouver Romain. Abel de son vrai nom, mais il préférait Romain. Abel, c’était pour sa femme, mais plus pour longtemps, il l’avait promis à Rozennn. « Ma petite coccinelle » comme il aimait l’appeler.
— Putain, j’suis majeure ! J’suis majeure, se répéta avec délectation Rozenn Le Bihan, âgée de tout juste dix-huit ans.
Depuis le 5 juillet dernier en effet, deux millions et demi de jeunes gens n’auraient plus à attendre les vingt et un ans réglementaires pour disposer d’eux-mêmes, une volonté du nouveau président, Valéry Giscard d’Estaing, qui avait enthousiasmé la jeune génération et semé la zizanie dans les familles. Celle de Rozenn, des fermiers besogneux habitant près de Lervily en Audierne et ayant peu fréquenté l’école, n’y avait pas échappé.
— C’est pas ça qui va changer les choses ! avait braillé la mère en apprenant la nouvelle sur la première chaîne du poste de télévision en noir et blanc. Si j’ai b’soin de t’calotter, j’vais pas m’gêner… Majeur, pfut, j’t’en foutrai ; tu leur pinces le nez, y leur pisse du lait. Giscard, penn kloug1 !
Son père était plus nuancé.
— La majorité, la majorité… T’en as plein la bouche, mais est-ce que c’est ça qui va t’faire manger ? T’as même pas d’métier…
— J’ai quand même mon bac…
— La belle affaire, est-ce qu’on a b’soin d’un diplôme pour torcher l’cul des vaches ou ramasser le guano ? avait ricané la mère quasi illettrée.
— Jamais j’torcherai le cul des vaches, encore moins celui des mouettes !
— Qu’est-ce que tu vas faire alors ? La poufiasse ?
— Demain je passe mon permis et je l’aurai…
Sa mère, qui ne conduisait pas, avait haussé les épaules, son père avait rétorqué :
— Évidemment que tu l’auras, t’as toujours conduit l’tracteur et la camionnette, comme tous les gosses d’agriculteurs. Et ensuite, hein ?
— Ensuite, on verra.
— C’est pas une réponse, ça ! Si au moins tu voulais te marier, y’en a plein qui t’voudraient bien…
Car la jeune Rozenn, que son amoureux avait qualifiée de sosie de Marlène Jobert, était d’une beauté à couper le souffle avec ses courtes mèches de feu, ses taches de rousseur, ses yeux aigue-marine dans un ovale parfait et sa moue boudeuse. Et cela, alors que ses deux parents étaient d’une laideur remarquable.
Sa mère, Soizic, était un grand échalas au visage osseux orné de deux arcades sourcilières proéminentes telles que devaient en arborer les hommes de Néandertal. Son père, Ronan, un petit gros qui faisait la moitié de la taille de sa femme, avait des cheveux noirs et gras qu’il peignait consciencieusement sur le côté, comme VGE, pour masquer sa calvitie.
Rozenn tourna le bouton de l’autoradio ; après quelques cracouillements, la voix puissante de Mike Brant retentit dans l’habitacle :
Rien qu’une larme dans tes yeux
C’est toujours ta seule réponse
Quand je te dis qu’il vaudrait mieux
Ne plus se revoir nous deux.
Le cœur de Rozenn se serra à cette dernière phrase ; et si Romain ne venait pas… Si finalement il avait décidé de rester avec sa femme ? Mais non quelle idée, bien sûr qu’il allait venir, c’était un homme de parole.
J’étais certain cette fois
Que rien ne me retiendrait
On se trompe quelques fois
Une larme a tout changé
Bien que Rozenn fît tout pour oublier cette conversation avec ses parents, celle-ci lui revint en mémoire, quand son père avait remis le mariage sur le tapis.
— Le fils Penneg, il m’déplairait pas…
Rozenn avait gonflé les joues d’agacement. Comme à chaque fois qu’il était question de son avenir, son père se mettait à chanter les louanges de Malo Penneg, héritier d’une des plus grosses maisons de produits de la mer, Les Viviers Penneg. Leur unique concurrent était le vivier de Jacques Le Gall qui, dix ans plus tôt, avait racheté la maison Stoop, au grand dam des Penneg.
— La langouste, ça marche bien et le homard aussi… Mieux que les vaches, j’peux t’l’assurer. T’as vu leur baraque de Primelin, c’est un manoir. Sans parler de l’appartement de Nice… En plus ils t’aiment bien, les Penneg, la preuve, c’est qu’ils t’ont invitée à Pâques là-bas… Tu serais pas bien à faire la navette entre l’ouest et le sud ? C’est une belle occasion comme beaucoup d’femmes en rêveraient. D’autant que Malo te comble de cadeaux…
C’était vrai, le jeune Penneg ne manquait jamais de lui rapporter quelque chose, notamment quand il revenait de Nice. Dernier présent en date, un ravissant sac pochette en perles de plastique rose dernier cri.
— C’est pas vrai qu’il la gâte Malo, mam ?
La mère hocha la tête.
— Bien trop… J’ai pas eu cette chance, au lieu de ça, j’ai ramassé la merde des vaches !
— Oh ça va, t’as pas fait qu’ramasser la merde des vaches, t’as passé une bonne part de ton temps à t’occuper de Malo quand sa mère est morte.
— Fallait bien, l’avait à peine cinq ans.
— Pourquoi que l’père Penneg, il t’a choisie, toi, pas maternelle pour deux sous ?
— J’vais t’en coller une bonne, tu vas voir si j’suis pas maternelle ! Fri Kreien2…
— Ne parle pas comme ça à ta mère, intervint le père en tentant de faire redescendre la pression entre les deux femmes.
— N’empêche, le bel Armel, pourquoi qu’il a pris maman quand il en avait treize à la douzaine dans sa boutique qui d’mandaient qu’ça d’venir s’occuper d’son mioche ?
— Tu le sais bien, pourquoi.
— Non j’le sais pas.
— Parce que… Parce que… je lui ai rendu un service pendant la guerre, voilà…
— Quel service ?
— Oh, c’est loin tout ça. Bon alors, le fils Penneg, je parle à son père oui ou non ?
— Ça pue !
Soizic s’avança vers Rozenn la main ouverte dans l’intention manifeste de la lui appliquer sur la joue.
— Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ?
La jeune femme s’esquiva au fond de la grande salle à manger aux murs sans couleur définie et au plafond crépi de chiures de mouches, du moins celles qui avaient échappé au « collant » suspendu au lustre en opaline à fleurs orange.
— J’dis que le vivier, ça pue le poiscaille jusque dans les bureaux, même Malo, il pue !
— Parce que les vaches, ça pue pas peut-être ? Oh, la garce, elle va l’avoir sa baffe !
— Du calme, mamm…
— Non, mais tu l’entends, tad ?
— Oui, j’entends, et elle aussi elle nous entend, et elle va se montrer gentille…
La voix de son père s’était faite doucereuse :
— Tu sais, maître Laffargue, le notaire, il vend sa Coccinelle… En plus, elle a l’autoradio. Il m’la laisse pour un bon prix, alors si tu veux que j’te la prête de temps à autre après l’permis, faut prouver que t’as d’bonnes dispositions…
Rozenn avait étouffé un soupir ; Malo, il n’était pas vilain garçon. Quoique saillants, il avait d’assez beaux yeux bleus mais il était très timide, sans doute était-ce dû à son bégaiement, il semblait aussi très soumis à son père, Armel Penneg, veuf et grand séducteur devant l’Éternel, surnommé par les Audiernois « Le bel Armel » pour sa prestance et ses beaux costumes de chez Brummel.
Aucune femme travaillant dans son entreprise n’avait résisté à ses avances. D’autant que sa situation d’homme disponible et aisé aiguisait bien des appétits. Et ce n’était pas pour faire plaisir à son fils qu’il avait accepté d’emmener Rozenn à Nice, mais bien dans l’intention d’en faire sa maîtresse. La belle rousse aux traits de nymphe qui semblait d’accord au premier abord – Armel Penneg en était sûr – s’était soudain montrée réfractaire. Il n’avait compris la raison que la veille de leur retour pour Audierne quand un coup de klaxon avait précipité Rozenn dans les escaliers de « L’Amiral », tout premier immeuble du complexe Marina Baie des Anges, un ensemble de bâtiments en forme de bateau au pied de la plage. Armel Penneg y avait acquis le premier appartement deux ans plus tôt, en 1972.
Au bas de « L’Amiral » l’attendait ce photographe qui avait couvert le mariage d’amis niçois de Penneg. Cet opérateur avait fait jaser tous les invités : c’était un repris de justice qui avait tenté d’assassiner de Gaulle, du moins était-ce la renommée qui l’avait précédé. Mais il était aussi l’ami de hautes personnalités de Nice, ce qui expliquait sa protection. Car ce photographe aux traits taillés à coups de serpe et à la réputation sulfureuse n’était autre qu’Abel Santini dit « Romain ». Et entre Rozenn et l’ancien bandit au regard libertin, le coup de foudre avait été immédiat. Il en allait de même de leur complicité, « Romain » débarquant à Brest huit jours après leur rencontre et faisant de Rozenn une femme. Ce soir-là, il lui avait promis de l’emmener vivre avec lui.
« Où ? » et « comment ? » étaient deux questions que Rozenn n’avait pas posées. Elle n’avait rien demandé non plus au sujet de son épouse, « Carla », infirmière possédant son propre cabinet à Nice. Romain pourvoirait à tout cela, il prendrait soin d’elle. Ne lui avait-il pas dit qu’il en avait plus qu’assez de son magasin de photos ; les mariages, certes, ça rapportait, mais c’était d’un ennui… Même l’appartement au-dessus, il ne le supportait plus. Il préférait de loin sa bergerie dans l’arrière-pays. Rozenn avait compris que la vie à deux ne serait certainement pas parisienne, Romain privilégiant les endroits sauvages, la nature, les grands espaces. Mais avec le soleil au rendez-vous toute l’année et les boutiques de Nice à deux pas, cela serait tolérable.
Lorsqu’il avait eu fini de lui faire l’amour dans la chambre de l’hôtel Continental à Brest, il avait déclaré en lui caressant les cheveux :
— Tu es trop belle pour saler le poisson…
Les paroles de Romain faisaient étrangement écho aux pensées de Rozenn et elle avait souri. Elle ne s’était jamais sentie attirée par la vie de « patronne de vivier ». Elle ne s’était jamais non plus sentie à sa place dans sa propre famille. Sa mère ne lui avait pas donné d’affection, une fille, lui avait-elle répété, n’en mérite pas quand elle prend la place du fils attendu. Ou celle de l’enfant disparu…
En revanche, cette femme sèche et revêche s’était toujours montrée attentionnée avec Malo. Sans doute avait-il remplacé le fils tant désiré. Il n’empêche qu’une telle révélation avait attisé le feu entre la mère et la fille d’autant que Rozenn grandissait en beauté. Soizic Le Bihan était alors devenue encore plus agressive. Vers l’âge de douze ans, elle avait même tenté de la défigurer en lui appliquant le fer à repasser chaud sur une joue. La jeune fille avait hurlé de douleur et s’était enfuie chez sa Mamm-gozh. Pour réduire sa contrition et empêcher la formation d’une cloque, la vieille dame avait étalé sur sa peau brûlée une bonne couche de miel qu’elle avait ensuite protégée d’une compresse tenue par deux pansements. Mamm-gozh avait accompagné ses soins d’un chapelet d’injures bretonnes à l’encontre de Soizic Le Bihan, sa belle-fille.
— Louka, teileg, penn boultouz, gwiz, jamais compris c’que ton père lui avait trouvé d’autant que c’était une fille et une sœur de miliciens… et khaz gleb3 avec ça !
Rozenn aimait beaucoup Mamm-gozh Maria qui habitait une petite maison non loin du sémaphore. L’été, elle la trouvait près de sa cheminée à ravauder ou à faire des krampouezh, l’été dans ses ruches, à peine cinq pour suffire à sa consommation personnelle et revendre quelques pots sur le marché d’Audierne avec les œufs roux de sa douzaine de poules grises et blanches, des Coucou de Rennes.
Mamm-gozh était l’une des dernières à posséder cette race abandonnée par la plupart des éleveurs bretons car longue en croissance. Mais Mammgozh était aussi une solide Bretonne à la coiffe brodée immaculée vissée sur son crâne aux cheveux d’argent. Respectée, nul ne se serait avisé de lui en remontrer, pas même Soizic Le Bihan. Seul refuge et unique amie de Rozenn, elle ne s’était pas réveillée au matin de Noël 1970. La jeune fille avait pleuré toutes les larmes de son corps tandis que sa mère avait conclu « Bon débarras ». La maison de Maria avait été vendue, une partie de la somme avait servi à l’achat d’une télévision qui faisait saliver tous les voisins à deux kilomètres à la ronde. Les poules mises à la casserole, le père avait récupéré les ruches, et les avait même fait prospérer. Maintenant, il y en avait une douzaine au fond du jardin, de la Noire de la pointe du Raz qui produisait un miel crémeux aux saveurs de trèfle, bruyère, ronce et une pointe de châtaignier.
Au retour de chez Mamm-gozh, Rozenn avait pris une raclée mémorable de la part de son père pour la punir de les avoir fait s’inquiéter. Sur le geste de la mère et sur la joue encore enflée, pas un mot.
Romain, à qui Rozenn s’était confiée sur cette affaire lors de leur moment intime au Continental, l’avait consolée et lui avait promis que tout cela appartiendrait sous peu au passé.
— J’ai un plan, avait-il dit en brandissant un livre de poche dont le titre était Tous à l’égout de Robert Pollock.
Rozenn ne lisait pas, il n’y avait jamais eu de livres à la maison, pas même le journal. « De la distraction de riches », disait sa mère. Ce qui n’empêchait en rien celle-ci, une fois ses occupations terminées, de se planter devant la télé et ses émissions favorites Aujourd’hui Madame et la série Aux frontières du possible.
— Tout est là-dedans, avait dit Romain.
— Tout quoi ? avait demandé Rozenn.
— Avec ça, je vais te sortir de ta ferme où personne n’a su reconnaître ta valeur. À nous deux la belle vie, on la mérite.
— Fais voir ton livre…
— Non…
— Allez, donne-le-moi, j’en ai jamais eu…
Il avait souri et dans un baiser avait jeté le livre de l’autre côté du lit.
Elle devrait seulement patienter jusqu’à leur départ fixé pour le 15 juillet. Rozenn n’aurait qu’à dire qu’elle allait chez Malo, ils ne lui refuseraient pas d’aller voir un ami.
Non ils ne le lui avaient pas refusé et même sa mère n’avait émis aucune recommandation d’usage :
— Sois là pour dîner, fais attention…
Soizic avait tourné les talons pour se rendre à l’étable. Rozenn en avait été attristée malgré tout. Voilà le seul souvenir qu’elle garderait de sa mère. Une grimace et un regard mauvais. Quand la jeune fille avait vu son père monter dans sa 4L break blanche, – il lui avait adressé un petit signe en partant –, elle avait couru jusqu’à sa chambre faire son baluchon. Elle n’emporterait pas grand-chose : son jean « pattes d’eph », une chemise à carreaux et un pull beige. Elle avait hésité à prendre « Lulu », un petit ours bon marché en peluche offert par Mamm-gozh pour ses cinq ans. Rozenn l’avait saisi, serré contre son visage, embrassé, puis l’avait reposé sur son oreiller en lui disant « Adieu ». Il appartenait à sa vie d’avant, celle dont elle ne voulait plus entendre parler et il n’y avait pas de place pour lui dans sa nouvelle existence.
Elle avait jeté le baluchon sur la banquette arrière de sa voiture puis elle avait pris la route d’Audierne. Il était un peu plus de seize heures lorsqu’elle avait débarqué sur la place de la République.
Elle se gara sur le petit parking sur le port. La mer d’un bleu intense paraissait épouser le ciel inondé de soleil. Elle voulait revoir une dernière fois Audierne.
Il faisait un temps superbe, les femmes dans leurs jupes courtes de couleurs vives ressemblaient à des fleurs évoluant sur les quais. Un vent léger et salé comme il y en a toujours en bord de mer faisait voyager des confettis multicolores, souvenirs du bal du 14 juillet, deux jours plutôt. Certains volaient même jusque sur le pont des bateaux. Çà et là des affiches, à demi arrachées pour certaines, annonçaient le bal populaire du 14 juillet avec feu d’artifice sans oublier la course en sac, événement auquel Rozenn ne s’était pas rendue, trop occupée à songer à Romain.
Tout désormais lui semblait laid, commun, médiocre… « Rien de pire que la médiocrité », lui avait répété Romain plusieurs fois et même dans ses lettres qu’il adressait chez Malo, confident qui désapprouvait sa liaison avec cette « fripouille ».
Malo. Rozenn songea soudain qu’elle ne lui avait pas non plus dit « Au revoir ».
Elle lui écrirait… plus tard. Et puis ils se reverraient à Nice.
Rozenn poussa un énorme soupir, puis elle fit démarrer la Coccinelle et quitta Audierne par le quai Anatole-France pour passer devant son école, seul endroit où elle avait trouvé du réconfort enfant. Elle sentit son cœur se serrer, il était grand temps d’aller retrouver Romain à l’hôtel de la Ville d’Ys au creux de la baie des Trépassés. Elle longea doucement la côte : Esquibien, Primelin, Plogoff, et au loin le manoir des Penneg… Malo était-il rentré du vivier ? À la radio, cette chanson interprétée par l’acteur Jean Gabin. Toute nouvelle sur les ondes, Malo l’avait d’emblée adorée mais pas Rozenn.
Cette fois, pourtant, cette chanson plus parlée que chantée la fit sourire. Elle se mit même à fredonner :
Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes
J’parlais bien fort pour être un homme
J’disais, je sais, je sais, je sais…
Plogoff apparut, qu’elle dépassa en direction de la pointe du Raz ; la baie se dessina comme sous un majestueux coup de pinceau.
Nulle part ailleurs la mer n’était aussi bleue, pas même à Nice où les flots semblaient figés. Lorsqu’elle aperçut la Citroën SM bleu marine de Romain devant l’hôtel de la Ville d’Ys, le cœur de Rozenn s’emballa et elle accéléra pour se garer près de la grosse berline aux chevrons. Elle chantait encore en tournant la clef dans la serrure :
La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses.
On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses.
C’est tout ce que j’sais, mais ça, j’le sais4.
— Rozenn ?
— Malo ? Qu’est-ce que tu fais là ? Tu m’as suivie ?
Le jeune homme, longue mèche châtain clair lui balayant le front et favoris descendant sur les joues, haussa les épaules.
— C’est… c’est… t… oi qui… qui… m’en as p-parlé…
— Mais je ne t’ai pas dit quel jour.
Malo ignora le regard furieux de la jeune femme et prit une énorme respiration pour ne pas bégayer, il y parvenait sur les phrases courtes en se concentrant très fort.
— Rozenn, ne pars pas…
— Je t’écrirai dès que je serai installée, promis.
— Il va… va… te… t-tuer…
— Mais ça va pas la tête ? Romain m’aime.
— M-mon… p-père…
— Quoi ton père ?
— Il v-veut…
Rozenn le vit rougir et ses yeux s’affoler. Sa respiration s’accéléra. La jeune femme posa sa main sur son bras et dit doucement :
— Respire fort, Malo… Là, voilà, calme-toi…
Elle attendit que l’émotion dont le jeune homme était étreint s’apaise, puis elle demanda :
— Qu’est-ce qu’il veut ton père ?
— T-t’épouser…
Rozenn hésitait entre se mettre en colère ou éclater de rire. Et dire que son père pensait demander la main de Malo pour elle au bel Armel ! C’était assez comique dans le fond.
— Il n’est pas sérieux ?
Malo hocha la tête pour indiquer que si.
— Et toi, ça te plairait que je sois ta belle-mère ?
— M-moi c’qui m-m’plai-rait c’est… c’est… que tu… partes… pas…
— Même en étant la femme de ton père ?
— O-oui…
Après avoir écarquillé les yeux, Rozenn prit Malo dans ses bras et lui caressa le dos.
— Je suis désolée…
— Et… m-oi ?
— Tu veux que je sois ta femme ?
— O-oui… Je… je t-t’ai… me.
— Moi aussi, Malo, je t’aime, mais on est comme frère et sœur…
Il enfouit la tête dans son cou et se mit à pleurer, doucement et sans bruit. Elle le laissa déverser son chagrin quelques instants, puis elle s’écarta et sourit comme on sourit aux enfants.
— Je dois y aller… On se voit à Nice…
Rozenn fit brusquement demi-tour pour ne plus voir son visage désemparé. Puis elle se dirigea vers l’entrée de l’hôtel. À mesure qu’elle s’en approchait, la tristesse de Malo fut emportée par la brise et elle sourit au destin.
1Tête de con !
2Nez à morve sèche.
3Poufiasse, tas de fumier, face de lamproie, vieille truie… et hypocrite.
4 Maintenant je sais, chantée par Jean Gabin.
Chapitre 2 : « Les états d’âme d’une fleur »
Pointe de la Torche. Printemps 2017.
Le soleil de cette fin mars perçait timidement, mais le temps était doux. Devant eux se trouvait la Pointe de la Torche où s’étendait un kilomètre carré de jacinthes se déclinant en rose, blanc, camaïeu de mauve, violet améthyste… Dans quelques jours, ce serait au tour des tulipes de faire leur entrée dans ce tableau parfumé situé à quelques centaines de mètres de l’océan dont on entendait le ressac.
— Un régal pour les yeux et le nez, avoue-le quand même, sourit Antoine en serrant Audrey contre lui.
— Oui.
Oui, le spectacle était divin, oui, l’appendice nasal était comblé par l’arôme de ces milliers de fleurs sorties du sable, bien en avance sur les autres régions grâce aux températures clémentes du Finistère, mais pas uniquement : cette armée florale était aussi gourmande en produits phytosanitaires, insecticides avant la plantation, bulbes badigeonnés aux fongicides, pesticides une fois les fleurs écloses. Le sol sableux étant incapable de retenir cette manne toxique, celle-ci finissait par se déverser dans la mer où se formaient des nappes de mousse étrange donnant aux surfeurs une sensation de brûlure des yeux et des lèvres, car cet endroit précis était un spot : une plage baignée de vagues propices à la glisse.
La jeune femme se baissa et ramassa un corps de stylo à bille.
— Un touriste qui l’aura égaré, temporisa Antoine, qui sentait monter une diatribe écologique.
— On ne perd pas un stylo cassé. On le jette à la poubelle chez soi, pas dans un champ, encore moins dans un champ de fleurs. À moins d’être un sacré cochon !
— Et il y en a, hélas.
— Ici, les fleurs sont « nourries » de compost issu des poubelles. Si je poursuis mes recherches, je suis bien sûre de trouver d’autres déchets en plastique.
— Attention, tu es dans une propriété privée.
— Je sais. Mais regarde plus loin, tu vois ce que je vois… La vache ! Une fourchette en plastique aux dents cassées.
Antoine étouffa un soupir : Shissdrake5 !
Dire qu’il avait cru faire plaisir à son épouse en l’emmenant voir ce spectacle champêtre. Il n’était pas assez naïf pour croire que cette exploitation industrielle était bio, mais il n’aurait quand même pas pensé trouver des stylos cassés dans les rangs de jacinthes, encore moins une fourchette, et Dieu ou le diable savait encore quoi d’autre. Comme il ne souhaitait pas du tout qu’Audrey ait envie de dénicher d’autres objets insolites, il prit un ton faussement enjoué pour demander :
— Et si on allait manger une crêpe ?
— Tiens, oui, c’est une idée. Où ça ?
— À Pors Carn ? J’aime cette plage, ses rochers et son côté sauvage.
— Hoppla6.
Ils regagnèrent le 4x4 Range Rover blanc garé non loin de là. Cinq minutes plus tard, ils débarquaient sur le parking réservé aux visiteurs de la longue plage de sable blanc réputée pour son espace naturel. En ce mois d’avril, les touristes n’étaient pas encore trop nombreux et seul un restaurant-crêperie à l’enseigne de Chez Marie-Cath, simplement doté d’une terrasse extérieure avec vue imprenable sur la plage, était ouverte. Après avoir avalé un kouign — crêpe du Pays bigouden, spécialité de la maison – au miel pour Audrey, au rhum pour Antoine, ils déambulèrent sur le sable blanc, humant la brise salée venue de la mer aux flots aigue-marine.
— André me manque, dit Audrey.
— Jo7 ?
Antoine ne pensait pas de même. Revenu de mission après presque dix mois d’absence, il avait retrouvé, à la place du nourrisson, un bambin courant, sautant, éparpillant ses jouets, bref, un enfant plein de vie auquel il avait eu du mal à se connecter. Sa patience, assez réduite, avait été mise à rude épreuve et le ton était rapidement monté entre lui et Audrey.
— Tu le laisses tout faire, ah, bravo !
— C’est facile pour toi de donner des leçons. Tu nous as laissés à l’abandon presque un an !
Antoine avait manqué de s’étouffer.
— À l’abandon ? Tu savais très bien que j’étais en Opex8 où j’ai vraiment failli y rester, et plus d’une fois.
— N’empêche que tu as laissé croire que tu étais mort !
— Pas moi, la DGSI, qui tenait à préserver ce secret le temps de terminer le boulot ici. Si tu crois que j’étais d’accord…
— Bien sûr que tu l’étais ; tu n’as pensé qu’à une seule chose, celle qui t’obsède depuis toujours : ta carrière !
— Shissdrake, Audrey, je le fais pour toi, pour André.
Audrey l’avait regardé dans les yeux.
— Non, Antoine, tu le fais pour toi. Tu ne rêves que d’une chose : le képi à étoiles, et pour prouver quoi à qui ?
Il n’avait pas répondu et s’était enfermé dans le dédain, même quand maman Stein était montée au créneau pour soutenir sa bru.
— Ta femme a raison. Maintenant que te voilà revenu d’entre les morts, pense un peu à ceux qui ont vécu dans les affres tout le temps de ton absence, et je ne parle pas de moi, dont le cœur a frôlé la crise cardiaque une première fois avec la disparition de Walter en Afghanistan, ensuite avec la tienne en Syrie…
— Jo…9 nous sommes tous deux revenus !
— Mais dans quel état psychologique ? Vous êtes tous les deux à prendre avec des pincettes. Passe encore pour lui qui est seul, mais toi, tu as une femme et un fils qui a besoin d’un père, pas d’un censeur !
Il encaissait, mais se sentait de plus en plus étranger au sein de sa propre famille. Seul son père Gerhardt lui apportait un réconfort discret en lui tapotant l’épaule ou en venant le rejoindre dans un coin du rucher. Car, contre toute attente, Antoine qui, jusque-là, n’avait jamais manifesté d’intérêt pour la vie des abeilles – d’ailleurs il détestait le miel – avait soudainement pris un certain plaisir à venir observer leur ballet. Il s’asseyait même en tailleur à une distance respectable pour ne pas être piqué et appréciait la quiétude apportée par l’observation des butineuses revenant à la ruche les pattes pleines de pollen doré, orangé et parfois rouge. Audrey ne lui avait-elle pas dit que cette activité, ô combien bucolique, marquait la fin de la vie de l’ouvrière épuisée par tant de labeur ? Devant les atterrissages et les décollages sur la planche d’envol, tout lui paraissait simple et harmonieux. Ici, les dysfonctionnements n’existaient pas, puisque tout était régi selon les mêmes modes, depuis des siècles, par la nature : la reine pondait ses deux mille œufs par jour, dont s’occupaient les nourrices dévouées autant aux futures butineuses qu’aux mâles sans oublier les larves de souveraines destinées à renouveler la matriarche le moment venu.
Son père ne s’était permis qu’une seule fois de le conseiller.
— Sois tolérant, ta femme a été seule longtemps avec le petit et elle était bien dans le chagrin de t’avoir perdu.
— Vraiment ?
— Bien sûr.
Un silence pesant avait suivi cette assertion.
— À la brigade, on dit que…
— On dit quoi ?
Antoine hésitait à poursuivre ; il n’aimait pas étaler ses affaires, même auprès d’un proche comme son père. Et puis, à quoi bon l’inquiéter avec ce qui n’était peut-être que des racontars ? Ses parents avaient fourni un gros effort en quittant l’Alsace pour le Quercy ; il n’allait pas tout gâcher en manifestant de l’acrimonie.
— Aucune importance, avait-il conclu dans un soupir.
Sur la plage de sable blanc de Pors Carn, Antoine tâcha de rassurer Audrey.
— Nous ne sommes partis que depuis avant-hier et puis il est bien avec ses grands-parents.
Papa et maman Stein, qui avaient déménagé début janvier, s’occupaient du petit garçon de deux ans et demi avec une grande tendresse et même une sacrée dose de patience qu’Audrey n’aurait jamais soupçonnée chez Claudia, sa belle-mère. Au retour de sa mission d’espionnage, Antoine, bombardé lieutenant-colonel, avait pu choisir son affectation. Ce n’était pas les DOM-TOM comme son supérieur en avait fait la suggestion, à laquelle Audrey avait opposé un refus catégorique. Il était donc resté à Brive-la-Gaillarde et c’était bien le moins que la Gendarmerie pût faire, selon Audrey, pour lui avoir laissé croire que son mari avait péri dans une catastrophe aérienne, ce afin de pouvoir infiltrer plus commodément ce qu’il restait de la German Connection en France. Pour l’heure, Antoine était venu une semaine en Bretagne afin d’intervenir auprès des élèves de l’école de gendarmerie de Châteaulin. Audrey avait fait concorder ce déplacement avec une conférence sur le crime contre l’environnement.
— Antoine, j’ai envie de rentrer à La Quincaillerie.
C’était le nom de leur chambre d’hôtes, située en plein centre-ville d’Audierne, sur la route de la pointe du Raz. Là encore, c’était Antoine qui lui avait fait cette surprise sur les conseils d’un camarade gendarme : retenir une chambre insolite dans une ancienne quincaillerie datant du XIXe siècle. Audrey avait d’emblée adoré l’ambiance chaleureuse et amicale entretenue par Véronique et Jean-Christophe, secondés par une amie anglaise également à la tête d’un restaurant-salon de thé : la cuisine y était simple et savoureuse.
— Je dois me préparer pour la conférence de demain à Quimper.
Antoine hocha la tête.
— Et moi, pour l’intervention de mercredi. Rentrons. J’irai au salon-bibliothèque du premier étage ; ainsi, tu réviseras plus tranquillement.
Audrey lui sourit en guise de remerciement. Voilà sept mois que leur vie de couple était comme un chariot lancé à l’assaut des montagnes russes. Certes, avec un compagnon sorti de Saint-Cyr et vétéran d’Afghanistan, médaillé d’or aux derniers championnats du monde de natation aux Jeux mondiaux militaires, l’existence n’avait jamais ressemblé à un long fleuve tranquille, mais, depuis le retour au foyer de son mari, pourtant tant espéré, tout était devenu compliqué. De part et d’autre, admettait Audrey. Antoine s’enfermait dans le mutisme quand elle souhaitait évoquer sa mission en Syrie et notamment ses conditions d’évasion de la maison de paysans talibans chez lesquels il avait été retenu prisonnier après son refus de monter dans l’hélicoptère surchargé devant le conduire de Damas à Beyrouth. Quant à Audrey, elle menait une vie de célibataire organisée autour de son fils et de ses amis apiculteurs ainsi que de l’inénarrable ex-adjudant-chef Francis Lebel, « gendarme un jour, gendarme toujours », selon ce tintinophile grand séducteur devant l’Éternel. Installé non loin de chez elle, Lebel, pour l’heure, filait le parfait amour – un de plus ! – à Brest chez une éleveuse de chevaux de trait bretons. Il restait que ce voyage en Bretagne était aussi destiné à recoller les morceaux de son couple. Y parviendraient-ils ?
Une heure plus tard, ils débarquaient à Audierne. Antoine dénicha une place tout en haut de la rue Berthelot. Il l’accompagna jusqu’à l’entrée de la chambre d’hôtes.
— Vas-y, je vais redescendre en ville acheter le journal.
— Tu lis le journal ?
Il haussa les épaules.
— Je ferai un tour…
Ils se séparèrent. Lui se dirigea vers la librairie, elle vers la pension qui abritait également, dans son arrière-cour, l’Atelier du 5 où se réunissaient des passionnées de couture. À son arrivée dans la salle à manger aux murs crépis d’anciennes factures et de photos des enfants des propriétaires, Audrey tomba sur Véronique, petite quinquagénaire aux courts cheveux bruns, qui installait les couverts pour les réservations du soir. Elle était accompagnée d’un chat gris « Loulou ».
— Seule ? demanda celle-ci dans un sourire montant jusqu’à ses yeux derrière ses lunettes.
La jeune apicultrice sourit à son tour.
— Antoine est parti chez Ar Vro.
— Ah ! chez Bruno… C’est un super libraire ; il a beaucoup de choix et il fait bien vivre sa librairie en organisant des rencontres. Si vous écriviez un livre, vous seriez la bienvenue.
— Je suis apicultrice. Auteure, c’est encore un autre métier.
— Vous devriez partager vos connaissances, trop de gens sont encore dans l’ignorance de la vie des abeilles, de la fragilité de la nature…
— Vous avez raison, mais comment retenir l’attention longtemps sous une forme qui ne soit pas ennuyeuse ? Une conférence, comme celle que je vais donner demain, ça dure une heure, pas plus ; au-delà, les gens décrochent, j’ai pu le constater.
Véronique secoua la tête.
— Je parie que, dans vos conférences, la plupart de vos auditeurs sont des convaincus ou des aficionados, qui viennent se perfectionner en quelque sorte…
— C’est pas faux, admit Audrey.
La porte de la cuisine, donnant sur la salle à manger, s’ouvrit et livra passage à un grand brun au sourire doux, Jean-Christophe, le compagnon de Véronique, qui portait une pile de serviettes marron à déposer dans les assiettes blanches.
— Moi, j’ai une idée…
Véronique le taquina :
— Tu écoutes aux portes ?
— C’est encore là qu’on apprend le plus intéressant !
— Voyez-vous ça !
— Voyons plutôt son idée, plaisanta Audrey, qui appréciait le couple.
— Le roman policier est un genre prisé…
Devant les yeux noirs arrondis de surprise d’Audrey, Jean-Christophe poursuivit malicieusement :
— Vous avez un mari gendarme ?
— A priori, oui !
« Mais pour combien de temps encore », songea Audrey qui se repentit aussitôt d’une telle pensée. Ne s’étaient-ils pas promis, avant de partir, de tout faire pour sauver leur couple ?
— Servez-vous de vos expériences pour composer une apicultrice confrontée à un crime à l’environnement, auquel personne ne croit, et obligée de mener sa propre enquête.
— Quelle imagination, Jean-Christophe !
— Merci, Véronique !
— Cela dit, c’est pas idiot du tout.
Le couple avisa Audrey, qui, amusée, émit de sérieux doutes.
— Je ne suis pas sûre de savoir écrire une enquête ; ma littérature se borne à des articles parus dans les magazines professionnels.
— Aller à l’essentiel est difficile, bien plus que de s’étaler dans un roman.
— Peut-être… Mais je ne connais rien au monde de l’édition et pas question de me lancer dans l’autoédition ; ah, tous ces arbres débités pour coucher les souvenirs de famille ou les récits extravagants de tous les Dan Brown régionaux ! Excusez-moi, mais je dois repasser mes notes pour ma conférence. À ce soir.
— Ce sera tajine d’agneau du Domaine des Agneaux de Poullan-sur-Mer.
— Je m’en régale d’avance.
— À ce soir, conclurent les deux hôtes.
Tandis qu’Audrey disparaissait dans la cage d’escalier menant à sa chambre du second étage, Véronique soupira :
— C’est pas gagné pour voir naître demain une apicultrice enquêtrice.
— Laisse l’idée faire son chemin. Et puis n’est-ce pas demain que nous accueillons un fameux auteur breton, sinon le plus fameux ?
— Et alors ?
— Alors, on le lui présentera.
— Toi, tu ne lâches rien.
Jean-Christophe secoua la tête en souriant.
— Jamais ! Tu devrais le savoir.
Mélanie, l’hôtesse anglaise, secondant le couple à La Quincaillerie, surgit dans la salle à manger.
— Que se passe-t-il ici ?
— Oh, trois fois rien ! C’est Jean-Christophe qui trouve qu’il n’a pas assez de boulot ici et veut se transformer en agent littéraire pour faire de la jeune apicultrice du deuxième une nouvelle JK Rowling.
— Oh ! What a wonderful idea !10
5« Merde » en alsacien.
6Interjection alsacienne signifiant « allons-y », « en avant », équivalent du let’s go anglais.
7Dérivé de l’allemand ja, ce terme dialectal alsacien n’a rien à voir avec le parler de banlieue ! Interjection marquant le doute, l’étonnement, la surprise, l’acquiescement, la déception, l’exaspération… Ici, l’étonnement agacé.
8Opération extérieure, mission à l’étranger.
9Exaspération.
10« Quelle idée merveilleuse ! »
Chapitre 3 : « Le crime d’une coccinelle »
Quimper, centre des congrès du Chapeau Rouge.
Partout, le bâtiment accueillant les événements sentait le neuf, et pour cause : il avait été inauguré huit jours plus tôt. Déambulant à la suite du maire, qui avait coiffé sa « casquette de guide », Audrey et Stein avaient appris que le Chapeau Rouge avait été autrefois un local multifonction servant aussi de salle de cinéma. Le maire leur avait fait visiter, au dernier étage, l’espace de réception, doté de terrasses, qui offrait une vue fabuleuse sur les toits de la ville ainsi que sur la colline baptisée « le Mont Frugy », laquelle était couverte d’un bois emblématique planté de chênes et de châtaigniers, où Audrey se promettait d’aller se balader une fois sa conférence achevée. Le maire les emmena ensuite dans l’immense « salle plénière » équipée d’un non moins immense écran qui fit s’effarer Audrey :
— Ils n’ont pas vu un peu grand, les gens du syndicat d’apiculture ?
— Oh ! je ne pense pas. Savez-vous que mille cinq cents personnes sont attendues ?
— Non, je ne savais pas.
— C’est la première fois que vous avez autant de monde ?
— En France, oui ; dans les pays de l’Est, non.
Ce fut au tour du maire de soulever les sourcils d’étonnement, mais il changea de sujet.
— La conférence démarre dans quarante-cinq minutes. De notre côté, tout est prêt. Vous souhaitez sans doute vous préparer, aller aux toilettes…
— Je souhaite surtout m’isoler pour revoir mes notes.
— Dans ce cas, je vous laisse tranquille.
— Moi aussi, dit Antoine en emboîtant le pas du maire.
Audrey attendit que les deux hommes eussent quitté la salle pour se laisser tomber sur l’un des strapontins noirs face à la scène. Puis elle ouvrit son Mac portable… C’était la première fois qu’elle donnerait une conférence, non sur les abeilles ou les produits de la ruche, mais sur le crime contre l’environnement. Saurait-elle se montrer convaincante ?
*
— Si je vous dis « écocide », vous me répondez « pesticides », « insecticides », « fongicides » – elle eut un sourire ironique –, et mon préféré « biocide » ? – bio, du grec bios : « vie », – cide, du latin caedere : « frapper, tuer ».
Audrey attendit que son auditoire acquiesce pour poursuivre :
— Ou éventuellement « pollution des mers » ?
Un brouhaha d’adhésion parcourut la salle. Elle affermit sa main sur le micro et demanda :
— Une autre idée ?
Une main se leva, celle d’un jeune binoclard.
— L’exploitation des forêts ?
— Oui, pour être exact, l’exploitation illégale des forêts pour le chauffage, les bâtiments, les meubles et les papiers. Le bois est une alternative écologique au béton et au plastique, et vu par beaucoup comme « the bonne solution » pour jouer les écolos. Ce devrait, en effet, en être une. Malheureusement, nous en consommons de plus en plus. Quand je dis « nous », cela signifie « le monde entier », la France n’arrivant « qu’au » sixième au rang des pays consommateurs et importateurs, car nos forêts ne suffisent, bien entendu, pas à satisfaire ce besoin. Le bois est tiré des grands domaines forestiers : l’Amazonie, les forêts du Congo, les forêts boréales, et sa production est rarement durable.
La jeune femme fixa la salle bien remplie.
— Production durable : quèsaco ?
Cette fois, elle n’attendit pas de réponse de son public et poursuivit :
— C’est produire dans les limites écologiques, économiques et sociales, sans porter atteinte à l’intégrité des personnes et des êtres vivants. En ce qui concerne l’agriculture durable, il s’agit de limiter les pesticides.
Elle appuya sur la télécommande et l’écran noir se couvrit d’images de forêts disloquées et d’arbres abattus sans scies de bonne qualité, ce qui générait ensuite de la perte lors de la mise aux normes industrielles des troncs. Les animaux vivant dans ces abris de feuilles, principalement des singes, étaient chassés, voire traqués, car ils constituaient un mets de choix.
Audrey soupira.
— Les besoins mondiaux en bois sont d’environ quatre milliards de mètres cubes par an. Pour y répondre, on surexploite les forêts, ce qui a, bien entendu, des conséquences sociales et environnementales très lourdes : réduction de la biodiversité, érosion des terrains, pollution de l’eau, perturbation de son cycle. La forêt a du mal à se renouveler, sans oublier que certaines populations qui y habitent sont parfois, assez souvent même, victimes de violation de leurs droits et poussées à la sédentarisation en ville dans des conditions insalubres. Un mot sur les animaux dans tout ça. Comme vous l’avez vu sur les images, ils sont les victimes collatérales, chassés de leur habitat qui se réduit comme peau de chagrin, ou tués pour être consommés.
La jeune femme délaissa le sujet « forêt » pour aborder celui du commerce illégal des matières précieuses, qui fut suivi de celui du commerce des déchets, dont le plus lucratif était celui des déchets toxiques. Elle ne voulut pas terminer sur une note négative, partant du principe que le cerveau ne retient pas longtemps les notes pathétiques, et conclut sur la légende du colibri : si chacun faisait un peu, il y aurait déjà beaucoup de changement.
Un quart d’heure fut ensuite consacré aux diverses questions des spectateurs, à l’issue duquel elle serra une bonne quarantaine de mains et prit la pose pour quelques « autophotos » ou « égoportraits » selon les expressions québécoises pour désigner les selfies. Le dernier à se présenter fut un quadragénaire qui souleva son panama.
— Madame Astier…
Il bafouilla un nom qu’elle ne comprit pas.
— Excusez-moi, je n’ai pas saisi votre nom, dit-elle en observant le nouveau venu au style baroudeur, de taille moyenne et plutôt mince.
— Gabriel Le Bihan.
Pour le coup, Audrey écarquilla les yeux de surprise. Gabriel Le Bihan était the célèbre photographe des abeilles auxquelles il avait consacré sa vie en parcourant le monde pour en immortaliser toute la diversité apicole. Il signait ses magnifiques clichés du pseudonyme de Gargamiel. Audrey en possédait deux accrochés dans son salon. Gabriel était aussi l’auteur de trois merveilleux livres de photos, qui, bien entendu, tenaient une belle place dans sa bibliothèque. Elle abandonna le rangement de son matériel et fit un signe à Antoine qui pianotait sur son portable en attendant que la cour de sa femme se fût dispersée pour venir l’aider.
— C’est aimable de passer me voir.
— J’ai assisté à la conférence : c’était à la fois passionnant et désolant.
Audrey eut un hochement de tête et présenta Antoine.
— Monsieur Abeille, enfin si l’on peut dire, car il déteste le miel !
— Cela me donne des maux d’estomac, tenta de se justifier Antoine.
— C’est très possible. Tout le monde n’assimile pas bien les enzymes présents dans le miel.
— Enfin quelqu’un qui essaie de me comprendre, plaisanta Stein en tendant une main franche à Gargamiel pour une prise de contact.
Après quoi, le photographe toussota.
— Madame Astier, je ne suis que de passage, chez mes parents, lesquels sont décédés…
— Je suis désolée.
— Il n’y a pas de mal. Un accident de voiture survenu il y a dix ans à un passage à niveau.
— Oh ! fit Audrey.
Antoine eut un claquement de langue. C’était terrible la façon dont les gens pouvaient se laisser avoir en pensant qu’ils avaient le temps de passer et, pour gagner dix précieuses secondes, plongeaient dans l’éternité de la mort.
— J’ai un pied-à-terre à Paris…
Il sourit comme pour s’excuser, ce qui illumina ses yeux bleu vert, dont l’un était piqueté de brun.
— J’ai failli choisir Perpignan, dont la gare est le centre du monde selon Dalí, mais ce n’est pas là que se font les meilleures affaires, alors j’ai opté pour un petit logement avenue de la Grande-Armée.
Antoine eut un « Jo » long traduisant son admiration.
— Oh ! ce n’est qu’une piaule sous les toits dont les murs ont sûrement gardé la mémoire des peines des bonnes y ayant vécu autrefois.
— Comme c’est poétique.
— Veuillez m’excuser, je suis un incorrigible bavard et rêveur aussi, sans quoi je ne ferais pas ce métier.
Audrey se récria. Face à Gargamiel, elle se sentait comme une ado devant sa rock star préférée. Il reprit :
— Mon père était apiculteur…
— D’où votre passion pour les abeilles ?
— Oui. Il a, enfin, il avait vingt colonies de Noires du Cap-Sizun.
— Oh !
Audrey connaissait cet écotype parfaitement adapté au climat et à la flore du Cap depuis des milliers d’années. Hélas, une menace planait sur la belle Noire : l’importation par les apiculteurs amateurs de colonies étrangères, caucasiennes et italiennes, réputées plus costaudes et pouvant butiner plus loin. Or, on ne pouvait empêcher un bellâtre italien de séduire une reine noire ! L’hybridation était sérieusement prise en compte, car, à terme, la Noire du Cap-Sizun risquait bien de disparaître.
— Voudriez-vous les reprendre ?
— Gabriel, je suis très honoré de votre proposition, mais, au vu des problèmes engendrés par les croisements, je suis sûre qu’un apiculteur affilié à l’association de protection serait ravi de les inclure dans son rucher.
— Ce n’est pas aussi dramatique que l’on dit.