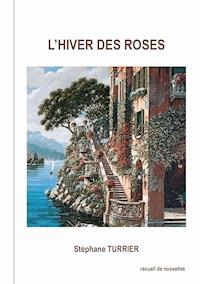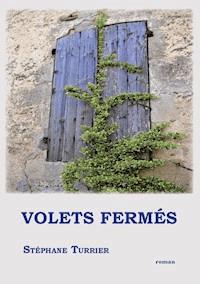
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Daniel, un adolescent d’une quinzaine d’années, a été confronté dès son plus jeune âge aux beuveries effrénées de ses parents. Lui, ses frères et sœurs, sont les témoins indésirables de leur déchéance. Pour Daniel, seul l’amour incommensurable qu’il voue à son père lui fournit la force de supporter les turpitudes qu’il endure chaque jour, bon an, mal an. Quelles sont les séquelles d’une telle situation sur les proches, et est-il possible de se sortir des ravages de l’alcool ? Dans ce récit poignant, à la fois tendre et cruel, empreint d’authenticité, Stéphane Turrier retrace le parcours de Daniel, ce bout de chemin semé d’embûches.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce témoignage est une fiction inspirée de faits réels. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé ou existant actuellement serait purement fortuite.
Du même auteur :
L’automne d’une vie, Éd. Les 2 Encres, 2003 - Éd. BoD, 2016
Louise, recueil Le Centième Titre (nouvelles), Éd. Les 2 Encres
À Véronique
ENIVREZ-VOUS
Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question.
Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps
qui brise vos épaules et vous penche vers la terre,
il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ?
De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise,
mais enivrez-vous !
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais,
sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez,
l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent,
à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge ;
à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule,
à tout ce qui chante, à tout ce qui parle,
demandez quelle heure il est.
Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge
vous répondront, il est l’heure de s’enivrer ;
pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps,
enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie,
de vertu, à votre guise.
Charles Baudelaire
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
1
Paris s’était lentement confiné dans un hiver onduleux, hostile et froid, sans âme, à la fois sale et fuyant, fade et gluant. On traînait le quotidien derrière soi, comme un boulet. Tous les Parisiens s’étaient fardé le visage d’une poudre grisâtre et affichaient des moues mornes et inquiétantes.
Le lycée Utrillo n’était pas très loin de l’appartement familial et j’avais plaisir à attendre les copains au coin de la rue du Poteau. J’étais souvent un peu endormi et triste.
Triste de voir mon père partir. Triste du sempiternel rituel qui avait pris fin.
Nous étions tous deux matinaux. Vers six heures et demie, mon père entrait à pas feutrés dans la chambre, s’approchait de notre lit, puis me déposait un baiser sonore sur le nez, en me susurrant à l’oreille des mots doux et encourageants. Son haleine empestant l’alcool s’engouffrait dans mes narines et me réveillait aussitôt. Je savais alors qu’il était rentré tard.
J’aimais ce moment particulier de la journée. C’était la preuve que mon père tenait à moi et que j’occupais une place particulière dans son cœur.
Chaque matin, il me préparait un chocolat chaud accompagné de tartines grillées et, pendant qu’il pissait dans l’évier puis noircissait sa moustache au crayon, grimaçant de concentration, j’enrichissais mon Banania d’une dizaine de morceaux de sucre. Une fois son rituel accompli, il m’observait en silence depuis le miroir suspendu au mur puis venait m’embrasser sur le front.
Pendant ce temps, ma sœur, cette grande girafe, s’éclipsait dans la salle de bains pour se gratter le derrière – c’est ainsi que notre chère mère se complaisait à dénommer la toilette matinale – tandis que mon jeune frère Philippe dormait à poings fermés, car il n’allait pas encore à l’école.
À sept heures et demie tapantes, six jours par semaine, mon père et moi entamions le parcours du combattant. Une entreprise aussi insolite que périlleuse. Descendre les escaliers de notre petit appartement du deuxième étage en aveugle. Hormis les Arabes du rez-de-chaussée qui grognaient à juste titre, les Vietnamiens du premier et les autres ne payaient pas leur redevance d’électricité, et mes parents n’étaient pas prêts à le faire pour eux; donc, personne ne voyait goutte dans ce couloir multiculturel.
Les Chinetoques au placard.
Le noir complet et d’étroites marches en bois délabrées.
L’Himalaya parisien un mois de décembre.
Mon père tenait à prendre la tête de l’expédition. Je tâtonnais donc derrière lui, chargé de mon lourd cartable contenant les livres qui me serviraient d’oreiller durant les premières heures de cours. Cette descente périlleuse éveillait chez moi une angoisse insupportable : je craignais de trébucher et de tomber dans les précipices asiatiques, emportant dans ma chute mon guide adoré.
Une fois en bas, mon père enfourchait le Solex. Une espèce de brouette à moteur qu’il chevauchait été comme hiver. Sa vieille casquette vissée sur le crâne, les moustaches aiguisées, il m’ébouriffait les cheveux une dernière fois avant de s’époumoner sur son engin pétaradant qui le menait au bureau. À ce moment-là, je ne savais jamais vraiment quand il nous reviendrait.
Comme d’habitude, mes copains m’attendaient près de la boulangerie, au coin de l’église Sainte-Hélène, près du croisement où se trouvait la maternelle où nous nous étions bagarrés pour la première fois. Le curé de l’église Sainte-Hélène refusait catégoriquement que nous jouions dans la cour adjacente à la paroisse. Lorsqu’il nous surprenait, il essayait en vain de nous attraper. C’était notre jeu préféré : jouer au chat et à la souris avec ce pauvre curé. Ces folles poursuites nous rendaient hilares. Quel plaisir de prendre la poudre d’escampette en lançant de sonores « Miaou, miaou ! », alors que le curé était à nos trousses !
La brume matinale déformait leurs silhouettes exsangues. Seuls leurs rires stridents traversaient le brouillard. Un brouillard sombre, poisseux, cérébral. Ils étaient là, se moquaient de moi, m’attendaient, et la vie renaissait pour un instant. Un instant crucial qui se nourrissait du quotidien. J’étais heureux.
Je m’approchai et reconnus la voix criarde de Fabrice :
– Hé ! T’as vu les filles là-bas !
– Où ? s’exclama Laurent en scrutant les alentours.
– En face, idiot !
– J’vois rien... Tu vois des nanas quelque part, Daniel ? m’interrogea Laurent en guise de salut.
– Oui, trois grosses là-bas, répondis-je en désignant l’autre côté de la rue.
– Alors, tu les vois ! s’écria Fabrice, impatient.
– C’est pas des filles, c’est des horreurs ! commentai-je d’un ton connaisseur. Fabienne, Christine et l’autre, je ne sais plus son nom… Si on te laissait faire, tu sauterais sur tout ce qui bouge ! lançai-je à Fabrice d’un ton moqueur.
– Au fait, t’as gratté pour l’interro de ce matin, Daniel ? me demanda Laurent d’un air soucieux.
– Que dalle, répondis-je la mine déconfite. Je n’ai pas eu le temps…
– Ta mère vous a encore mené la vie dure ?
– Je ne suis pas un chaud lapin ! s’insurgea Fabrice, nullement gêné d’interrompre notre conversation.
– Elle n’a pas arrêté… À trois heures du matin, mon père n’était toujours pas rentré et elle était dans tous ses états, répondis-je sans prêter attention à la remarque de Fabrice. Une fois de plus, j’ai dû enlever les clenches !
– Eh bien, au moins, elle ne pouvait plus claquer les portes, commenta Laurent avec logique.
– C’est sûr, observai-je, mais ça ne suffit pas pour l’arrêter ! De colère, elle s’est mise à cogner des poings sur les portes en nous traitant de tous les noms d’oiseaux…
Je levai les yeux au ciel en repensant à la scène d’hier soir.
– Je ne sais pas comment ma sœur parvient à se concentrer pour réviser ; pour ma part, c’est impossible !
Laurent semblait particulièrement disposé à m’écouter vider mon sac, aussi décidai-je de poursuivre mon histoire :
– Elle travaille dans son lit, sous le drap, et elle s’éclaire avec une lampe électrique. C’est moi qui lui procure les piles, ajoutai-je fièrement. Je les pique au Prisunic !
– Et ton frère ? demanda Laurent d’un air compatissant.
– Oh, lui, dans ces cas-là, il se roule en boule dans son lit et se met à brailler de toutes ses forces… J’ai beau lui en coller une pour qu’il se calme, rien à faire ! Il se met à gueuler encore plus fort.
– Pourquoi vous n’allumez pas la lumière ? s’enquit Fabrice d’un air naïf.
– Tu me poses toujours la même question ! rétorquai-je, excédé. Mon père a enlevé l’ampoule de la chambre, juste pour nous embêter… et de toute façon, ma mère coupe tous les soirs le disjoncteur de la maison.
– Alors, vous vous retrouvez dans le noir ? s’exclama Fabrice, l’air horrifié.
– Ça, c’est pas grave… à trois heures du matin, c’est plutôt normal ! rétorquai-je, taquin.
Fabrice ne releva pas et me tourna le dos pour s’inté-resser à une nouvelle jeune fille qui venait de rejoindre son groupe d’amies de l’autre côté du trottoir.
– Mes cocottes, vous ne perdez rien pour attendre ! marmonna-t-il en se frottant les mains.
– Fabrice, t’es encore puceau ! lui fis-je remarquer en soupirant, avant de m’éloigner avec Laurent pour rejoindre l’école.
– Hé, attendez-moi! On se fait une partie de foot cet après-midi ?
Le jeudi, à huit heures du matin, nous avions deux heures de maths avec madame Pilline Embouteiller, cela dit en passant, un nom bien dur à porter. Elle nous détestait certainement moins que nous-mêmes la haïssions, entre autres à cause de ses interrogations écrites qui arrivaient toujours à l’improviste. Dès son entrée dans la classe, nous savions ce qui nous attendait. Le visage épanoui, les lèvres pulpeuses légèrement entrouvertes et la poitrine rehaussée par un corsage bleu ciel, elle nous observait quelques secondes, avant de nous inviter à reprendre la leçon précédente que nous n’avions évidemment pas comprise. Cette entrée sensuelle signifiait qu’elle était dans un bon jour : elle était sûrement sortie avec le prof de gym la veille. Le prof de gym, un mec tout en muscles, qui nous faisait courir comme des dératés tous les mercredis, de trois à cinq.
L’heure de maths se déroulait alors dans une douce léthargie : le regard fixé sur ses jambes oblongues, nous nous laissions aller à nos espoirs.
Dans ses mauvais jours, elle arrivait décoiffée, la mine défaite, vêtue d’une longue robe noire qui enténébrait ses atouts féminins et dissimulait ses désirs inassouvis. Encore ensommeillés, nous n’en étions pas moins compatissants. Mais notre peine s’estompait dès qu’elle nous demandait froidement de sortir une feuille pour l’interro. C’était ainsi environ tous les quinze jours.
En ce qui me concerne, je n’avais rien contre la Pilline. En fait, je dois même avouer que je l’aimais bien. Souvent, elle me fixait de son regard enjoué et investigateur. Je baissais alors les yeux, honteux qu’elle puisse deviner mes pensées salaces. J’adhérais à son désarroi mais, malheureusement, je ne comprenais strictement rien à ses maths et je m’en fichais d’ailleurs royalement. En connivence de quoi, elle m’avait collé au dernier rang, à côté d’Ourmia… et je lui en serai toute ma vie reconnaissant.
Ourmia était un véritable génie. Un surdoué. Un incompris. Grâce à lui, je suis moi aussi devenu premier de la classe. Moins que lui, bien entendu, puisque mon succès dépendait de ma capacité à recopier ses réponses, sans que personne ne remarque mon regard rivé sur sa feuille. Ce garçon était tellement gentil qu’il lui arrivait même de me confier une antisèche qu’il m’avait gentiment préparée la veille. Tous les élèves de la classe avaient essayé d’obtenir ma place aux côtés d’Ourmia, en vain. C’était trop tard : nous étions devenus amis. Ce marginal esseulé et silencieux ne tolérait que ma présence à ses côtés. Depuis des années, Ourmia avait pris l’habitude d’apprendre par cœur tous les manuels scolaires au cours du premier mois suivant la rentrée. C’était sa manière à lui de prendre sa revanche, de se venger des coups que son père lui assenait à l’aide de câbles électriques, transformés pour l’occasion en martinet, et que son dos noir et massif endurait au quotidien. Il lui suffisait de parcourir l’ouvrage pendant une heure et le contenu restait gravé dans sa mémoire. Toutes les matières étaient ainsi acquises en moins d’un mois. Le reste de l’année, il s’ennuyait à mourir. Même les profs les plus hargneux s’étaient résignés et avaient cessé de l’interroger. Il avait réponse à tout et obtenait chaque trimestre une moyenne générale de 18/20. Il s’ennuyait du matin au soir, ne sachant quoi faire de ses dix doigts.
Un refoulé ressassant sa colère peut s’avérer dangereux. C’est sans doute la raison pour laquelle il voulait casser la gueule à tout le monde. Il avait même à son actif quelques nez cassés d’écoliers imprudents ou de profs inattentifs. Par conséquent, il s’était fait virer du lycée de nombreuses fois, ce qui lui valait en général un surplus de 220 volts à la maison.
De temps en temps, il fuguait pour se réfugier dans les caves de l’établissement, muni de lampes de poche, de bougies, de conserves et de vieilles couvertures. Il y restait deux ou trois jours, le temps que son dos cicatrise, fumant comme un pompier joints et cigarettes. C’était un prisonnier volontaire, muré dans l’obscurité et le silence. Il avait besoin de ces moments en solitaire pour gérer le désarroi qui envahissait ses quinze petites années et rongeait à petit feu un avenir éphémère.
J’étais le seul à connaître son secret et à lui rendre visite. J’en étais à la fois fier et apeuré. Huit cents collégiens et une centaine de profs le craignaient, l’évitaient, peu fiers mais rassurés de le maintenir en cage. Qu’aurait-on pu faire ? Une bête malsaine, mystérieuse, et intelligente de surcroît, ne pouvait que susciter la peur.
Un jour, je trouvai Ourmia d’une humeur particulièrement morose : ses parents l’avaient chassé de la maison et il s’était réfugié dans les souterrains du bahut, mais continuait à assister au cours.
Ce matin-là, le cours de dessin – assuré par l’une des profs les plus appréciées du lycée – dégénéra brusquement. En effet, Patrick, un fils à papa du genre aristocrate, interpella Ourmia d’un air moqueur :
– Hé, Ourmia, qu’est-ce que tu vas nous dessiner aujourd’hui ? Une banane, une pomme, une gonzesse ? Tu sais les faire, les filles avec des gros nichons ?
– Laisse-moi tranquille, répondit Ourmia d’un ton calme tout en s’installant.
– Je suis sûr que tu ne sais même pas dessiner une nana ! pouffa Patrick en le narguant. Tu joues les caïds, mais moi, je sais que c’est du bluff !
Ourmia leva les yeux, posa son sac et s’approcha de son camarade :
– Répète un peu pour voir !
Les lèvres pincées et les poings serrés, il fixait son adversaire comme un prédateur guette sa proie. Il était clair qu’il ne se contiendrait pas longtemps et la rapide métamorphose qui s’opérait ne laissait présager rien de bon. Patrick avait eu l’audace de le provoquer, de le blesser dans son orgueil et j’étais certain qu’Ourmia ne lui pardonnerait pas une telle offense. Comment ce freluquet osait-il l’humilier ainsi publiquement? Le regard d’Ourmia devenait de plus en plus menaçant et un rictus nerveux se dessina sur ses lèvres charnues. Il n’en ferait qu’une bouchée et rien ni personne ne pourrait l’arrêter…
Dans un silence de mort, nous l’observâmes en train de bomber le torse d’un air majestueux, démontrant ainsi sa supériorité, avant de s’avancer vers Patrick qui fit mine de reculer. Ourmia tendit vers lui ses bras musclés et le saisit brusquement à la gorge.
– Ourmia, arrête ! hurlai-je en me précipitant vers lui.
Le claquement sec du cran d’arrêt qui venait d’appa-raître comme par magie dans sa main me freina net dans mon élan. Chacun de nous était pétrifié et observait ce grand bonhomme noir écumant de rage. Il tenait Patrick d’une poigne de fer, tandis qu’il approchait la lame acérée de sa gorge. Il la fit soudain glisser sur la peau et une légère entaille laissa coula un filet de sang qui tacha la chemise blanche du jeune garçon terrifié. Le temps semblait s’être figé et même la prof paraissait incapable d’intervenir, nous étions tous hypnotisés par ce qui se déroulait sous nos yeux. Mon regard ne pouvait se détacher de ce pauvre Patrick devenu livide. Il était évident que personne ici ne le portait dans son cœur, mais de là à le regarder se faire saigner sans lever le petit doigt !
– Répète un peu ce que tu viens de dire ? siffla Ourmia en le secouant.
– Je suis désolé, Ourmia. Je ne recommencerai plus, sanglota l’autre.
– Tu vas passer un sale quart d’heure…
– Excuse-moi ! cria Patrick d’une voix désespérée.
Ourmia fixa l’assistance d’un regard menaçant. Je sentis alors l’odeur âpre de l’urine envahir la pièce et compris qu’elle provenait de Patrick. Je fus brusquement tiré de ma léthargie et réalisai que certains des élèves étaient en train de pleurer. Sans savoir pourquoi ni comment, je secouai mon corps engourdi et me dirigeai vers Ourmia. J’étais tout aussi effrayé que les autres, et peut-être même davantage, car je connaissais bien son caractère belliqueux et sa volonté d’aller au bout des choses, sans avoir de limite. Était-ce cette myriade de paires d’yeux anxieux fixés sur moi qui me poussa à réagir, tous ces mômes qui savaient qu’une amitié latente s’était liée entre la bête et moi? Que voulais-je faire ? Empêcher Ourmia de commettre l’irréparable ou me prouver que j’étais capable de courage ? Comme dans un rêve, je vins me placer devant lui et plongeai mon regard dans le sien. Je fus littéralement transporté : j’avais en face de moi un gladiateur numide, fort et fier, gorgé de haine, prêt à tout.
– Ourmia, donne-moi ce couteau ! ordonnai-je d’une voix à la fois douce et ferme.
L’entreprise était audacieuse, d’autant plus qu’Ourmia ne supportait pas les ordres, qu’il considérait comme un affront. Il préférait s’adonner corps et âme à des rixes sans merci. Dans ce cas précis, je savais qu’il n’y aurait pas de retour en arrière. Nous avions le choix entre un aller simple vers l’enfer ou un dénouement pacifique.
– De quoi tu te mêles ? grogna Ourmia en serrant le couteau avec plus de force.
– Donne-le-moi, s’il te plaît, répétai-je posément. Il n’a pas voulu t’offenser. Je suis sûr qu’il ne recommencera plus, n’est-ce pas Patrick ?
Celui-ci opina vivement du chef et un jet de sang jaillit de l’entaille pour venir imbiber le col de sa chemise. Patrick poussa un cri de douleur comme jamais je n’en avais entendu, pas même au cinéma dans les films de Kung-fu. La prof était au bord de l’évanouissement : elle s’affala sur une chaise, une main plaquée sur la bouche, comme pour retenir un cri d’effroi.
L’assurance que je ressentais quelques secondes auparavant en montant sur le devant de la scène laissa soudain place à une terrible angoisse.
– Donne-le-moi ! Arrête tes conneries! murmurai-je.
Je tendis lentement la main et m’emparai du couteau en tentant de dissimuler mes tremblements. Ourmia me laissa faire sans réagir, secoué de soubresauts incontrôlables. Ses gros yeux sombres et globuleux, cernés de haine, étaient noyés de désespoir. Je réprimai une grimace en sentant la douleur provoquée par la lame affûtée qui venait de m’entailler la paume. Je l’avais empoignée avec force pour l’arracher des mains de son propriétaire. Soudain, Ourmia lâcha Patrick qu’il poussa violemment vers moi, avant de s’enfuir en courant. Je ne le revis jamais. Quelques jours plus tard, on le retrouva au fond d’un dépotoir où il avait élu domicile. Il s’était logé une balle de 38 dans la tête, un dernier bras d’honneur à la société qui l’avait refoulé.
Je l’aimais bien.
Adieu Ourmia. Adieu mes bonnes notes…
2
– Dany, donne-moi cette lampe! exigea ma sœur d’un ton sans appel.
– Je dors, répliquai-je en me tournant dans mon lit. Tu as vu l’heure? Il est plus de deux heures du matin!
– Daniel, s’il te plaît! Il faut que je révise pour demain: j’ai une interro de français et je n’ai encore rien fait!
– Ne parle pas si fort, tu vas réveiller Philippe, grommelai-je en me redressant sur mes coudes pour l’apercevoir dans la pénombre. Tu crois que maman est couchée?
– Non, affirma ma sœur, agacée. La lampe!
– Oh, la lampe, la lampe, la barbe! Tu m’embêtes avec ta lumière. Moi aussi j’ai deux interros: histoire et espagnol… une de plus que toi et je n’en fais pas un drame!
Ma sœur m’observait, attendant patiemment que je me taise.
– La différence entre nous, c’est que moi, je suis organisé, poursuivis-je. J’ai préparé des antisèches et je me suis assuré la meilleure place pour copier… Il ne me manque donc qu’une bonne nuit de sommeil pour réussir!
Le lit bateau que nous occupions, mon frère, ma sœur et moi, tangua dangereusement quand Isabelle déploya vers le haut ses longues jambes musclées pour venir taper dans mon sommier. L’échelle métallique fixée sur la rambarde partit à la renverse et brisa la vitrine de notre petit secrétaire. Réveillé en sursaut, Philippe se mit à crier et ma sœur jura entre ses dents.
– Allume! lança-t-elle sèchement.
– Papa a enlevé l’ampoule, répliquai-je.
– Prends la lampe électrique, imbécile!
Une idée me vint soudain:
– J’allume à une condition: tu ne te laves pas les cheveux demain aux aurores, déclarai-je.
– Je ne peux pas aller en cours sans me laver les cheveux! gémit ma sœur.
Elle ne supportait pas de sortir sans une toilette préalable et le bruit qu’elle faisait tôt le matin dans la salle de bains me réveillait invariablement. En effet, si l’on ouvrait trop vite le robinet d’eau chaude, le chauffe-eau jouait du tambour et ce raffut résonnait dans toute la maisonnée. L’appartement que nous occupions était pitoyablement exigu. Situé dans la rue du Ruisseau, quartier populaire du XVIIIe arrondissement, il se composait de deux chambres minuscules, d’un étroit salon contigu à la cuisine Thénardier et d’un petit escalier qui menait aux lavabos et à une douche escamotable qui n’avait jamais fonctionné.
En règle générale, ma sœur et moi allions nous laver chez notre grand-mère paternelle, une à deux fois par semaine. Elle habitait rue Brochant dans le XVIIe. Quant à Philippe, il utilisait la grande bassine destinée à la vaisselle, cela faisait bien l’affaire. Isabelle, qui était la préférée de ma grand-mère, avait droit aux lotions depuis son plus jeune âge. Pour ma part, je devais me contenter du récurant et du produit vaisselle Spic qui, selon ma grand-mère, étaient amplement suffisant. Après tout, j’étais un garçon et tout le monde sait que les garçons ne se plaignent pas...
Un mélange savamment dosé de récurant et de liquide vaisselle parfumait subtilement ma peau et me rendait quasiment irrésistible. Les filles frémissaient d’amour à mon odeur avant de s’éparpiller dans tous les sens en gloussant à chaudes gorges. Là au moins, j’étais persuadé d’être propre. Récuré.
Outre les impitoyables scènes de ménage nocturnes que les parents nous infligeaient au quotidien, mon second calvaire s’avérait donc être les cheveux trop longs de ma chère sœur. Tous les deux jours, cet exécrable rituel, rythmé par des insultes très recherchées, nous procurait son lot de soucis.
Chaque semaine, j’essayais toutefois de m’arranger pour que le shampooing de ma sœur ne soit planifié que pour le vendredi matin. Ce jour-là, je pouvais en effet profiter du cours de musique, de neuf heures à onze heures, pour récupérer et piquer un somme éphémère. Le prof, monsieur Poisson, était un ivrogne invétéré, connu et reconnu depuis longtemps par les bistrots environnants. De surcroît, il était sourd comme un pot. Lorsque le pauvre homme faisait l’appel, seul dix des trente-deux élèves de notre classe étaient présents. Neuf d’entre eux venaient uniquement pour faire leurs devoirs pour le lendemain, et moi, j’étais là pour terminer ma nuit, avachi sur le pupitre, la tête enfouie dans mes bras croisés. Le reste de la classe draguait ou jouait au flipper au café du coin, en fumant des cigarettes empruntées à leurs parents.
Monsieur Poisson avait bien conscience de notre laxisme, mais jamais il ne lui serait venu à l’esprit de nous dénoncer. Peut-être aussi craignait-il que le Proviseur ne le surprenne en état d’ébriété notoire.
Quelques années plus tard, je le rencontrai attablé dans un bistrot, en compagnie de son épouse. Il épongeait un petit vin blanc, le nez rouillé, la bedaine s’échappant de sa chemise souillée. Il était à la retraite.
– Ah! Deschamps! s’était-il écrié, ravi. Cela fait plaisir de vous revoir. Juliette, je te présente l’un de mes élèves les plus assidus. Le plus brillant que j’aie jamais connu au cours de ma carrière.
J’avais croisé le regard morne de sa femme, dont l’esprit était complètement ailleurs.
Chaque matin, quitter la chambre pour rejoindre la salle de bains était un véritable parcours du combattant: il en allait de ma responsabilité de guider mon frère et ma sœur pour les mener à bon port. En effet, nous devions monter sans bruit treize marches défoncées dans une pénombre inquiétante. Elles étaient parsemées d’obstacles invisibles, ce qui compliquait un peu plus les choses. Il y avait tout d’abord les six litres de vin rouge ainsi que les quatre litres de bière déposés quotidiennement au pied de l’escalier. Ensuite, il fallait toujours garder à l’esprit que les troisième et huitième marches grinçaient horriblement. Cependant, le plus dangereux, c’étaient les bouteilles vides, déposées n’importe où en travers de l’escalier. Il n’y avait pas de règle à ce sujet : tout dépendait de l’état d’ébriété de leurs propriétaires. Quelquefois, ils parvenaient à les déposer dans un coin de l’escalier, mais le plus souvent ils trébuchaient et la consigne se brisait sur les marches. Pour arriver en haut, il fallait donc inspecter attentivement chaque marche pour ne pas se blesser et cela prenait un temps considérable.
Toute mission destinée à faire sortir l’un de nous de la chambre m’incombait de droit. Ma sœur en était généralement la principale instigatrice car ni Philippe ni moi-même ne quittions les lieux de notre plein gré; nous tenions à rester au calme le plus longtemps possible. Mais c’était sans compter sur les prérogatives d’Isabelle. Elle n’avait cure de notre tranquillité. Les cheveux d’abord, l’hygiène avant tout!
Rien ne pouvait convaincre ma sœur de faire une croix sur l’entretien de ses longs cheveux soyeux. Avec le temps, elle finit cependant par comprendre que ce n’était pas le plus important: chaque année, elle les raccourcissait un peu plus. Même si à l’époque je préférais une coupe courte, quelques décennies plus tard, j’aurais aimé la retrouver avec ses longs cheveux. Bref, notre relation resta à jamais insoluble...
Dès mon plus jeune âge, j’avais mis au point plusieurs techniques d’évasion pour quitter la chambre en douce. Il y avait par exemple celle de l’éclaireur: tous les indices réunis laissant prévoir une beuverie forcenée au cours de la soirée, je prenais soin d’ôter les clous des clenches quelques heures avant le grand départ. La bataille de cris et d’injures faisant rage entre mes parents, j’attendais patiemment que l’ennemi se retranche dans ses quartiers, l’oreille collée à la porte. Je profitais alors d’un moment d’inattention – lorsque, chacun dans leur coin, mes parents ressassaient les dernières injures proférées en étanchant leurs gosiers asséchés – pour les enfermer dans des pièces séparées. Ma mère dans la cuisine, un verre à la main, et mon père dans la chambre, allongé sur son lit, un mégot aux lèvres.
L’attaque devait être fulgurante. Quand ma sœur me donnait le signal, je me précipitais dans le couloir pour leur claquer la porte au nez et retirais toutes les clenches, sans jamais oublier de pousser un hurlement de victoire. Moi, le jeune écervelé de quinze ans, j’avais réussi à déjouer la vigilance des adultes grâce à ma malice. J’étais tout simplement astucieux. Je pouvais alors distinguer une petite lueur de reconnaissance et d’admiration dans le regard d’Isabelle. J’étais fier. Je me sentais déjà un petit homme. Bien sûr, cette opération éclair provoquait presque immédiatement un tapage nocturne dont nous nous délections avec satisfaction. Nous étions maîtres des lieux. Les portes tenaient bon et nous étions sains et saufs. Nous avions réussi à mettre en cage ces deux rats enragés!
C’était à cet instant que le concert d’insultes atteignait son apogée: mes parents, enfermés chacun dans une pièce, se livraient une bataille d’insultes sans merci. Nous avions honte d’être les spectateurs impuissants d’une telle vulgarité et préférions parfois nous boucher les oreilles pour ne pas entendre les reproches sordides qu’ils échangeaient au sujet de leurs ébats amoureux. Généralement, la conversation était sans grand intérêt. Tout cela se terminait par de violents coups de pied assenés contre la porte de la cuisine, mais c’était plus pour la forme, alors que la nuit touchait à sa fin. Lors des bruyantes disputes de mes parents, aucun voisin ne protestait. Les Vietnamiens étaient de nature nocturne et semblaient trouver ce boucan plutôt folklorique et divertissant, tandis que les Arabes, les crouilles, prenaient leur mal en patience afin d’éviter tout contact avec la police.
Les boules Quiès s’avéraient être le moyen le plus diplomatique et le plus astucieux pour ne plus entendre les sempiternelles disputes parentales. Cette solution était certes onéreuse, mais elle était aussi très drôle. De temps en temps, j’en chapardais une ou deux boîtes au supermarché du coin ou bien mes copains me refilaient des occases, récupérées dans la poubelle familiale. Isabelle raffolait de ces petites boules de caoutchouc. Elle se les enfonçait si profondément dans les oreilles qu’elle avait parfois du mal à les retirer. Quant à Philippe, il trouvait étrange qu’on lui insère de force dans les mauvais orifices ce qu’il pensait être des friandises. Il ne comprenait pas que nous confondions la bouche et les oreilles! Ne supportant pas de ne plus rien entendre, il n’avait de cesse de les arracher, préférant s’appliquer à mâcher cette gomme au goût âpre et farineux qu’il finissait par avaler goulûment!
Lorsque le calme revenait enfin, Isabelle sortait de la maudite chambre et se pavanait en montant les escaliers princiers, d’une démarche hautaine et un sourire narquois sur les lèvres. Elle pouvait enfin aller se laver la tignasse en toute sécurité. Elle prenait alors plaisir à se frotter le crâne en rythme avec le tambourinage désespéré des parents prisonniers. Elle m’en était d’ailleurs reconnaissante et me gratifiait d’un baiser sur le front puis me regardait en silence de ses grands yeux bleus en forme d’amande.
Au petit matin, nos parents finissaient par s’épuiser, et rapidement, nous tombions tous dans un profond sommeil. Nous n’étions nullement inquiets de leur réaction au réveil car nous savions pertinemment qu’ils auraient oublié les événements de la nuit. Ou bien désiraient-ils seulement nous le faire croire? Une chose était sûre, ils n’en parlaient jamais et, de notre côté, nous ne pouvions savoir de quoi ils se souvenaient.
Après trois cuites consécutives, accompagnées de crises de foie aussi douloureuses que nauséabondes, l’heure était à la réconciliation et aux bouteilles de choum. Le plus souvent, cette trêve entre mes parents avait lieu le dimanche. Ils s’affublaient alors de petits noms doux, tels que Chouchou et Sissi, ils ménageaient mutuellement leurs maux de tête et se prodiguaient de tendres attentions, vautrés toute la journée dans le canapé. Nous aussi, nous étions à la noce: ils nous couvraient d’éloges et de caresses et n’avaient que des mots gentils à notre égard. L’amour avec un grand A, comme il se manifeste rarement. Nous étions brusquement transportés dans un univers harmonieux qui nous était inconnu. Nous étions désorientés lors de ces inhabituelles démonstrations d’affection. Cette quiétude chaude et rassurante à laquelle nous aurions voulu nous cramponner nous échappait immanquablement à la fin de cette journée irréelle. Nous nous délections de ces merveilleuses heures de répit. Tels des acteurs médiocres qui ont une fois de plus oublié leur texte, nous avions l’impression de jouer aux enfants heureux comme d’autres jouent aux gendarmes et aux voleurs.
D’un coup de baguette magique, notre détresse se volatilisait le temps d’une journée, elle disparaissait aux confins d’un monde parallèle, presque irréel, qui nous rattraperait pourtant dès le lendemain. En attendant, nous étions redevenus des enfants. Immatures à souhait. Nous leur étions reconnaissants de nous accorder ces quelques heures de bonheur. En vérité, ils nous aimaient, c’était sûr. Mon père installait même une ampoule dans notre chambre pour l’occasion. Si ça, ce n’était pas une preuve!
Ils étaient fiers de leur sage progéniture, obéissante, bien éduquée et enviée de tous, pour laquelle ils sacrifiaient toute leur énergie. Oui, ils nous aimaient… comme on aime un vulgaire jouet électrique aux piles neuves, trouvé par hasard un matin de Noël.
Le soir, repus d’amour, de sérénité et de pot-au-feu – du bœuf trop cuit accompagné de pain rassis – nous avions encore le privilège de regarder la télévision dans leur chambre, l’antre de la Bienfaisance. Nos parents modèles s’enfouissaient alors sous de douillettes couvertures, tandis que mon frère, ma sœur et moi étions avachis par terre, adossés côte à côte au sommier. Nous avions parfois droit à des coussins, mais c’était plutôt rare: en effet, les parents ne pensaient pas à nous en proposer et, de notre côté, nous n’osions pas les réclamer.
À la fin du film, nous allions nous coucher. J’appré-hendais ce moment car je pouvais certes compter sur une nuit calme et réparatrice, choisir le rêve de mon choix avec le luxe de pouvoir le vivre jusqu’au bout, sans embûche, mais c’était sans compter sur l’intervention de ma sœur et de ses maudits cheveux. Pendant le film, ma sœur me lançait des regards en coin. Elle me mettait aussi des coups de coude et de pied, levait les yeux au ciel, se grattait le crâne de façon exubérante et grimaçait, déformant ainsi son joli visage. Cette gestuelle extravagante constituait les prémisses de l’opération « serpent ».
Après les hypocrites afféteries d’usage de ma mère: Bonne nuit les enfants, dormez bien! mon père se levait pour venir nous embrasser sur le front. Il en profitait pour aller pisser discrètement dans la cuisine, certain que nous n’entendrions pas le bruit dans l’évier. Mais aucun son ne nous échappait, preuve en était que les cloisons n’étaient pas épaisses. Quelques instants plus tard, la maisonnette était plongée dans le silence et l’obscurité à peine troublés par des soupirs languissants.
Mon petit frère Philippe avait peur de nos parents. Depuis sa naissance, il était habitué à vivre et à dormir dans le grabuge total. Le seul fait d’être privé de cris et de tumulte le rendait anxieux. Pour le rassurer, je jouais avec lui, je lui accordais de bonne grâce sa séance de tournis assortie d’antiennes abrutissantes qui m’exaspéraient et que je faisais parfois taire à coups de gifles. Vingt minutes plus tard, Chouchou, Sissi et Philippe étaient dans les bras de Morphée.
En allumant l’ampoule, Isabelle donnait le départ. Elle était drôle: accoutrée d’une robe de nuit jaune citron appartenant à ma grand-mère et les bras chargés de brosses et de shampooings qu’elle dissimulait dans un cagibi.
Sans attendre davantage, un rictus au coin des lèvres et les yeux fatigués, je me mettais à l’ouvrage avec la dextérité d’un maître serrurier. J’empoignais la clenche en poussant la porte de toutes mes forces et je commençais à détendre les ressorts de la poignée, centimètre par centimètre, tel un cambrioleur chevronné. Clic, clic, clic... et c’était terminé. Six petits clics menant au Paradis, à la caverne d’Ali Baba, aux savons tant convoités. Je tirais vivement la porte vers moi et Isabelle franchissait le seuil d’un saut de gazelle. Autant dire qu’elle se jetait dans la gueule du loup. Là-bas, toutes les portes restaient entrouvertes. Ma sœur se faufilait silencieusement entre les meubles pour s’engouffrer allégrement dans les escaliers qui menaient au trésor. La difficulté de l’opération résidait moins dans le fait de devoir serpenter de pièce en pièce tel un caméléon – et déjouer les pauses cigarettes que mon père s’octroyait toutes les heures – que de gravir les treize marches grinçantes dans la pénombre et d’enfouir un mètre de cheveux épais dans un lavabo de quarante centimètres de circonférence. Il était encore possible de les mouiller à l’aide d’un robinet minuscule crachotant de l’eau glacée, puis de les frotter énergiquement, mais l’étape du rinçage s’avérait plus délicate. En effet, c’était un peu comme de cuisiner un mètre de spaghettis dans une poêle à crêpes et de les égoutter à l’aide du même ustensile, alors qu’une grosse marmite aurait été nécessaire. Pourtant ma sœur était capable d’une telle prouesse. Le lendemain, elle se levait de bonne humeur, humait avec plaisir sa chevelure parfumée, s’habillait gaiement en fredonnant un refrain à la mode et s’en allait d’un pas léger sur le chemin du lycée, fière de son exploit. Mon père ne remarquait jamais la fraîcheur de sa crinière et ma mère dormait encore.
Mais parfois, la bonne étoile d’Isabelle lui faisait faux bond. Un gobelet dégringolant les escaliers, un courant d’air faisant claquer le fenestron, voire un éternuement intempestif, suffisaient à faire échouer notre entreprise. L’hygiène à la dérive, ma sœur s’échouait alors lamentablement contre le rebord de l’évier, les cheveux trempés, englués de mousse, les yeux rougis par le savon. Mon père ne tardait pas à lui sauter dessus et la pauvre Isabelle devait endurer sans broncher ses cris de fureur que j’entendais depuis mon lit. Dépitée, elle revenait se coucher, honteuse, telle une voleuse prise la main dans le sac. Elle se recroquevillait sur elle-même et pleurait doucement sous les draps.
Malgré ma fatigue, j’essayais de la consoler :
– Allez, Isabelle, c’est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Tu veux que je t’aide à les sécher?
Dans ces moments-là, une véritable détresse s’emparait d’elle qui devrait se rendre à l’école dans cet état, les cheveux sales, englués de savon…
3
L’année 1978 se mourait dans une gaieté circonspecte. Inévitablement, les préparatifs des fêtes de décembre envahissaient les artères et les vitrines parisiennes, tandis qu’un froid glacial et une pluie fine et pénétrante enveloppaient les passants. Je suais sous mon vêtement de nylon. Encore un long mois de torture m’attendait, cette fois-ci coloré de guirlandes. Le soir venu, les rues, les arbres, les magasins et les fenêtres étincelaient de mille bougies multicolores. Les gens emmitouflés dans de chauds manteaux rentraient chez eux, après une longue journée de labeur, et semblaient prendre plaisir à exhiber leurs lourds paquets enrubannés. Chaque cave, chaque grenier, chaque armoire fermant à clé, ainsi que toutes les cachettes possibles et imaginables étaient réquisitionnés pour accueillir les présents tant convoités, destinés à être déposés sous le sapin.
La rue du Poteau ne faisait pas exception. Moi, je n’avais rien et j’avais faim. Ce soir-là, je rentrais de la bibliothèque, mes devoirs bâclés dans le cartable et des bandes dessinées plein la tête. Je traînais de boucheries en charcuteries, de traiteurs en boulangeries, affriolé comme une mouche à merde par leurs vitrines alléchantes. Une nouvelle fois, le haut responsable des animations de fin d’année n’avait pas pensé à moi. Le Père Noël ne récompensait que les gens heureux et méritants.