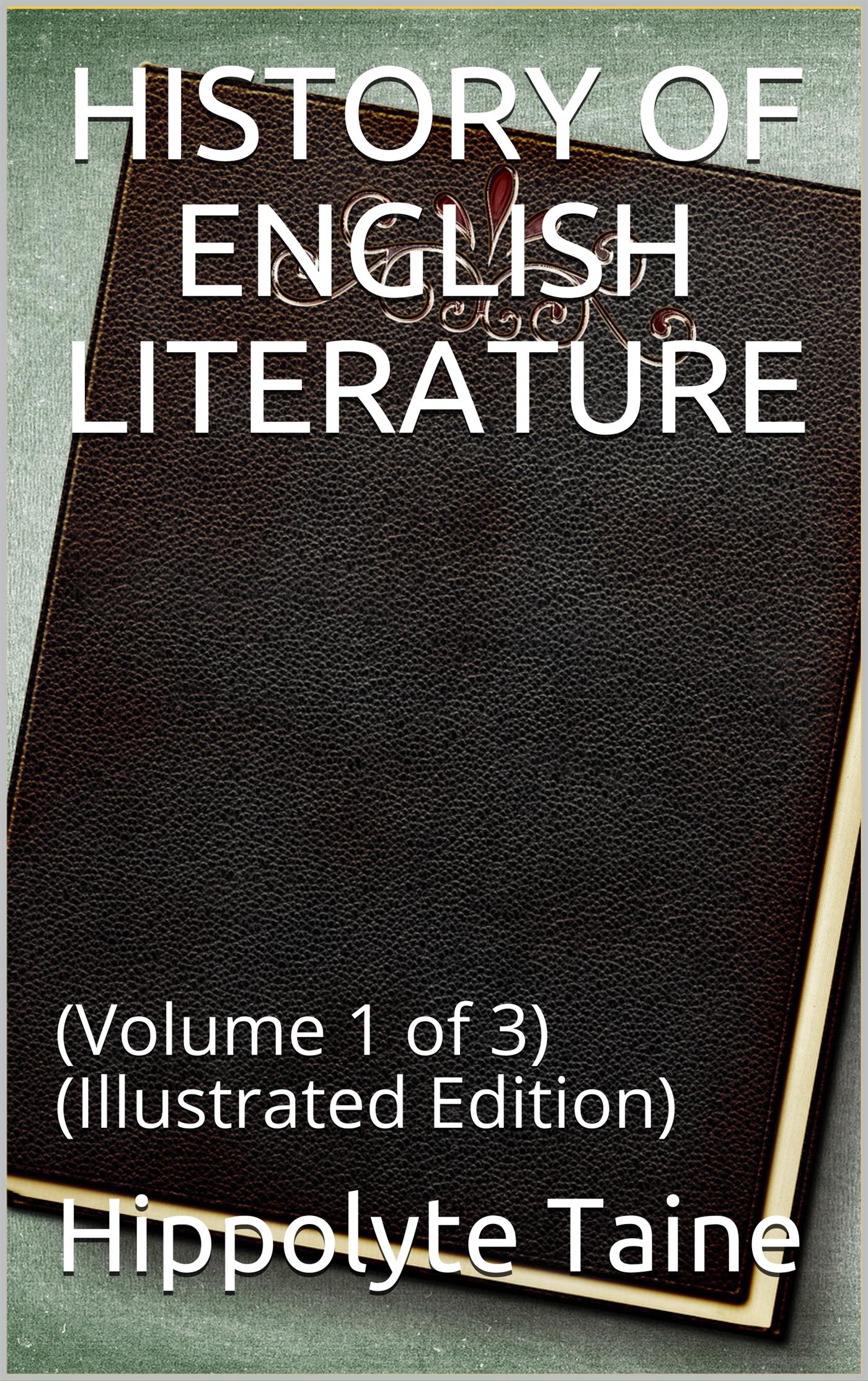Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "Il y a une infinité d'entr'actes en voyage : ce sont les heures vides, celles de la table d'hôte, du coucher, du lever, l'attente aux stations, l'intervalle entre deux visites, les moments de fatigue et de sécheresse..."À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARANLes éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes. LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants : • Livres rares• Livres libertins• Livres d'Histoire• Poésies• Première guerre mondiale• Jeunesse• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À M. CHARLES BELLAY
PEINTRE À ROME
Acceptez ce livre, mon cher Bellay, en souvenir de nos
promenades, de nos discussions et de vos complaisances, en témoignage de ma grande estime et de ma vive amitié.
Décembre 1865.
H. TAINE.
À M…. à Paris
Connais-tu rien de plus désagréable que les entractes ? On se tortille sur son fauteuil, et l’on se détire les membres en bâillant avec discrétion. On a mal aux yeux ; on regarde pour la centième fois les figures tirées des musiciens, le premier violon qui fait des grâces, la clarinette qui reprend haleine, la contrebasse patiente qui ressemble à un cheval de louage dételé après un relais. On se retourne vers les loges ; on aperçoit au-dessus des épaules décolletées une grosse tache noire, la lorgnette énorme qui semble un morceau de trompe et cache les visages ; un air malsain, épais, pèse sur la fourmilière de l’orchestre et du parterre ; dans un poudroiement de lumière crue, on démêle une multitude de têtes inquiètes et grimaçantes, des sourires faux ; la mauvaise humeur perce sous la politesse et la décence. On achète un journal, qu’on trouve stupide ; on va jusqu’à lire le libretto, qui est encore plus stupide, et on finit par se dire tout bas qu’on a perdu sa soirée : l’entracte est plus ennuyeux que la pièce n’est amusante.
Il y a une infinité d’entractes en voyage : ce sont les heures vides, celles de la table d’hôte, du coucher, du lever, l’attente aux stations, l’intervalle entre deux visites, les moments de fatigue et de sécheresse. Pendant tout ce temps-là, on voit la vie en noir. Je ne sais qu’un remède, c’est d’avoir un crayon et d’écrire des notes…
Prends ceci comme un journal auquel il manque des pages et, de plus, tout personnel. Quand une chose me plaira, je ne prétends pas qu’elle le plaise, encore moins qu’elle plaise aux autres. Le ciel nous préserve des législateurs en matière de beauté, de plaisir et d’émotion ! Ce que chacun sent lui est propre et particulier comme sa nature ; ce que j’éprouverai dépendra de ce que je suis.
À ce propos même, je dois commencer par un petit examen de conscience ; il est prudent de regarder la construction de son instrument avant de s’en servir. Expérience faite, cet instrument, âme ou esprit, éprouve plus de plaisir devant les choses naturelles que devant les œuvres d’art ; rien ne lui semble égal aux montagnes, à la mer, aux forêts et aux fleuves. Dans le reste, la même disposition l’a suivi ; en poésie comme en musique, en architecture ou en peinture, ce qui le touche par excellence, c’est le naturel, l’élan spontané des puissances humaines, quelles qu’elles soient et sous quelque forme qu’elles se manifestent. Pourvu que l’artiste ait un sentiment profond et passionné, et ne songe qu’à l’exprimer tout entier, tel qu’il l’a, sans hésitation, défaillance ou réserve, cela est bien ; dès qu’il est sincère et suffisamment maître de ses procédés pour traduire exactement et complètement son impression, son œuvre est belle, ancienne ou moderne, gothique ou classique. À ce titre, elle représente en abrégé les sentiments publics, les passions dominantes du temps et du pays où elle est née, en sorte que la voilà elle-même une œuvre naturelle, l’œuvre des grandes forces qui conduisent ou entrechoquent les évènements humains. – L’instrument ainsi construit a été promené dans l’histoire, surtout parmi les œuvres littéraires, longtemps aussi parmi les œuvres d’art, les seules qui par leur relief sensible conservent à la postérité le corps vivant et toute la personne humaine, à travers les estampes et les musées de France, de Belgique, de Hollande, d’Angleterre et d’Allemagne. Comparaison faite, il s’est trouvé sensible d’abord et au-dessus de tout à la force héroïque ou effrénée, c’est-à-dire aux colosses de Michel-Ange et de Rubens, – ensuite à la beauté de la volupté et du bonheur, c’est-à-dire aux décorations des Vénitiens, – au même degré et peut-être plus encore au sentiment tragique et poignant de la vérité, à l’intensité de la vision douloureuse, à l’audacieuse peinture de la fange et de la misère humaines, à la poésie de la lumière trouble et septentrionale, c’est-à-dire aux tableaux de Rembrandt. C’est cet instrument que j’emporte aujourd’hui en Italie ; voilà la couleur de ses verres ; tiens compte de cette teinte dans les descriptions qu’il produira. Je m’en défie moi-même, et j’ai tâché de me munir d’autres verres pour m’en servir à l’occasion ; la chose est possible, l’éducation critique et historique y pourvoit. Avec de la réflexion, des lectures et de l’habitude, on réussit par degrés à reproduire en soi-même des sentiments auxquels d’abord on était étranger ; nous voyons qu’un autre homme, dans un autre temps, a dû sentir autrement que nous-mêmes ; nous entrons dans ses vues, puis dans ses goûts ; nous nous mettons à son point de vue, nous le comprenons, et, à mesure que nous le comprenons mieux, nous nous trouvons un peu moins sots.
C’est déjà ici le vrai pays méridional ; il commence aux Cévennes. La terre du Nord est toujours mouillée et noirâtre ; même en hiver, les prairies y restent vertes. Ici tout est gris et terne : montagnes pelées, rocs blanchâtres, grandes plaines sèches et pierreuses ; presque point d’arbres, sauf sur les pentes adoucies, dans les creux encombrés de cailloux, où des oliviers pâles, des amandiers abritent leurs files souffreteuses. La couleur manque, c’est un simple dessin, délicat, élégant comme les fonds du Pérugin. La campagne ressemble à quelque grande étoffe d’un gris de lin, rayée, uniforme ; mais le doux soleil pâle luit amicalement dans l’azur ; une brise faible arrive aux joues comme une caresse ; ce n’est point l’hiver, c’est une attente, l’attente de l’été. – Et tout d’un coup s’étalent les magnificences du Midi, l’étang de Berre, admirable nappe bleue, immobile dans sa coupe de montagnes blanches ; puis la mer, ouverte à l’infini, la grande eau rayonnante, paisible, dont la couleur lustrée a la délicatesse de la plus charmante violette ou d’une pervenche épanouie ; tout alentour des montagnes rayées, qui semblent couvertes d’une gloire angélique, tant la lumière y habite, tant cette lumière, emprisonnée dans les creux par l’air et la distance, semble être leur vêtement. Une fleur de serre dans une vasque de marbre, les veines nacrées d’un orchis, le velours pâle qui borde ses pétales, la poussière de pourpre violacée qui dort dans son calice, ne sont pas à la fois plus splendides et plus doux.
Le soir, sur la route qui longe la mer, un air tiède venait au visage ; les senteurs des arbres verts se répandaient de toutes parts comme un parfum d’été, l’eau transparente était semblable à une émeraude liquide. Les formes vagues des montagnes demi-perdues dans l’obscurité, les grandes lignes des côtes, étaient toujours nobles, et, tout au bord du ciel, une éclaircie, une bande de pourpre ardente laissait deviner la magnificence du soleil.
Ce port silencieux, ce grand bassin noir luisant sont étranges. Les agrès, les cordages, le sillonnent de raies encore plus noires. Trois falots luisent dans le lointain comme des étoiles, et la longue traînée de lueur qui tremblote sur l’eau semble un collier de perles qui se défait. Le navire s’ébranle avec lenteur, comme un saurien colossal, quelque monstre antédiluvien qui ronfle ; sur les deux flancs, dans le sillage, les renflements et les abaissements de l’eau font une horrible nageoire noirâtre ; ou croirait voir la membrane d’une grenouille monstrueuse. Au-dessous de soi, on sent l’hélice qui infatigablement troue la mer de sa tarière ; les côtes du navire en tremblent ; jusqu’au matin, on sent ce percement puissant et monotone, comme d’un plésiosaure devenu esclave, et employé à remplacer le travail des hommes.
Ce matin, le temps est doux, brumeux et calme. Les crêtes des petits flots parsèment de leurs blancheurs le brouillard ardoisé ; des nuées moites pendent et s’égouttent aux quatre coins de l’horizon. Mais comme ces vagues de velours terni seraient belles si le soleil s’étalait sur leur dos ! J’ai vu le ciel et cette mer en plein été, dans leur splendeur. Il n’y avait point de mots pour exprimer la beauté de l’azur infini, qui de tous côtés s’allongeait à perte de vue. Quel contraste avec le dangereux et lugubre Océan ! Cette mer ressemblait à une belle fille heureuse dans sa robe de soie lustrée, toute neuve. Du bleu et encore du bleu rayonnant jusqu’au bout, jusqu’au fond, jusqu’au bord du ciel, et çà et là des franges d’argent sur cette soie mouvante. On redevenait païen, on sentait le perçant regard, la force virile, la sérénité du magnifique soleil, du grand dieu de l’air. Comme il triomphait là-haut ! Comme il lançait à pleines poignées toutes ses flèches sur la nappe immense ! Comme les flots étincelaient et tressaillaient sous la pluie de flammes ! On pensait aux Néréides, aux conques sonnantes des Tritons, à des cheveux blonds dénoués, à des corps blancs lavés d’écume. L’ancienne religion de la joie et de la beauté renaissait au fond du cœur, au contact du paysage et du climat qui l’ont nourrie…
Toujours le même ciel tiède et triste. La mer route lentement, demi-rougeâtre et demi-bleuâtre, avec telle teinte d’ardoise foncée qu’on voit dans les carrières profondes. Parfois le soleil affleure entre les nues, et on voit reluire au loin tout un morceau de mer.
Vers le soir, apparaissent des pics neigeux, une longue bordure de montagnes ; puis, de plus près, les âpres flancs bosselés, la côte brune de la Corse. Cela est grau à force de simplicité, mais cette nudité est stérile. On se récite involontairement les vers d’Homère sur « l’Océan infécond, indomptable. » Cette grande eau sauvage n’est bonne à rien ; on ne peut pas l’apprivoiser, la soumettre, l’accommoder aux usages de l’homme.
Le bateau s’est arrête. Tout à coup, dans la clarté grise de l’aube, on aperçoit un môle rond, une ligne crénelée de maisons, des toits plats et rougeâtres nettement tranchés sur la surface tranquille de l’eau.
Vers la pleine mer, un beau navire à voiles avance, demi-penché comme un oiseau qui plane. – Rien de plus ; deux ou trois lignes noires sur un fond clair, avec la blancheur et la fraîcheur de la mer et de l’aube. On dirait d’une marine esquissée au crayon par un grand maître.
On entre dans la ville, et l’impression change : une triste ville, mélange de ruelles infectes et de bâtiments administratifs qui ont la platitude et la correction de l’emploi. Quelques-unes de ces ruelles ont cinq pieds de large, et les maisons s’appuient les unes sur les autres par des contreforts mis en travers. Le soleil n’y arrive jamais ; la boue est gluante. Parfois l’entrée est une vieille bâtisse du Moyen Âge avec un porche et des sortes de créneaux. On entre avec hésitation dans ce boyau, et des deux côtés apparaissent des bouges noirs où des enfants crasseux, de petites filles ébouriffées enfilent leurs bas et tâchent de rattacher ensemble leurs haillons. Jamais une éponge n’a passé sur les vitres, ni un balai sur les escaliers ; la saleté humaine les a imprégnés et en suinte ; une âcre odeur saumâtre monte aux narines. Plusieurs fenêtres semblent croulantes ; les escaliers disjoints rampent autour des murs lépreux. Dans les rues transversales, parmi la fange, les tronçons de choux et les pelures d’oranges, quelques échoppes, plus basses que le pavé, entrebâillent leur trou, et l’on y voit s’agiter des ombres : un boucher qui étale de la viande saignante et des quartiers de veau pendus au mur ; un fruitier qui a l’air du plus farouche sicaire ; un énorme moine, sale, l’air effronté, qui rit largement les mains posées sur sa bedaine ; un chaudronnier noblement drapé, calme et fier comme un prince ; et tout alentour une quantité de figures expressives, quelques-unes parfaitement belles, presque toutes énergiques, avec des attitudes d’acteur, souvent avec une sorte de gaieté bouffonne et une promptitude extrême à prendre l’expression grotesque. Nos Français du bateau, nos vingt jeunes soldats avaient l’air bien plus doux et bien moins emphatique ; c’est une race de fabrique moins forte et plus fine.
C’est ici que notre pauvre Stendhal a vécu si longtemps, les yeux tournés vers Paris. « Mon malheur, écrivait-il, c’est que rien n’excite la pensée ; quelle distraction puis-je trouver au milieu des cinq mille marchands de Civita-Vecchia ? Il n’y a là de poétique que les douze cents forçats ; impossible d’en faire ma société. Les femmes n’ont qu’une seule pensée, celle de se faire donner un chapeau de France par leur mari. » Il reste encore ici un ami de Stendhal, un archéologue : à ce litre, il passe pour libéral ; depuis vingt ans, il n’a pu obtenir la permission d’aller passer trois heures à Rome.
Çà et là dans les rues, sur les places, s’étale la vie méridionale. Un chaudronnier, des cordonniers ambulants travaillent en plein air. – Des gamins, pieds nus, le museau barbouillé, jouent aux cartes sur une charrette. – À l’angle d’une ruelle ignoble, sous un bec de lampe, une madone entourée de cierges, de fleurs, de couronnes, de cœurs coloriés, sourit sous son verre, et les passants se signent. – Deux pêcheurs arrivent sur la place avec trois corbeilles ; un marché s’improvise, vingt personnes s’assemblent alentour avec curiosité comme devant un spectacle, gesticulant et fumant ; des demi-messieurs emportent leur poisson dans leur foulard. – Une quantité de polissons déguenillés et de grands gaillards drapés dans leurs manteaux noirs ou bruns vaguent dans les coins, respirent l’odeur des fritures, regardent la mer ; certainement il y a dix ans qu’ils couchent par terre dans leur manteau, jugez de la teinte ; l’orteil perce à travers les souliers crevés. Le pantalon a passé cinq ou six fois à travers les couleurs claires et sombres, du gris au noir, du noir au brun, du brun au jaune, troué de plus et rapiécé ; on ne saurait trouver une chose plus composite. Cela leur est indifférent ; ils flânent philosophiquement, en contemplatifs, en épicuriens ; ils se laissent vivre ; ils récréent leurs sens par le spectacle des belles choses et la conversation oiseuse ; ils laissent le travail aux lourdauds. À l’embarcadère, il a fallu cinq quarts d’heure pour enregistrer vingt-cinq malles. Sur six hommes employés, deux travaillaient, les quatre autres délibéraient et regardaient ; pour les faire aller, il fallait se mettre en colère. Aucun ordre ; une malle passait d’autant plus vite que les propriétaires avaient crié bestia d’une voix plus rude. Plus la nature est belle et bonne, moins l’homme est obligé d’être actif et soigneux. Le Hollandais, le paysan de la Forêt-Noire seraient trop malheureux, si leur intérieur n’était pas agréable et propre. Ici le travail et la discipline sont superflus, la nature se charge de fournir le bien-être et la beauté.
On longe la mer, qui s’étend à l’infini, toute plate, d’un bleu terne, avec un faible roulement monotone ; on ne cesse pas de la voir à droite, pendant des lieues, bordant le sable d’une grosse frange toute blanche. Sur la campagne plane toujours le grand-voile de brume tiède.
À gauche, les collines se suivent, montant, s’abaissant, avec d’aimables teintes d’un vert effacé et comme amorti. Elles n’ont point de vrais arbres, mais des genêts, des genévriers, des lentisques, des ajoncs, d’autres arbres encore à feuilles tenaces. Tout cela est désert ; à peine si dans tout le trajet, de loin en loin, au bord d’un creux, on aperçoit une ferme. Des ruisseaux descendent, tordant leur lit, puis s’étalent en flaques ; la mer les repousse ; cela fait un pays malsain, hostile à l’homme. Quelques chevaux libres, des bœufs noirs, aux longues cornes, paissent sur les pentes ; on se dirait dans les landes de Gascogne. De temps en temps on voit le long du wagon un bois de grands arbres gris, dénudés, mélancoliques comme des malades.
Voici enfin la campagne de Rome ; rien que des collines nues, sans arbres ni arbustes, avec un mauvais tapis d’herbes vieilles et jaunâtres ; point d’aqueducs encore, rien qui rompe la monotonie lugubre ; puis des jardins, des baies d’épine noire liées par de grands joncs blanchâtres, des plantes potagères, des dômes à l’horizon, un vieux rampart de briques et de bastions noircis, un long aqueduc comme un mur immense, Sainte-Marie-Majeure avec un campanile et deux dômes. Au débarcadère, une cohue de fiacres, des criailleries de cochers, de conducteurs, de guides, qui à toute force s’approprient votre bagage et votre personne, un flot roulant de figures hétéroclites, Anglais, Allemands, Américains, Français, Russes, tous se heurtant, s’entassant, se renseignant avec tous les accents et dans toutes les langues ; sur tout le trajet jusqu’à l’auberge, l’aspect d’une ville de province, mal tenue, mal rangée, baroque et sale, avec des rues étroites et boueuses, avec des taudis, des galetas, des fritures en plein vent, du linge qui sèche aux cordes, et quantité de hautes maisons monumentales, dont les fenêtres treillissées, les grillages énormes, les barreaux croisés, boulonnés, multipliés, donnent l’idée d’une forteresse et d’une prison.
J’avais une journée, j’ai voulu voir le Colisée et Saint-Pierre. Certainement il est imprudent de noter ici ses premières impressions, telles qu’on les a ; mais, puisqu’on les a, pourquoi ne pas les noter ? Un voyageur doit se traiter comme un thermomètre, et, à tort ou à raison, c’est ce que je ferai demain comme aujourd’hui.
Au Colisée d’abord. Tout ce que j’ai vu de la calèche était rebutant : des ruelles infectes pavoisées de linge sale ou de linge qui sèche, de vieilles bâtisses suintantes, noirâtres, tachées d’infiltrations graisseuses, des tas d’ordures, des échoppes, des guenilles, tout cela sous une petite pluie. Les ruines, les églises, les palais qu’on aperçoit sur le chemin, tout l’ancien appareil me semblait un habit brodé il y a deux siècles, mais vieux de deux siècles, c’est-à-dire dédoré, flétri, troué et peuplé d’une vermine humaine.
Le Colisée apparaît, et l’on est subitement secoué. On l’est véritablement : cela est grand, on n’imagine rien de plus grand. Personne dans l’intérieur ; un profond silence ; rien que des blocs de pierre, des herbes pendantes, et de temps en temps un cri d’oiseau ; on est content de ne pas parler, et on demeure immobile ; les yeux montent, et redescendent, et remontent sur les trois étages de voûtes et sur l’énorme mur qui les domine ; puis on se dit que c’était là un cirque, qu’il y avait sur ces gradins cent sept mille spectateurs, que tout cela criait, applaudissait, menaçait à la fois, que cinq mille bêtes étaient tuées, que dix mille captifs combattaient dans cette enceinte, et l’on prend une idée de la vie romaine.
Cela fait haïr les Romains ; personne n’a plus abusé de l’homme ; de toutes les races européennes, aucune n’a été plus nuisible ; il faut aller cherche les despotes et les dévastateurs orientaux pour leur trouver des pareils. Il y avait là une monstrueuse ville, grande comme Londres aujourd’hui, dont le plaisir consistait avoir tué et souffrir. Pendant cent jours, plus de trois mois de suite, ils venaient tous les jours ici pour voir tuer et souffrir. Et c’est là le trait propre, distinctif de la vie romaine : le triomphe d’abord, le cirque ensuite. Ils avaient conquis une centaine de nations, et trouvaient naturel de les exploiter.
Sous un pareil régime, les nerfs et l’âme devaient arriver à un état extraordinaire. Nul travail ; on les nourrissait avec des distributions ; ils vivaient oisifs, se promenaient dans une ville de marbre, se faisaient masser dans les bains, regardaient des mimes, des acteurs, et, pour se distraire, allaient contempler la mort et les blessures ; cela les secouait, ils y passaient des journées.
Saint Augustin a éprouvé et décrit cet attrait terrible ; tout le reste paraissait fade ; on ne pouvait plus s’en arracher. Au bout d’un temps, parmi ces habitudes d’artistes et de bourreaux, l’équilibre humain s’est renversé, il s’est produit des monstres extraordinaires, non pas seulement des brutes sanguinaires ou des assassins calculateurs comme au Moyen Âge, mais des curieux et des dilettanti, des Caligula, des Commode, des Néron, sortes d’inventeurs maladifs, poètes féroces, qui, au lieu d’écrire ou de peindre leurs fantaisies, les ont pratiquées. Beaucoup d’artistes modernes leur ressemblent, mais par bonheur ne sortent pas du papier noirci. Alors comme aujourd’hui l’extrême civilisation produisait l’extrême tension et les convoitises infinies. On peut considérer les quatre premiers siècles après le Christ comme une expérience en grand dans laquelle l’âme a recherché par système la sensation excessive. Tout ce qui était moindre lui paraissait plat.
Du centre, quand le gladiateur voyait les cent mille figures et les pouces relevés qui demandaient sa mort, quelle sensation ! C’est celle de l’écrasement sans pitié ni rémission. Ici s’achève le monde antique ; c’est le règne incontesté, impuni, irrémédiable de la force. Comme il y avait des spectacles pareils dans tout l’empire romain, on comprend que sous une pareille machine l’univers soit devenu vide. – De là, et par contraste, le christianisme.
On revient et on regarde. La beauté de l’édifice consiste dans sa simplicité. Les voûtes sont le cintre le plus naturel et le plus solide, avec une bordure unie. L’édifice s’appuie sur lui-même, inébranlable, combien supérieur aux cathédrales gothiques avec leurs contreforts qui semblent les pattes d’un crabe ! Le Romain trouve son idée suffisante, il n’a pas besoin de la décorer. Un cirque pour cent mille hommes et qui dure indéfiniment, cela est assez. Il agit là comme dans ses inscriptions dans ses dépêches, supprimant les phrases. Le fait parle assez haut et se fait entendre par lui seul. En cela consiste sa grandeur : des actions et non des paroles une sorte de sereine et hautaine confiance en soi, l’orgueil calme, la conscience de pouvoir faire et supporter plus que les autres hommes. – Mais le sentiment de la justice et de l’humanité lui a toujours manqué, non seulement dans l’antiquité, mais encore à la Renaissance et au Moyen Âge. Les Romains ont toujours compris la patrie à la façon antique, comme une ligue fermée, utile pour opprimer et exploiter autrui. Bien plus, au Moyen Âge, cette patrie n’a été pour eux qu’un champ clos où chaque homme fort tâchait par ruse et violence d’asservir les autres. Je ne sais plus quel cardinal, passant d’Italie en France, disait que si l’on prend pour marque du christianisme la bonté, la douceur, la confiance mutuelle, les Italiens sont deux fois moins chrétiens que les Français. Voilà l’objection que je me suis toujours faite en lisant Stendhal, leur grand admirateur, que j’admire tant. Vous louez leur énergie, leur bon sens, leur génie ; vous dites avec Alfieri que la plante homme naît en Italie plus forte qu’ailleurs, vous vous en tenez là, cela vous paraît l’éloge le plus complet, vous n’imaginez pas qu’on puisse souhaiter autre chose à une race. C’est prendre l’homme isolément, à la manière des artistes et des naturalistes, pour voir en lui un bel animal puissant et redoutable, une pose expressive et franche. L’homme pris tout entier est l’homme en société et qui se développe ; c’est pourquoi la race supérieure est celle qui est apte à la société et au développement. À ce titre, la douceur, les instincts sociables, le sentiment chevaleresque de l’honneur, le bon sens flegmatique, la sévère conscience puritaine, sont des dons précieux, peut-être les plus précieux de tous. Ce sont eux qui au-delà des Alpes ont produit des sociétés et un développement ; c’est le manque de ces dons qui de ce côté des Alpes a empêché la société de s’établir et le développement de se faire. Un certain instinct de subordination prompte est un avantage dans une nation en même temps qu’un défaut dans un individu, et peut-être est-ce la puissance de l’individu qui a barré ici le chemin à la nation.
Au centre du cirque est une croix : un nomme en habit bleu, un demi-bourgeois, s’est approché au milieu du silence, a ôté son chapeau, replié son parapluie vert, et avec une dévotion tendre a baisé trois ou quatre fois de suite, à baisers pressés, le bois de la croix. On gagne par baiser deux cents jours d’indulgence.
Le ciel s’est éclairci, et à travers les arcades, tout à l’entour, on voyait des escarpements verts, de hautes ruines panachées de buissons, des fûts de colonnes, des arbres, des amas de décombres, un champ de longs roseaux blanchâtres, l’arc de Constantin posé en travers, le plus singulier mélange d’abandon et de culture. C’est ce que l’on trouve partout en traversant Rome : des restes de monuments et des morceaux de jardins, une friture de pommes de terre sous des colonnes antiques, près du pont d’Horatius Coclès l’odeur de la vieille morue, et sur les flancs d’un palais trois savetiers tirant leur alêne, ou bien un plant d’artichauts.
On laisse ses jambes aller, et on flâne. Point de cicerone, c’est le moyen de ne rien voir et d’être assourdi. Je demande mon chemin à un demi-monsieur, fort complaisant, qui fait la conversation avec moi. Il est allé à Paris, admire fort la place de la Concorde et l’arc de l’Étoile ; il a visité Mabille, et en a gardé un souvenir profond. Les photographies des danseuses et des lorettes illustres de Paris sont ici affichées aux vitres ; j’ai vu partout à l’étranger que ces dames faisaient notre principale réputation. Ah ! que la France est agréable, qu’il fait bon de se promener sur le boulevard Montmartre !
Le ciel était devenu tout à fait clair, l’air était tiède et le pavé sec. Du café où j’ai déjeuné, je ne sais plus sur quelle place, je voyais une quarantaine de drôles assis sur le trottoir, ou appuyés aux angles des maisons, occupés à ne rien faire ; ils fumaient, flânaient, faisaient es commentaires sur le temps et les passants. Trois ou quatre, en guenilles qui laissaient voir la chair aux genoux, sales comme de vieux balais, dormaient contre le mur, à plat sur les cailloux. Une demi-douzaine, les plus actifs, jouaient à la morra, ouvrant et fermant la main et criant le nombre des doigts fermés ou ouverts. Le plus grand nombre ne disait rien et ne bougeait pas.
Assis en file sur le rebord du trottoir, le menton sur la main, le manteau ramené sur les cuisses, ils étaient contents d’avoir chaud, et point trop chaud ; cela leur suffisait. Quelques-uns, les voluptueux, mâchonnaient Point remué pendant une grande heure.
Sur toute la longueur de la rue, les fenêtres s’ouvrent, et les femmes, les jeunes filles se montrent aux balcons et prennent l’air. On ne peut pas imaginer un contraste plus étrange : belles pour la plupart, de vigoureuses têtes expressives, des cheveux noirs lustrés, soigneusement relevés sur les deux tempes, des yeux brillants, la forte et franche couleur florissante de la santé, une robe fraîche, un peigne doré, une chaîne, des bijoux, et tout cela encadré dans le mur d’un bouge. Les plâtras se sont disjoints ; la vieille boue éclabousse les devantures, et sur toute la rue allonge sa traînée noirâtre. Si l’on approche, on voit une entrée borgne, des toiles d’araignées qui pendent aux barreaux descellés, un escalier qui tourne comme un boyau, et à l’intérieur toutes les vilenies du ménage, du linge en un tas, une casserole à terre, des enfants en chemise. Ce ne sont point de malhonnêtes femmes ; mais leur bonheur consiste à bien s’habiller, à passer leur après-midi sur leur balcon, comme un paon sur son perchoir.
Au bout d’une longue rue, Saint-Pierre se découvre. Nulle beauté plus solide et plus saine que celle de cette grande place ; notre Louvre, la place de la Concorde ne sont en comparaison que des décorations d’opéra. Elle va montant, et se découvre ainsi d’un coup d’œil tout entière. Deux superbes colonnades l’enserrent de leur courbe. Au centre, un obélisque, et sur les flancs deux fontaines agitant leurs panaches d’écume peuplent son énormité. Quelques points noirs, des hommes assis, des visiteurs qui montent, une file de moines, rayent la blancheur de ses gradins, et, au sommet de tous ces escaliers, sur un entassement de colonnes, de frontons, de statues, s’élève le gigantesque dôme.
On a pourtant fait tout ce qu’il fallait pour le cacher. Au second regard, il est clair que la façade l’écrase ; c’est celle d’un hôtel de ville emphatique ; on l’a construite dans un temps de décadence. On a compliqué les formes, multiplié les colonnes, prodigué les statues, entassé les pierres, en sorte que la beauté a disparu sous l’encombrement. On entre, et à l’intérieur la même impression réparait. Un mot reste sur les lèvres : grandiose et théâtral. Cela est puissant, mais cela est emphatique. Il y a trop de dorures et de sculptures, trop de marbres de prix, trop de bronzes, d’ornements, de caissons et de médaillons. À mon gré, toute œuvre architecturale ou autre doit être comme un cri, comme une parole sincère, l’extrémité et le complément d’une sensation, rien d’autre : par exemple, tel Titien ou tel Véronèse fait pour occuper voluptueusement et magnifiquement les yeux pendant un festin d’apparat ou une représentation officielle, ou bien encore un intérieur de vraie cathédrale gothique, celle de Strasbourg avec son énorme nerf noirâtre traversée de pourpre ténébreuse, avec ses files de piliers muets, avec sa crypte sépulcrale engloutie dans l’ombre, avec ses rosaces lumineuses qui, parmi toutes ces terreurs chrétiennes, semblent une percée sur le paradis.
Au contraire, il n’y a pas de sensation franche et simple qui aboutisse à cette église ; c’est une combinaison, comme notre Louvre. On s’est dit : « Faisons la plus magnifique et la plus imposante décoration qu’il se pourra. » Bramante a pris les grandes voûtes du palais de Constantin, Michel-Ange le dôme du Panthéon, et, de ces deux idées païennes, agrandies l’une par l’autre, ils ont tiré un temple chrétien.
Ces voûtes, cette coupole, ces puissantes courbures, cet appareil est magnifique et grand. Et pourtant il n’y a en somme que deux architectures, la grecque et la gothique ; les autres en sont des transformations, des déformations ou des amplifications.
Les gens qui ont fait Saint-Pierre étaient des païens qui avaient peur d’être damnés, rien de plus. Ce qu’il y a de sublime dans la religion, l’effusion tendre devant un Sauveur compatissant, l’effroi de la conscience devant le juste juge, l’enthousiasme lyrique et viril de l’Hébreu devant la face du Dieu foudroyant, l’épanouissement du libre génie grec devant la beauté naturelle et heureuse, tous ces sentiments leur manquaient. Ils faisaient maigre le vendredi et peignaient un saint pour obtenir ses bons offices. Michel-Ange, en manière de récompense, reçut du pape je ne sais combien d’indulgences, à la condition de faire à cheval le tour des sept basiliques de Rome. Ils avaient de fortes passions, une énergie intacte, ils ont atteint la grandeur parce qu’ils sortaient d’une grande époque ; mais le vrai sentiment religieux, ils ne l’ont point eu. Ils ont renouvelé l’ancien paganisme, mais une seconde pousse ne vaut jamais la première. La petite superstition, la dévotion étroite sont venues vite déformer et affadir la puissante inspiration primitive. On n’a qu’à regarder la décoration intérieure pour voir vers quels vices ils penchent. Bernin a infesté l’église de statues maniérées qui se déhanchent et font des grâces. Tous ces géants sculptés qui se démènent avec des visages et des habits demi-modernes, et qui pourtant veulent être antiques, font le plus piteux effet. On se dit, en voyant cette procession de portefaix célestes : « Beau bras, bien levé. Mon brave moine, tu tends vigoureusement la cuisse. Ma bonne femme, la robe flotte convenablement, sois contente. Mes petits anges, vous vous enlevez aussi lestement que sur l’escarpolette. Mes chers amis, vous surtout, les cardinaux de bronze, et vous, les vertus symboliques, vous êtes des figurants réussis qui posez pour l’expression dramatique. »
Je reviendrai : probablement aujourd’hui je suis injuste ; mais, pour la sincérité du sentiment, je suis sûr qu’elle manque. On se sent pris de mauvaise humeur devant ces danseurs sentimentaux que Bernin a rangés en file sur le pont Saint-Ange. Ils veulent avoir l’air tendre ou coquet, et tortillent leur vêtement grec ou romain comme une jupe du dix-huitième siècle. Aucune de ces œuvres d’art n’est pure ; trois ou quatre sentiments contraires y viennent heurter leurs disparates. Le sujet est un personnage ascétique ayant pour occupation de jeûner et de donner les étrivières, et on lui donne un corps, un vêtement païens, toute sorte de traits qui expriment l’attache à la vie présente. Rien de plus déplaisant pour moi qu’un gril, un cilice, des yeux mystiques dans un vigoureux jeune homme, dans une jeune femme bien portante, qui, en somme, ne songent qu’à faire l’amour. Impossible ici de ressentir aucun des attendrissements, aucune des terreurs qui sont le propre de la cathédrale gothique et de la vie chrétienne ; l’édifice est trop doré, trop bien éclairé, les voûtes et les piliers ont une beauté trop forte. Impossible d’y trouver cette fraîcheur de sensations simples, cette sérénité riante, ce souffle d’éternelle jeunesse que l’on respire dans un temple antique et dans la vie grecque. Les croix, les tableaux de martyres, les squelettes d’or et le reste rappellent par trop d’emblèmes les mortifications et es renoncements mystiques. En somme, il n’y a ici qu’une salle de spectacle, la plus vaste, la plus magnifique du monde, par laquelle une grande institution étale aux yeux sa puissance. Ce n’est pas l’église d’une religion, mais l’église d’un culte.
Les rues sont presque désertes, et le spectacle est grandiose, tragique comme les dessins de Piranèse. Très peu de lumières ; il n’y en a que juste ce qu’il faut pour montrer les grandes formes et faire ressortir l’obscurité. Les saletés, les dégradations, les mauvaises odeurs ont disparu. La lune luit dans un ciel sans nuages, et l’air vif, le silence, la sensation de l’inconnu, tout excite et secoue.
Cela est grand, voilà l’idée qui revient sans cesse. Rien de mesquin, de commun ou de plat : il n’y a pas de rue ni d’édifice qui n’ait son caractère, un caractère tranché et fort. Aucune règle uniforme et comprimante n’est venue niveler et discipliner ces bâtisses. Chacune a poussé à sa guise sans se soucier des autres, et leur pêle-mêle est beau comme le désordre de l’atelier d’un grand artiste.
La colonne Antonine dresse son fût dans la nuit claire, et autour d’elle les solides palais s’asseyent fortement, sans lourdeur. Celui du fond, avec ses vingt arcades éclairées et ses deux larges baies rondes toutes luisantes, semble une arabesque de lumière, quelque étrange féerie qui flamboie dans l’ombre.
La fontaine de la piazza Navone ruisselle magnifiquement dans le silence, et ses eaux jaillissantes renvoient en cent mille reflets les clartés de la lune. Sous cette lumière qui vacille, dans l’ondoiement incessant, les statues colossales semblent vivantes ; l’apparence théâtrale s’efface : on ne voit plus que des géants qui se tordent et qui s’élancent parmi des bouillonnements et des lueurs.
Les corniches des fenêtres, les vastes balcons saillants, les rebords sculptés des toits, rayent les murs de puissantes ombres. À gauche et à droite, on voit s’ouvrir des ruelles lugubres, béantes comme un antre ; çà et là se dresse le flanc noir d’un couvent qui paraît abandonné, quelque haute maison surmontée d’une tour qui semble un reste du Moyen Âge ; les lumières lointaines tremblotent misérablement, et les ténèbres s’épaississant semblent dévorer toute vie.
Rien de formidable comme ces énormes monastères, ces palais carrés, où pas une lumière ne brille, et qui se lèvent isolés dans leur masse inattaquable, comme une forteresse dans une ville assiégée. Les toits plats, les terrasses, les frontons, les âpres formes enchevêtrées tranchent avec leurs fortes arêtes sur le ciel clair, tandis qu’à leurs pieds les portes indistinctes, les bornes, les tournants rampent dans l’ombre.
On avance, et tout reste de vie s’efface. On se croirait dans une ville abandonnée et morte, squelette d’un grand peuple soudainement anéanti. On passe sous les arcades du palais Colonna, le long des murs muets de ses jardins, et l’on n’entend plus, on ne voit plus rien d’humain ; seul, de loin en loin, au fond d’une rue tortueuse, vague d’un porche qui semble un soupirail, un réverbère mourant vacille avec son cercle lueur jaunâtre. Les maisons fermées, les hautes murailles allongent leur file inhospitalière comme une rangée d’écueils au flanc d’une côte, et au sortir de leur ombre de grands espaces s’ouvrent tout d’un coup blanchis par la lune, pareils à une plage de sable déserte.
Voici enfin la basilique de Constantin et ses arcades énormes avec leur chevelure de plantes grimpantes. Les yeux s’arrêtent devant leur courbe puissante ; puis soudainement, entre leurs rebords lézardés, on aperçoit le bleu pâle, l’étrange azur nocturne, comme un pan de cristal incrusté de pointes de flammes. On fait trois pas, et la divine coupole du ciel, le grand épanchement de clarté sereine, les mille pierreries scintillantes du firmament, apparaissent dans le Forum vide. On marche le long des colonnes gisantes dont le tronc semble encore plus monstrueux. Appuyé contre un de ces fûts dont l’épaisseur monte jusqu’à la poitrine, on regarde le Colisée. La paroi qui est demeurée entière est toute noire et se lève d’un seul élan, colossale. On dirait qu’elle penche vers le dehors et va tomber. Sur la portion ruinée, la lune verse une lumière si vive qu’on démêle la teinte rougeâtre des pierres. Dans ce ciel limpide, la rondeur du cirque devient sensible ; il forme une sorte d’être complet et formidable. Au milieu de cet étonnant silence, on dirait qu’il existe seul, que les hommes, les plantes, toute vie passagère n’est qu’une apparence ; j’ai éprouvé autrefois cette sensation dans les montagnes ; elles aussi semblent les vrais habitants de la terre ; on oublie la fourmilière humaine, et, sous le ciel qui est leur tente, on devine le dialogue muet des vieux monstres, possesseurs immuables et dominateurs éternels.
Au retour, au pied du Capitole, les basiliques lointaines, les arcs de triomphe, surtout les nobles et élégantes colonnes des temples ruinés, les unes solitaires, les autres encore assemblées en files fraternelles, semblent vivantes. Ce sont aussi des êtres calmes, mais en outre beaux et simples, comme des éphèbes grecs. Leur tête ionienne porte un ornement de chevelure, et la lune pose un reflet sur le poli de leur corps de marbre.
Un long aqueduc sur la droite ; de loin en loin à l’horizon une ruine ; çà et là sur le passage une arche isolée, tombante, et à perte de vue, tout alentour, la plaine jaunâtre et verdâtre, onduleuse, sous un vieux tapis d’herbes flétries que la pluie lave et que le vent ébouriffe. Les nues grises et violacées pendent lourdement sur le ciel et la fumée de la machine roule des oncles blancs qui vont se mêler aux nuages. Mille après mille, l’aqueduc monotone reparaît comme une digue de rochers dans une mer d’herbes mouvantes. Vers l’orient, des montagnes noirâtres se hérissent, à demi blanchies par les neiges ; vers le couchant, s’étend une campagne cultivée, avec les petites têtes et les mille tiges fines des arbres à fruit dépouillés ; un ruisseau jaune y fraye sa route en ravinant les terres.
Tout cela est triste, et les stations le sont encore davantage. Ce sont de misérables cabanes en bois où l’on allume un feu de fagots pour réchauffer les voyageurs. Quelques mendiants, de jeunes garçons se pressent à l’entrée, implorant une baïoque, une demi-baïoque, une pauvre petite demi-baïoque pour l’amour de Dieu, et de la madone, et de saint Joseph, et de tous les saints du paradis, avec l’insistance, l’âpreté et les petits cris tendres ou violents de chiens qui voient un os et n’ont pas mangé depuis huit jours. Je ne sais pas ce qu’ils ont aux pieds ; ce ne sont pas des sandales, encore moins des souliers : cela semble un paquet de linges, de vieux chiffons ramassés dans les ruisseaux et qui clapotent avec eux dans la boue. Le chapeau à larges bords plié et défoncé, la culotte, le manteau sont indescriptibles ; rien n’y ressemble, sauf les torchons de cuisine, les vieux linges infects qu’on entasse dans les entrepôts de chiffons pour faire du papier.
J’ai regardé beaucoup de figures, et celles que j’ai vues depuis que j’ai mis le pied en Italie me sont revenues en mémoire. Tout cela se groupe autour de trois ou quatre types saillants. – Il y a d’abord la jolie et fine tête de camée, parfaitement régulière, spirituelle, à l’air vif et alerte, capable de tout comprendre « à l’instant, faite pour inspirer l’amour et pour bien parler d’amour. – Il y a aussi la tête carrée plantée sur un coffre solide, avec de fortes lèvres sensuelles et une expression de grosse joie, de verve bouffonne ou satirique. – Il y a l’animal maigre, noir, brûlé, dont le visage n’a plus de chair, tout en traits saillants, d’une expression incroyable, avec des yeux de flamme, des cheveux crépus, semblable à un volcan qui va faire explosion. – Il y a enfin l’homme beau et vigoureux, fortement bâti et musclé, sans lourdeur, au teint chaudement coloré, qui vous regarde fixement en lace, tout à fait complet et fort, qui semble attendre l’action et l’expansion, mais qui en attendant ne se prodigue pas, demeure immobile.
Tout ce chemin et ce paysage jusqu’à Naples doivent être bien beaux, mais par un ciel clair et en été : quantité de montagnes nobles et variées, point énormes et cependant grandes, demi-boisées ; parfois une ville blanche et grise qui couvre une colline entière, ronde comme une ruche d’abeilles… Mais la pluie et le brouillard confondent les formes, l’hiver salit tout : il n’y a point de verdure ; les feuillages, secs et roussis, pendent aux arbres comme un vieux vêtement, les torrents bourbeux défoncent la terre. C’est un cadavre, au lieu d’une belle fille florissante.
C’est un autre climat, un autre ciel, presque un autre monde. Ce matin, en approchant du port, quand l’espace s’est élargi et que l’horizon s’est découvert, je n’ai plus vu tout d’un coup que de blancheurs et des splendeurs. Dans le lointain, sous la brume qui couvrait la mer, les montagnes s’étageaient et s’allongeaient, lumineuses et satinées comme des nuages. La mer s’avançait à grandes ondes blanchissantes, et le soleil, versant son fleuve de flammes, faisait comme une tramée de métal fondu jusqu’à la plage.
J’ai passé une demi-journée sur la Villa-Reale ; c’est une promenade plantée de chênes et d’arbustes toujours verts, et qui longe la côte. Quelques jeunes arbres, transpercés par la lumière, ouvrent leurs petites feuilles tendres et épanouissent déjà leurs fleurettes jaunes. Des statues, de beaux jeunes gens nus, Europe sur le taureau, penchent leurs corps de marbre blanc entre le vert léger des plantes. Des flaques de clarté viennent s’étaler sur les gazons, des herbes grimpantes s’entrelacent autour des colonnes, çà et là éclate la pourpre vive des fleurs nouvelles, et les calices délicats ; veloutés, tremblent sous la brise tiède qui arrive entre les troncs des chênes. L’air et la mer sont bienfaisants ; quel contraste, si l’on se rappelle les côtes de l’Océan, nos falaises de Normandie et de Gascogne, battues par les vents, flagellées par la pluie, où les arbres rabougris se cachent dans les creux, où les ajoncs, le gazon rasé, se collent misérablement contre les pentes ! Ici le voisinage des flots nourrit les plantes ; on sent la fraîcheur et la douceur du souffle qui vient les caresser et les ouvrir. On s’oublie, on écoute le petit bruit des feuilles qui chuchotent, on regarde leurs ombres qui remuent sur le sable. Cependant, à six pas, la mer roule avec un bourdonnement profond, à mesure que ses nappes écumeuses viennent s’amincir et s’arrondir sur le sable. La brume s’évapore sous le soleil ; entre les feuillages, on aperçoit le Vésuve et ses voisins, toute la chaîne des monts qui se dégagent. Ils sont d’un violet pâle, et, à mesure que le jour baisse, ce violet devient plus tendre. À la fin, la plus fine teinte de mauve, une corolle de fleur est moins charmante ; le ciel s’est épuré, et la mer calmée n’est plus qu’azur.
Impossible de rendre ce spectacle. Lord Byron a bien raison : on ne peut pas mettre de niveau les beautés des arts et celles de la nature. Un tableau reste toujours au-dessous et un paysage toujours au-dessus de l’idée qu’on s’en peut faire. Cela est beau, je ne sais pas dire autre chose, cela est grand et cela est doux ; cela fait plaisir à tout l’homme, cœur et sens ; il n’y a rien de plus voluptueux et il n’y a rien de plus noble. Comment se donner l’embarras de travailler et de produire quand on a cela devant les yeux ? Ce n’est pas la peine d’avoir une maison bien ordonnée, de construire laborieusement ces vastes machines qu’on appelle une constitution ou une église, de rechercher des jouissances de vanité ou de luxe : on n’a qu’à regarder, à se laisser vivre ; on a toute la fleur de la vie avec un regard.
J’étais assis sur un banc ; je voyais le soir gagner, les teintes s’effacer, et il me semblait que j’étais dans les Champs-Élysées des anciens poètes. Les formes élégantes des arbres se dessinaient dans l’azur clair. Les platanes dépouillés, les chênes nus, eux-mêmes, semblaient sourire. La sérénité délicieuse du ciel, rayé par le fin treillis de leurs branches, se communiquait à eux. Ils ne paraissaient point morts ou engourdis comme chez nous, mais assoupis, et, sous l’attouchement de cet air tiède, prêts à entrouvrir leurs bourgeons, à confier leurs pousses au printemps voisin. Çà et là une étoile s’allumait, la lune commençait à verser sa lumière blanche. Les statues, plus blanches encore, semblaient vivantes dans cet aimable jour mystérieux et nocturne. Des groupes de jeunes femmes dont les robes ondulaient légèrement avançaient sans bruit, comme des ombres heureuses. Il me semblait que j’assistais à l’antique vie grecque, que je comprenais la finesse de leurs sensations, que l’harmonie de ces formes effilées et de ces teintes effacées suffirait à m’occuper toujours, que je n’avais plus besoins de coloris ni de splendeur. J’entendais réciter les vers d’Aristophane ; je revoyais son jeune athlète, chaste et beau, content, pour tout plaisir, de se promener, une couronne sur la tête, parmi les peupliers et les smilax en fleur, avec un sage ami de son âge. Naples est une colonie grecque, et, plus on regarde, plus on sent que le goût et l’esprit d’un peuple prennent la forme de son paysage et de son climat.
Vers huit heures il n’y avait plus un souffle de vent. Le ciel semblait de lapis-lazuli ; la lune, comme une reine immaculée, luisait seule au milieu de l’azur ; son ondée tremblait sur la grande eau, et paraissait un fleuve de lait. Il n’y a pas de mot pour exprimer la grâce et la douceur des montagnes enveloppées dans leur dernière teinte, dans le vague violet de leur robe nocturne. Le môle, la forêt des barques, par leur noirceur profonde, les rendaient encore plus charmantes, et Chiaja, vers la droite, arrondissant autour du golfe sa ceinture de maisons illuminées, lui faisait une guirlande de flammes.
De toutes parts, les fanaux brillent ; les gens, en plein air, causent haut, rient et mangent. Ce ciel à lui seul est une fête.
Quelles rues on traverse ! Hautes, étroites, sales, bordées à tous les étages de balcons qui surplombent, une fourmilière de petites boutiques, d’échoppes en plein vent, d’hommes et de femmes qui achètent, vendent, bavardent, gesticulent, se coudoient, la plupart rabougris et laids, les femmes surtout, petites et camardes, la face jaune et les yeux brillants, malpropres et fripées, avec des châles à ramages et des fichus violets, rouges, orangés, toujours de couleur voyante, et des bijoux de cuivre. Aux environs de la piazza del Mercato s’enchevêtre un labyrinthe de ruelles dallées et tortueuses, encrassées de poussière ancienne, jonchées d’écorces d’oranges et de pastèques, de restes de légumes, de débris sans nom ; la foule s’entasse, noire et grouillante, dans l’ombre palpable, au-dessous de la bande claire du ciel. Tout cela remue, mange, boit, sent mauvais ; on dirait des rats dans une ratière : c’est l’air épais, la vie débraillée et abandonnée des lanes de Londres. Par bonheur, ici le climat est favorable aux galetas et aux guenilles.
Parfois, au milieu de ces taudis, s’élève l’encoignure énorme, la porte monumentale d’un ancien hôtel ; on aperçoit, par une ouverture, de larges escaliers à balustres qui montent et s’entrecroisent, des terrasses intérieures soutenues par une colonnade, les restes de la vie murée et grandiose telle qu’elle apparut sous la domination espagnole. Les seigneurs habitaient là avec leurs gentils hommes, leurs domestiques armes, leurs carosses, quêtant des pensions, donnant des fêtes, assistant aux cérémonies, seuls apparents, seuls importants, pendant que dans les ruelles la canaille des marchands et des artisans regardait leurs somptueuses parades, elle-même aussi dédaignée et aussi piteuse que jadis le trou peau des serfs tolérés autour du donjon féodal.
Quantité de moines trottent dans la boue avec des sandales ou des souliers sans bas ; plusieurs ont une tête narquoise et bouffonne, comme d’un Socrate croisé de Polichinelle ; la plupart sont vraiment peuple : ils pataugent dans leur vieux troc râpé, et marchent des épaules avec une allure de cocher. Un d’eux se penchait, accoudé à un balcon, pour nous mieux voir, charnu, pansu, joufflu, gros frocard avisé comme en peint Rabelais, bien étalé dans son importance et sa graisse, tel qu’un porc curieux et défiant qui regarde. D’autre part, dans de meilleures rues, on rencontrait de jeunes abbés élégants, tout en noir, tirés à quatre épingles, avec une expression de réserve intelligente et diplomatique. Haut et bas, il y en a pour les salons et pour les gargotes.
Cinq ou six églises sur la route ; les statues de la Vierge y sont peintes comme des poupées de coiffeurs, et, de plus, habillées comme des dames, l’une avec une grande robe rose, de larges rubans bleus, une coiffure savante, et six épées dans la poitrine. Le petit Jésus, les saints, sont aussi vêtus à la façon moderne ; quelques-uns portent un froc véritable, d’autres montrent leur peau de cadavre et des stigmates saignants. Impossible de parler plus physiquement aux yeux et à tous les sens. Une vieille femme à genoux gémissait devant la Vierge. Ainsi habillée et ensanglantée, la Madone est aussi réelle que telle princesse veuve ; on lui parle du même ton, et on pleure pour l’attendrir.
Santa-Maria della Pietra, Santa-Chiara, San-Gennaro. La première est une bonbonnière brillante : on y montre une statue de la Pudeur sous son voile ; mais le voile est si mince, si collant, si bien tendu par la gorge et les nudités du corps, qu’elle est plus que nue. Au fond d’une crypte est un Christ mort enveloppé dans son linceul ; le gardien allume une bougie, et dans cette teinte blafarde, dans l’air humide et froid, les yeux, les sens, tout l’être nerveux se trouble comme au contact d’un cadavre. Ce sont là les tours de force de la superstition et de la sculpture ; il y a de quoi faire briller l’artiste, amuser l’épicurien et faire frémir le dévot. Je ne parle pas du luxe des peintures, des ornements prodigués, de la décoration prétentieuse ; cela est encore bien plus visible à Santa-Chiara dans les énormes feuillages d’argent qui encombrent l’autel, dans la quantité de balustrades en cuivre doré, dans les pompons, les petites boules d’or, les cierges enguirlandés, les autels surchargés de colifichets, comme ceux que les petites filles arrangent et enjolivent à la Fête-Dieu. Il en est de même dans une quantité d’églises dont j’oublie les noms. Ce catholicisme païen est choquant ; on y découvre toujours un fonds de sensualité sous une apparence d’ascétisme. Les têtes de mort, les sabliers, les invocations mystiques font disparate sur les dorures, colonnes de marbre précieux et les chapiteaux grecs. Ils n’ont du christianisme que la superstition et la peur. Ici particulièrement, la grandeur manque et l’afféterie règne. Ils font d’une église un magasin de jolies choses.
En cherchant bien le sentiment des gens pour qui on a bâti cela, je ne trouve que le désir d’aller prendre le frais dans une boutique d’orfèvrerie, ou tout au plus la Pensée qu’en donnant beaucoup d’argent à un saint il vous préservera de la fièvre ; c’est un casino à l’usage des cervelles imaginatives. Pour les architectes et les peintres, ce sont des déclamateurs qui, par leurs trompe-l’œil, leurs voûtes énormes à courbes étranges, essayent de réveiller l’attention blasée. Tout cela indique une vilaine époque, l’extinction du vrai sentiment, l’enflure d’un art qui se travaille et qui s’use, les pernicieux effets d’une civilisation gâtée et d’une domination étrangère. Et pourtant, dans cette décadence, il y a toujours quelque morceau qui se sent de l’ancien et puissant génie : à San-Gennaro par exemple, de vigoureux corps peints par Vasari au-dessus des portes, des plafonds de Santa-Fede et de Forti, des groupes amples, des personnages de fière tournure et bien lances, des tombeaux, une grande nef où s’allongent en file des médaillons d’archevêques, et dont la haute courbe monumentale, le fond doré en coquille s’étalent avec la majesté d’une décoration.
Nous montons par des ruelles sales et populeuses ; je ne puis m’habituer à ces déguenillés qui remuent les bras et bavardent. Les femmes ne sont point jolies ; le visage est d’un ton terreux, même chez les jeunes filles ; le nez épaté gâte la figure : le tout n’est qu’un minois éveillé, parfois piquant, assez voisin des visages chiffonnés du dix-huitième siècle, mais à cent lieues de la beauté grecque qu’on lui attribue.
Nous montons, nous montons encore, nous montons toujours. Cela ne finit pas : escaliers sur escaliers, et toujours des guenilles et du linge pendu aux cordes, puis encore des ruelles, des ânes chargés qui assurent leur pied sur la pente glissante, des ruisseaux fangeux qui dégringolent misérablement entre les cailloux, des gamins en guenilles qui demandent l’aumône, des ménages en plein vent. La montagne est une sorte d’éléphant où se sont nichés des insectes humains qui grattent et tracassent. Telle maison n’a pas de rez-de-chaussée, on y monte par une échelle ; ailleurs la porte demeure ouverte, et dans l’enfoncement sombre on voit un homme qui joue d’une guitare parmi des femmes qui épluchent des légumes. Et tout d’un coup, au sortir de cette friperie, de ces trous à rats, de ce campement de pauvres diables, s’ouvre le splendide couvent, parmi toutes les magnificences de la nature et toutes les recherches de l’art.
Une cour surtout, ample, bordée de quatre portiques de marbre blanc, avec une vaste citerne grisâtre au centre, m’a semblé admirable. Des buis hauts et épais, des lavandes bleuâtres, la couvrent de leur simple et saine verdure ; au-dessus brille le blanc luisant des marbres, puis le riche azur du ciel : chaque couleur encadre et fait ressortir l’autre. Comme on comprend ici l’architecture et les portiques ! Dans le Nord, ils ne sont qu’un hors-d’œuvre, une importation dépendants ; on n’en a que faire ; on ne se promène pas le soir en plein air, on n’a pas besoin d’abri contre le soleil, ni d’ouvertures pour recevoir la brise de la mer. Et surtout on n’y sent pas le besoin de lignes nettes et tranchées, de couleurs simples, en petit nombre, largement opposées. Il faut être sous le plein azur du ciel, pour jouir du poli et de la blancheur des marbres. L’art est fait pour ce Pays. Dans la disposition heureuse où le ciel lumineux et cet air frais mettent l’âme, on aime l’ornement, on est content de voir sous ses pieds des marbres colorés qui forment un dessin, d’apercevoir au bout de la galerie un grand médaillon richement sculpté, de contempler, au sommet des portiques, des statues demi-nues de beaux jeunes saints, une sainte finement drapée. Le christianisme devient pittoresque et aimable, il réjouit les yeux, il met l’âme dans une attitude riante et noble. Au bout de la galerie s’ouvrent des balcons sur la mer. De là paraît Naples, immensément étalée et prolongée jusqu’au Vésuve par une traînée de maisons blanches, autour du golfe la côte qui se courbe, embrassant la mer toute bleue, et au-delà le miroitement d’or, le fourmillement lumineux des flots sous le soleil, qui a l’air d’une lampe suspendue dans la rondeur concave du ciel.
Au-dessous descend une longue pente d’oliviers d’un vert terne ; ce sont les jardins du couvent. Des allées ombragées de treilles s’allongent partout où le sol a pu être de niveau. Des plates-formes avec de grands arbres solitaires, des bâtisses massives qui enfoncent leurs assises dans le roc, une colonnade en ruine, en face le golfe entier, les petites voiles des navires, le Monte-San-Angelo, le Vésuve qui fume : le couvent est un petit monde fermé, mais complet, et combien de beautés dans son enceinte ! On est transporté à cent lieues de notre petite vie étriquée et bourgeoise. Ils vont tête nue, dans un froc brun ou blanc, avec de gros souliers ; mais la beauté les entoure, et je n’ai pas vu de palais de prince qui laisse une impression si noble. Le petit confort manque, et à cause de cela tout le reste est relevé.
J’ai vu dernièrement une des plus riches et des plus élégantes maisons modernes, située comme celle-ci en face de la mer. Le maître est un homme de goût qui a gagné des millions, et qui jette l’argent. Tout est vernissé, et il n’y a rien de grand ; pas une colonnade, pas une haute salle d’apparat ; qu’en ferait-on ? Cela est agréable à habiter ; mais il n’y a pas un coin, ni au-dehors, ni au-dedans, qu’un peintre eût envie de copier. Chaque objet pris en soi est une merveille de raffinement et de commodité, il y a six boutons de sonnettes auprès du lit ; les stores sont admirables ; rien de plus doux que les fauteuils. On aperçoit, comme dans les maisons anglaises, quantité de petits ustensiles qui pourvoiront à de petits besoins. L’architecte et le tapissier ont raisonné sur les meilleurs moyens d’éviter le chaud, le froid et le trop grand jour, de se laver, de cracher, mais ils n’ont point raisonné sur autre chose.
Les seuls objets d’art sont quelques tableaux de Watteau et de Boucher. Encore font-ils disparate : ils rappellent un autre âge. Est-ce qu’il subsiste encore chez nous quelque reste du dix-huitième siècle ? Est-ce que nous avons de vraies antichambres et la splendide parade de la vie aristocratique ? Tant de laquais nous ennuieraient, si nous gardons des courtisans, c’est dans nos bureaux ; nous ne voulons chez nous qu’un bon fauteuil moelleux, des cigares choisis, un dîner fin, et, tout au plus pour les jours de représentation, l’étalage d’un luxe neuf qui nous fasse honneur. Nous ne savons plus prendre la vie en grand, sortir de nous-mêmes ; nous nous cantonnons dans un petit bien-être personnel, dans une petite œuvre viagère. Ici on réduisait le vivre et le couvert au simple nécessaire. Ainsi dégagée, l’âme comme les yeux, pouvait contempler les vastes horizons, tout ce qui s’étend et dure au-delà de l’homme.