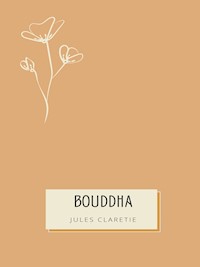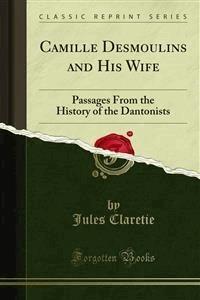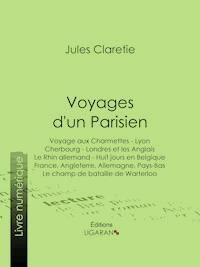
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est surtout, c'est seulement peut-être en matière de voyages que l'éclectisme est chose excellente. Quand la fantaisie vous prend, un beau jour, de quitter votre ruisseau de la rue du Bac, peu importe que vous partiez pour l'Angleterre ou pour la Chine. Chacun choisit son but selon son humeur ou sa fantaisie, et Paul qui part pour l'Italie ne trouve pas étonnant que Pierre prenne la route d'Espagne. On obéit à ses goûts, à ses instincts, à ses rêves".
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À
M. H. SHELTON-SANFORD
Ministre des États-Unis d’Amérique à Bruxelles
Vous êtes, Monsieur, un de ceux dont le suffrage m’est le plus cher. Vous avez bien voulu reporter sur moi l’amitié que vous avez pour les miens. Permettez-moi donc de mettre ce livre sous votre patronage.
C’est un livre de voyages, mais vous n’y trouverez ni descriptions de contrées lointaines, ni découvertes d’hémisphères inconnus. Nous autres Français – je ne le dis pas à notre louange – nous semblons avares de nos pas ; une excursion à Saint-Cloud nous paraît un voyage au long cours, et le Savoisien Xavier de Maistre avait devancé l’annexion en écrivant le Voyage autour de ma Chambre. C’était une façon de se naturaliser Français.
Mais si nous sortons peu de chez nous, peut-être avons-nous cette qualité de voir beaucoup en peu de temps, en marchant, en rêvant, en causant…
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mon respectueux et sincère attachement.
JULES CLARETIE
Paris, 1er février 1865.
Le départ. – Chapitre des projets. – Souvenirs de Jean-Jacques. – La poésie du wagon. – De Paris à Lyon. – La ville des canuts. – Fourvières. – Le pèlerinage. – Archéologie. – Le musée de Lyon. – Vingt lignes d’histoire. – Espagnols et Flamands. – Les peintres lyonnais.
C’est surtout, c’est seulement peut-être en matière de voyages que l’éclectisme est chose excellente. Quand la fantaisie vous prend, un beau jour, de quitter votre ruisseau de la rue du Bac, peu importe que vous partiez pour l’Angleterre ou pour la Chine. Chacun choisit son but selon son humeur ou sa fantaisie, et Paul qui part pour l’Italie ne trouve pas étonnant que Pierre prenne la route d’Espagne. On obéit à ses goûts, à ses instincts, à ses rêves. Et y a-t-il rien de plus charmant que le départ pour un voyage depuis longtemps médité, projeté, souhaité ? Que de fois vous êtes-vous promis de visiter enfin quelque contrée riche de surprises, d’interroger certain coin de terre tout plein encore de souvenirs ! Mais les années ont passé, le loisir vous a fait défaut, il vous a fallu demeurer où la nécessité vous attachait et vous contenter d’un mirage. À ce voyage chimérique vous ne songez plus désormais que pour vous convaincre que les espérances ici-bas sont trompeuses, et que l’homme a beau proposer, Dieu ne dispose pas toujours.
Mais un jour vient (vous qui l’attendez, prenez patience ; il viendra) où toute une échappée de liberté vous apparaît. L’occasion si longtemps cherchée est enfin offerte, la route est tracée, le chemin est libre : à votre porte les chevaux piaffent et là-bas la locomotive siffle. – « Comment ! je puis partir ? » – Mieux que cela, vous devez partir. Et voilà que tout joyeux vous allez en riant vers le but désiré, pendant que vous apparaissent déjà, – selon que votre désir évoque le Nord ou le Sud, – les vieux burgs du Rhin, les hautes terres écossaises ou les rouges palais de Venise.
C’est ainsi que je suis parti l’autre jour, ému comme si j’eusse dû aller au bout du monde. Je n’allais pas si loin, mais depuis longtemps j’attendais ce voyage et j’y marchais avec toute une escorte de souvenirs. J’allais simplement aux Charmettes. Mais ceux-là comprendront pourquoi j’avais hâte d’arriver qui ont lu ce pauvre grand livre, les Confessions, dont on ne parle plus beaucoup aujourd’hui et qu’on dédaigne, mais qui fut notre ami le premier, le premier nous murmura tout bas les plus douces paroles, trompeur charmant qui nous montrait tant de sourires et tant de joies encadrées dans de si riants paysages ! Comme on le lit avec émotion, comme on le relit avec fièvre, ce testament d’un cœur ulcéré par la vie, mais qui redevient bon au souvenir de son bonheur ! Quelle irrésistible et douce séduction ! et comme on suit, le cœur battant, à travers tous les sentiers fleuris, ce guide enivré qui nous enchante ! C’est que ce n’est pas un auteur, ce Rousseau, c’est un homme ; et ce qu’il a ressenti, ce qu’il a aimé, ce qu’il a souffert, avec lui plutôt qu’après lui, nous le ressentons, nous le souffrons et nous l’aimons. Avec lui nous avons crié : « Un aqueduc ! un aqueduc ! » avec tout l’accent du triomphe. Nous avons été comme lui tout tremblants quand il s’est agenouillé devant cette bonne et charmante madame Basile ; nous aurions voulu jeter nos lèvres à mademoiselle Galley comme il lui jetait ses cerises, et nous arrêter avec lui, pour savourer toute sa joie, dans cet asile des Charmettes où l’amante était une mère, où le rêveur décorait son amour du nom de vertu.
Et je suis parti prenant le plus long, à la façon de La Fontaine, ou comme Nodier, qui s’arrêtait à tout vent dans ses promenades, et en route pour l’Académie stationnait bonnement devant la baraque de Polichinelle. À quoi servirait à la ligne droite d’être la plus courte si la ligne courbe n’était pas la plus agréable ? Mais non, ne médisons pas de la ligne droite ; elle a son charme. La ligne droite, c’est-à-dire le chemin de fer, quel ami complaisant, et comme promptement il vous obéit sur un geste, sur un signe ! Ce soir à Paris, il vous emportera dans une nuit à Marseille, à Turin, en Allemagne, où vous voudrez. En le pressant un peu, il vous réveillerait à la station de Pékin ! On l’a décrié ; il laisse dire, redouble de vitesse et ne connaît pas de bornes. Il sait le prix du temps, il sait le prix de la vie. En quelques heures, il vous montre la France entière, et sous vos yeux il déroule son infini panorama, vaste succession de tableaux charmants, de surprises nouvelles. D’un paysage il ne vous laisse voir que les grandes masses ; c’est un artiste qui procède à la façon des maîtres. Ne lui demandez pas les détails, mais l’ensemble où est la vie. Puis, quand il vous a charmé ainsi par sa verve de coloriste, tout à coup il s’arrête, et voilà qu’il vous dépose simplement où vous vouliez arriver, surpris de la complaisance du guide autant que de la beauté du pays qu’il vous a montré.
Nous avions de cette façon quitté Paris, le soir, à l’heure où le soleil empourpre les toits et salue d’un dernier rayon les grands édifices, où l’on se presse devant la porte d’un théâtre, où les cafés s’allument, où Paris se tarde pour la nuit ; et, laissant loin les bruyères de Fontainebleau, n’apercevant à travers la brume argentée que les grandes lignes noires et la silhouette des arbres de la Bourgogne, nous vîmes s’estompant vaguement dans le matin les toits de Dijon, Dijon la vieille ville, qui garde encore les tombeaux et le souvenir de ses ducs. Puis la course fut folle à travers les coteaux couverts de vignes. Le soleil se levait comme un globe embrasé, aspirant la buée des ruisseaux qui montait à lui comme un encens. Parfois, un village ; quelques paysans, la bêche sur l’épaule, regardant machinalement ce train emporté ; puis Mâcon, la Saône bordée de peupliers, tout un paysage féerique, des collines aux bois profonds, riches d’une mâle verdure et peu à peu, enfouies dans les arbres, blanches au milieu des feuilles comme des perles dans un écrin, des maisons, des villas coquettes, les avant-coureurs d’une grande ville, les retraits où les Lyonnais vont en bateau se reposer le dimanche venu.
Lyon n’était pas éveillé quand j’y entrai. À peine ce vague bruissement qui précède le bourdonnement de la foule. Quelques ouvriers se rendant à l’ouvrage. On en rencontre peu dans les rues de Lyon : ils habitent à peu près tous dans un quartier distinct, la Croix-Rousse, qui domine la ville et s’étend de la Saône au Rhône, entre deux fleuves. Pour y parvenir il faut gravir quelquefois des montées à pic. Certaines rues étroites ressemblent avec leurs crêtes de murailles couronnées de petits arbres à des villes espagnoles bâties contre le roc, comme des nids d’aigles.
Les Lyonnais disent fièrement que leur cité est la deuxième ville de France. Elle est grande en effet et aussi grandiose. Les maisons hautes lui donnent je ne sais quel aspect monumental. Mais à ces rues larges et droites, à cette vaste cité, il manque cette animation qui fait le charme de Bordeaux. Vaguement, on songe à Londres ; il semble que le bruit des métiers retentisse plus haut que la voix du fleuve.
L’industrie est reine, et tandis que les grisettes bordelaises passent coquettement avec leurs mouchoirs improbablement fichés sur leurs noirs cheveux, les ouvrières de Lyon marchent rapidement comme si elles craignaient de manquer l’heure de la fabrique. On éprouve une certaine surprise en contemplant la ville du haut de la montagne de Fourvières. Tant de maisons entassées, tant de fenêtres surtout. Combien de familles agglomérées dans ces bâtiments noirs ! On arrive à escalader Fourvières par une rampe assez rapide et une rue pavée de marches, qu’on appelle la Montagne des Anges, sans doute parce qu’il faudrait des ailes pour la franchir. Les rues qui aboutissent à cette montée sont de vraies ruelles du Moyen Âge, resserrées et sombres, un ruisseau coulant au milieu, les auvents projetant leur ombre sur ces étroits boyaux. Aux angles des maisons, quelques madones encore honorées des fidèles. Les eaux fortes de Flameng, avec leurs tons sinistres et leurs replis bizarres, peuvent donner une idée de ces espèces de culs-de-sac qui s’appellent la rue Juiverie.
Fourvières forme à lui seul une ville distincte et affecte de ressembler à une vaste communauté. Pour parvenir à la chapelle on suit un chemin bordé de hautes murailles qui sont les murailles d’un couvent. Sur la porte d’entrée est tracée cette inscription : Laus Jesu et Mariœ perpétua ! Comme j’y passais on jouait à l’intérieur je ne sais quel morceau de musique sur le piano. Comment a-t-on transporté ce piano là-haut ? La chapelle de Notre-Dame de Fourvières est très fréquentée et jouit d’un grand renom. Chaque jour la foule s’y presse pour écouter la messe ou suspendre quelque ex-voto devant l’autel. Une inscription placée à l’entrée annonce que le 15 avril 1807, le pape Pie VII a accordé à tous ceux qui feraient ce pèlerinage une indulgence quotidienne plénière confirmée par Grégoire XVI, laquelle donne à Notre-Dame de Fourvières les mêmes faveurs qu’à Notre-Dame de Lorette. La chapelle est petite, froide, encombrée de ces ex-voto qui sont la négation de l’art, – peintures inquiétantes qui me rappelaient les plus réprouvés tableaux du Salon des refusés. Après tout, ces cadres grotesques représentent je ne sais combien de douleurs, de prières et d’actions de grâces ! On voudrait rire, mais ce sont là autant de fils revenus à leurs mères, autant de pauvres femmes rendues à leurs enfants ; c’est un marin qui a pensé à ce coin de terre pendant une tempête et qui est venu prier et pleurer sur cette dalle où vous posez un pied désœuvré. J’avais copié des vers ridicules placés au bas d’un de ces cadres ; j’allais les citer. Je les efface… Quand on rencontre un sentiment vrai, de quelque façon qu’il soit exprimé, à quoi bon railler ?
Pour dominer Lyon tout entier, il faut monter au haut de la chapelle, dans le clocher qui mène au socle de la statue de la Vierge. L’ascension est pénible ; l’escalier de fonte tremble quelquefois sous vos pas. Mais là-haut la vue est superbe. On recule d’abord, comme si ce panorama si vaste venait vous souffleter brusquement. L’œil est ébloui, puis peu à peu on s’habitue à ce tableau splendide. Partout l’air, la lumière ; il semble qu’on touche le ciel, et là-bas, bien bas, bien loin, la grande ville resserrée comme un point petit ; là-bas les fleuves devenus des lignes lumineuses, le Lyonnais, le Dauphiné tout entier et jusqu’aux monts de l’Auvergne qu’on découvre à travers la brume, tandis que de l’autre côté, se déroule la chaîne des Alpes et que le Mont-Blanc apparaît vaguement à l’horizon.
Il faut redescendre. Le vertige de l’infini vous prendrait bientôt. Comme toujours, les noms des visiteurs, gravés sur le socle de la statue, se croisent, s’entrecroisent et s’effacent les uns les autres. J’ai lu ces mots gravés à cette hauteur : « J’aime ma femme. J. Girard (Côte-d’Or). »
La population de Fourvières est en grande partie composée de religieux. Toutes les maisons affichent je ne sais quelle allure monacale. Des marchands de reliques et d’objets religieux à chaque pas. Ce ne sont que chapelets, statuettes d’ivoires, médaillons, paquets de cierges. M. Émile Deschanel, qui a fait justement cette route, s’est plu à en copier quelques-unes. J’en ai relevé une qui n’existait pas sans doute au moment de son voyage. Il s’agit d’une institution en faveur des enfants et une inscription vous donne un bienveillant avis : « Cette providence prendra les petites orphelines sans distinction de paroisses. »
Le passage Sainte Philomène, qui conduit de Notre-Dame de Fourvières à la Montée des Anges, est établi sur l’emplacement où s’élevait jadis le palais de l’empereur Claude. Le propriétaire de ce terrain s’occupe à faire des fouilles et il a découvert déjà quantité d’objets remarquables. On vient de mettre à nu une salle de bain encore bien conservée, et où se voient le carrelage du sol et les peintures à fresque des murailles. Quelques squelettes, des vases en quantité, des monnaies du temps d’Auguste gisent sur la route ou sont accrochés à des piquets avec une inscription. Comme je passais, on venait de déterrer une vaste amphore de terre noire et on en mesurait la contenance. – Vingt-cinq litres ! dit-on. L’amphore, pleine jadis du falerne que buvait l’empereur, servira au propriétaire du passage qui a établi un restaurant sur la hauteur. Les archéologues ont tort de dédaigner ce coin de terre. Ils y trouveraient des objets aussi précieux et peut être plus authentiques que ceux des vitrines du Louvre.
Le gouvernement a justement donné à Lyon une grande partie de la collection Campana. On ne donne qu’aux millionnaires. Elle figure au musée de la ville, dans une salle spéciale et fort riche en antiquités. Mais le côté remarquable du musée de Lyon, c’est la peinture. J’ai passé là fort agréablement plusieurs heures, seul avec le concierge qui me dispensait de tout catalogue. Honte à nos faiseurs de Salons ! Cet homme-là s’y connaît comme pas un en fait de couleur, de dessin et de style. Est-ce l’habitude qu’il a de vivre parmi ces toiles, qu’il admire et qu’il aime, est-ce mémoire et répète-t-il seulement ce qu’il a entendu dire par les visiteurs ? Toujours est-il que son jugement est assuré, son goût irréprochable, et que si j’étais peintre, je tiendrais beaucoup à l’approbation d’un tel critique. Je regrette de ne pas savoir son nom pour l’imprimer ici avec d’autant plus de plaisir qu’il m’a servi de guide avec une complaisance vraiment rare. Lyon ne possédait guère en 1806 qu’une dizaine de tableaux déposés, dit une notice, dans l’infirmerie de l’ancien monastère des Dames-de-Saint-Pierre, lorsque le préfet et le maire du Rhône eurent l’idée de créer une galerie de tableaux. Ils nommèrent pour directeur de ce petit musée un de ces savants de province qui amoncellent tranquillement, au fond de leur cabinet ignoré, des trésors de science. Celui-ci se nommait M. Artaud.
C’était un savant et un artiste. C’était surtout un homme de bonne volonté. Grâce à lui, grâce aux dons du cardinal Fesch, de madame Récamier, des maires successifs de Lyon, le musée grandit et devint ce qu’il est aujourd’hui, un des plus remarquables musées de nos provinces.
Nous n’avons pas, nous n’aurons peut-être jamais, au Louvre, un tableau pareil à l’Ex-voto d’Albert Dürer, qui figure au musée de Lyon, haut de 1 m 37 de largeur, ce qui est considérable pour ce maître. L’empereur Maximilien Ier et l’impératrice Catherine sont agenouillés devant la Vierge et l’Enfant Jésus, qui posent sur leurs têtes des couronnes de fleurs apportées par des anges. Dürer est cette fois pris en flagrant délit de grâce, et le sombre maître qui fait chevaucher la Mort derrière les cavaliers, dans les forêts empestées, s’est élevé ici jusqu’à la suavité de Filippo Lippi. Durer s’est placé lui-même dans un coin du tableau, signant son nom sur un rouleau de papier qu’il tient à la main. Au musée de Lyon Rubens est représenté par deux tableaux, la Colère de Jésus-Christ et l’Adoration des Mages. Mais ici le maître d’Anvers n’est pas un peintre religieux, ses bienheureux semblent encore enluminés par les feux de la kermesse et le Christ, le maigre Christ des premiers maîtres italiens, ressemble à quelque Samsun pulvérisant les Philistins. Comme je lui préfère celui de Jean Jouvenet, placé en face, et qui chasse les vendeurs du temple ! Sans doute il n’a pas sa couleur éclatante, mais la composition est vraiment superbe. Ce tableau passe d’ailleurs pour le chef-d’œuvre du grand artiste rouennais. L’école allemande compte à Lyon de superbes tableaux. Voici deux toiles importantes de Philippe de Champagne : la Cène, où l’artiste a représenté, sous les traits des apôtres, les plus fameux solitaires de Port-Royal : Antoine Lemaistre, le grand Arnauld et Blaise Pascal, qui rêve dans son coin. L’auteur du Christ mort se révèle tout entier dans l’Invention des reliques de saint Gervais et de saint Protais. Au premier plan, la tête coupée du saint paraît saigner encore et produit un cruel effet de réalisme.
Mais les Flamands, en fait d’effroi, ne vont pas aussi loin que les Espagnols. Voyez ce Zurbaran. Un saint François d’Assise mort et demeuré debout, dans une grotte, les yeux ouverts et tournés vers le ciel. Ce tableau, qui appartenait avant la Révolution à je ne sais quel couvent de religieuses de Lyon, fut un beau jour perdu, puis acheté dix-huit francs dans une vente, par un artiste qui en fit une gravure, et appela l’attention sur ce chef-d’œuvre. Ce n’est rien qu’une figure, mais cette figure est étonnante. Ce cadavre debout, ces yeux fixes, ces membres rigides, ces grands plis du froc et du capuchon, cette ombre qui remplit les orbites, ces plis sinistres qui creusent cette face émaciée, tout est terrible et tout est beau. Quelle main farouche a donc pesé sur l’Espagne pour faire éclore sous un ciel éclatant des œuvres de ténèbres et quel vent a soufflé pour courber les esprits jusqu’à la tombe dans cette terre bénie, toute frissonnante de vie ?
Il faudrait m’arrêter longtemps ici ; les Jordaëns, les Sneyders, les Breughel, les Terburg m’attirent de ce côté. De cet autre, les Tintoret, les Bordone et les Bassan. De Bassan on me montre une bataille superbe, furieuse, féroce, digne de Salvator. Mais, hélas ! la peinture s’écaille et le tableau va se perdre. Le musée du Louvre pourra longtemps chercher avant de rencontrer un David qui vaille ce portrait de Maraîchère placé plus loin. Figurez-vous une vieille femme, au regard profond, étrangement belle, ridée comme la vierge de Denner, mais plus largement peinte, la bouche édentée, l’air si féroce, qu’on a voulu y voir une de ces tricoteuses qui escortaient Olympe de Gouges. Jamais le maître n’a fait mieux et je sacrifierais tous les Romulus du monde à ce portrait d’une républicaine inconnue. L’école de l’Empire est représentée par Gérard, Drolling, Granet, M. Court et M. Heim.
Ils étaient consciencieux, tous ces peintres, et les dessins de Drolling et les perspectives de Granet me comblent d’étonnement. Mais la patience n’est même pas la cousine de l’art. Parlez-moi de ce Delacroix que j’aperçois là, fulgurant de couleur et écrasant le Déluge de Court et la Corinne de Gérard, pourtant remarquables. Cette Corinne est un don de madame Récamier, qui était Lyonnaise. Le musée possède un beau portrait d’elle. Vous le voyez auprès de la porte de sortie, au pied du superbe Caïn de M. Etex.
Le portrait et la statuette de madame Récamier se retrouvent d’ailleurs plusieurs fois dans ce musée. Pourquoi ne mettrait-on pas à côté d’elle l’image de ce bon Ballanche, qui ne quitta jamais la muse de l’Abbaye-aux-Bois ? J’ai retrouvé sur plusieurs enseignes de Lyon l’aimable nom du philosophe.
J’allais oublier ce que notre Louvre ne possède pas. Des Lesueur, des Rigaud, des Mignard, des Desportes, il peut en montrer. Mais a-t-il un Marilhat qui vaille cette Forêt au bord d’une rivière ? Ce n’est pas l’orientaliste que vous trouverez ici, mais c’est toujours le maître. Quelle paix et quelle grandeur dans ces arbres paisibles, dans cette eau limpide et reposée ! Le soir vient. Qu’il ferait bon s’asseoir sous cette ombre et regarder coucher le soleil ! Avons-nous surtout un tableau de Charlet qui vaille cet Épisode de la campagne de Russie ? J’avais vu quelques jours auparavant le chef-d’œuvre de Meissonier, et combien je l’avais admiré, mais qu’il pâlit devant cette lugubre toile, farouche, sinistre, où l’horreur, la mort, le désespoir semblent se coudoyer tandis que l’abattement seul plane sur Le 1814 de Meissonier.
Le musée de Lyon a réservé une salle spéciale aux artistes lyonnais. Peut-être a-t-on donné là l’hospitalité à trop de gens qui ne sont pas tous égaux par le mérite. Mais une ville est comme une mère qui doit, paraît-il, aimer ses enfants d’un même amour. Je le regrette pour Hippolyte Flandrin, parfois assez mal entouré. Mais il se trouve entre compatriotes, presque en famille. Lyon possède son Dante et Virgile aux enfers, qui demeurera pendant un an encore surmonté d’une couronne d’immortelles et d’un voile noir en signe de deuil.
M. Biard a donné à son pays un de ses bons paysages des mers polaires, M. Paul Flandrin des imitations du Poussin magistralement réussies et j’y ai trouvé des fleurs de Saint-Jean plus éclatantes peut-être et plus colorées que la nature.
Le jour où je le visitai, Lyon était en fête. Il s’agissait de célébrer un de ces concours d’orphéons qui feront beaucoup pour l’instruction et l’émancipation de tous. On avait pavoisé la place Bellecour qui semblait toute rayonnante. Les théâtres étaient gratuitement ouverts au public, les rues encombrées de corporations musicales et de tous côtés éclataient des fanfares. J’ai remarqué combien peu parmi cette foule se montrait le vrai peuple de Lyon. Il est triste et les canuts demeurent obstinément enfermés dans leurs chambres, car les enfants crient, et le métier ne doit pas s’arrêter.
À Paris, tout est occasion de fêtes. À Lyon, le travail ne perd jamais ses droits. L’ouvrier lyonnais est d’ailleurs chez lui à la Croix-Rousse. Quand il s’agit de descendre aux Terreaux, c’est tout un voyage. Les rues noires lui plaisent, ses pauvres maisons l’attirent, son misérable coin de cheminée, il ne le quitte pas. Il aime beaucoup au surplus l’ouvrier parisien, chez lequel il rencontre sa propre énergie, avec quelque chose de plus, la gaieté.
La grotte de Rousseau. – Le Rhône. – Grenoble et le Dauphiné. – Une statue de Bayard. – Le roman du voyage. – Saint-Laurent du Pont. – Le peloton du curé. – Le Guiers-Mort. – Une heure dans le Désert. – La Grande-Chartreuse. – Où l’on rencontre des Anglais. – Ma cellule. – Un vers du Dante. – Voltaire et saint Bernard. – L’office de nuit. – La légende de Casalibus. – Ce que pense un chartreux. – Solitudo !
J’aurais voulu ne pas quitter Lyon sans visiter cette grotte tapissée de lierre où Jean-Jacques passa la nuit, une fois qu’il était sans asile. N’aurais-je pas retrouvé là ce que j’allais chercher aux Charmettes, l’ombre mélancolique du rêveur contemplant cette grande ville, plus petite encore que celle qu’il allait conquérir ? Mais devant combien de choses passe-t-on en voyage qu’on oublie ou qu’on ne peut voir, faute de cette complice de l’homme, l’occasion ? La vie aussi est un voyage et l’on arrive bien souvent à son but sans connaître la route que l’on a suivie. Je partis donc, laissant derrière moi cette Saône paisible et reposée, et ce Rhône grondant toujours, où il me semblait voir encore la rouge galère du cardinal remorquant à sa suite Cinq-Mars et de Thou qu’on allait décapiter là-bas, sur la place des Terreaux. À bien prendre, il est terrible ce Rhône, emporté, bruyant, et dans ses furies quelquefois il dévaste en un jour toutes ses plaines. Les maisons construites en pisé semblent d’ailleurs ne pas essayer de lui résister. Elles doivent brusquement s’affaisser dès qu’il les mine et céder sur-le-champ à sa rage.
J’allai à Grenoble. La route de Lyon au Dauphiné est insignifiante d’abord, plate et uniforme. À droite pourtant quelques collines se montrent de loin en loin, comme des montagnes encore timides. Puis les chênaies abondent, le paysage se boise, le terrain semble se bosseler tout à coup, et à l’horizon, à perte de vue, se dresse la chaîne du Dauphiné, toute noyée dans une brume violacée. La verdure et les arbres envahissent la route. Des maisons aux toits rouges, semblables à des villas italiennes, apparaissent parmi les arbres comme des baies de corail. La vigne couvre quelquefois tout un coteau ; de temps à autre, quelque paysan appuyé sur sa houe et semblable au calme contemplateur de Millet ; une vache, qui broute immobile les frondaisons des jeunes arbres, s’arrête pour regarder cette machine qui passe en sifflant et, sur les prairies qu’on côtoie, la fumée va se perdre et voluptueusement se rouler, comme altérée de fraîcheur. On approche de Chabons par la vallée de l’Isère, fertile, boisée, toute parsemée de fermes. De temps à autre, des lits entiers de cailloux ronds, roulés par je ne sais quel cours d’eau disparu, tranchent par leur blancheur sur la verdure. On laisse à gauche Voreppe, où Lacordaire a fondé, il y a quelques années, un couvent de Dominicains, et la locomotive s’arrête à Grenoble, non loin de ces portes que les habitants arrachèrent pour les mettre sous les pieds de l’empereur au retour de l’île d’Elbe.
Les Grenoblois ne sont pas ingrats. J’ai remarqué que s’ils n’élèvent pas une statue à tous leurs grands hommes, au moins ils leur consacrent à tous un souvenir. Des plaques de marbre indiquent à chaque pas que tel ou tel illustre citoyen est né dans cette rue, dans cette maison. Ici c’est Condorcet, là Bayard, plus loin Vaucanson ; Bayard a même sa statue. On l’a représenté mourant ; il embrasse la croix de son épée : mais l’artiste a si mal exprimé cette agonie sublime qu’on ignore si le bon chevalier songe à sa fin dernière, ou si, du pommeau de son épée, il envoie délicatement un baiser aux fenêtres environnantes.
Singulière préoccupation de l’homme ! Ceux qui ont élevé, il n’y a pas cinquante ans, cette statue à Bayard, ont fait graver leurs noms sur le socle, pour les léguer ainsi à la postérité. Et déjà on les lit sans qu’ils éveillent en vous l’écho d’un souvenir. Reconnait-on, il est vrai, tous les noms des compagnons de Bayard, de ces hommes d’armes, de ce capitaine, de ce porte-étendard, qui furent aussi des chevaliers sans peur ? Tout s’efface. Et peut-être si Bayard s’était contenté de sabrer les Impérianx serait-il oublié comme ses compagnons. Mais nous honorons son nom encore, c’est que ce soldat avait une idée. Ce n’est pas à son épée sans doute qu’on a élevé cette statue, c’est à son âme.
De Grenoble on se rend à Voiron où l’on prend la diligence qui doit vous conduire à la Grande-Chartreuse. Voiron est une petite ville, très coquette, très séduisante et très riche, qui affecte les allures d’une cité suisse. Une grande place, avec une fontaine au milieu, des maisons en amphithéâtre encadrées dans des montagnes couvertes de sapins : on se croirait à Neufchâtel. Je faisais route avec un gros monsieur qui, la voiture à peine ébranlée, tira de sa valise un livre et se mit à lire. Pendant que les surprises et les tableaux superbes se succédaient autour de nous, il avait hâte de connaître le dénouement du roman nouveau, et si M. Léon épouserait mademoiselle Berthe. Pour moi, je trouve inutile de lire quoi que ce soit en voyage, et j’ai mauvaise opinion d’un compagnon de route qui préfère à la séduction de la nature le charme de quelque in-dix-huit. Vous aimez la lecture ? mais le livre véritable, le voilà ; il est à vos côtés. Chaque tour de roue en tourne un nouveau feuillet, chaque temps de galop vous en montre une page nouvelle. Essayez de faire entendre raison à des sourds !
La voiture s’arrête à Saint-Laurent du Pont. C’est un petit village fort éprouvé, souvent brûlé, parfois inondé. Ce ruisseau qui coule là-bas modestement a quelquefois des fureurs de Rhône. Il se gonfle, il gronde, et si la fonte des neiges vient l’aider par hasard, il emporte sans façon les maisons environnantes. Sur la grand-route, un prêtre assis au revers d’un fossé faisait répéter à une troupe d’enfants les cérémonies pour la Fête-Dieu qui approchait. Les enfants, têtes blondes, grosses bonnes figures toutes rouges, chantaient, se mettaient à genoux, se relevaient et s’exerçaient à encenser avec des morceaux de bois, des bouteilles et des toupies attachés au bout d’une corde. La diligence dispersa leur troupe, rangée comme une compagnie de soldats prussiens. Instinctivement ils se prirent à courir après les chevaux, en jetant des cris d’écoliers échappés, et je plains le curé qui dut reconstituer son régiment en bon ordre. De Saint-Laurent du Pont on peut aller à la Grande-Chartreuse en deux heures. On vous propose une voiture, mais je vous engage à n’accepter point. Heureux les voyageurs qui voyagent à pied ! La route est belle d’ailleurs et facile. On gravit quelquefois des côtes assez rudes, mais toujours, à chaque angle du chemin, des merveilles nouvelles.
La route n’est pas large ; quelquefois elle a été creusée dans le roc par les Chartreux eux-mêmes. À gauche le ruisseau dont je parlais gronde en courant et se brise parfois blanc d’écume. Tantôt c’est un enfant rieur qui se jette de cime en cime, de caillou en caillou, pirouette sur les troncs d’arbres renversés, s’amuse et chante ; tantôt c’est un prisonnier en liberté qui s’enivre de grand air, jaillit de roc en roc, se précipite, rebondit, caresse ses rives rocheuses ou les combat furieusement : quelquefois il s’arrête brusquement, se recueille, devient pensif, et son eau claire laisse apercevoir le sable fin de son lit et les truites se jouant dans ses eaux profondes. Il porte un nom sinistre, le Guiers-Mort. Nom mal choisi ; c’est la vie au contraire ce torrent ; c’est le bruit, c’est l’agitation, c’est la fièvre. À gauche et à droite, les montagnes se dressent, effrayantes parfois, vous écrasant de leur hauteur. Des quartiers de roc surplombent sur votre tête, des montagnes tout à coup semblent vous barrer le chemin ; les mélèzes, les sapins, mêlent leurs verdures différentes. Le soleil éclaire ces couleurs si diverses dans leur unité, et se joue comme un bienheureux dans tous ces verts, depuis le vert tendre du bourgeon jusqu’au vert sombre des vieux arbres. Au bruit du Guiers-Mort se joint un bruissement étrange, on ne sait d’où venu, pénétrant, endormant, doux, mélancolique. C’est le murmure de toutes ces sources infinies qui descendent des montagnes, filtrent à travers les rochers, suintent parmi la glaise, glissent sur les mousses, de gouttes d’eau se font ruisseaux, de ruisseaux, cascades. Autant de petits torrents, clairs et frais, où les myosotis semblent tout joyeux de mirer leur tête bleue.
Quelle patience, quels efforts et quel courage il a fallu à ces Chartreux pour creuser un tel chemin à travers le roc ! Autrefois cette partie de la forêt, qu’on appelle le Désert, était défendue par des rochers qui, s’étageant sur le Guiers-Mort, en défendaient brutalement l’entrée. C’était bien un désert, en effet, et le plus sauvage des déserts. Parfois on n’aperçoit que l’étroit chemin semblable à une raie blanche, le Guiers qui écume à vos pieds, les deux côtés de la montagne qui semble vouloir vous étouffer, et quelque lambeau de ciel entre deux crêtes de rochers. Il faut traverser des ponts hardiment jetés sur le torrent, des grottes creusées vaillamment dans le roc ; quelquefois, au milieu de cette sauvage nature, tout à coup une oasis, une prairie où viennent paître les troupeaux. C’est dans une oasis semblable que la Grande-Chartreuse est bâtie. Elle vous apparaît brusquement, comme pour vous surprendre. Ses murailles blanches et ses toits d’ardoises se montrent à travers les arbres. Encore quelques pas, et cette porte s’ouvrira au moindre son de cloche.
Le frère portier qui nous reçut à l’entrée du couvent nous accueillit avec un visage riant, et nous conduisit au coadjuteur chargé de recevoir les visiteurs étrangers. On nous demanda de quelle nation nous étions, et l’on nous introduisit dans une vaste salle à la porte de laquelle était tracée cette inscription : Aula provinciarum Franciœ. Une vaste cheminée, des fenêtres à carreaux de plomb, un plafond à solives de chêne parfaitement luisantes, une grande table au milieu de la salle. L’air est vif en ces montagnes, même au printemps ; de robustes troncs d’arbres se consumaient dans le foyer, et nous attendîmes le dîner en nous réchauffant sous l’énorme manteau de la cheminée.
Dès que l’on a pénétré dans ce couvent, jeté là comme à la fin du monde, dans le plus beau site et au milieu de l’air le plus pur qu’on puisse rencontrer, on se sent réellement envahi par je ne sais quelle sensation pénétrante de calme et de repos. À peine a-t-on traversé la grande cour où les oiseaux viennent se baigner dans les fontaines, à peine a-t-on aperçu ces longs couloirs aux murailles blanches, que soudain la paix qui règne en ce lieu vous envahit tout entier. Cette nudité plutôt riante que sévère a je ne sais quelle invincible force. C’est un séjour de paix, et de paix qui semble douce, tant il y a de calme et de majesté dans ce qui vous entoure. On mange de bon appétit. Point de viande ; du vermicelle, de la panade, du poisson, des œufs, des fruits. Avec cela, une délicieuse chose : des fraises des bois accommodées avec cette saine liqueur qui fait la fortune du couvent et aussi celle des pauvres gens du pays, car les Chartreux associent généreusement les malheureux à leurs bénéfices. Ils font construire des églises, ils ont élevé un hôpital où plus de quarante malades peuvent tenir à l’aise, et dans leurs inventaires tout le monde a quelque chose à gagner.
Mais pourquoi à cette table des provinces de France ai-je retrouvé deux de ces éternels Anglais qui gâteraient le plus beau paysage ? L’un était grand et maigre, l’autre était petit et gros ; tous deux roux, tous deux faits à souhait pour le crayon de Cham. Outre que la couleur locale leur faisait défaut, car ils portaient, au milieu de cette nature alpestre, cet horrible chapeau noir qui conduirait un statuaire au suicide, ils semblaient ignorer quelque peu les propriétés de la politesse. La table était à eux, les chaises à eux, les plats à eux. Point de remerciements au frère chartreux qui les servait. Ils traitaient le couvent en pays conquis. J’avais envie de m’écrier : shocking !
Le repas achevé, on nous demanda si nous voulions nous faire éveiller pour l’office de nuit. – Mes Anglais répondirent : nô ! Je donnai le numéro de la cellule qu’on m’avait désignée, j’en pris la clef, on me mit dans les mains une bougie qui ne ressemblait pas du tout à un cierge, comme celle dont on dota certain soir M. Deschanel, et je montai dans ma cellule. Ce retrait ne laissait pas que d’être mélancolique. Figurez-vous une petite pièce aux murs blanchis à la chaux, vide et nue, avec un prie-dieu et un lit étroit pour tous meubles. Au fond, une fenêtre à carreaux minuscules qui donnait sur la chapelle. Le couvent découpait ses hautes murailles sur la nuit claire et la lune emplissait la cellule de sa clarté. Je me pris à lire toutes les inscriptions qu’on avait tracées sur la muraille, quelques-unes au crayon, d’autres creusées avec un canif. Décidément chacun tient à laisser une trace de son passage partout où il va. Et cependant a dit le poète :
Que de sottises tracées là ! que de noms qui ne parlent pas ! que de paroles irritantes ou vides ! Des mots, des mots ! dirait Hamlet. Comment ! ce sont là les hôtes habituels de ces cellules faites pour la rêverie, pour la contemplation, pour le silence ? Qu’y ont-ils vu, qu’y ont-ils rencontré, ceux qui ont inscrit leurs noms sur cette muraille ? – M. Tourangeau, qui y a « passé une nuit d’insomnie, le 24 mai 1854. » – M. Lucien Pertat, qui y a « songé à Clara. » – M. C. V…, qui « aimerait mieux être ailleurs, » et tant d’autres que la seule curiosité avait amenés et qui sont partis comme ils étaient venus ! Un inconnu a écrit en lettres rouges ce vers de Dante :
Laissez l’espérance !… Et qui sait ? Vous qui entrez, vous trouverez ici l’espérance peut-être ! Comment pourrait-on vivre dans cette ombre si je ne sais quelle ardeur ne vous soutenait toujours en vous montrant dans l’avenir le but ardemment désiré ? S’ils vivent ainsi, ces religieux, n’est-ce pas qu’ils espèrent ? Sans doute la volupté de la contemplation les fortifie dans le sacrifice et les nourrit, leur âme communie chaque jour en une rêverie savoureuse où tout leur apparaît de ce qui est grand et beau. Rien de nos passions ne va jusqu’à eux, rien de ce qui est bas ne parvient jusqu’à leur cellule. Tout ce vain bruit qui se fait parmi nous, ils ne l’entendent pas. Seuls ils écoutent cet infini murmure qui vient de là-haut. Ils ont su renoncer à la fumée de toutes choses et ils en ont gardé la flamme : la prière, la réflexion, la contemplation, la pensée. C’est de tels hommes qu’il faudrait ambitionner le suffrage, qui ne savent rien de ce qui passe, qui seulement connaissent ce qui dure, et qui, créatures mortelles, ont su dès avant la mort se mesurer avec l’éternité.
Et pourtant, si dans leur silence quelque bruit d’autrefois leur venait, si quelque souvenir cuisant ne quittait pas leur cellule, si le fantôme du passé se dressait devant eux, pour les tenter, quelles angoisses et quelles tortures !
« Ô heureuse solitude ! ô seule béatitude ! » dit saint Bernard. Mais à ce cri du rêveur, Voltaire répond :
Qui des deux a raison ? Et faut-il croire, avec certain plaisant, de passage en cette cellule, que : « quitter le monde pour le cloître, quand on est jeune, c’est prendre son bonnet de nuit et se mettre au lit dès le matin ? » Absorbé par ces pensées, je songeais, lorsque j’entendis frapper à la porte. C’est un des frères qui a pris ce soin, comme distraction, d’éveiller ainsi les voyageurs. Il regarde les numéros des étrangers qui veulent assister à matines, et, en s’y rendant lui-même, il leur donne le signal de l’office.
Il était minuit. À travers les couloirs sombres, j’allai vers la chapelle qu’on m’avait indiquée. Les étrangers s’installent dans une galerie qui domine le chœur. Tout est plongé dans l’obscurité, une veilleuse seule éclaire faiblement la chapelle où l’on respire une pénétrante odeur d’encens. Peu à peu comme des ombres on aperçoit se mouvoir dans la nuit le froc blanc des moines qui prennent place dans les stalles. Puis un silence se fait ; les religieux sont là, prosternés, le front contre terre. Tout à coup ils se relèvent, chacun d’eux découvre la lanterne qu’il portait, et ces têtes rasées émergent subitement des ténèbres. C’est un spectacle magique. Ces reflets rouges de la lumière sur les capuchons, ces stalles luisantes, ces plis rigides des robes blanches, ces alternatives d’ombre et de lumière, de silence et de bruit, ces moines qui psalmodient en tournant les feuillets de grands livres, vous saisissent. On regarde, on écoute. Leurs chants sont encore ceux des premiers chrétiens. Jusqu’à deux heures, ils entonnent les psaumes, puis se retirent lentement, en silence, comme ils sont entrés.
J’avais rencontré sur la route de la Grande-Chartreuse un aimable compagnon de voyage, et nous avions résolu d’escalader ensemble le Grand-Som, un des géants des Alpes dauphinoises. Un guide nous y devait conduire dans la nuit. Nous voilà sortant de matines et errant à travers le couvent. Les corridors sont immenses et facilement on peut s’égarer. Nous en étions là, lorsque, tout au bout d’une galerie, nous aperçûmes, venant à nous, un moine, sa lanterne à la main. – Cherchez-vous votre cellule ? nous demanda poliment cette apparition, qui partout ailleurs eût été effrayante. Quand le chartreux sut que nous attendions notre guide, il nous conduisit jusqu’à la loge du frère portier, qu’il éveilla, et, après lui avoir recommandé de ne pas oublier nos provisions et nos alpin-stocks, il nous salua de son capuchon et s’éloigna. – C’est le père général, nous dit alors le frère, avec grand respect.
Les pères chartreux sont au nombre de quarante ; ils sont tous ordonnés prêtres, et chacun d’eux possède sa cellule, d’où il ne sort pas, et où il reçoit sa nourriture par une petite porte pratiquée dans le mur. Une fois par semaine est jour de jeûne. Les pères ont le visage rasé comme la tête ; les frères portent au contraire leur barbe tout entière. Il y a au surplus deux sortes de frères : les frères convers, dont le vêtement est blanc comme celui des pères, et les frères donnés, vêtus de laine brune. Ce sont les frères qui, sous la direction d’un père, seul gardien de la formule secrète, fabriquent la liqueur qui descend chaque jour par charretées vers Grenoble.
Le couvent actuel date du XVIIe siècle ; il en a le style régulier et froid. L’ancien couvent était bâti un peu plus loin ; il fut écrasé par une avalanche. À mi-chemin de l’emplacement de l’ancien couvent et du nouveau, la chapelle de Casalibus me rappelle une légende. Il paraît que certain jour, saint Bruno étant allé faire un voyage à Rome et ne revenant pas, les Chartreux se prirent à désespérer de lui, et, lassés de la vie claustrale, mirent la clef sous la porte et partirent. À peine avaient-ils fait quelques pas qu’ils rencontrèrent saint Pierre. – « Où donc allez-vous ? dit le saint, Bruno sera prochainement de retour. Regagnez vos cellules et continuez cette existence qui vous conduira droit au ciel. » – Un peu honteux, les bons pères reprirent le chemin du couvent, et, à l’endroit où s’était montré saint Pierre, ils bâtirent de leurs mains une élégante chapelle, afin de désarmer le courroux de saint Bruno, qui ne se fâcha, dit-on, qu’à moitié.
Le lendemain de notre arrivée, on nous fit, trop rapidement peut-être, visiter l’intérieur du couvent. Les tableaux y sont rares : quelques portraits des généraux de l’ordre, des copies de Lesueur, et c’est tout. On voit que Lesueur a longuement vécu parmi les Chartreux ; les plis de leurs frocs, l’expression de leurs visages, leurs attitudes n’ont point de secret pour lui. Une chose sinistre, c’est la chapelle des morts : un squelette revêtu d’un suaire vous invite au silence, à la porte, en mettant ses doigts décharnés sur sa bouche sans lèvres. Plus loin, le cimetière. Il est petit. Les religieux reposent là sous des croix de bois : les généraux seuls ont des croix de pierre, et, sur cette croix, leur nom. Je me tournai vers la tombe des pères :
– Pas de noms à ceux-ci ? dis-je au frère qui nous conduisait.
– Pourquoi y on aurait-il ? répondit-il simplement.
On n’entre pas dans les cellules des Chartreux. Leur compagnon, c’est la solitude. Chacun d’eux a placé sur sa porte quelque verset préféré. La cellule du père général porte ces mots : Quœrite Deum et vivet anima vestra ! Une inscription en français vous prie de marcher doucement et de faire silence en cheminant à travers les couloirs. Qui sait si le bruit de vos pas ne réveillerait point dans l’âme des religieux cachés derrière ces murailles tout un monde de souvenirs, de douleurs, et peut-être de regrets ?
Ainsi disais-je du moins au coadjuteur, qui avait bien voulu causer avec moi.
– Les regrets ? me répondit-il. Nous ne les connaissons pas. Ici habite la paix. Nous obéissons à une règle que chacun de nous a choisie. Hors de nos statuts, nous sommes libres. Point de chaînes : le mondain a ses passions qui le dominent ; nous, nous avons dompté les nôtres. Ce qui terrifie l’homme, la pensée de la mort, nous apparaît comme une récompense. Cette solitude, qui vous paraît effrayante, nous devient bientôt chère. Les pères ne prennent leur repas en commun que deux fois l’an : au 1er janvier et le jour de la fête du général. Eh bien, quand le vénérable père veut nous combler de joie, il nous permet de dîner, ces jours-là, seuls dans notre cellule. L’habitude de la prière et de la contemplation est bonne, et la cellule longtemps continuée s’adoucit. Cellula continuata dulcessit. Ce n’est pas à vingt ans, monsieur, que je suis entré ici, et de près j’ai vu le monde. Croyez-moi, lorsque dans les premiers temps de mon arrivée au couvent, je songeais à tous ceux qui s’agitent là-bas, à tous ceux qui courent après la fortune, les honneurs ou l’amour : – Pauvres gens ! me disais-je… Ils cherchent le bonheur ! Ils ne le trouveront pas !
– Et vous l’avez trouvé ? demandai-je, sans doute indiscrètement.
Il me répondit par la parole de saint Bernard :
– O beata solitudo ! O sols beatitudo !
Quand je sortis du couvent les oiseaux chantaient, les sauterelles grinçaient dans les herbes, toutes les fleurs des montagnes s’épanouissaient sur le bord du chemin. Je m’étais enivré du philtre calmant du repos ; j’avais hâte de goûter au cordial puissant de la vie. Pourtant, respirant la senteur des pins, le grand air pur des monts, le parfum des herbes : – La vie est un combat, me disais-je, et nul de nous n’a le droit de déserter à l’heure de la mêlée ; mais ont-ils donc abandonné leur poste, ceux qui se retirent à l’écart priant pour leurs frères tombés sur le champ de bataille ?
De la Grande-Chartreuse à Chambéry. – Le Pas de l’Échelle. – Un botaniste. – Le lac du Bourget. – Rencontre d’une vipère. – Vieille chanson. – L’amoureux et le philosophe. – Madame de Waran. – Les cerises et mademoiselle Galley. – Claude Anet. – Le temps passé. – Ce qu’on pense de Rousseau. – L’album des voyageurs. – M. Arsène Houssaye.
Le lendemain, sur la route de Saint-Laurent du Pont à Chambéry, le postillon, qui était bavard, me montra, dans le creux d’un rocher, une excavation profonde qui, dit-il, servait autrefois de refuge à Mandrin et à sa troupe. Pareil asile du même Mandrin m’avait été désigné près de Voiron, dans ces montagnes escarpées qui tombent à pic sur la vallée de l’Isère. Singulière mémoire du peuple ! Il se souvient de ceux-là seuls qui l’ont terrifié par leurs crimes ! Le plus populaire des empereurs romains, ce n’est point Marc-Aurèle, c’est Néron.
Sur cette route, les Échelles, que Rousseau appelle dans ses Confessions le Pas-de-l’Échelle, me firent songer à son premier voyage à Chambéry, où il demeura si longtemps à contempler certaine cascade, « la plus belle, dit-il, qu’il vit de ses jours. » Elle s’appelle la cascade de Thiboust. Pour la montrer à mon voisin qui dormait, le conducteur l’éveilla. L’autre répondit par un grognement, et, quand il eut ouvert les yeux, la cascade, où se jouait en arc-en-ciel un rayon de soleil était déjà loin de nous.