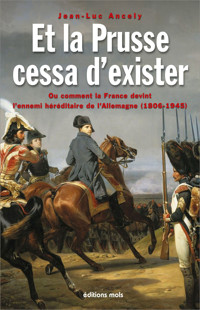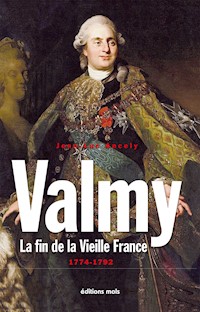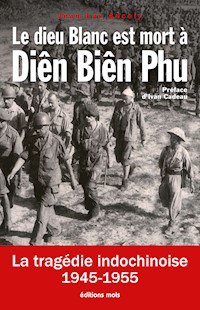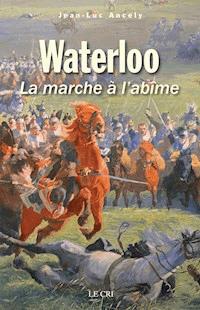
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Récit et analyse d'une célèbre bataille de l'Histoire.
À Waterloo, dans les plaines du Brabant, l’Europe coalisée mettait un terme à l’aventure d’un homme qui avait changé le monde.
Waterloo, c’est d’abord le choc de trois tempéraments : face au génie du petit Corse, le flegme très professionnel de Wellington, sans état d’âme, allié à la haine farouche du Prussien Blücher qui ne souhaite que pendre Bonaparte et dépecer la France.
Après Waterloo, ce drame de cinq jours, le dix-huitième siècle se termine et, avec lui, le grand bouleversement révolutionnaire qui avait agité le continent. Le monde moderne peut naître.
Mais comment expliquer que des hommes, formés par vingt années de luttes incessantes, ont pu commettre autant de fautes, laissé s’échapper autant d’occasions ?
Waterloo, une guerre perdue d’avance ? Une catastrophe française ou un immense soulagement pour l’Europe ?
Waterloo, choc fondateur dont nous sommes, deux cents ans après, les témoins incrédules et les inévitables héritiers.
Le point de vue est tantôt français, tantôt anglais, tantôt prussien ou même hollandais. La tension naît au fur et à mesure que les scènes défilent.
Découvrez ce livre surprenant, qui tient à la fois de l'essai historique, du théâtre et du roman d’aventure !
EXTRAIT
Jamais campagne ne fut mieux conçue stratégiquement.
Jamais chance de vaincre ne fut plus gaspillée.
Jamais tant de bravoure et d’abnégation ne furent autant volatilisées pour un résultat aussi désastreux – du point de vue français s’entend.
Jamais un capitaine – Wellington – n’acquit une gloire aussi durable en déployant aussi peu de talent.
Jamais le destin d’un peuple ne bascula aussi brutalement qu’en ce dimanche de juin. Le matin de la bataille, Napoléon, quoique son astre pâlît depuis 1812, était encore l’épouvantail de tous les généraux d’Europe. Le soir, il n’était plus qu’un fuyard.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Luc Ancely est Français et réside en Belgique ; ancien élève de Saumur, il a fait carrière dans l’Arme blindée Cavalerie. Il est l’auteur d’ouvrages littéraires, essais et tragédies. Il tente ici une critique pour expliquer et comprendre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Catherine Mauvernay,sans qui ce livre n’aurait pas vu le jour.
« Tout échoue dans le malheur, même le succès.Dans le bonheur tout réussit. »Jean d’Ormesson
« À partir de 1810, il semble qu’un nuage s’interpose parfois entre lui [Napoléon] et les objets réels ; l’imagination et l’orgueil l’emportent sur le caractère, de sorte que l’admirable équilibre de ses facultés s’en ressent. »Commandant H. Lachouque, Le secret de Waterloo
Waterloo ou la bataille des extrêmes
Waterloo ! Nom exotique que mon père refusa toujours de prononcer : « Nous autres Français disait-il, devrions la nommer “bataille du Mont Saint Jean” car jamais le moindre coup de feu ne fut tiré de ou sur Waterloo. »
Il avait raison. C’est parce que le duc de Wellington rédigea son rapport d’une maison de Waterloo que l’histoire a retenu le nom de cette bourgade belge aux portes de Bruxelles. Il y avait eu un précédent célèbre : Austerlitz… Donc Waterloo.
Waterloo, bataille des extrêmes, de tous les excès, bataille du pire et du meilleur, caricature de bataille napoléonienne comme si le météore Napoléon devait achever sa trajectoire dans une fulgurance tragique où le sublime côtoierait l’insensé.
Jamais campagne ne fut mieux conçue stratégiquement.
Jamais chance de vaincre ne fut plus gaspillée.
Jamais tant de bravoure et d’abnégation ne furent autant volatilisées pour un résultat aussi désastreux – du point de vue français s’entend.
Jamais un capitaine – Wellington – n’acquit une gloire aussi durable en déployant aussi peu de talent.
Jamais le destin d’un peuple ne bascula aussi brutalement qu’en ce dimanche de juin. Le matin de la bataille, Napoléon, quoique son astre pâlît depuis 1812, était encore l’épouvantail de tous les généraux d’Europe. Le soir, il n’était plus qu’un fuyard.
L’armée française qui, le matin encore, était celle qui avait donné la leçon à toutes les autres durant vingt années, n’était plus, dans l’ombre grandissante, qu’une horde en déroute.
Jamais des chefs aguerris, éprouvés, compétents et l’ayant tant de fois démontré, ne furent aussi maladroits, follement braves ou désespérément aveugles.
Il demeure un mystère quant aux raisons de cette catastrophe. On a tout dit ou cru tout dire mais a-t-on compris pourquoi ?
Waterloo, ce serait l’histoire d’un joueur entrant au casino sûr de sa martingale et ressortant les poches vides.
Mais Waterloo c’est aussi le tombeau de milliers d’hommes et l’amorce du déclin inéluctable d’une nation. La France après 1815 ne sera jamais plus « la Grande Nation » et même le redressement de 1918, obtenu au prix de tant de sang, ne sera qu’un éphémère sursaut.
Jamais campagne ne dura si peu : quatre jours pleins !
Jamais autant d’hommes ne tombèrent en quelques heures sur un espace aussi exigu – même à Verdun, même au Chemin des Dames ! Waterloo ! Ce nom résonne comme le coup de gong du destin ; comme si une malédiction s’attachait à ce lieu paisible, comme un arrêt des dieux.
Jamais victoire ne fut autant à portée de main et défaite plus évitable.
Il ne nous appartient pas de déterminer si une victoire de Napoléon à Waterloo eût été bénéfique à la France. Sans doute pas. Efforçons-nous cependant d’expliquer les causes, les enchaînements, de comprendre l’incompréhensible.
Que faisions-nous dans cette « morne plaine » ce dimanche de juin 1815 ? Il convient de revenir quelque temps en arrière…
I
Un immigré qui a réussi
Cherchez dans les trente siècles d’histoire moderne combien d’hommes connurent un destin comparable à celui de Bonaparte. Cherchez. Je n’en vois guère. César, Alexandre ? Mais l’un comme l’autre partirent de plus haut ; le premier était issu de la haute aristocratie romaine, le second était roi avant de s’élancer à la conquête du monde. Bonaparte est sorti du néant. Qui aurait pu imaginer que le gamin chétif, le boursier du roi, l’élève du collège de Brienne deviendrait Empereur d’Occident ? Napolioné di Buonaparté est l’un des fils d’un Corse rallié à la puissance occupante. Poussons la comparaison : imaginez un Français, en 1941, envoyant son fils dans un collège ALLEMAND ! Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le père, Charles, gentillâtre corse fort impécunieux et se prétendant patriote, n’hésita pas à se rallier aux autorités conquérantes pour subvenir aux besoins de sa tribu. Charles courut les antichambres afin de placer sa progéniture aux frais du roi. Il fallait bien vivre.
Quand il débarque à Brienne, il est un petit immigré, un déraciné que tout désarçonne : la langue, les paysages – il ignore ce qu’est la neige. Que peut-il espérer ?
Cherchez dans l’histoire de France combien d’immigrés montèrent aussi haut ? Boursier du roi Louis baragouinant le Français avec difficulté, officier de l’armée royale puis, la Révolution aidant : chef de bataillon, général, général en chef, Premier Consul, Empereur. Bel exemple de ce que la France peut offrir à ceux qui savent devenir français. Sans la Révolution qui brise les cadres de l’Ancien Régime, Bonaparte, homme de si petite extraction, eût sans doute pris sa retraite au soleil de son île, chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis et le monde eût ignoré la fulgurante brûlure du météore. Depuis lors, les auteurs sont partagés quant à « l’utilité » de Napoléon ; pour certains, il eût mieux valu qu’il n’existât pas – ce n’est pas faux. Pour d’autres, Napoléon c’est aussi l’œuvre immense et durable du législateur, le reconstructeur de la France en ruines de 1799. Œuvre pérenne puisque nous passons chaque jour au pied de ses réalisations, puisque nous percevons au quotidien tout ce qui a été conçu, promulgué, édifié, réalisé en une poignée d’années.
Le vertige nous saisit devant cette accélération de l’Histoire qui a jeté sur le sol national ces « masses de granit » dont le Corse était si fier : édifices, routes, ponts, canaux, lois, code civil, tribunaux de commerce, banque de France, franc germinal – constant durant un siècle ! –, lycées, université rénovée, administration préfectorale, Conseil d’État, etc.
On comprend mal cet homme si l’on omet son côté « bureaucrate », législateur, organisateur. Bonaparte est un homme de structures. Il n’aima rien tant que ces séances du Conseil d’État où, entouré de jeunes et ardents juristes, il discutait, écoutait, encourageait et suscitait la controverse. Ayant tout lu, tout retenu, tout assimilé, il est pétri de cette jurisprudence romaine dont le Code Napoléon est imprégné. Bâtisseur, administrateur, rien de ce qui concernait la vie politique, juridique, légale, financière, économique du pays ne lui était étranger. Il y avait du Colbert dans cet homme, la froideur et l’intrigue en moins. Il fut surtout et avant tout un grand commis de l’État, un forcené de la chose publique. Monstre d’activité, épuisant ses ministres, il ne pouvait – j’entends par là qu’il lui était physiologiquement impossible – demeurer inactif. Il fut l’archétype du monarque absolu en ce sens que tout remontait jusqu’à lui et que tout provenait de lui. Ce fut un travailleur monstrueux et son cerveau, l’organisation de son intellect constituent encore une étrangeté. Il travaillait toujours, partout et à toute heure. Il avait la faculté, selon ses dires, de fermer et ouvrir les tiroirs de son cerveau à volonté et selon les besoins du moment. Même à l’île d’Elbe il travaillera comme un propriétaire veille à la mise en valeur de son domaine étroit. À Sainte Hélène, il ne pourra faire plus que dicter ses mémoires ; cette absence d’activité ne le tuera peut-être pas mais l’affaiblira sans nul doute. Voulant tout, sachant tout, apprenant tout, veillant à tout, tout à la fois Premier ministre, Ministre de la Guerre, général en chef, souverain. Ses ministres, quelles que fussent leurs compétences, ne pouvaient être que des commis ou des directeurs généraux. Sous un tel homme, on ne pouvait qu’obéir ou s’opposer. Les deux seuls Ministres de poids qui manifestèrent quelque indépendance, quoique opposés l’un à l’autre par les vicissitudes de l’histoire, furent ses ennemis implacables dans les pires circonstances. Je veux nommer là Fouché et Talleyrand. On peut parler de despotisme à propos de Napoléon, mais il ne peut être comparé à la tyrannie du Comité de salut public. Par bonheur, cet homme omnipotent n’était pas cruel et il fut toujours un légaliste répugnant à forcer la loi (nous le verrons ainsi abdiquer plutôt que de recourir à la guerre civile). Son coup d’État de Brumaire, la seule fois où il viola la loi constitutionnelle, faillait être une catastrophe ; il y fut brouillon, mal à l’aise, confus ; c’est parce qu’il était conscient de n’être pas dans son droit. Et sans son frère Lucien, il eût été mis hors-la-loi…
Il est un homme du dix-huitième siècle, un fils des Lumières nourri de Voltaire et de Rousseau tout autant que de Tacite et Plutarque. Son despotisme serait plutôt un despotisme « éclairé » en référence à celui de Frédéric II de Prusse ou de Pierre le Grand. La tyrannie se fonde sur la peur, la force brute, la police et le bourreau ; le despotisme est une forme achevée de la monarchie « absolue » en ce sens qu’elle gouverne effectivement et directement ; c’est le contraire du système anglais.
Faisons ici une pause ; repensons à l’état de la France en 1799, après dix années de convulsions révolutionnaires. Ruinée, dévastée, incapable de finir ses guerres, gouvernée (?) par un Directoire corrompu et impuissant, essuyant défaite sur défaite, dirigée par des hommes que le peuple méprise, sans monnaie, sans crédit, incapable d’assurer la sûreté des biens et des personnes, violant ses propres lois en invalidant les élections qui déplaisent, voilà, en quelques mots, ce qu’était la France de 1799.
En 1789, dix petites années auparavant – dix années mais une éternité – la France est la première puissance de la planète. Elle a effacé la défaite de 1763. Sa marine a vaincu la Royal Navy ! Elle a donné l’indépendance aux Américains. La France sous un roi intelligent et cultivé – que depuis on a fait passer pour un benêt – est au sommet de son prestige. Mais incapable de se réformer et surtout fiscalement, elle tombe. Pour certains la Révolution est une naissance, pour d’autres elle est la plus grande catastrophe de notre histoire. Nous ne prendrons pas parti mais force nous est de constater que, dix ans après, la belle et patiente construction de dix siècles n’est plus qu’une ruine. La faux sanglante de la Terreur a passé. La terre de France a mué. La bourgeoisie et la grosse paysannerie ont renversé l’ancien ordre des choses ; la terre a changé de mains ; la noblesse est fauchée, détruite, émigrée ou assassinée par charrettes entières. Le clergé est en dissidence ou fonctionnarisé. Il faut avoir à l’esprit ce fait capital : ceux qui avaient du numéraire ou de l’ambition ont acheté les biens nationaux, biens de l’Église ou biens des émigrés. La Révolution fut avant tout une gigantesque spoliation. On a tué des hommes et volé leurs biens au nom de principes généreux car c’est toujours sous le masque des bons sentiments que l’on commet les crimes les plus atroces.
L’économie, le visage foncier du pays en sont bouleversés. Le véritable et indéfectible soutien de Bonaparte, homme d’ordre, c’est la masse des acquéreurs de biens nationaux. Dans une France éminemment rurale qui recrute ses soldats parmi les paysans, Napoléon sera celui qui conserve ce que nous nommons les acquits. Tant que cette nouvelle classe de possédants, de parvenus, aura confiance en lui, elle le soutiendra. Dès qu’elle sentira qu’il n’est plus capable de maintenir ce pour quoi il a été plébiscité, le pacte sera rompu et on le lâchera : ce sera 1814.
En fait, les Français demandaient deux choses à Napoléon et leur adhésion reposait là-dessus : l’égalité des chances et l’imprescriptibilité de l’acquisition des biens nationaux. Dans son serment d’Empereur, il jurera explicitement de conserver les conquêtes de la Révolution et ces biens nationaux. En ce sens, il est bien le continuateur de Robespierre. Mais il se veut aussi le prolongement des rois puisqu’il dit « tout assumer depuis Clovis jusqu’au Comité de Salut Public ». Méfiant envers toute idéologie, sa grande idée politique sera d’opérer la fusion entre la nouvelle société des parvenus de 93 et l’ancien régime. Idée pacificatrice, réconciliatrice. Ce sera partiellement une réussite et sûrement un échec.
L’égalité des chances, c’est le bâton de maréchal dans la besace du simple soldat, c’est la sénatorerie pour le fils de paysans enrichis. La fraternité était une fiction grammaticale, une utopie rousseauiste. Quant à la liberté, Napoléon avait fort bien compris qu’elle est la mère de l’anarchie et du désordre révolutionnaire ; on la rangerait donc pudiquement au magasin des accessoires.
Vivant paradoxe, il fut peut-être le moins « militaire » de tous les généraux. Souvenons-nous de ce mot lâché en 1808. Il poursuit sous la neige espagnole une armée anglaise. En traversant la sierra de Guadarrama dans la tourmente, il lâche cet aveu qui résume tout : « Foutu métier ! ».
Par les rapports des préfets il se tenait constamment informé de l’état d’esprit des populations, par eux il était à l’écoute de l’opinion publique. Point besoin pour cela de recourir à l’élection. Il détenait un moyen infaillible de mesurer la température des Français : le rendement fiscal et la conscription. Si les impôts rentraient (sous la Convention et le Directoire, les Français « oubliaient » de payer l’impôt), si les conscrits ralliaient leur corps, s’il y avait peu de déserteurs ou d’insoumis, cela signifiait incontestablement une adhésion de fait au régime. Les préfets étaient d’ailleurs notés selon ces critères de rendement. Les années passant, les défaites succédant aux victoires, l’insoumission devint une plaie suppurante. Soyons clairs : une population qui accorde ses fils au gouvernement soutient celui-ci. Si les conscrits se cachent, deviennent des réfractaires et des insoumis que l’on protège, c’est que la confiance a disparu.
Il convient ici d’ouvrir une parenthèse. On a tant dit de Napoléon qu’il était un ogre assoiffé de sang qu’il est utile de rappeler que le service militaire obligatoire est une invention de la République. Les idéologues humanitaristes de 89, 91 et 93 ont peut-être voulu faire le bonheur du genre humain, mais ils n’ont rien trouvé de mieux que de contraindre les jeunes gens à se battre pour des idéaux qui, somme toute, leur étaient assez étrangers. Aucun roi n’eût osé promulguer une telle loi qui eût passé pour abominable : la guerre pour tous ! La République généreuse est la mère des hécatombes de 1914, entre autres… Les armées limitées en nombre de l’ancien régime étaient basées sur un système d’une grande simplicité : la noblesse devait l’impôt du sang – ce qui justifiait ses privilèges. Formés par nature au commandement et au métier des armes, les jeunes nobles devenaient officiers. Ils payaient même pour acquérir leur grade. Convenons qu’au cours des siècles ils ne marchandaient pas leur sang si nécessaire. La troupe, quant à elle, était constituée de volontaires recrutés, percevant une solde (les « soldats ») et de mercenaires étrangers (Suisses, Allemands, etc.). Que ce « volontariat » fût quelque peu contraint, que l’on enivrât la recrue afin de lui faire signer un engagement, que les sergents recruteurs fussent des bonimenteurs, c’est vrai. Mais il n’en demeure pas moins qu’on eût effaré un paysan beauceron, un vigneron bordelais, un berger auvergnat ou un saute-ruisseau parisien en lui disant qu’à vingt ans il lui faudrait endosser PAR FORCE l’uniforme et aller se faire casser les os sur la frontière. C’était tout simplement une incongruité et c’est pour avoir voulu violer cet us millénaire que la Convention déclencha, entre autres causes, l’insurrection POPULAIRE des Vendéens (décret de levée de trois cent mille hommes de mars 93).
Si les Français ont conservé le vieux fond batailleur des Gaulois, ils n’ont pas le goût du militaire et de ses contraintes. C’est ainsi qu’il y avait de nombreux corps étrangers dans l’armée royale. L’armée était aussi le refuge des chômeurs, des déclassés, des crève-la-faim de tous les pays. On peut donc dire que les rois faisaient la guerre avec des officiers nobles et des lansquenets germaniques, ce qui, au fond, était d’une grande sagesse quant à la paix sociale du pays.
1793. Tout change. La France révolutionnaire a déclaré la guerre « au roi de Bohême et de Hongrie ». Aux rois et à toute l’Europe. Il est désormais établi que les Girondins au pouvoir ont poussé à la guerre pensant par là régler les difficultés intérieures. Ces idéologues dangereux car irresponsables, ces dogmatiques idéalistes entendaient bien, en exportant les idées de la Révolution, catéchiser l’Europe. Résultat : vingt années de guerre, deux millions de morts français et combien d’autres chez les peuples européens ?
Pour bouter le feu à un continent ils ne disposaient que des restes de la vieille armée royale, décimée par l’émigration de ses cadres, vidée de sa substance par la propagande et la suspicion. Cette armée n’est plus qu’un fantôme. Il convient ici de dissiper l’illusion tricolore du peuple de France se levant et s’enrôlant en masse aux cris de « la Patrie en danger ! » Cet appel au volontariat eut un faible rendement et l’armée de Valmy, celle de Kellermann et Dumouriez, n’est nullement, comme l’aurait dit le duc de Brunswick, une armée de « savetiers et de tisserands ». À côté de volontaires médiatisés et inexpérimentés, c’est encore la vieille armée du royaume et ses régiments de tradition.
1793. Le tournant. L’exécution de Louis XVI, cette tête de roi jetée en défi aux rois d’Europe, amène la création d’une coalition à laquelle il faut bien faire face. Mesures d’urgence : par un décret de mars, la Convention Nationale décide de lever trois cent mille hommes. C’est de cette première levée que date le service militaire obligatoire. La République découvre que l’on peut créer des armées à moins de frais qu’auparavant, la recrue coûtant moins que le mercenaire. Cette mesure ne fut pas sans effets négatifs ; c’est de là que date le soulèvement vendéen (il y eut aussi des causes religieuses mais nous sortirions du sujet). On connaît la suite, cette tache sanglante, période atroce de notre histoire longtemps et prudemment occultée pendant deux siècles d’enseignement laïc et obligatoire. Malgré toutes ces vicissitudes, la Révolution venait d’inventer la « nation en armes », mère des nationalismes et de leurs excès.
Napoléon, ce « Robespierre à cheval », décida d’assumer le passé, tout le passé et c’est parce qu’il sut donner assez de gages à la gauche (allant jusqu’à faire saisir et fusiller le jeune duc d’Enghien, un Bourbon) que les survivants de la Convention, les Thermidoriens, Fouché et les autres, le soutinrent. Cet homme ne pouvait plus les trahir puisque, d’une certaine manière, il devenait un peu régicide comme eux. Héritier indirect de Robespierre, il a conservé la conscription comme un moyen légal pratique d’assurer le renouvellement de ses armées à bon compte. Sans la conscription, la longue série de guerres de 1792 jusqu’à 1814 eût été impossible faute de moyens.
Ici deux écoles s’affrontent, deux clans : les partisans de Napoléon démontrent que les guerres qu’il a livrées lui ont été imposées par les événements ; qu’étant l’héritier et le fossoyeur de la Révolution, il ne pouvait qu’en poursuivre l’œuvre, c’est-à-dire conserver ses conquêtes territoriales. L’autre clan en a fait un boutefeu, un incendiaire, un fauteur de guerre, incapable de laisser l’Europe en repos, esclave de son ambition effrénée.
L’une et l’autre de ces thèses sont parfaitement démontrables si l’on confond le général Bonaparte et l’Empereur Napoléon, le militaire et le politique. Si « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », nous comprenons que chacune des campagnes menées par Napoléon Bonaparte n’est que la conséquence d’un échec politique : l’incapacité à obtenir la paix, une paix juste et durable. Sans cela, il faut voir Napoléon comme un dément, un tyran oriental que le peuple français aurait supporté en silence. Cette proposition est évidemment absurde.
En accédant au pouvoir en novembre 1799 par les moyens que l’on sait, il devient le maître d’un pays en état de guerre, extérieure et intérieure car, on l’oublie un peu, le foyer vendéen n’était pas éteint et ne le sera qu’en 1800.
Guerre extérieure surtout, en Italie, en Allemagne contre l’Autriche, en Suisse contre les Russes de Souvorov. La première campagne du Consul Bonaparte, celle de Marengo, ne sera pas décisive puisqu’il faudra attendre la victoire de Moreau à Hohenlinden, le 3 décembre 1800, pour que le Habsbourg consente à la paix. Et c’est parce qu’elle demeurera seule que l’Angleterre acceptera du bout des lèvres la paix d’Amiens en 1802.
Ah ! Le voici apparu en pleine lumière l’ennemi redoutable, patient jusqu’à l’obstination, celui qui sera derrière TOUTES les coalitions continentales : l’Angleterre. Jamais elle ne désarmera ; jamais elle ne consentira à la domination d’une seule puissance de l’Atlantique au Niémen. L’Angleterre est forte parce qu’elle sait diviser ses ennemis et combattre par l’entremise de ses alliés stipendiés. Pendant vingt ans elle s’alliera avec tout ce qui peut nuire à la France, fût-ce le diable lui-même. Elle n’aura qu’un but, qu’un objectif : abattre la puissance française, la réduire, la contraindre dans ses anciennes frontières. Elle sera avec la Prusse, l’Autriche, la Russie, Naples, l’Espagne, le Portugal, la Suède. S’il l’avait fallu elle aurait été avec l’Empereur de Chine, le Shah de Perse, le roi des Papous… Elle sera le financier des coalitions avant que de mettre le pied militairement sur le sol continental : en 1808 au Portugal, en 1809 en Hollande, en 1814 en France, en 1815 en Belgique. Et tout cet acharnement a un nom : Anvers.
C’est parce que la République – et non l’Empire – a conquis la Belgique jusqu’à l’Escaut et tient Anvers, « ce pistolet braqué au cœur de l’Angleterre » selon le mot de Pitt, que les gouvernements de Sa Majesté ne renonceront jamais. N’y voyons là aucune manifestation de francophobie. En 1914, l’Angleterre entrera en guerre pour les mêmes raisons : ne pas voir la Belgique occupée par une puissance.
L’histoire est l’esclave de la géographie : Anvers, port de guerre, menace directement l’embouchure de la Tamise. Qui tient la Belgique fait courir un péril mortel à la vieille Albion. Bonaparte, en succédant au Directoire, a hérité de la Belgique et de la rive gauche du Rhin – frontières naturelles de la Gaule, but ultime de tous nos rois. En prêtant serment, Napoléon s’engage à maintenir ces conquêtes. De ce jour, plus de paix possible : l’Angleterre menacée dans son commerce maritime, dans ses œuvres vives, ne lâchera pas. Ce sera la lutte à mort. Constance des politiques britanniques de Pitt à Churchill de 1805 à 1945…
Les guerres de l’Empire ne sont au fond qu’une seule et même guerre, constamment renouvelée, contre l’île indomptée. Napoléon, du jour où il échoue à franchir la mer, depuis Trafalgar et même depuis l’échec de Boulogne, devra aller se battre partout, à Austerlitz, à Iéna, à Eylau, à Borodino, en Espagne, jusqu’à Paris… Napoléon décrétera le blocus continental pensant par là ruiner le commerce anglais. Pour assurer l’étanchéité du blocus, il parcourra toute l’Europe, livrant bataille après bataille, remportant victoire sur victoire, afin d’atteindre son ennemi lointain. Il entrera à Vienne, à Berlin, à Madrid, à Moscou – il aurait pu entrer à Pékin – sans jamais franchir la Manche. Il succombera sous le poids conjugué de la Livre Sterling et des masses européennes. Toute cette gloire militaire dont nous ornons nos monuments n’est au fond que l’aveu de l’échec d’une politique. Trop fort militairement, les guerres dureront. Moins talentueux, vaincu plus vite, la paix anglaise se fût établie sur l’Europe. Paradoxe…
Napoléon ira même jusqu’à épouser une archiduchesse d’Autriche (lui, le lieutenant corse !), escomptant par là entrer dans la famille des rois et devenir enfin fréquentable. Mais quoi qu’il entreprît, il ne sera jamais un « gentleman » et on ne négocie pas avec un individu qui ne serait pas un gentleman. D’où les guerres, le déclin, peu à peu. L’Empire est une bête blessée qui saigne en Espagne, en Russie mais se bat encore. Elle saigne en Allemagne en 1813 mais lutte toujours. Elle agonise en Champagne en 1814 et tombe, exsangue. La suite est connue : l’abdication, Elbe, ironique royaume de Sancho Pança, trop petit et trop proche. Faute politique : en 1814, connaissant l’homme, il fallait le pendre ou le déporter au bout de la terre. Lui donner Elbe, c’est tenter le diable.
II
Le retour du Père-la-violette1
Et le diable se laissa tenter. Avec un millier de diablotins (le bataillon de l’Île d’Elbe, un escadron de lanciers polonais, etc.), le voici débarqué à Golfe Juan. Pure folie, acte de désespéré ? Voire. Si Louis XVIII avait convaincu le peuple français, Bonaparte n’eût pas fait cinquante lieues sans être arrêté et son escapade se fût achevée dans le grotesque ou le tragique. Mais la France de 1815 n’est plus celle de 1785. Louis XVIII, homme fin et intelligent, l’avait bien compris. Il aspirait à la paix sociale, à la réconciliation des deux Frances et au pardon des offenses. Il était sans doute le seul parmi son entourage. Le malheur fut que ceux qui accédèrent au pouvoir en avril 1814, qui occupèrent les places, les grades et les fonctions publiques ne le comprirent pas. Ils ne pouvaient effacer vingt ans d’épopée, dix ans de révolution. Absents depuis vingt années, survivants de familles martyrisées sous la Terreur, fidèles jusqu’à l’outrance à leur roi légitime, dévoués jusqu’à l’abnégation à ce qu’ils pensaient être la vraie patrie, ils ne voulurent ou ne surent voir ce qu’elle était devenue, ayant plus changé en une génération qu’en mille ans.
Et tout d’abord l’armée : elle a beau arborer la cocarde blanche, elle a le cœur tricolore. La première Restauration fut un épouvantable malentendu : la France, épuisée, accepta avec soulagement le retour du roi bourbon faute d’avoir pu servir le roi de Rome. Le roi, c’était la paix, enfin, en gage de joyeux avènement. Les émigrés crurent que la France, au fond, était demeurée royaliste. Cruel malentendu, source de rancœurs. Ces hommes qui « avaient vaincu toute la terre, chassé vingt rois, passé les Alpes et le Rhin » (Hugo) éprouvaient quelque difficulté à servir sous des chefs survivants de l’armée de Condé ou chouans avérés. Lorsque les Français réalisèrent que la Restauration portait bien son nom, ils déchantèrent. Les généraux et maréchaux d’Empire s’en accommodèrent dans l’ensemble car Louis, sagement, leur conservait titres, donations et rang. Les parvenus de l’armée du Rhin, d’Italie ou de Sambre et Meuse firent bon accueil au roi qu’ils avaient quelque peu contribué à installer parmi les dépouilles opimes de Napoléon. N’oublions jamais que des hommes tels que Ney, Lefebvre, Macdonald, Marmont, par leur attitude insurrectionnelle, avaient carrément poussé l’Empereur dehors. C’est parce que Marmont avait livré son corps devant Corbeil que les Alliés hésitants avaient rejeté la régence de Marie Louise. Ces hommes gavés d’or, de titres et d’honneurs n’entendaient plus se ruiner la santé pour un homme fini. C’est sans doute ce rustaud de Lefebvre, duc de Dantzig qui sut le mieux résumer la pensée des autres : « Après tout, il n’avait qu’à pas nous ôter la besace de dessus le dos ! »
Mais ceux qui portaient encore la besace, les officiers de troupe, les réformés, licenciés, mis à la demi-solde, ceux qui revenaient des bagnes de Sibérie et des pontons de Cadix, ceux-là constituèrent sur tout le territoire autant d’abcès de frustration qui se mirent à fermenter.
Pour bon nombre de Français, l’Empire, malgré ou grâce à la guerre, apportait la prospérité : négociants, fournisseurs aux armées, industriels du textile, de la chimie, ouvriers des manufactures, éleveurs de chevaux, ouvriers des arsenaux, gros laboureurs. Tous profitaient de la consommatrice effrénée qu’est une armée sans cesse en activité. La guerre a toujours dopé une économie, le blocus continental, en maintenant des prix élevés, entretenait un haut niveau d’emploi ; les peuples vaincus, occupés ou vassaux devaient nous acheter nos produits, sans la concurrence des produits anglais.
Quand vint la paix, tout changea. Cette paix si ardemment souhaitée, en ouvrant les frontières au flux du commerce, ruina les entreprises protégées. La paix amena la récession et le chômage, elle fut une source de mécontentement : que faire de tous ces produits que l’on ne pouvait plus écouler ? Plus près de nous, rappelons-nous ce que furent les immédiates après-guerres de 1918 ou 1945 en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Il y eut donc un instant où la France REGRETTA Napoléon. L’Empereur, tout en leur demandant leurs fils, les avait enrichis peu ou prou et gavés de gloire. Obéissante, certes, elle était toute pétrie d’un orgueil militaire et d’une suffisance que mêmes les désastres des deux dernières années n’avaient pas effacés.
Sans qu’on s’en aperçût, les hommes rentrés dans le sillage du roi et qui prétendaient au retour de l’ancien ordre des choses finirent par symboliser la défaite et les « fourgons de l’étranger ». Ils allèrent même jusqu’à exiger d’être dédommagés d’avoir perdu leurs biens en émigrant. Ces biens, confisqués, avaient changé de mains : c’étaient une partie des biens nationaux. On alla jusqu’à parler du « milliard des émigrés ».
Ainsi quand le roi en appela à la France entière pour courir sus au brigand Bonaparte, la France jeta sa cocarde blanche et ressortit sa cocarde tricolore qu’elle avait soigneusement dissimulée au cas où.
Certains mots sont lourds de sens politique : Louis avait réoccupé et non reconquis le trône de ses ancêtres. Par orgueil dynastique, il « octroya » la Charte de 1814 – charte d’ailleurs assez libérale. Octroyer c’est concéder, comme on accorde des gages à ses serviteurs. Octroyer, verbe maladroit. Que ne l’eût-il acceptée ou reçue des Chambres ? Le sens en eût été tout autre. Mais le Bourbon descendant de trente rois ne pouvait se laisser imposer une constitution par l’émanation même édulcorée du peuple. Il avait au cœur le souvenir de son défunt frère à qui l’on avait imposé tant de choses outrageantes. Mais en « octroyant », il prenait le meilleur chemin pour ulcérer les républicains et les libéraux.
Appelons un chat un chat : en ce printemps de 1815, par son attitude envers Bonaparte, la France « vota ». Oh, certes, elle vota sans urnes ni bulletins, mais elle vota : pour ou contre le roi, pour ou contre l’empire bis. Le résultat, écrasant, déconcerte comme il déconcerta l’Europe. Ces Français sont décidément incorrigibles ! Si la démocratie, l’opinion, le peuple, quel que soit le nom qu’on lui donne, s’exprime ainsi, il est certain que l’accueil fait à Napoléon, au fur et à mesure de sa lente remontée sur Paris, ressemble bigrement à un plébiscite. En partant s’embarquer pour Elbe en 1814, Bonaparte avait craint pour sa vie en Provence. Connaissant l’état d’esprit de cette province, il choisit de l’éviter en remontant par la route des Alpes. À cet instant, il n’est encore qu’un aventurier. L’armée royale est fidèle à ses chefs et ne s’émeut guère aux tentatives de débauchage suscitées par les agents bonapartistes.
Les premiers jours, ce furent les paysans qui accoururent à lui, lui offrant des violettes. Au sixième jour, on a atteint le défilé de Laffrey, sur la route de Grenoble. La petite troupe du début est doublée par l’appoint des paysans et villageois alpins. C’est à Laffrey que tout bascule : un bataillon du 5e de ligne se rallie. La suprême habileté de Napoléon est d’avoir senti le vent de l’opinion. Dépouillant l’Empereur, il redevient le général Bonaparte, celui de 93 : « Vos pères sont menacés du retour des dîmes, des privilèges et des droits féodaux. N’est-il pas vrai, citoyens ? » Citoyens ! Il retrouve, ô habileté, le vieux langage oublié de la Révolution. À Grenoble on chantera la Carmagnole sous ses fenêtres. À Grenoble, c’est tout le 7e de ligne, colonel de la Bédoyère en tête qui se rallie. Plus tard, après les Cent-Jours, la Bédoyère le paiera de sa vie. Et « la victoire marchera au pas de charge. L’Aigle, aux couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre Dame ! » Plébiscité par le peuple des faubourgs et des champs : ouvriers, artisans, cultivateurs, rejoint par les troupes lancées contre lui, plus rien désormais ne l’arrête, ni les proclamations du roi ni les généraux demeurés fidèles au gouvernement. Débarqué rebelle et hors-la-loi, mis au ban de la France avant d’être à celui du monde civilisé, Bonaparte marche sur Paris. Sagement, il ne fera rien pour empêcher le départ du roi ni pour le bloquer. Son nouveau règne eût fort mal débuté par un bain de sang franco-français. Quel que soit notre sentiment envers Bonaparte, force nous est de reconnaître qu’il conquit la France à lui tout seul et sans tirer un coup de feu. Il avait simplement vingt millions de complices : la France elle-même.
Avant son ralliement, Ney dira fort justement : « Nous assistons à une rechute de la Révolution. » C’est exact : révolution sans heurt, en douceur, mais révolution tout de même. Le vol de l’Aigle, l’entrée enivrante aux Tuileries, porté en triomphe par ses partisans, toute l’aventure est le début d’une méprise. Aux Cent-Jours, en mars du moins, les Français attendirent le général Vendémiaire et non l’Empereur Napoléon. La suite devait les dégriser. Seul Paris refusa de s’enivrer du petit vin bonapartiste, préférant la tisane royaliste. Cet état d’esprit assez mitigé ne sera pas sans conséquences après Waterloo.
Le 20 mars 1815, sous les acclamations de ses fidèles et les huées de l’Europe, Napoléon reprenait possession des Tuileries. Le même jour, la très bourgeoise Garde Nationale de Paris continue d’arborer la cocarde blanche. De ce hiatus naîtra dans trois mois un gouffre béant.
La France l’ignore, Napoléon s’en doute : on a mangé le pain blanc. Désormais, la sueur, le sang et les larmes…
III
Une impossible paix…
Qu’il soit bien entendu que Napoléon n’avait pas débarqué à Golfe-Juan dans l’intention de combattre à nouveau. L’an d’avant, la France l’avait désavoué en comprenant que le génie militaire de l’Empereur n’était plus en mesure de repousser l’invasion. D’autre part, sur le plan politique, il ne lui était plus possible de restaurer l’Empire absolu avec ses Chambres muettes, son Sénat servile, son opinion acquiesçant sans mot dire à chaque décret impérial sous l’œil vigilant du préfet et de ses gendarmes. Ce que les historiens nommeront l’Empire « libéral » fut une restauration constitutionnelle dans laquelle des Chambres hostiles et méfiantes entendaient garder une vue critique et vigilante sur le Corse. Des hommes comme Benjamin Constant, Lanjuinais ou Lafayette, phares de l’opposition libérale, ne pouvaient être taxés d’idolâtrie envers le revenant. Fouché attendait son heure, araignée au centre de sa toile. Il jouait gagnant à tout coup : si l’Empereur assoyait son pouvoir face à l’Europe, il saurait se montrer utile comme par le passé. S’il tombait, comme c’était à prévoir, sous les coups d’une septième coalition, le duc d’Otrante entendait bien jouer un rôle d’entremetteur afin de s’assurer les grâces de Sa Majesté Louis XVIII. Le seul vrai soutien de Napoléon bis, outre le populaire dont il répugnait à se servir, on verra pourquoi, était l’armée. S’il avait tenu des propos révolutionnaires au début du « vol de l’Aigle », ceux-ci s’étaient fort assagis au fur et à mesure de sa remontée sur la capitale. À Vizille, les Français étaient des citoyens, à Paris, ils étaient redevenus des sujets. Napoléon refusera de jouer sa seule vraie carte, la carte républicaine après Waterloo. À l’annonce de la défaite et de la marche des alliés sur Paris, les tirailleurs fédérés et les ouvriers des faubourgs réclameront des armes. C’était 92 qui revenait ! Napoléon allait-il établir une dictature robespierriste, à gauche toute, en s’appuyant sur cette frange du peuple qui avait été à la base des « journées » révolutionnaires. Ces hommes qui n’avaient rien reçu de l’Empire, les laissés-pour-compte étaient prêts à tout lui accorder pourvu qu’il fût le bras armé de la révolution régénérée.
Par nature, Napoléon y répugnait. Il avait toujours craint la foule et ses débordements. Jeune officier, il avait servi la Révolution – pouvoir légal du moment – mais il n’avait jamais pataugé dans les horreurs de ses excès. Il avait assisté avec dégoût aux abominations de la prise des Tuileries au Dix Août 92 ; à Toulon, il s’était bien gardé d’entrer dans la ville reconquise afin de ne pas participer à la féroce répression ; en 94, il refusait de rejoindre son affectation en Vendée, préférant battre la semelle et crever la faim sur le pavé de Paris. Lors des journées de Vendémiaire, ce n’est pas sur le peuple qu’il fait tirer mais bel et bien sur des milices royalistes armées qui marchent sur la représentation nationale. Homme d’ordre, de goût bourgeois, il perdait ses moyens devant la fureur populaire, les cris, le tumulte. À Saint Cloud en Brumaire, il manque tout compromettre, bégayant devant les cris des députés. Des hommes hurlant, vociférant, le désarçonnent. Au fond, il n’est heureux qu’au milieu de ses soldats calmes, respectueux, aimants, prévisibles. Le spectre de la Révolution avec ses émeutes, ses foules avinées, ses femmes dépoitraillées brandissant des piques emmanchées de têtes tranchées lui faisait horreur. Le souvenir des massacres de Septembre 92 (une honte pour la patrie des Droits de l’Homme) était pour lui un cauchemar. C’est avec exécration qu’il qualifiait un individu de « septembriseur » ; ce mot prenait valeur d’insulte dans sa bouche. Il faut donc mal connaître l’âme profonde de cet homme pour envisager qu’il eût pu se conduire en meneur terroriste et se couler dans la peau d’un tribun à la Danton.
Lui qui avait tenté de rallier l’ancienne noblesse ne se voyait pas accrochant les aristocrates à la lanterne. Lui qui avait rétabli les autels du catholicisme ne s’imaginait pas faisant la chasse aux prêtres. Lui, fondateur d’une nouvelle noblesse, qui avait voulu la fusion des vieilles familles de France avec celles de la nouvelle élite, ne voulait pas établir de nouvelles listes de proscription engendrant une autre émigration.
Bref, plus qu’une défaite militaire, il redoutait d’avoir à livrer la France à la guerre civile. Il le dira avant que de s’embarquer en juillet 1815. L’homme agit toujours selon sa nature profonde et ses décisions politiques sont l’émanation de sa culture, de sa formation et de son âme. À un homme qui fut sacré par le pape, on ne pouvait demander de se conduire en forcené de 94.
C’est la bourgeoisie qui fit la Révolution. Cette classe émergente avait toujours été le soutien de la monarchie capétienne. Face à la turbulence et à l’esprit rebelle des féodaux, les rois de France s’étaient appuyés sur ce moteur du Tiers État, élément créateur de richesses, cultivé et désireux de le faire savoir. C’est dans cette « classe » – terme impropre alors – que les Capétiens directs, les Valois puis les Bourbon avaient recruté leurs meilleurs ministres, de Philippe le Bel avec Marigny à Louis le Grand avec Colbert. Cette bourgeoisie, détentrice de l’argent et du savoir, comprit vers 1760 qu’elle pouvait être une force face à une aristocratie engourdie, jouisseuse ou dégénérée. C’est de ses rangs que sortira le personnel de la Constituante et de la Législative, Robespierre et Danton étaient avocats, ainsi que des Girondins, Marat était médecin, Desmoulins journaliste, Fouché enseignant, etc. Comme il arrive souvent au cours des révolutions, elle fut débordée par ses éléments les plus extrémistes. La machine s’emballa puis le coup d’État de Brumaire ne réussit que parce que Bonaparte, au fond, apportait à tous un élément d’ordre intérieur. D’une certaine façon, la nouvelle classe dominante agréa le Consulat puis l’Empire parce que Napoléon était un homme dans lequel cette classe retrouvait ses désirs de tranquillité, de calme, d’ordre public et de libre exercice des activités professionnelles. Napoléon gouverna au centre droit et l’Empire ne fut jamais une dictature militaire.
Les chefs de l’armée, maréchaux, généraux, colonels, s’étaient comme leur souverain « embourgeoisés » et, si ce qualificatif a pris de nos jours une connotation péjorative, il n’en était rien vers 1810. La meilleure preuve est que les deux seules fractions opposantes furent, aux extrêmes, les irréductibles du faubourg Saint-Germain d’une part et les nostalgiques de la Révolution d’autre part. Les attentats, complots et tentatives d’assassinat qui jalonnèrent le Consulat et l’Empire furent tous l’œuvre de ces extrémistes de droite (Cadoudal) ou de gauche (Malet, Arena, Topino Lebrun).
En 1815, Napoléon a par-dessus tout besoin de la paix. Une certaine France l’a accueilli avec enthousiasme, une autre le regarde avec méfiance. En mars et avril, l’Empereur ne cesse d’affirmer urbi et orbi qu’il veut la paix, qu’il ne désire la guerre avec quiconque. Le 27 mars, Caulaincourt écrit ainsi à Metternich : « Nous voulons la paix. Sa Majesté me charge d’en donner à votre cour l’assurance formelle. » De même, Fouché écrivait à Londres : « Le cabinet des Tuileries est disposé à recevoir du gouvernement anglais toute proposition qui assurerait une paix solide et durable. » Napoléon lui-même, afin de convaincre les hésitants, les avait assurés qu’il entretenait une correspondance secrète avec son beau-père l’Empereur d’Autriche et qu’il avait son soutien. C’était faux. Il était seul et le savait. Il déclara la paix à tous les gouvernements de l’Europe, tentant de retarder l’inéluctable. Il y a, à relire les documents de la première période des Cent-Jours, quelque chose de pathétique. Cet homme qui, durant quinze ans, a dicté sa loi à l’Europe, en est réduit à mendier une paix qu’en d’autres temps on eût craint qu’il rompît. Lui, dont on redoutait jadis un froncement de sourcils, ne faisait plus peur. On savait qu’il pouvait être vaincu par des masses accumulées. Mis au ban du continent, il prêchait dans le désert. Mal assuré sur ses propres arrières, il ne pouvait même plus espérer diviser ses adversaires. Ceux-ci, réunis au congrès de Vienne, circonvenus par Talleyrand, étaient devenus des moutons enragés. Par leur proclamation du 13 mars, ils déclarèrent unanimement vouloir la peau du perturbateur de l’Europe.
Ainsi pour avoir la paix, il lui fallait la guerre. La guerre, une nouvelle fois. On se lasse à énumérer, dans la carrière de cet homme, les guerres déclenchées dans le but de conquérir cette paix qui, seule, lui eût permis de gouverner la France à son gré. Il est paradoxal de ne voir dans la carrière de Napoléon qu’une ascension jalonnée de réussites et de coups d’éclat. Ce n’est qu’une apparence. La réalité est qu’il échoua année après année, sauf en 1802 avec la fragile paix d’Amiens, paix trompeuse, trêve plutôt que paix sincère et durable. La gloire de l’Empire a pour toujours masqué cette misère politique. Napoléon, dans un de ses nombreux aphorismes, a bien résumé le problème : « On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s’asseoir dessus. » La guerre n’est pas une fin en soi et, à moins d’être Attila ou Gengis Khan, la conquête guerrière offre peu d’intérêt. La véritable réussite d’un gouvernement se mesure à ce qu’il peut assurer à son peuple paix et prospérité. Là fut la pierre d’achoppement de l’épopée.
Si vis pacem, para bellum. Dès avril, la guerre monte à l’horizon des frontières. Prochaine, inéluctable, elle s’annonce inexpiable. Cette guerre sera un règlement de comptes.
IV
Veillée d’armes
Et tout d’abord un règlement de comptes franco-prussien : en 1814, les Prussiens se sont conduits en pillards dans les départements français envahis. Humiliés, écrasés en 1806, la guerre de 1813-1814 devenait pour eux une guerre de libération de l’Allemagne asservie. Les combats de 1815 entre Français et Prussiens seront des égorgements féroces. Après les avoir vaincus pendant dix ans, les Français avaient le sentiment qu’à forces égales jamais les Prussiens n’auraient le dernier mot.
Mais il existait aussi un lourd contentieux entre les Anglais et les vétérans des guerres de la péninsule ibérique. Les anciens de Baylen, de Busaco, de Torrès Vedras ou des Arapiles avaient souffert du feu terriblement ajusté de la mousqueterie anglaise qui décimait les colonnes d’assaut. Il y avait des Français qui avaient une raison toute personnelle de haïr les soldats écarlates : c’étaient les rescapés des sinistres pontons de Cadix, de Portsmouth ou de l’îlot de Cabrera, ces camps de concentration où les Anglais les avaient laissés pourrir durant leur captivité.
L’armée française de 1815 serait donc habitée par un désir de vengeance, un goût de la revanche qui lui donnerait un mordant sans précédent. Elle aborderait l’ennemi avec la ferme intention d’aller au corps à corps, sans souci des pertes. L’inconvénient de cet état d’esprit est qu’il prive la troupe de sa lucidité et de son sang-froid essentiels à la manœuvre. On en verra les effets lors de la boucherie du Goumont.
L’instrument que Napoléon va manier est redoutable : enthousiaste, tranchant, désireux d’en finir une bonne fois pour toutes, mais nerveux, fragile, émotif, enclin à voir des traîtres partout, soupçonneux à l’égard des hauts officiers, idolâtre envers l’Empereur, bref une armée redoutable dans l’assaut mais susceptible de panique au moindre revers.
L’armée française des Cent-Jours, c’est l’armée royale, soit environ deux cent mille hommes toutes armes confondues. Compte tenu des garnisons des places, des malades des hôpitaux, des hommes en congé, réfractaires et manquants divers, la masse de manœuvre, celle qui constitue l’armée de campagne, n’excède guère cinquante mille hommes en avril. Quoi de plus normal ? La France était en paix. On avait débauché, réformé, mis à la retraite des hommes et des cadres ; ceux qui demeuraient sous les armes étaient tous des vétérans des campagnes précédentes.
Pour des raisons de politique intérieure, Napoléon n’entendait pas faire renaître la conscription tant détestée. Mais il possédait un artifice juridique lui permettant, le territoire national menacé, de mobiliser les Gardes Nationales mobiles : c’étaient les décrets lois de 1791, 1792, 1805 et 1813.
Les rappelés à compter du 25 avril donnèrent quelque quatre-vingt mille hommes ; il y eut environ quinze mille engagés volontaires plus tous les cadres licenciés par le roi. La mobilisation légale des Gardes Nationales donna 326 bataillons, hommes âgés de vingt à quarante ans et déjà instruits. On les dirigea sur les places fortes ; certains furent adjoints à la Ligne. Ne voyons pas dans ces milices des troupes de second ordre, ce serait une erreur. En 1814, à la Fère Champenoise, la division de Gardes Nationales du général Pacthod livra un combat héroïque aux masses alliées et se fit détruire plutôt que de mettre bas les armes. Napoléon ne l’avait pas oublié. Au 15 juin, cent cinquante mille Gardes Nationales avaient, d’enthousiasme, rejoint les places qui leur avaient été assignées. Ainsi le général Gérard écrivait : « Les dix bataillons des Gardes Nationales de la réserve de Nancy sont superbes. Dans trois semaines, il n’y aura pas de différence avec la troupe de ligne. »
La guerre devenant plus que probable, on leva la classe de 1815 en se gardant bien de parler de conscription. Il y avait à cela une raison : cette classe avait été appelée en 1814 mais il restait un reliquat de cent mille recrues qui n’avaient pu rejoindre à la chute de l’Empire. Les considérant comme légalement appelés, on les assimila à des militaires en congé. Au 11 juin, quarante-six mille d’entre eux étaient sous les drapeaux. Si la guerre se prolongeait et si l’on tenait jusqu’en octobre, on aurait six cent mille hommes sous les armes, ce qui nous mettrait à égalité, ou peu s’en faudrait, avec les contingents alliés. Mais il fallait tenir jusqu’à l’automne…
C’était cependant une armée équipée de bric et de broc, un rien clochardisée. Les énormes besoins des campagnes de 1813 et 1814 avaient vidé les magasins et le roi n’avait pas jugé nécessaire de pousser les armements. La guerre, c’était le passé. Ainsi, en 1815, des escadrons de cuirassiers manquaient de cuirasses, des havresacs n’avaient pas de courroies, des ficelles tressées remplaçaient la buffleterie. Dans les bataillons d’infanterie, seules les compagnies de grenadiers étaient équipées du sabre court dit « briquet ». On vit même le 4e régiment de Grenadiers de la Garde n’avoir pas de bonnets d’ourson et coiffer des shakos et des bonnets de police. La cavalerie prussienne à Ligny les prendra pour des Gardes Nationales ; il lui en cuira et l’habit ne fait pas le moine.
Mais s’il manquait plus d’un bouton de guêtre, par contre, on avait des armes, des canons, des fusils et cinq millions de cartouches, dotation de l’armée de campagne. Pour les réserves mobilisées, on verrait plus tard.
Napoléon poussait Davout, ministre de la Guerre, jour et nuit. La guerre inévitable, il fallait tout reconstituer, tout remonter et le temps pressait. Le prince d’Eckmühl houspillait les bureaux ; les bureaux harcelaient les fournisseurs, les arsenaux, les dépôts de remonte, les manufactures. Ce fut un travail colossal. Serait-on prêt avant que la coalition ennemie se mette en branle ?
La légende veut que l’Empereur fût vieilli, alourdi, bouffi, somnolent, déclinant, à quarante-six ans. Mais, à mesurer la tâche accomplie en quelques semaines, entre le 20 mars et son entrée en campagne le 14 juin, on aurait tendance à modérer ce jugement hâtif. Tâche monstrueuse, diplomatique, politique, juridique, militaire. Tout relancer, tout contrôler, tout remettre en chantier, agir, commander, vérifier, corriger puis réfléchir, penser, décider, ordonner ; tout partait de lui, tout lui revenait dans les mains. Depuis quinze ans on était habitué à ce que la France fonctionnât ainsi, machine gigantesque actionnée par un seul cerveau.
Davout, son meilleur maréchal, fut un exemple de ministre de la Guerre. Dans l’histoire de l’Empire, Davout est mal aimé ; il était détesté par ses collègues : mauvais coucheur, bourru, rabat-joie, intransigeant sur la discipline, il était tellement supérieur aux autres généraux dans l’art de la guerre qu’il leur faisait de l’ombre. Napoléon ne l’aimait pas, jaloux de son talent. Quand Murat, Lannes, Ney, Soult sont nimbés de la gloire impériale, Davout semble n’en recueillir que les reflets. Napoléon, sans l’avouer jamais, éprouvait du dépit à constater que cet homme-là était peut-être son égal. Lorsqu’il apprit le résultat de la bataille d’Auerstedt, le 14 octobre 1806, l’Empereur eut un doute : avec trente-trois mille soldats, Davout avait écrasé soixante-quatorze mille Prussiens ! Le même jour à Iéna, Napoléon avait la supériorité numérique. Cependant, les bulletins exaltèrent léna et occultèrent quelque peu Auerstedt. On alla même jusqu’à trafiquer les chiffres. L’Empereur fit cependant de son maréchal un duc d’Auerstedt et lui permit d’entrer le premier dans Berlin. À Austerlitz, par son action à l’aile droite, Davout avait grandement permis le succès. À Eckmühl, en 1809, il fut fait prince. Davout fut le seul maréchal de l’Empire à ne JAMAIS être vaincu. Les alliés le craignaient terriblement et son corps d’armée valait presque la Garde. Gouverneur de Hambourg en 1813, il tint la place jusqu’à ce que le roi, en 1814, lui donnât formellement l’ordre de mettre bas les armes. Quoique mal aimé, Davout fut un des seuls à servir fidèlement jusqu’à la chute. Il refusa de servir Louis XVIII quand tant d’autres « allaient à la soupe ». Fort logiquement, aux Cent-Jours, Napoléon s’appuya sur ce roc. Nul doute que, Davout présent en Belgique, les alliés eussent été avalés d’un seul coup de mâchoires. Mais, pour des raisons de politique intérieure et de sûreté des arrières, Napoléon ne pouvait s’en remettre qu’au prince d’Eckmühl. C’est par l’arrière bien plus que sur le terrain que l’Empire s’était écroulé en 1814. Napoléon ne tenait en aucun cas à recommencer la même erreur et fit donc de Davout son ministre de la Guerre – donc l’organisateur de l’armée, des approvisionnements, des places, de la mobilisation, des renforts, bref le maître d’œuvre de la logistique. Il le fit en outre gouverneur militaire de Paris, première place forte de France, base arrière de l’armée et point de départ de sa ligne de communications, fonction essentielle s’il en est. Avec Davout à la Guerre et le républicain Carnot (« le grand Carnot ») à l’Intérieur, Napoléon prenait ses aises. Il pouvait combattre sans craindre les défections dont il avait été victime l’année précédente.
Davout au ministère, l’armée en voie de reconstitution, il lui fallait trouver des chefs pour exercer les grands commandements, divisions et corps d’armée, état-major général. Il lui fallait des hommes expérimentés, sûrs, dévoués et qui puissent dans certains cas, se commander eux-mêmes, surtout ceux qui allaient agir aux frontières de l’Est et du Sud-est. La France étant le centre d’un cercle hostile, il ne pouvait être partout à la fois, sur les Alpes, le Rhin, les Pyrénées. L’agitation reprenait dans l’Ouest, il faudrait se garder aussi dans ce secteur. Napoléon n’entendait pas poursuivre de sa vindicte ceux qui l’avaient lâché en 1814 sauf Marmont, moderne Iago, et Augereau, lamentable à Lyon. Ayant besoin de chefs, il passa l’éponge sur les offenses et les propos malheureux (Soult, Ney…).
L’usage et la tradition voulaient que les corps d’armée fussent commandés par des maréchaux, mais il en restait bien peu parmi les vingt-six qui avaient reçu le bâton depuis 1804. Bessières, Lannes, Poniatowski étaient morts au combat. Pérignon, Sérurier, Kellermann, maréchaux honoraires, étaient trop âgés. Masséna, malade, n’était plus que l’ombre de ce qu’il avait été. Macdonald, Marmont, Victor avaient suivi le roi en exil. Augereau, radié de la liste des maréchaux. Berthier, irremplaçable chef d’état-major, était quasi prisonnier chez son épouse, à Bamberg. Il se suicidera bientôt et son absence sera une des causes de la défaite de Belgique. Oudinot, compromis, demeura sans emploi de même que Gouvion Saint-Cyr, assigné à résidence dans sa terre de Reverseaux. Moncey et Lefebvre furent nommés pairs et donc écartés de l’action. Il pouvait donc faire usage de Soult, Mortier, Brune, Ney (avec réticence), Suchet, un des meilleurs, voire Murat qui s’offrait, mais Murat avait porté les armes contre la France en 1814; on ne pouvait décemment lui confier la cavalerie. On choisit donc Grouchy, le dernier maréchal, pour occuper ce poste. Choix excellent d’ailleurs car Grouchy avait montré tout son talent de chef de cavalerie à Hohenlinden, Eylau, Friedland, Wagram, la Moskowa. Hélas, Grouchy n’avait jamais commandé hors de la présence de son chef. Il ignorait la terrible solitude du chef d’armée. Autre cause de ce qui va suivre.
Napoléon mit Jourdan à Besançon, place forte d’une extrême importance face aux Austro-Russes. La Garde échut à Mortier. On repoussa donc Murat, discrédité. Il tentera sa chance à Naples et finira fusillé contre un talus comme un vulgaire bandit de grand chemin. Pauvre Murat !
L’impeccable Suchet, duc d’Albufera, gardera la frontière alpine avec vingt-trois mille hommes ; le républicain Brune tiendra la ligne du Var avec cinq mille cinq cents soldats. Comme il fallait se garder partout on constitua d’autres détachements : Rapp sur le Rhin avec un vrai corps de vingt-trois mille hommes ; Clausel et Decaen, chacun à une extrémité des Pyrénées, n’avaient pas quatorze mille soldats à eux deux. Le vieux républicain Lecourbe, à l’annonce de la patrie en danger, s’offrit à reprendre du service : on lui donna les huit mille hommes d’une armée dite du Jura ; comme l’ouest s’agitait sous les menées royalistes, il fallut encore distraire dix mille hommes de bonnes troupes dont deux mille de Jeune Garde confiés à Lamarque ; ils feront cruellement défaut le 18 juin au Mont Saint Jean… On était bien loin des 14 armées de l’an II créées par Carnot, mais comment faire mieux ? On en était là.
Avec le temps, on amalgamerait des bataillons de Gardes Nationales actives à ces noyaux de troupes régulières.
L’armée principale, celle qui prendrait l’offensive, aurait cent vingt-quatre mille hommes sous l’Empereur. Ce serait l’armée du Nord. Elle aurait 5 corps d’infanterie et 4 de cavalerie et ces corps ne seraient pas sous les ordres de maréchaux, mais ceci est un faux problème car tous leurs chefs étaient des généraux d’expérience : Gérard, Reille, d’Erlon, Pajol, Exelmans, Mouton, Kellermann fils. Ces hommes avaient tous exercé des commandements indépendants en Espagne ou ailleurs. L’Empereur les nommait d’ailleurs ses « nouveaux maréchaux », entendons par là ses futurs maréchaux. Sous l’œil du maître, ils ne devaient poser aucun problème. Demeurait cependant le choix crucial du major général, le bras droit de l’Empereur. Qui à la place de Berthier ?
Diriger, c’est aussi savoir choisir ses collaborateurs. Quel que soit son génie, à partir d’un certain niveau de responsabilités, l’homme seul périt écrasé sous l’immensité de la tâche. Napoléon avait l’œil infaillible pour discerner le talent utile à servir ses desseins. S’il avait choisi Alexandre Berthier, ce n’était nullement par affection ; il l’appelait sa « foutue bête ». Il est vrai que Berthier prêtait parfois à rire et que son ménage à trois avec une princesse allemande et la marquise Visconti faisait jaser. Mais il n’en était pas moins le meilleur chef d’état-major que Napoléon eût pu espérer.
Berthier, fait prince de Wagram et prince souverain de Neuchâtel et Valengin (en Suisse actuelle) était bien le seul qui pût transcrire en ordres intelligibles les pensées stratégiques de son maître. Incapable lui-même de commander ne fût-ce qu’une brigade, il était irremplaçable dans son rôle de bureaucrate infatigable, ponctuel, efficace et dévoué. Ses ordres arrivaient en temps et en heure, expédiés par autant de courriers que nécessaire. Dans l’armée allemande, le chef d’état-major est, de fait le « cerveau », le général commandant en chef étant celui qui exerce nominativement la direction des opérations ; ainsi Gneisenau était la « tête » de Blücher. Cette coopération est chose très naturelle dans bien des armées. Il n’en était pas question dans la Grande Armée, Napoléon étant lui-même son chef d’état-major. Le rôle de Berthier était plutôt celui d’un super secrétaire particulier, d’un intendant général qui ne pouvait prendre aucune décision et n’intervenait pas dans la conception des manœuvres. Il était le « débrouilleur » descendant au niveau divisionnaire si nécessaire, apportant renseignements, précisions, déterminant les étapes, les distances à parcourir, les cantonnements, le rôle de chacun et expliquant aux exécutants ce que l’Empereur attendait d’eux. Une bonne part des succès militaires de cette période est à mettre au crédit de Berthier car, sans son obscure efficacité, il est probable que bien des manœuvres eussent échoué, non du fait de leur conception mais de leur exécution tactique.
Mais Berthier n’est plus là et force est de le remplacer. Un tel homme existe-t-il ? Suchet sans doute présentait les qualités nécessaires mais le duc d’Albuféra est employé ailleurs (c’est à nos yeux une faute grave que de n’avoir pas mis Soult en lieu et place de Suchet…). Le seul homme d’envergure demeurant libre de tout engagement est donc Soult. Le duc de Dalmatie que Napoléon qualifia jadis de « meilleur manœuvrier de l’Europe » n’a hélas pas rempli les fonctions de chef d’état-major depuis 1794, et encore était-ce à l’échelon divisionnaire. Par les postes occupés au cours de sa carrière et les plus prestigieux, nous dirions qu’il est surqualifié pour tenir celui de Berthier et en même temps incompétent. Saura-t-il s’adapter ? Que se passera-t-il si les ordres ne parviennent pas, si la confusion règne, si l’armée devient un magma, si les rouages grippent au moment décisif ? Oui, que se passera-t-il ? Soult chef d’état-major « par défaut », en somme, c’est un bien grand risque avant d’entrer en campagne, alors qu’il faut vaincre ou périr.
En outre, l’armée n’a pas conservé une image très positive du duc de Dalmatie qui s’est gravement compromis durant la première Restauration. Quelle confiance inspirera-t-il aux Bonapartistes purs et durs quand ils recevront ses ordres ? Le spectre de la trahison les hantera nécessairement et il n’est pas évident qu’une absolue entente règne aux différents échelons de la chaîne de commandement. Bref, les généraux en sous-ordre sont-ils convaincus du dévouement de Soult à la cause commune ? Rien n’est moins certain. Le zèle de Soult est suspect à bien des yeux. Royaliste en mars, ne l’est-il pas demeuré au fond du cœur ?
Le non-choix de Davout, nous l’avons vu, s’expliquait par des motifs de politique intérieure. Napoléon assurait ses arrières avec le prince d’Eckmühl à Paris, mais ce dernier objectait fort justement : « En cas de victoire, vous n’aurez pas besoin de moi ; en cas de défaite, je ne pourrais rien pour vous. » C’était fort bien vu et c’est ce qui se passera.
Nous commençons à ressentir une certaine gêne prémonitoire ; déjà perce le risque d’imprécision, de flou, la méprise possible. Les choses s’annoncent mal ; on fait avec les moyens du bord, avec ce que l’on a. La prise de risque est considérable. Ah ! tout de même, un soulagement en apprenant que le général Bailly de Monthion, aide-major général, longtemps adjoint de Berthier, sera aux côtés de Soult. On peut attendre de cet homme expérimenté une assistance compétente, une aide précieuse apportée au duc de Dalmatie.
V
Où l’on comprend mieux la stratégie napoléonienne
Que le lecteur nous pardonne si le canon tarde à tonner, si les escadrons de cavalerie piaffent encore dans l’attente de la charge, si les colonnes serrées des fantassins demeurent l’arme au pied. La boucherie est pour très bientôt. Mais avant de s’entre-tuer, il nous faut donner quelques explications ; comment s’articule une armée napoléonienne, qui est tout sauf une cohue, comment elle se déplace, comment elle se bat. Nous verrons comment, à force de se faire rosser, les autres armées européennes adoptèrent le même système d’organisation.