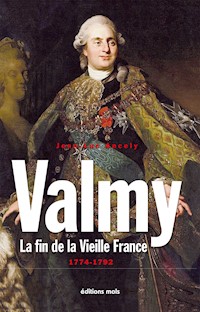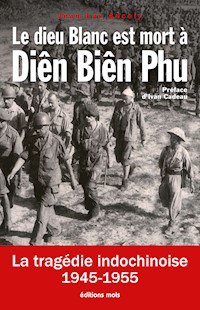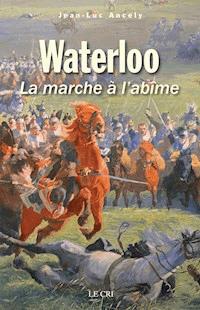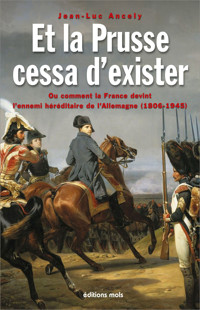
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Citons Henri Heine (poète rhénan, juif et antiprussien) : « Napoléon souffla sur la Prusse et la Prusse cessa d’exister. »
Ce livre a l’intention de faire revivre les étranges évènements qui se déroulèrent en Allemagne, puis en Pologne, à compter de l’automne 1806. L’Europe vit sur un mythe : celui de l’invincibilité de l’armée prussienne, celle du Grand Frédéric II. Ce mythe, Napoléon, maniant le plus parfait instrument de guerre dont il disposât jamais, va le briser en quelques jours. Cet effondrement ressemble furieusement à celui de l’armée française de 1940, elle aussi considérée comme la première du monde. Cet effondrement de 1806-1807 fut à l’origine d’une humiliation qui marqua les esprits prussiens au point que la France, jusque-là bien considérée, deviendra « l’ennemi héréditaire » dont parlera encore Hitler cent vingt ans plus tard dans « Mein Kampf ».
L’écrasement de la Prusse vit naître, fort curieusement, un « sentiment national allemand » qui n’existait pas. Écrit, chanté, répandu urbi et orbi par les poètes, les philosophes et les écrivains allemands, ce sentiment nouveau débouchera sur l’enthousiasme de la « guerre de libération » de 1813. Ce fut le début de l’unification de l’Allemagne par la Prusse, processus qui trouva son apothéose en janvier 1871 à Versailles. Cette volonté d’unité allemande se fit sur un nouveau mythe : celui de la France, devenue « ennemi héréditaire ».
Il nous a semblé important d’aller au fond des choses pour tenter de comprendre comment et pourquoi les deux nations qui, jusque-là, s’appréciaient et se respectaient, devinrent, l’une comme l’autre, un « ennemi héréditaire ».
Ce sentiment trop répandu gangrènera les relations franco-allemandes durant un siècle, amènera (avec d’autres causes) trois guerres dont les effets ne se sont pas toujours estompés. Notre vision de l’Allemand et la vision du Français par l’Allemand sont marquées, encore maintenant, par cette guerre étrange de 1806. Pourquoi ? C’est ce que nous allons essayer d’exposer
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Luc ANCELY est français et réside dans la région d’Autun ; ancien élève de Saumur, il a fait carrière dans l’Arme blindée Cavalerie.
Il est l’auteur d'ouvrages littéraires, essais et tragédies et, chez le même éditeur, de :
• Waterloo. La marche à l’abîme (Le Cri)
• Ainsi sont-ils (nouvelles)
• Le dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu. La tragédie indochinoise. 1945-1955
• Napoléon aura-t-il lieu ? La Fortune et la volonté. 1798-1800
• Valmy. La fin de la Vieille France. 1774-1792.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ET LA PRUSSE CESSA D’EXISTER
Du même auteur
Waterloo. La marche à l’abîme, Le Cri.
Ainsi sont-ils (contes et nouvelles), Mols.
Le dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu. La tragédie indochinoise. 1945-1955, préfacé par Ivan Cadeau, Mols.
Napoléon aura-t-il lieu ?, Mols.
Valmy. La fin de la Vieille France, Mols.
Jean-Luc Ancely
ET LA PRUSSE CESSA D’EXISTER
Ou comment la France devint l'ennemi héréditaire de l’Allemagne (1806-1945)
Essai
© Éditions Mols, 2022
Collection Histoire
www.editions-mols.eu
« La Prusse n’est pas un État qui dispose d’une armée mais une armée qui possède un État. »
Mirabeau, 1788
« Napoléon souffla sur la Prusse et la Prusse cessa d’exister. »
Heinrich Heine
« Si le hasard d’une bataille… a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. »
Montesquieu
INTRODUCTION
La guerre de 1806, aucun des deux participants (français et prussiens) n’y avaient d’intérêt. Rien ne les poussait à s’empoigner. J’irai plus loin : à cette époque, il n’y avait guère d’animosité entre ces deux nations. On peut même parler de bienveillance, voire de complicité. Alors, pourquoi ? La guerre de 1806 fut une guerre voulue, décidée par quelques individus (le roi et la reine de Prusse, la noblesse militaro-rurale des junkers). Elle fut, pour paraphraser Fouché, « plus qu’un crime, une faute ». Ce fut une guerre motivée par l’orgueil, basée sur la certitude de la supériorité, une guerre du mépris prussien envers la supposée médiocrité française. Après Austerlitz ! Comment fut-ce possible ?
À cette date, Napoléon est encore lucide et clairvoyant. Son seul souci, c’est la poursuite de la paix, paix qui s’avèrera impossible. Napoléon sera surpris en 1806 ; il ne comprendra pas la raison de l’agression prussienne. Il ne sera pas le seul et moi-même…
Mais avant d’entrer à coups de canon dans cette guerre, idiote parce qu’injustifiée, stupide parce qu’inutile, une guerre dont les conséquences se feront sentir jusqu’en 1945, guerre qui va créer, dans l’esprit des Français et des Allemands un ennemi héréditaire qui n’existait pas, pour la comprendre, donc, il convient de revenir un peu en arrière dans l’histoire de ce pays de Prusse, de ses relations avec la France avant 1805 et de la vision que nous, Français, avions de ce pays de sables et de forêts, de lacs et de philosophes (après tout, Emmanuel Kant est de Königsberg). Bref, qu’est-ce que la Prusse ?
25 octobre 1806, environs de Berlin. Un habitant parle : « Le premier fantassin entra ; c’était un homme grand et maigre avec un visage pâle, couvert d’une chevelure noire en broussaille… une capote courte couvrait son corps ; sur sa tête un petit chapeau, d’une forme indescriptible… les pantalons étaient de toile sale et très déchirée ; les pieds nus dans des souliers troués… Un soldat avec un chien en laisse et avec un demi-pain enfilé sur sa baïonnette ; à son briquet (le briquet est le sabre court des fantassins) pendait une oie et, sur le chapeau… brillait une cuillère étamée. »
Comprenons l’étonnement de ce brave homme : un soldat de Napoléon, ce vagabond, ce chemineau sale en haillons ? Ce sont donc ces loqueteux qui ont écrasé l’armée du Grand Frédéric, l’invincible armée prussienne ? C’est cela l’armée française ?
27 octobre, Berlin, Porte de Brandebourg, Bulletin officiel de la Grande Armée : « L’Empereur a fait une entrée solennelle à Berlin… Le maréchal Lefebvre ouvrait la marche à la tête de la Garde impériale à pied ; les cuirassiers de la division Nansouty étaient en bataille sur le chemin… Une foule immense était accourue sur son passage… La journée était superbe… »
Le Bulletin de la Grande Armée est un outil de propagande destiné aux populations. On dira bientôt « menteur comme un Bulletin ». Ce qui est vrai, c’est qu’il faisait beau ce 27 octobre 1806 ; une belle journée d’automne dans cette Europe du Nord et cette capitale ébahie par l’évènement.
Autre relation, celle du Moniteur (sorte de journal officiel de l’époque) : « S.M. l’Empereur des Français et Roi d’Italie a fait son entrée dans cette capitale aujourd’hui… Tous les habitants s’étaient portés au-devant de Sa Majesté ; on ne voyait que chapeaux agités en l’air ; on n’entendait que les cris de Vive l’Empereur ! Ce soir la ville entière est illuminée ; les rues sont remplies de monde…. »
Tu parles, Charles ! Le Moniteur en rajoute dans le mensonge et la flagornerie. Imagine-t-on les Berlinois envahis, crier en français : Vive l’Empereur ! ? Et les rues pavoisées ? Allons donc ! Rapprochons-nous des relations de soldats français témoins oculaires et redescendons sur terre.
Le commandant Parquin a écrit de très intéressants Souvenirs bien connus des lecteurs de L’épopée napoléonienne (éd. Tallandier). Voici : « Dans le village que nous occupions, les paysans avaient déserté leurs maisons… Nous nous dirigeâmes sur Berlin. Lorsque notre régiment avait traversé la ville, nous l’avions trouvée peu bruyante et triste. Toutes les boutiques étaient fermées ; personne aux fenêtres et peu de monde dans les rues… Le seul bruit qu’on entendait dans la rue était produit par l’artillerie et les caissons de notre armée… Nous ne fîmes que traverser la ville. »
Et le capitaine Coignet, célèbre vaguemestre impérial, dont les Cahiers ont fait l’ornement de maintes bibliothèques (même si Coignet se trompe, brode et mélange tout) : « L’Empereur fit son entrée le 28 (!)… Le peuple était aux croisées comme les Parisiens le jour de notre arrivée d’Austerlitz ; c’était magnifique de voir un si beau peuple se porter en foule sur notre passage. On aurait dit des libérateurs tant le peuple nous suivait… » Il rêve, le brave Coignet. Certes, la curiosité a pu amener les Berlinois à détailler ces bêtes curieuses de Français, mais de là à les voir en libérateurs !
Un autre témoin, d’envergure celui-ci : Henri Beyle, autrement dit : Stendhal. Il est commissaire des guerres, c’est-à-dire, chargé de l’intendance de l’Empereur. Le ton change : « Je rends grâce à Dieu d’être entré sain et sauf, avec mes pistolets soigneusement chargés, à Berlin, le 27 octobre 1806… L’Empereur marchait à vingt pas en avant des soldats ; la foule silencieuse n’était qu’à deux pas de son cheval ; on pouvait lui tirer des coups de fusil de toutes les fenêtres. »
Que penser ? Curiosité des habitants, retenue, méfiance et crainte. On n’en est pas encore à admirer. Imagine-t-on les Parisiens admirant les Allemands qui défilent à Paris le 14 juin 1940 ? Assistance clairsemée, muette, voilà ce qu’a dû être la réalité. Le 25, ce fut l’entrée des soldats du IIIe corps, celui de Davout, l’incroyable vainqueur d’Auerstedt. Napoléon, en leur permettant d’entrer les premiers, voulut les honorer de leur exploit. Ils avaient sans doute l’air de vagabonds en loques après avoir traversé toute l’Allemagne à pied et perdu un tiers des leurs dans la bataille. Des vagabonds auréolés de gloire, certes, mais sales et fatigués.
Le défilé officiel du 27, ce fut autre chose : ors, panaches, dorures, buffleteries blanchies au blanc d’Espagne, coiffés, brossés, armes fourbies et astiquées, tout le cérémonial guerrier de l’époque. En tête, la Garde impériale, les cuirassiers, bref, ce qui se faisait de mieux côté spectacle. La foule même clairsemée, dut apprécier : fracas des tambours défilant par rangs de six ou douze derrière les tambours majors, cuivres, claquements des sabots des chevaux sur le pavé de Berlin, commandements des chefs, sabres saluant, montures brossées, étrillées, peignées, mentons levés et airs farouches. Le cirque habituel.
Mettons-nous dans la peau d’un Berlinois lambda. Ce bon bourgeois doit aussi se poser la question : comment en est-on arrivé là ? Les Français dans Berlin ? Moi-même, deux siècles plus tard, je me pose également la question : quelle est cette histoire de cornecul ?
Pour comprendre, il nous faut remonter dans le temps et, tout d’abord, nous rendre en Moravie, le 2 décembre 1805, un an auparavant…
1er décembre 1805, près d’Olmutz, Moravie. Il fait froid. Deux empereurs, l’un russe, l’autre allemand, vont en affronter un troisième qui se dit empereur des Français mais qui n’est qu’un parvenu jailli de la Révolution : Bonaparte, devenu Napoléon Ier. La victoire ne fait aucun doute. La malencontreuse reddition du feld-maréchal Mack, encerclé dans Ulm, l’entrée des Français dans Vienne furent des incidents désagréables, certes, mais demain sera un autre jour. Demain, les glorieuses troupes russes aidées de contingents autrichiens vont déborder la droite française, faible, la tourner et couper aux Français la route de Vienne. Plan imparable.
2 décembre. Tout se passe comme prévu : le centre allié descend du plateau de Pratzen, attaque la droite française qui résiste et puis… et puis le centre français prend le Pratzen, coupe l’armée en deux et c’est la fin. C’est plus qu’une défaite : un écrasement sans recours possible. Si les Français se lancent à la poursuite, ce sera la fin des deux armées.
Mais, ô surprise, les Français ne paraissent pas devoir poursuivre. Étonnant quand on connaît la pugnacité de Bonaparte. Il semble timoré, hésitant et même, il accepte un armistice. L’armée russe peut se retirer. L’Autriche paiera l’addition.
Mais que s’est-il passé ? Car, bien sûr, nous, Français, avons d’Austerlitz une vision de gloire, de victoire définitive, celle d’un génie des échecs qui a manœuvré et vaincu où et quand il l’entendait. C’est vrai mais la réalité est un peu plus complexe.
D’abord, nous célébrons Austerlitz en omettant Trafalgar qui fut autrement décisive pour la guerre en Europe. Trafalgar, peu de temps avant Austerlitz, c’est la bataille que les Anglais ne devaient pas perdre et qui permettra aux adversaires de la France de ne jamais céder… jusqu’à Waterloo. Et puis, il nous faut bien trouver une explication à cette timidité apparente de Napoléon, victorieux mais qui hésite et accepte très vite de mettre fin au conflit. Pourquoi ?
Parce que, tandis qu’il fixait du regard la marche des Austro-Russes le 2 décembre, il avait un troisième œil tourné vers le nord. Le nord, ce sont les monts de Bohème d’où, à tout instant, pourrait surgir dans son dos une bête féroce et sans pitié. Cette bête, c’est l’armée prussienne. Le problème est fort simple : gagner, vite, pour que la Prusse hésite à se lancer dans l’aventure d’une guerre dans laquelle elle aurait tout à gagner et Napoléon tout à perdre.
Alors, ce sera Austerlitz et le loup de Prusse regagnera sa tanière. Ouf ! Il était temps. Mais, me direz-vous, la Prusse est neutre ! Nous sommes en paix avec elle depuis 1795. Et même, nous, Français, nous l’aimons beaucoup la Prusse, nous la ménageons, la cajolons presque. Pensez, la patrie du Grand Frédéric, l’ami de Voltaire ! Et puis la Prusse n’est pas l’Allemagne ; elle est autre chose. La Prusse n’est pas notre ennemie, etc. Oui, je réponds : oui. Pas encore. Et oui, elle n’est pas l’Allemagne. D’ailleurs il n’y a pas d’Allemagne mais des Allemagnes. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Des Allemagnes ? Expliquez-vous. » Cela me semble nécessaire. Je vais tenter de le faire.
Chapitre 1
UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ALLEMAGNE ET DES ALLEMANDS
Au commencement était Rome. Des postes gardaient ses frontières, son limes, sur le Rhin et le Danube. Au-delà, dans leurs sombres et épaisses forêts, grouillait tout un ensemble de tribus belliqueuses : les Germains. Depuis que les légions du consul Varus furent écrasées en l’an IX de notre ère par le bouillant Arminius – le Hermann des Allemands – Rome se gardait bien de franchir le limes. Ces peuplades prolifiques étaient toujours à l’étroit sur un sol pauvre, au rude climat, incapable de les nourrir tous. Ils furent toujours attirés par le soleil dans sa course vers l’ouest et vers le sud, cette Italie prometteuse. Quand l’Empire entra en décadence, ils franchirent le limes : certains, les Francs rhénans, s’installèrent en Gaule déjà romanisée, s’y convertirent à la nouvelle religion chrétienne et entreprirent de construire ce qui allait devenir la France. Un empire fut fondé : celui de Karl der Gross, notre Charlemagne, qui bloqua l’accès aux cousins de Saxe et de Thuringe.
Alors, ils se tournèrent vers l’Orient et entreprirent leur Drang nach Osten, cette marche vers l’est qui, les conduisant jusque chez les Slaves, leur permit de dégorger leur trop-plein de population. Ce fut une véritable opération de colonisation et même de remplacement de population, un peu semblable à ce que sera l’implantation de colons européens sur les territoires des Indiens d’Amérique. Les « Indiens », ici, ce seront les Slaves et notamment ces Borusses (d’où le nom de Prusse où ils vivaient). Les Slaves furent exterminés ou repoussés vers l’est.
L’occupation, la mise en valeur du sol, la christianisation de ces contrées pauvres et vides, où les forêts de pins se miraient dans des milliers de lacs, où le pied s’enfonçait dans les sables de la Baltique, sans routes, sans villes, ce fut l’œuvre d’un ordre religieux et militaire : les chevaliers teutoniques, ces croisés drapés dans leurs manteaux blancs frappés d’une croix noire qui fondèrent Magdebourg, capitale de l’Ordre. Leur expansion vers l’est fut arrêtée à Tannenberg, en 1410, où ils furent écrasés par les Slaves d’Alexandre Nevsky. Tout se figea.
Les colons qui s’implantèrent dans ces marches orientales venaient principalement de l’ouest et du sud de la Germanie : Saxons, Thuringiens, Souabes. Parmi ces familles souabes, il en était une promise à un bel avenir : les Hohenzollern. Il existe encore en Souabe, pas très loin de Tübingen, le château de Sigmaringen, berceau de la famille, encore occupé par une branche catholique de la famille (quand la branche prussienne adopta Luther et sa Réforme).
Ils s’installèrent dès 1415 dans le Brandebourg (très peu de temps après Tannenberg, donc). Le Brandebourg, la Prusse orientale, conservèrent longtemps un esprit féodal (tombé depuis longtemps en désuétude en Europe), basé sur le junker, grand propriétaire terrien, chef et commandeur, laboureur et soldat. Émergea alors une aristocratie militaire, toute puissante, ayant droit de vie et de mort sur ses fermiers, véritables serfs1. L’habitude du commandement, la vocation des armes, le sens de la hiérarchie, l’ignorance totale et voulue des libertés provinciales allemandes chères aux Allemands de l’ouest et du sud, libertés assimilées au désordre et à l’anarchie, toutes ces caractéristiques firent du Prussien un être dur, porté vers l’action, la conquête et les devoirs du soldat. Ce fut avec ces hommes, ces féodaux très semblables à ce que furent chez nous les premiers seigneurs dans leurs donjons, que se bâtit la Prusse moderne2.
Le territoire étant une zone-frontière, une « marche », il fallait la défendre. Il fallait donc des chefs et une armée. On trouva les uns et on construisit l’autre.
1410 (Tannenberg) – 1415 (arrivée des Hohenzollern en Brandebourg)… Coïncidence, peut-être ? Hasard de l’Histoire ? Probablement. L’écrasement des Teutoniques créa, par le vide, un appel d’air et libéra des places.
Le père fondateur du Brandebourg, au XIIe siècle, fut Albert l’Ours, vainqueur des Slaves. C’est pourquoi l’emblème de Berlin est un ours. La ville naquit au XIIIe siècle sur une plaine marécageuse des bords de la Havel et de la Sprée. Endroit médiocre, insalubre, où le pied s’enfonce dans le sable (Versailles fut bâtie sur un lieu semblable). Le premier Hohenzollern à s’installer fut Frédéric-Guillaume Ier en tant que margrave (marquis) de Brandebourg. C’est peu de chose3.
Les margraves de Brandebourg serviront bien l’Empire en défendant les marches de l’est. C’était leur mission. Et les empereurs germaniques les récompenseront en accroissant leurs domaines. Peu à peu, en prenant la suite des chevaliers teutoniques, autrement désignés comme « Chevaliers Porte-Glaive », les Hohenzollern prennent pied en Prusse. Un historien de Königsberg, Nesselmann, pourra ainsi s’écrier : « Ce peuple de Prusse, qui dort maintenant sous nos pieds et à qui nous avons tout pris, même son nom ! » Autrement dit, ces Prussiens originels ont été purement et simplement exterminés comme païens irréductibles.
Les Hohenzollern de Berlin-Brandebourg auront donc à peupler ce vide par l’apport massif de colons de toute l’Europe (Kant est écossais d’origine), et même s’ils l’ignorent encore, mettre fin au morcellement allemand et faire l’unité. Au XVe siècle, cette unité, nul ne l’envisage du fait qu’il n’existe aucun sentiment national parmi les peuples allemands. Les margraves se succèdent, de Frédéric en Joachim, jusqu’à l’évènement qui va faire leur fortune : la guerre de Trente Ans. Ceci se passa quand Corneille écrivait Le Cid, quand Louis XIV n’était pas encore né et que toute l’Europe centrale était à feu et à sang.
La guerre de Trente Ans, pour simplifier, ce furent les princes luthériens du nord, soutenus par la Suède (à l’époque une puissance militaire sous le règne de son roi Gustave Adolphe) contre le sud catholique. Ce fut une guerre atroce qui fit tant de dégâts qu’on a estimé la dépopulation de l’ordre de trente pour cent. Certaines régions d’Allemagne furent réduites à l’état de désert en friche, sans habitants, sans villes debout, sans rien, si ce n’était le règne des corbeaux et des loups gavés de chair humaine. Probablement quatre millions de victimes sur dix-sept millions d’habitants dans l’Empire !
Et tout cela par la faute d’un révolté, un moine allemand de Wittenberg nommé Martin Luther qui se voulut le réformateur de la chrétienté. La Réforme s’étendit partout, au point que la grande majorité des princes allemands se convertirent. Le Saint-Empire romain germanique (j’insiste sur le romain) était naturellement le défenseur du catholicisme. Charles-Quint, le plus allemand des rois d’Espagne, était bien sûr catholique… Je vous vois déjà perdus : l’Espagne, Charles-Quint allemand ? En vérité, il était flamand, né à Gand.
La guerre de Trente Ans, première guerre européenne de masse fut, en simplifiant, un combat entre la réaction catholique du sud (l’empereur Habsbourg) et les princes du nord, défenseurs des libertés. Mais, en sous-main, ce fut l’occasion pour la France, en s’alliant aux princes luthériens, d’abattre la puissance de son ennemi héréditaire (à l’époque) : l’Espagne, donc l’Autriche, donc l’Allemagne. Me suivez-vous ? Fort bien4.
Guerre atroce, menée par des armées de mercenaires sans scrupules (pas d’armées nationales permanentes en ce temps-là), guerre dans laquelle s’illustrèrent – si je puis oser ce verbe – des gloires nationales comme Turenne et Condé, Gustave II Adolphe, le Suédois, mais aussi d’étranges aventuriers comme Wallenstein, dont la personnalité n’a pas fini d’intéresser les romanciers. La France fut la grande gagnante : l’Artois, la Franche-Comté, l’Alsace, conquêtes françaises acquises en 1648 par les traités de Westphalie. Le grand perdant, c’est l’Empire, éclaté, éparpillé ; l’Allemagne devenant deux cents, trois cents Allemagnes, parfois minuscules. C’était voulu et notamment par Mazarin, mettant en œuvre le testament de Richelieu : en multipliant les principautés, on neutralisait la puissance des Habsbourg, on rendait l’Empire impuissant, sans force aucune, par l’éparpillement. C’était établir sur l’Europe une paix française sur un monceau de ruines et de cadavres. L’historien Robert Minder nommera cette période « la phase des malheurs » de l’Allemagne. L’Empire durera vaille que vaille jusqu’en 1806 avant d’être définitivement détruit par un autre Français : Napoléon.
Et la maison de Brandebourg, les Hohenzollern, dans tout cela ? Ils sont dans le camp des vainqueurs franco-luthériens. Par leur position excentrée, leurs états ont moins souffert de la faux brûlante qui a moissonné l’Allemagne. Ils acquièrent Magdebourg, la Poméranie orientale, Clèves, Ansbach. Ainsi, le Brandebourg-Prusse s’étend, par petits bonds, du Rhin à la Vistule. L’objectif sera désormais de relier entre eux tous ces territoires encore épars.
Frédéric-Guillaume Ier (1620-1688) devient Électeur de l’Empire. Il fait donc désormais partie du collège des princes « élisant » l’Empereur (en théorie). Il est le « Grand Électeur », margrave de Brandebourg et duc en Prusse avant de devenir duc de Prusse. Par ses réformes, c’est lui qui bâtit l’État prussien – notamment par la création de la première armée permanente – abandonnant le système du mercenariat trop coûteux et difficile à commander. C’est par lui que la Prusse, appelons-la ainsi désormais, commence son ascension.
Mais le destin semble vouloir favoriser la Prusse : en 1685, Louis XIV prononce la révocation de l’Édit de Nantes. Faute énorme ! Il va ainsi pousser une élite à l’émigration. Par l’Édit de Potsdam, Frédéric-Guillaume Ier décrète vouloir accueillir et protéger les Réformés de France, qui vont devenir par déformation du terme allemand Eidgenossen, des Huguenots. Qu’on en juge : Berlin n’a plus que six mille habitants et va recevoir l’apport de quatre mille deux cents Réformés et le Brandebourg, en tout, vingt mille ! Ce ne sont pas des gueux mais une élite d’artisans, d’enseignants et même de militaires. En 1700, le quart des Berlinois sont d’origine française. Un Collège français est fondé dès 1689. Le prince tient sa parole : « Je vendrais ma vaisselle plutôt que de les laisser manquer de secours. » Le résultat sera une véritable francophilie prussienne et Berlin parlera massivement français. Cette élite de tout poil donnera des ministres et des généraux à l’Allemagne moderne. Exemple : la famille de Maizière, venue de Metz, donne un Premier ministre à la RDA (1989-1990), un ministre fédéral à la RFA, un généralinspecteur de l’armée fédérale… et tant d’autres qui porteront le von ennoblissant (ex. : le général von La Motte-Fouqué au XXe siècle). On peut donc dire que, involontairement, en commettant cette faute stupide, Louis XIV a fait la fortune de la Prusse du XVIIIe siècle5.
Les électeurs du Saint-Empire romain germanique
Le Saint-Empire romain germanique, par son mécanisme de dévolution du pouvoir, avait quelque similitude avec la monarchie des premiers Capétiens : en théorie, le roi de France était « élu » par ses pairs, tant laïcs qu’ecclésiastiques. Ainsi, le roi n’était que le primus inter pares. Ce ne fut très vite que symbolique, le fils aîné du roi succédant à son père, ce qui contribua à assurer une grande stabilité au régime et à éviter l’angoisse de la succession. Dans l’Empire, ce fut différent : le souverain était réellement choisi par les électeurs (souvent soudoyés grassement). Ainsi, François Ier se porta candidat à l’élection, sans succès. Mais qui étaient-ils, ces électeurs ?
Peu nombreux, ils représentaient l’ensemble des territoires de l’Empire, du moins les plus importants : trois archevêques : Mayence, Cologne et Trèves et des laïcs : le roi de Bohème (d’où, en 1792, la déclaration de guerre de Louis XVI au « roi de Bohème et de Hongrie », autrement dit le Habsbourg) ; le prince palatin (le Palatinat représente donc la Rhénanie) ; le duc de Saxe et, enfin, le margrave de Brandebourg (dont on perçoit ici l’importance en dépit de son titre de margrave). Un huitième électorat fut créé pour représenter la Bavière puis un neuvième : celui de Brunswick-Lunebourg (dont les successeurs devinrent Électeurs de Hanovre).
C’est donc un collège électoral fort restreint : aucune ville « libre » n’est représentée (je pense ici aux villes de la Hanse qui prirent une importance économique considérable : Hambourg, Lübeck, Brême), de même que les états secondaires, duchés, comtés, etc. Cet ensemble siégeait à la Diète, sorte d’assemblée plus ou moins mobile mais qui n’était en aucun cas un « Parlement » à la mode anglaise. La plupart du temps, cette Diète se tenait à Ratisbonne (mais il y eut aussi Nuremberg).
En 1701, l’ascension des Hohenzollern se poursuit : le duc de Prusse reçoit le droit de se parer du titre de roi de Prusse (mais son duché originel de Prusse ne fait plus partie stricto sensu du Saint-Empire). Ainsi la Prusse prend de plus en plus ses distances en étant dans l’Empire et en dehors de lui.
Nous avons donc vu l’émergence d’États que nous allons côtoyer dans tout notre récit : Saxe, Brunswick, Hanovre. L’Empire vivait avec ses luthériens et ses catholiques, parfois déchiré par des luttes internes ; ainsi, la guerre de la Prusse contre l’Autriche en 1741, puis la guerre de Sept Ans (1756-1763) au cours de laquelle on vit la Prusse, alliée de l’Angleterre, combattre la France alliée de l’Autriche, ce qui était nouveau : la France alliée de son ennemi héréditaire autrichien !
Puis vint la Révolution française, les problèmes belges au sein de l’Empire (n’oublions jamais que la Belgique de l’époque, était constituée principalement des Pays-Bas autrichiens). Enfin Bonaparte vint, héritier de la Révolution, continuateur de Robespierre et gérant de fait des conquêtes révolutionnaires : les Pays-Bas autrichiens, la Hollande, la rive gauche du Rhin, tous territoires devenus français. Il fallut donc réformer le Saint-Empire, amputé de ces territoires. Ce fut le rôle du recès de 1803.
1803 : l’année de tous les succès
1803 ! Bonaparte, Premier consul de la République, est l’homme-miracle de l’Europe. Beethoven écrit sa 3e symphonie, Eroïca pour célébrer la mémoire d’un grand homme. Bonaparte a mis fin à la Révolution et ses désordres, contraint l’Angleterre à la paix (paix d’Amiens) et fait taire le canon dans toute l’Europe. Enfin, la paix !
Mais il faut bien procéder à la réorganisation du Saint-Empire germanique puisque la France a conquis et annexé des territoires qui en faisaient partie et notamment les Électorats ecclésiastiques de la vallée du Rhin. Pierre Gaxotte (Histoire de l’Allemagne, déjà cité) a mis en évidence un point important : cette refonte de l’Empire germanique fut pensée, rédigée, décidée dans le bureau parisien de Talleyrand, pas à Vienne qui subit le diktat français et, bien sûr, sans consulter les populations concernées6.
Cette réorganisation, ce malaxage de la pâte allemande prit des allures de vide-greniers et de marché aux puces européen. L’Allemagne du XVIIe passa de plus de trois cents États à quatre-vingt-deux.
Les Électorats de Trèves, Mayence et Cologne disparurent (puisque désormais en France). Le Premier consul, homme fort de l’Europe, fit créer de nouveaux sièges électoraux : le Wurtemberg, le pays de Bade, la Hesse-Cassel et le duché de Salzbourg. Inutile de préciser que ces nouveaux Électeurs ne l’étant que par la grâce du Premier consul surent se montrer reconnaissants. Ils furent des alliés constants durant tout l’Empire napoléonien, jusqu’au revirement de 1813.
La grande bénéficiaire fut, sans effort, la Prusse, comme d’habitude. La Prusse, « chouchoute » de la République gagne un demimillion de nouveaux sujets. Mais pourquoi diable ? La réponse tient dans ce propos de Bonaparte : « La Révolution – lui en l’occurrence – devait venger la Prusse de la guerre de Sept Ans soutenue par Frédéric contre la monstrueuse alliance de la France et de l’Autriche (c’est moi qui souligne). Posons-nous et comprenons calmement. Le nouveau maître de la France dédommage la Prusse parce que Louis XV allié à Vienne a fait la guerre au rapace de Sanssouci.
Mais que pensent les Allemands de cette refonte de l’empire ? On sait peu de choses, à vrai dire. Le sentiment qui prévalut fut sans doute l’indifférence générale. Les Allemands, j’insiste, en 1803, ne se perçoivent pas encore comme Allemands, mais Hessois, Bavarois, Colonais, Saxons et autres. Ils changent de maître ? Fort bien. Puis ils retournent à leurs affaires locales.
Et les Allemands éclairés ? Que pensent-ils ? Nous pouvons en avoir quelque idée par les écrits d’un auteur allemand de l’époque : Joseph Görres, publiciste et polémiste résidant à Coblence. Fondateur d’un journal, Le Mercure rhénan, il sera, au début, très favorable à la Révolution. En réalité, comme beaucoup d’intellectuels, la présence française mettant à bas l’absolutisme tatillon du Saint-Empire, ils la voyaient comme la fusion possible des droits de l’homme et de la morale kantienne, c’est-à-dire les Lumières appuyées sur « l’impératif catégorique » du philosophe de Königsberg. Görres déchantera et, à partir de 1813, il sera partisan de l’Allemagne unifiée.
Autre exemple emprunté à deux auteurs français : Émile Erckmann et Alexandre Chatrian. Dans Le conscrit de 1813, deux soldats français dans une taverne relatent combien la défaite de la Prusse, en 1806, fut accueillie avec plaisir par les Allemands puis, les guerres se succédant, le désastre de Russie ayant dévoré les contingents allemands alliés de Napoléon, l’opinion devint franchement hostile et francophobe. Certes, c’est un roman dont je pense l’atmosphère fort bien restituée.
Telle était donc la situation de la Prusse et de l’empire allemand remodelé en 1805.
La France de 1805
Le Comité de Salut Public de 1793, la dictature de Robespierre de 1794, ne firent que poursuivre la grande politique de tous les rois de France : la conquête des frontières naturelles. En politique étrangère, la République ne fut que le prolongement de la monarchie. Ainsi, aux yeux de l’Europe royale, la République française apparut comme un fleuve en crue qui déborde et s’étale largement hors de ses rives. La paix d’Amiens, douloureusement signée, fit mettre bas les armes au bout de dix ans de guerre européenne. Le dernier à se rendre fut l’Anglais mais avec tant d’arrière-pensées que chacun savait que cette paix ne serait qu’une trêve, l’Angleterre ne pouvant en aucun cas admettre que la France occupât Anvers et les Bouches de l’Escaut. Je l’ai dit et écrit à maintes reprises : la cause réelle, durable, profonde de toutes les guerres jusqu’à Waterloo fut là et pas ailleurs. Londres ne pouvait supporter cette menace mortelle sur la Tamise et Napoléon ne pouvait renier son serment de maintenir les conquêtes de la Révolution (d’ailleurs, l’Angleterre ne supportera jamais, ni en 1914, ni en 1940, qu’une puissance continentale la menaçât depuis le littoral belge ; si l’on oublie cela, on ne comprend rien à la politique européenne des XIXe et XXe siècles).
C’est ainsi qu’en 1804 la paix fut brisée et qu’en 1805, Napoléon, tournant le dos à la mer, marcha sur Ulm, Vienne, jusqu’à Austerlitz. Mais tout cela est connu. Et nous en arrivons au nœud de notre étude : la France face à la Prusse.
Chapitre 2
LES RELATIONS FRANCO-PRUSSIENNES DE 1792 À 1805
1792. La France met le feu à l’Europe, incendie qui, de flambées en flambées, va durer vingt-cinq ans. Nous ne reviendrons pas sur les causes de cette première guerre : la France, lancée dans un processus révolutionnaire, est dans une impasse. Louis XVI espère que le secours viendra de sa famille autrichienne. Les partis bellicistes de l’Assemblée législative, en exportant la révolution, pensent résoudre les difficultés intérieures. La France agresse ainsi « le roi de Bohème et de Hongrie » (c’est-à-dire l’Empire allemand), le 20 avril 1792. Face à elle se constitue la Première Coalition regroupant toute l’Europe sauf la Suisse : Angleterre, Autriche et Empire allemand, les Bourbons de Naples, Sicile, Espagne mais aussi la Russie, le Portugal et la Prusse. La Prusse sera d’ailleurs la première à se retirer, en 1795 et, par le traité de Bâle du 5 avril, cède ses possessions de la rive gauche du Rhin. L’Espagne suivra bientôt.
La Prusse, ce fut la puissance de l’invasion de 1792 qui culmina à Valmy. Là, au pied de l’Argonne, eut lieu un simulacre de bataille entre les troupes de Dumouriez et Kellermann opposées à celles du roi de Prusse commandées par le duc de Brunswick. Le duc de Brunswick sera un peu le personnage résurgent de tout notre récit. Considéré, en France, comme un souverain libéral et philosophe, on envisagera même, en 1791, de l’appeler au trône de France afin de remplacer Louis XVI bientôt déchu. Vue de l’esprit, certes, mais qui prouve que, entre la France issue des Lumières et la Prusse – le duc étant peu ou prou assimilé à un prince prussien – il n’existait ni contentieux, ni animosité. Les suites étranges de Valmy nous confortent dans cette attitude : les Prussiens obtinrent de se retirer sans être poursuivis (je renvoie les lecteurs à mon ouvrage : Valmy, la fin de la Vieille France, éd. Mols). Que Danton, Dumouriez et le duc de Brunswick aient été tous trois francs-maçons n’y est peut-être pas pour rien. Que la Prusse ait eu pour souci immédiat le « partage » de la Pologne et sa disparition ne peut être omis dans cette relation. Bref, la jeune république et le royaume de Prusse n’avaient objectivement aucune raison de se faire du mal, ayant bien d’autres chats à fouetter. Ainsi, en 1795, on signa de bon cœur un traité par lequel la Prusse cédait des territoires lointains (Berg, Clèves, Neuchâtel, Juliers) mais se payait largement à l’est.
Relations ambigües que celles de la France et de la Prusse. Nées d’un malentendu et d’une incompréhension, elles vont traverser sans varier toute la période des Lumières. Ce fut plus qu’une méprise, ce fut davantage un mythe : le mythe frédéricien qui va influencer tous nos penseurs, nos légistes jusqu’à Bonaparte lui-même. Qu’est-ce donc ?
Le « mythe frédéricien », cette « prussomanie » constante, a tenu essentiellement à la personnalité d’un homme exceptionnel : Frédéric II de Prusse, le « vieux Fritz » des Allemands, francophone, francophile (vraiment ?), « ami » et admirateur de Voltaire à qui il soumettait humblement ses vers français, figure de proue du « despotisme éclairé », c’est-à-dire : pouvoir personnel fort tempéré par la « philosophie ». Frédéric fut le héros de certains intellectuels qui ne savaient pas voir au-delà des apparences et le modèle de nombre de militaires par ses victoires sur le champ de bataille. Un de ses fervents admirateurs fut un jeune artilleur nommé Bonaparte. Le despotisme éclairé fut très à la mode et dans toute l’Europe : Catherine de Russie hébergeant Diderot, Frédéric avec Voltaire, mais aussi le Portugal de Pombal. Cela nous semble fumeux, comme un refus du régime parlementaire dont Tocqueville fit l’éloge en Amérique. Mais la révolution américaine était-elle exportable ? Les deux principes coexistèrent. La doctrine du despotisme éclairé perdura avec le « bonapartisme » et, si je puis oser, ce prolongement actuel qui est celui de la Ve république : exécutif fort, pouvoir très personnel du président appuyé sur la technocratie et parlement soumis à l’autorité.
Et puis, pour nous, Français, Berlin était cette capitale très « française » du fait de la présence de milliers d’émigrés huguenots. Frédéric avait, à Potsdam, construit Sanssouci, sa résidence qui se voulait un Versailles du Brandebourg. D’ailleurs, la Prusse – ou l’Allemagne, on mélangeait un peu tout – c’était Kant, Goethe, Schiller, Haydn et Mozart et bientôt Beethoven. L’Allemand ? Un bon bourgeois aimant la bière et la vie de famille, bonasse, jovial, entouré de ses filles plantureuses et peu farouches. Très réducteur mais aussi très répandu. Les troupes de la République en garnison à Mayence ou Trèves s’y trouvèrent fort bien et bien accueillies, alors…
Mais surtout, Frédéric, c’est l’inventeur de « l’ordre oblique », cette idée qui renouvelle l’art de la guerre et donne la victoire à coup sûr7. Donc tout concourait à ce que cet homme, ce souverain « moderne » devint un modèle. C’était faire fi de ce qu’il était réellement (ce que Voltaire comprit vite) : un rapace amoral. S’il est permis de porter un jugement négatif sur Frédéric II, il faut bien lui concéder des circonstances atténuantes. Son père, Frédéric-Guillaume, fut surnommé « le roi-sergent », ce qui n’est nullement un compliment. Dur, tyrannique, il se comporta envers son fils comme envers un soldat quelconque. La schlague, autrement dit la cravache, voilà ce qui convient à l’éducation d’un prince !
Frédéric-Guillaume, selon notre vision présente, serait qualifié de « sale type ». Tatillon, surveillant tout et tous, il « savait si les gens étaient au travail et l’argent à sa place. La vaisselle plate, les médailles, les vins fins, les diamants, les carrosses superflus et les animaux furent vendus pour payer les créanciers » (Pierre Gaxotte : Frédéric II, éd. Arthème Fayard, 1938). Obsédé par le militaire, quasiment soldatesque, son rêve fut de n’avoir que des soldats géants, des colosses qu’il ferait manœuvrer comme des pions. Il avait si peur de les perdre qu’il se garda bien de faire la guerre.
« Né anxieux, brutal, avare, despote et méticuleux, ne supportant ni retard, ni contradiction » (P. Gaxotte ibid.), comment aurait-il fait un père doux et attentionné ? D’ailleurs son idéal de souverain se résumait ainsi : « Je suis le général en chef et le ministre des Finances du roi de Prusse. » Il exige de tous une obéissance mécanique, sans réflexion : Nicht raisonnieren ! Despote, cet homme qui déclare : « Nous sommes le seigneur et roi et faisons ce que nous voulons. » Un autocrate borné. Son fils, le prince héritier ? Il en fera un soldat, dressé « à la prussienne », élevé à la dure : exercices, privations, devoirs répétés. Et, malgré tout, il aimait son fils, à sa manière d’adjudant de casernement.
Le prince a des goûts de son âge et montrera vite des désirs vite réprimés. Son père, le roi-sergent, ne saurait tolérer certaines fréquentations qui pourraient le conduire à des dérèglements jugés infâmes. Je n’en dirai pas davantage. Le drame de Frédéric est qu’il possède une âme supérieure qui fait de lui un rebelle. Les enfants de ce calibre-là, élevés de la sorte, qui refusent de plier sont, dans l’âge adulte, soit des névrosés graves anéantis pour jamais, soit des êtres supérieurs. Frédéric appartenait à cette race et sut le montrer à l’Europe étonnée puis admirative.
Mais quand on fait en sorte de tuer la douceur et la gentillesse chez un être, ne soyons pas surpris de le voir manifester à son tour dureté et sens de la dissimulation. Il avait été contraint d’être ainsi pour simplement survivre. Il fugua en compagnie de son ami von Katte. Pris, il fut purement et simplement emprisonné, au secret. Le roi le déclara déserteur et le prince craignit pour sa vie. Et ses compagnons, ses amis dévoués ? Le prince passa en jugement devant une commission militaire le 16 septembre 1730.
Frédéric-Guillaume, au bord de la folie, se persuade que son fils a voulu l’assassiner ! Renonçant à faire exécuter son fils, il fera mourir ses complices ! Katte est décapité le 5 novembre. Les ordres étaient que le jeune Fritz assistât à la mort atroce de son ami ! De sa fenêtre, il l’interpella : « Mon cher Katte, je vous demande mille pardons. Au nom de Dieu, pardon, pardon ! » À quoi le condamné répondit : « Point de pardon, mon prince, je meurs avec mille plaisirs pour vous. » Quand la tête roula sur l’échafaud, le futur Frédéric le Grand tomba évanoui. C’est ainsi qu’on tue la jeunesse. Il ne sera jamais plus ce qu’il avait été auparavant.
Il fallait, pour être honnête, relater ce drame pour comprendre ce qu’il serait plus tard, devenu roi. Son apparente « amoralité », son cynisme, son côté « rapace » sans foi ni loi, il les devait à son père. Qu’en ferait-il ?
Il ferait de la Prusse une caserne : le premier en Europe, il instaure le service militaire obligatoire : tout mâle est soldat de dix-huit à quarante ans, avec obligation de résidence. Ce qui signifie que le sujet qui décide de changer de place sans autorisation est assimilé à un déserteur. Le territoire est divisé en cantons, chaque canton fournissant un régiment. De plus, tout noble est tenu d’être officier et gare à celui qui refuserait d’observer ce devoir d’état ! Une phrase résume tout : « Tous les sujets sont nés pour les armes et obligés au régiment. » Le Prussien n’est pas un citoyen mais un serf militarisé. La réflexion de Mirabeau (voir première page), est parfaitement justifiée : « La Prusse est une armée qui dispose d’un État. »
Qu’on en juge par ces quelques chiffres : en 1740, à son avènement, la Prusse compte 72 000 militaires pour 2,4 millions d’habitants. En 1752 (en paix donc), elle a 135 000 soldats pour moins de 4 millions de sujets.
En 1740, Frédéric II fait main basse, comme un brigand, sur la Silésie autrichienne, sans raison si ce n’est la rapacité. Il fera de même en 1756 avec la Saxe et incorporera de force tous les soldats saxons prisonniers (qui déserteront dès que possible).
Les alliances, les traités ? Là, son cynisme parle : de 1741 à 1748, c’est la guerre de Succession d’Autriche et la Prusse est alliée de la France. Bien.
En 1757, jusqu’en 1763, c’est la guerre de Sept Ans et là, la Prusse est l’alliée de l’Angleterre contre la France et toute l’Europe (Berlin sera d’ailleurs occupée par les Russes). Victoires, défaites, alternent et souvent Frédéric fut à deux doigts du désastre. En 1762, il ne devra sa survie qu’à un miracle : la mort subite de la tsarine Élisabeth à qui succède Pierre III, mari imbécile de Catherine II.
On a souvent voulu établir un parallèle entre Frédéric II et Napoléon. Je pense que c’est une erreur. En France, les soldats sont et demeurent des citoyens (même si Napoléon les désigne comme ses sujets) et chaque soldat peut espérer devenir officier et noble, ce qui est l’exact contraire de la Prusse frédéricienne.
Et l’Allemagne, pendant ce temps ? Elle vit, monsieur, pas trop mal, sous le régime du Kleinstaaterei (klein pour petit et staat pour État), autrement dit le morcellement institutionnel avec des monnaies différentes, des unités de mesure changeant d’une frontière à l’autre. Cet éparpillement sera la chance intellectuelle de ces Allemagnes dont l’essor artistique sera prodigieux. C’est une constante de la création artistique : elle ne s’épanouit qu’avec la liberté et les régimes tyranniques stérilisent les artistes (qu’on en juge par le IIIe Reich ou l’Union soviétique). Et même, l’Allemagne non prussienne n’a aucune aspiration à l’unité !
Cependant, l’Allemagne se cherchait un héros depuis Luther : elle en trouva un dans la personne de ce roi, héros fortement idéalisé et qui donna naissance au mythe frédéricien. Ce mythe perdurera jusqu’à la Révolution de 1789. Kant résume fort bien le pourquoi et le comment par ces mots : « L’Allemand est de tous les peuples civilisés celui qui est le plus facilement et le plus constamment gouvernable. Il est l’ennemi des nouveautés et de la résistance à l’ordre établi. » J’appellerai cela la placidité du bœuf à l’étable mais, bon, passons…
Et pourtant ! Comment qualifier ce souverain qui fait main basse sur la Silésie, la Saxe, démembre (avec ses complices certes) la pauvre Pologne ? Le drapeau prussien porte en son centre une aigle noire tenant une épée. Un vautour eût mieux convenu. Et la France des Lumières, les Encyclopédistes, le chantent et le vénèrent ! Jusqu’à sa mort, en 1786. Et l’illusion devint mythe.
Si je vous ai infligé cette longue digression, c’est tout simplement qu’on ne comprend rien à ce qui va suivre si l’on méconnait ce qui a précédé. En dépit de l’invasion de 1792, la plupart des Français instruits éprouvent respect et sympathie pour la Prusse (en qui ils ne voient pas encore un danger mortel).
La provocation fut le fait de la France révolutionnaire. Le jacobin Anacharsis Cloots, baron allemand renégat, s’exclame : « Nos écrits sont des torches en Allemagne… Inondons leurs provinces de nos assignats avec l’aide de nos armées. Les cases du damier de la France seront augmentées de douze cases nouvelles dont le rebord sera le Rhin8. »
Puis ce fut Valmy et l’armée du roi de Prusse fut « autorisée » (quel autre vocable employer ?) à se retirer sans mal pour aller dévorer ce qui restait de Pologne libre. Ensuite ce fut la paix de Bâle, en 1795, entre la République française et le royaume de Prusse. La Rhénanie devint et demeura française, départementalisée et Mayence fut une ville vraiment française. La France admet que le Hanovre pourrait bien échoir dans l’escarcelle prussienne, si les circonstances le permettent.
Le voici, le prétexte tout trouvé de 1803, 1805 et 1806 : le Hanovre !
Le Hanovre ou la poule aux œufs d’or
La diplomatie exclut la naïveté et les pourparlers entre États prennent souvent des airs de discussions entre marchands de tapis. L’air qu’on y respire est souvent porteur de remugles qui offusquent l’honnête homme. C’est pourquoi Napoléon et Talleyrand s’entendirent si bien, l’un comme l’autre étant sans scrupules ni illusions sur la nature humaine9. La diplomatie devient souvent du marchandage, du genre : « Tu me donnes tel territoire et je te rends celui-ci. Il n’est pas à moi ? Qu’importe ! Tu n’as qu’à le saisir et je te laisserai faire. » J’exagère ? Hélas ! Le « droit des gens » me direz-vous ? On le met à toutes les sauces, le droit des gens, tandis que le droit du plus fort est autrement parlant. Staline disait, cyniquement : « Le Pape ? Combien de divisions ? » Autrement dit, la force de la moralité, si elle existe, est souvent impuissante devant la marche des gros bataillons.
En 1805, la France, pour se garantir la neutralité prussienne – autrement dit, pour qu’elle regarde ailleurs quand on marchera sur Ulm et Vienne – la France donc, a offert le Hanovre au roi de Prusse. Le Hanovre, les Prussiens en salivent déjà : c’est l’État qui, au nord de l’Allemagne, empêche la réunion de la Prusse de l’est avec ses possessions rhénanes à l’ouest. Le problème est que l’Électeur de Hanovre est aussi roi d’Angleterre ! Pas de problème : on dévalisera un ennemi pour récompenser un « allié », tout au moins afin de garantir sa neutralité. On accède là à la constante politique de Napoléon : ménager la Prusse, la circonscrire en l’achetant, la « gaver » sans qu’elle ait à combattre. Étrange indulgence de Napoléon envers Berlin.
Le 23 août 1805, Duroc, envoyé spécial de Napoléon, est à Berlin ; il est chargé de promettre le Hanovre à la Prusse si elle accepte de faire la guerre au tsar, ce qu’elle ne fera pas, bien évidemment. Et puis, c’est Austerlitz… Le 7 décembre 1805, le comte d’Haugwitz, envoyé par le roi de Prusse, est au camp de Napoléon. Sa mission est de tenter d’arrêter « l’Ogre de Corse », faute de quoi, la Prusse, n’est-ce-pas… Mais Napoléon ne se démonte pas : « Je veux de la sécurité ou je me sépare de vous. Je marche sur mes ennemis partout où ils se trouvent. » Haugwitz, mal à l’aise, mettonsnous à sa place, ne sait quoi rétorquer. Le 15 décembre, la Prusse laisse donc les mains libres en Allemagne à Napoléon qui la paie du Hanovre. C’en est fait !
Lettre d’Haugwitz à son roi : « À la suite d’une guerre glorieuse, ce serait déjà un beau succès (il parle du Hanovre) ; mais l’avoir sans risque et garder toutes nos forces intactes, c’est bien mieux. » Certes.
Le seul qui tente de freiner Napoléon, c’est Talleyrand. À quoi bon écraser, humilier l’Autriche ? On n’en aura même pas l’alliance sincère ni la gratitude de la Prusse. Mais déjà, on ne freine plus Napoléon qui rêve son projet fédératif européen. Il gratifie ses alliés allemands : Bade, Bavière, Wurtemberg, Hesse-Darmstadt, de territoires et élève leurs princes à la royauté comme on fait la promotion d’un officier au grade supérieur. « Voilà, dit Napoléon, les quatre piliers de ma future Confédération allemande. »
Vint l’année 1806. Napoléon pense donc avoir les mains libres en Allemagne. Le 12 juillet, il fonde la Confédération du Rhin qui élimine définitivement l’Autriche. Mais, ce qu’il ignore, c’est la scène théâtrale qui s’est déroulée le 1er juillet à Potsdam.
Là, sur le tombeau du Grand Frédéric, le roi de Prusse et le tsar Alexandre, accompagnés par la belle reine Louise de Prusse, ont étendu leurs mains sur le marbre du tombeau et se sont jurés fidélité. Le double jeu continue.
Le coup de maître de la diplomatie anglaise
Pitt est mort à l’annonce d’Austerlitz. L’ennemi irréductible de Napoléon, rongé par le surmenage, l’abus de porto et le désespoir, le grand William Pitt n’est plus. Le gouvernement change. Le successeur de Pitt, Grenville, a choisi Fox comme ministre des Relations extérieures, un Talleyrand anglais en quelque sorte, qui n’est pas aussi rigide que ses devanciers. Il ne ferme pas la porte aux négociations avec Napoléon. On a beaucoup fantasmé sur Fox – qui mourra lui-même bientôt – on a trop supputé que si Fox avait vécu… Illusion. Fox était avant tout anglais.
Lord Yarmouth est mandaté à Paris afin d’entreprendre des pourparlers. Là, il va réussir un coup incroyable, digne d’un grand joueur. Le 2 août, il rencontre l’ambassadeur de Prusse, Lucchesini, et lui laisse entendre que Napoléon rendrait le Hanovre à l’Angleterre si elle consentait à désarmer. Stupéfaction du Prussien qui se croit joué ! Machiavélisme de l’Anglais (à qui Napoléon n’a rien promis d’aussi concret) ! Lucchesini, affolé, affole son roi en l’informant. À Berlin, c’est la panique : à quoi bon s’être vendu à Napoléon s’il retire sa mise ?
La réaction de Frédéric-Guillaume est immédiate : le 9 août, il mobilise et masse des troupes aux frontières. La belle manœuvre du diplomate anglais a réussi : il a séparé les deux comparses – Prusse et France – sans rien donner ! La Prusse, gavée et corrompue par Napoléon, prend peur et, comme chacun sait, la peur est mauvaise conseillère.
Et pourtant, Napoléon ne veut pas la guerre. Qu’y gagneraitil ? Le 26 août, en dépit des bruits de bottes prussiens, il déclare à Berthier, son indispensable chef d’état-major : « Mon intention est de faire rentrer effectivement mes troupes en France. » Trop tard.
Sur un mensonge générant la peur, la Prusse va se lancer dans une aventure périlleuse sans le soutien de personne, sans que rien ne l’y oblige et sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi elle le fait.
Chapitre 3
LA MONTÉE DES PÉRILS
1806. Napoléon a éliminé l’Autriche de ses possessions allemandes. François II est devenu François Ier d’Autriche. La Prusse, seule grande puissance au nord est son alliée ou, au pire, neutre. Il a donc les mains libres. Il va poursuivre son implantation en mariant ses parents à des princesses allemandes. Ainsi son beau-fils Eugène de Beauharnais, épouse une princesse bavaroise ; Jérôme son plus jeune frère, se marie avec une princesse de Wurtemberg ; Murat son beau-frère, mari de Caroline, devient grand-duc de Berg et Clèves (anciens territoires prussiens). Même son chef d’état-major, Louis-Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel et Valangin (également anciens fiefs prussiens) avait lui aussi épousé une princesse bavaroise, nièce du roi de Bavière. Ce n’est nullement une spoliation. Comme on l’a vu, la Prusse a été grassement rétribuée par le Hanovre anglais qui fait le lien entre le royaume et ses possessions de l’ouest. Ce n’est pas tout…
Le 12 juillet 1806, il porte aux fonts baptismaux son œuvre nouvelle : la Confédération du Rhin : Bavière, Bade, Wurtemberg, Hesse-Darmstadt, Berg, Nassau, etc. C’est un pas de plus vers l’unification de l’Allemagne. Un pas de géant. Napoléon, qui était déjà roi d’Italie (du moins de l’Italie du nord), médiateur de la Confédération helvétique, devient également protecteur de cette nouvelle Confédération. Il a placé son aîné, Joseph, sur le trône de Naples. Ayant la mainmise sur la Hollande par son frère Louis qu’il a fait roi, il a, en conséquence, constitué un empire qui va de la mer du Nord à l’Adriatique. C’est déjà l’Empire de Charlemagne reconstitué. De plus, depuis 1795, l’Espagne est notre alliée. Les nouveaux rois allemands faits de son impériale main, lui sont servilement acquis. Les statuts de la Confédération disent qu’elle lui accordera un contingent permanent de 63 000 soldats. Quant à lui, il promet d’assurer sa défense avec 200 000 hommes. Cette Confédération était dans la faible main de Charles de Dalberg, ex-archevêque et Électeur de Ratisbonne. Le 19 avril, il avait écrit, le front dans la poussière, sans honte, à Napoléon pour le supplier d’être le régénérateur de l’Allemagne : « Que le génie de Napoléon ne se borne pas à créer le bonheur de la France ; la Providence accorde l’homme supérieur à l’Univers. L’estimable nation germanique [qui n’existe pas, notons-le] gémit dans les malheurs de l’anarchie politique et religieuse ; soyez, Sire, le régénérateur de sa Constitution ». À ramper ainsi aux pieds du Lion, il sera récompensé mais on ne peut lire ces mots sans ressentir quelque gêne. Ainsi fut fait.
Plus grave : Napoléon propose à la Prusse, encore et toujours favorisée, de constituer une Confédération de l’Allemagne du nord, que le roi de Prusse présidera avec le titre d’Empereur (22 juillet 1806). C’est déjà 1866 avant l’heure10 !
Ainsi donc, en cet été 1806, tout semble sourire à la France. Les vainqueurs d’Austerlitz ont regagné l’Allemagne où ils sont en villégiature. Leurs chefs sont à Paris ou dans leurs châteaux. Il fait beau. À Paris, les plénipotentiaires anglais font semblant de négocier. Allons, tout va bien. Oui et non. À Berlin, la fièvre monte. On s’excite tout seul. On se monte la tête. Mais que se passe-t-il ?
Un drame romantique
La guerre n’est pas une fatalité. Pour qu’elle se déclenche, pour que deux peuples en arrivent à se prendre à la gorge, il faut bien que certains hommes décident que le temps n’est plus à la parole mais au meurtre organisé. Certains hommes ou certaines femmes.
Il en est une qui symbolise plus que personne le parti de la guerre en Prusse. Elle, c’est Louise de Mecklembourg-Strelitz, la reine Louise. Personnage romantique, c’est-à-dire névrosée et hystérique, elle est belle, elle est jeune (trente ans) et frustrée. Mère féconde qui va donner dix enfants à son époux, elle se rêve un destin. Elle voudrait être – si je puis oser cette comparaison – la Chimène de son Cid de mari. Mais Frédéric-Guillaume n’est pas Rodrigue. Ce n’est pas un va-t’en-guerre. C’est un homme « timide, timoré, avide d’agrandissements sans risques ». Bref, en cette période de tumulte européen, il n’est pas à la hauteur des acteurs et des évènements.
Mais revenons à la reine Louise. Déçue par le coté velléitaire de son époux, elle va s’enticher du nouvel archange sauveur : le tsar Alexandre. Jeune, beau, puissant, elle va voir en lui l’espoir de mettre à bas ce parvenu de Bonaparte, ce moins que rien, cet assassin du duc d’Enghien, la bête, l’antéchrist, l’Ogre de Corse, etc. Elle se garde bien de savoir que son héros, Alexandre, a plus ou moins suscité l’assassinat de son père Paul, le tsar-fou.
Louise, ce pourrait être une héroïne de Stendhal ou de Walter Scott. Des héroïnes romantiques, elle présente tous les symptômes, y compris l’hystérie et la maladie de poitrine qui va l’emporter en 1810, à trente-quatre ans. Est-ce l’effet de sa maladie ? On sait que les tuberculeux peuvent être exaltés, vivre dans les chimères (relire La montagne magique de Thomas Mann). Il est même possible qu’un certain mépris de son mari l’habite. Elle se voit mariée à un faible, lui en veut et, par conséquent, va le pousser à agir malgré lui. Rappelons-nous le serment nocturne de Potsdam, quand le tsar et le roi s’unissent en posant leurs mains sur le marbre du tombeau de Frédéric le Grand. Tout l’arsenal romantique est là : la nuit, le tombeau, les flambeaux vacillants, un roi et un empereur, des serments et une reine témoin et caution de leur engagement. Du Hugo pur jus !
À la cour, les officiers sont tous amoureux de leur belle reine qui, elle, s’est entichée du bel Alexandre. Elle souffle sur les braises et attise l’incendie. Elle va perdre tout sens commun en allant jusqu’à revêtir l’habit de colonel de son régiment des Dragons de la Reine et suivre l’armée jusqu’à Iéna. Belle âme que celle de la reine Louise qui voudrait faire se dresser l’Europe civilisée « contre le tyran français » selon le propos de Sorel (Louise de Prusse, éd. Adami). Mais âme haineuse que celle de cette princesse qui, dans ses lettres, traite Napoléon de « misérable, monstre, être échappé de l’enfer » et autres gracieusetés ! Napoléon ne s’y trompera pas. Louise, c’est Armide. Dans la Jérusalem délivrée, écrite par Le Tasse, le poète a peint cette héroïne maléfique, cette magicienne qui va être la tentatrice du croisé Renaud. Armide, c’est la mauvaise influence de la femme sur l’homme séduit. On retrouve là le côté misogyne du caractère de Napoléon qui détestait les femmes qui osaient se mêler de politique. La reine Louise va l’apprendre bientôt à ses dépens.
Il est bien certain que Louise, à elle seule, n’a pu pousser un pays entier à la guerre. Il fallut autre chose. Poursuivons dans la tentative d’explication psychologique du conflit.
La marche à l’abîme des Hohenzollern
L’individu qui accepte bassement de recevoir des gages de serviteur, pour ne pas dire de larbin, finit par éprouver de la honte. Honte de sa servilité, honte de recevoir le mépris du maître avec son salaire. Puis la honte se transforme en réprobation, en aversion, en agressivité et, parfois, en haine. Haine envers celui qui vous a humilié et dont vous avez été, par le fait, le complice. L’élite prussienne se savait complice de Bonaparte pour avoir accepté de lui tant et tant de cadeaux. Ils se savaient achetés, ce qui, pour un homme d’honneur, est insupportable. Voulez-vous une preuve ? Lisons ce que disait le Prussien Hardenberg à l’agent anglais Jackson (le 20 mai 1806), à propos du Hanovre : « J’abhorre la manière infâme par laquelle nous faisons cette acquisition… Nous pouvions rester les amis de Bonaparte (il ne dit pas Napoléon), sans devenir ses esclaves11. » Et que penser des propos du Russe Rostopchine (théoriquement allié) qui ne cache pas son mépris pour cette Prusse écœurante, ces traîtres de Prussiens qui s’asservissent à Napoléon ? Même Talleyrand ne mâche pas ses mots auprès de Mme de Rombech : « La Prusse ! Vous croyez à la Prusse ? Nous n’y croyons pas, nous, Madame. Apprenez que la Prusse n’est ni pour vous (la dame est autrichienne) ni pour nous : elle n’est que pour elle ! ». Autrement dit : la Prusse est un État égoïste et sans honneur qui ne respecte pas ses partenaires et ne tient jamais parole. Méprisée par tous, honteuse d’elle-même, la Prusse (enfin, la Cour et les hauts dignitaires civils et militaires, le peuple de Prusse, lui, s’en contrefiche du Hanovre), la Prusse, donc, est mûre pour la poussée de fièvre qui mène à la folie furieuse.
Le roi hésite. C’est dans son caractère. Poussé par la reine, tiraillé par sa famille, subissant les respectueuses remontrances de ses généraux, Frédéric-Guillaume est sur des charbons ardents. L’Angleterre, pour marquer le coup, lui a déclaré la guerre (toujours ce cadeau empoisonné du Hanovre). Le roi de Suède lui souhaite tout le malheur possible (il est un ennemi acharné de Napoléon et donc de ceux qui s’acoquinent avec lui). Pauvre Frédéric-Guillaume !
Et comme si cela ne suffisait pas, on apprend le 25 juillet, la création de la Confédération du Rhin ! C’en est trop ! Le monde prussien perd la tête : Blücher, général de cavalerie que l’on reverra jusqu’en 1815, n’a-t-il pas clamé « qu’avec sa seule cavalerie, il se chargeait d’aller à Paris ». Rien que cela !
Tenez, voici un nouvel incendiaire, le prince-électeur de Hesse-Cassel qui déclare devant le ministre de France à Cassel, en parlant de la Prusse : « Quand on a 250 000 hommes, la première armée du monde, cette armée de Frédéric II qui a tenu tête à l’Europe entière, le plus beau corps d’officiers tous nobles, ce qui fait beaucoup, monsieur, on est en état de résister à tout. » Lui aussi, on ne l’oubliera pas quand on soldera les comptes…
Le seul, peut-être, qui garde la tête froide et ne mésestime pas les Français, c’est le duc de Brunswick. Les Français, il les a affrontés à Valmy. Il a vu. Il a compris. Mais Valmy, c’était il y a quatorze ans. Une éternité à l’échelle de ce temps de révolution qui s’est accéléré et court tel un cheval emballé.
Et l’opinion publique prussienne, que pense-t-elle ? Pas grand-chose pour la bonne raison qu’il n’y a pas d’opinion publique à Berlin, Erfurt, Dantzig ou Königsberg.