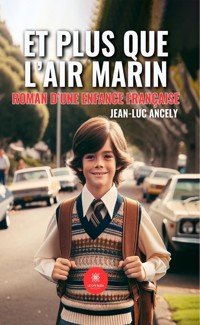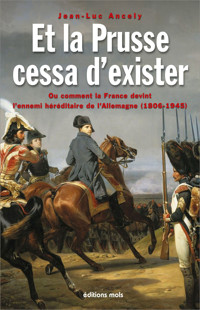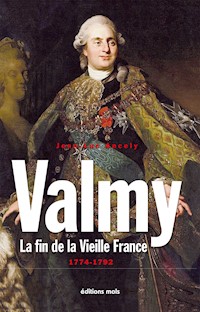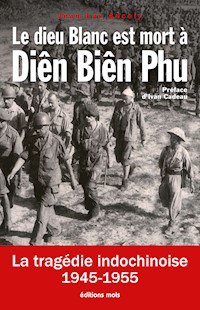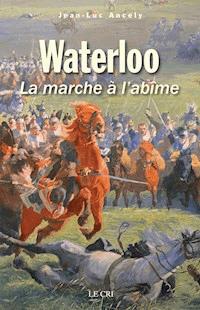Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Durant trente mois essentiels à l’Histoire, ceux qui vont de mai 1798 (le départ pour l’Égypte) à décembre 1800 (l’attentat de la rue Saint-Nicaise), Bonaparte, que rien ne destinait à l’aventure prodigieuse, fut servi par une chance absolument invraisemblable, une chance qui n’arrive d’habitude qu’une ou deux fois dans une vie quand chez lui elle se répète à six (!) reprises. Tout autre aurait pu y voir un signe de la Providence, du genre : “ Va ! L’avenir t’appartient. ”
L'auteur va plus loin : selon les lois mathématiques des probabilités, cette aventure n’aurait jamais dû avoir lieu.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Luc Ancely est Français et réside en Belgique ; ancien élève de Saumur, il a fait carrière dans l’Arme blindée Cavalerie.
Il est l’auteur d'ouvrages littéraires, essais et tragédies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAPOLÉON AURA-T-IL LIEU?
Du même auteur
Waterloo. La marche à l’abîme, Le Cri.
Ainsi sont-ils (contes et nouvelles), Mols.
Le dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu. La tragédie indochinoise.
1945-1955, préfacé par Ivan Cadeau, Mols.
Jean-Luc Ancely
NAPOLÉON AURA-T-IL LIEU?
La Fortune et la volonté (mai 1798-décembre 1800)
Essai
© Éditions Mols, 2020
Collection Histoire
www.editions-mols.eu
« Il n’est pas de grandes actions qui soient l’œuvre du hasard et de la fortune; elles dérivent toujours de la combinaison et du génie… Quand on veut étudier les ressorts de leurs succès, on est tout étonné de voir qu’ils (Alexandre, César, etc.) avaient tout fait pour l’obtenir. »
Propos de Napoléon tenus à Las Cases, rédacteur du Mémorial de Sainte-Hélène.
« De vrais amis, mes chauds partisans, me demandaient parfois, sous le Consulat… où je prétendais arriver; et je répondais toujours que je n’en savais rien. »
(Bonaparte à Las Cases in Le Mémorial).
« Bonaparte n’a jamais su où il allait, parce qu’il ne pouvait pas le savoir, et c’est pourquoi il est allé si loin. »
Jacques Bainville, Napoléon (Fayard)
Préambule
L’uchronie est un genre littéraire qui séduit tout autant les auteurs que leurs lecteurs. L’uchronie nous rapproche du fantastique et même de ces jeux enfantins que nous inventions, du genre: « Et si l’on disait qu’on serait X ou Y et que ce qui s’est passé ne s’est pas passé comme ça? » Le « wargame » est une uchronie. L’uchronie, c’est la tentation de refaire l’histoire: « Et si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo? », « Et si de Gaulle était mort en Août Quatorze sur le pont de Dinant? » La plus célèbre peut être attribuée à Pascal: « Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde en eût été changée. »
Quant à moi, je m’y refuse. Ce qui suit n’est pas une chronique uchronique. Je vais m’efforcer de coller aux faits afin d’exposer ce qui, logiquement, mathématiquement parlant n’eût pas dû se produire. Le vrai mystère de cette histoire réside en ce que, bravant toute évidence logique, elle s’obstinera, l’Histoire, à être ce qu’elle fut.
Je me contenterai, en guise de préambule, de poser deux aphorismes de Napoléon, aphorismes qui illustrent bien, je pense, mon propos quant à la chance et à la volonté. Le premier date de 1810: « Je suis l’instrument de la Providence; elle me soutiendra tant que j’accomplirai ses desseins, puis elle me cassera comme un verre. »
Quant à la volonté, voici ce qu’il dit, en 1820, déporté à Sainte-Hélène: « J’ai toujours été heureux [c’est-à-dire chanceux], jamais mon sort n’a résisté à ma volonté. »
Introduction
Le comte de Narbonne, interrogé en 1810 par l’Empereur quant à l’opinion des Français à son propos, lui dit ceci: « Les uns disent que vous êtes un dieu, les autres que vous êtes un diable, mais chacun convient que vous êtes plus qu’un homme. » On estime à plus de cinquante mille les ouvrages écrits sur lui, ses actions, sa personne, sa vie! Et ce n’est pas fini (la preuve)! Pourquoi? Qu’y a-t-il donc chez cet homme qui nous fascine ou nous exaspère tant? Même ses détracteurs – ils sont légion – reconnaissent qu’il est, pour l’histoire, incontournable, qu’il y eut un avant et un après Napoléon Bonaparte. Après tout, si ses institutions survivent passés deux siècles, c’est qu’elles ont fait entrer la vieille France dans la modernité. Despote? Génie politique? Homme de guerre exceptionnel mais inculte en économie? Tout est vrai, hélas.
Goethe, après l’avoir rencontré, dit: « Ne le jugez pas; il est trop grand pour nous. » Goethe, ce géant, était aussi un courtisan sachant manier la flatterie. Mais il était probablement sincère et savait reconnaître un homme d’exception – au sens littéral – quand il en voyait un. Je cite Goethe: « Napoléon vécut tout entier dans l’idée, mais il ne parvenait pas à la saisir par sa conscience, il repousse en général tout l’idéal et nie sa réalité, tout en s’efforçant passionnément à le réaliser. » C’est la Volonté faite homme. Mais la volonté est impuissante sans la Chance.
Devenu empereur, quand on lui proposait un homme pour une promotion, une fonction supérieure et qu’on lui vantait les mérites du candidat, il demandait toujours: « Oui, je sais tout cela. Mais a-t-il de la chance? »
Sa chance à lui, il l’appelait « son étoile ». Après le désastre – prévisible – de Waterloo, il dira: « Je ne voyais plus mon étoile. »
Ce que je vais m’efforcer de mettre en exergue dans cette étude, c’est que, durant trente mois essentiels à l’histoire, ceux qui vont de mai 1798 (le départ pour l’Égypte) à décembre 1800 (l’attentat de la rue Saint-Nicaise), cet homme, que rien ne destinait à l’aventure prodigieuse, fut servi par une chance absolument invraisemblable, une chance qui n’arrive d’habitude qu’une ou deux fois dans une vie quand chez lui elle se répète à six (!) reprises. Tout autre aurait pu y voir un signe de la Providence, du genre: « Va! L’avenir t’appartient. » Je vais plus loin: selon les lois mathématiques des probabilités, cette aventure n’aurait jamais dû avoir lieu.
L’histoire aurait pu commencer par ces mots, comme dans un conte: « Il était une fois, dans l’île de Corse, un enfant pauvre qui s’appelait Napoléon Bonaparte. » Son père, Charles, gentillâtre rallié à la nouvelle puissance occupante, la France (ce qui, aux yeux des Corses patriotes ne le mettait pas en odeur de sainteté), devait mourir jeune. À force de faire des pieds et des mains (comment faire quand on a huit enfants à élever?), Charles obtint du roi une bourse permettant de faire éduquer son fils Napoléon en tant que pensionnaire au collège militaire de Brienne-le-Château, dans ce qui devait devenir plus tard le département de la Haute-Marne. Ce collège était réservé aux enfants de la noblesse (c’est-à-dire que les noblaillons campagnards aussi gueux que leurs fermiers casaient là leurs rejetons aux frais de l’État afin d’en faire, plus tard, des militaires.) Cela ressemblait un peu à nos prytanées actuels. Mais, me direz-vous, Charles Bonaparte était-il vraiment noble? Il se faisait appeler Charles de Buonaparte. Il se battit pour faire admettre des quartiers de noblesse plus ou moins toscane et assez peu évidente. Disons, pour simplifier, qu’on lui fit cette faveur parce qu’il était corse, rallié à la France et porteur d’un nom de famille qui signifiait quelque chose à Ajaccio. Alors, sa noblesse, authentique ou pas?1
Donc Brienne. Mais d’abord Autun, en compagnie de son frère Joseph. Le Lycée Bonaparte d’Autun a gardé le souvenir vivace de la présence des jeunes Bonaparte dans ses murs. Pourquoi? Parce que, avant toute chose, il leur faut apprendre le français! Ces gamins corses parlent le corse; ils sont parfaitement étrangers et un peu perdus comme le sont les petits immigrés. Pourquoi Autun? Parce que le gouverneur de la Corse pour le roi est M. de Marbeuf et que son neveu est Mgr de Marbeuf, évêque d’Autun. On a même casé le jeune Joseph Fesch (frère de Letizia), admis, lui, au petit séminaire d’Aix. On voit par-là que, faute de moyens, Charles Bonaparte – pardon, de Bonaparte – se démène pour caser toute sa nichée. C’est ainsi que, le 17 décembre 1778, le petit Nabulio, les deux Joseph et M. de Bonaparte s’embarquent pour cette contrée lointaine et inconnue: la France.
Le gamin de dix ans a quitté son île ensoleillée, ses arbres, ses escapades dans les ruelles d’Ajaccio, les collines des alentours, pour la morne, froide et triste Champagne (et Dieu sait que les environs de Troyes ne sont pas gais l’hiver pour un enfant qui n’a jamais vu la neige!)
Là, sans le sou, sans affection, privé de l’amour de sa mère Laetitia Ramolino, de la présence grouillante de ses frères et sœurs, il apprit que la vie est une lutte de chaque instant, que certains sont plus nantis que d’autres mais il sentit – il sut – que sa valeur suppléerait à tout et qu’elle lui ouvrirait des portes. Il fallait que le monde se prêtât à son ambition et qu’un évènement survînt. Plus qu’un évènement, un cataclysme. Ce cataclysme qui jeta bas tout ce qui était depuis dix siècles pour ériger tout ce qui pouvait enfin être, ce fut la Révolution. Il n’est pas dans notre propos de juger la Révolution: pour les « progressistes » (comme Michelet), ce fut la libération du peuple-roi; pour les autres, une catastrophe sanglante. Peu importe. Quoi qu’il en soit, elle ouvrit des portes et abattit des murs centenaires. Et le petit Corse, sans la Révolution, n’aurait jamais été ce qu’il fut.
Oui, on eût pu commencer par ces mots: « Il était une fois un enfant corse qui s’appelait Napoléon Bonaparte. » Mais quel écrivain, quel rêveur, quel romancier déjanté eût pu oser une aventure aussi extravagante?2
***
À Sainte-Hélène, Napoléon, déchu, prisonnier, déporté, s’exclama: « Quel roman que ma vie! » Tout est dit. Quant à moi, j’affirme qu’un romancier proposant à son éditeur l’histoire d’un homme aussi démuni de tout, sorti de nulle part, parti de si bas, que cet homme devînt l’être humain le plus connu sur la planète et ce, depuis deux siècles, que cet auteur donc se fît vertement rabrouer par un propos du genre: « Allons donc, vous déraisonnez. Cela passe l’entendement. Personne n’y croira. » Et pourtant… Invraisemblable, dites-vous?
Clio a parfois de l’humour. Certains jours, elle laisse éclater un rire tonitruant du genre: « Vous croyez avoir tout vu? Attendez, naïfs que vous êtes. Je m’en vais vous étonner autant que faire je puis. Je vous concocte un personnage qui sera connu jusqu’au fond de la Papouasie et dont vous parlerez, jour après jour, dans deux cents ans. Il sera aussi connu que le Christ qui, Lui, n’était sans doute pas un homme. Ah! vous avez déjà tout vu? Chiche? On y va? »
S’il en est qui sont convaincus d’avoir tout vu, blasés et rebelles revenus de tout – et même du pire –, ce sont les Parisiens. Napoléon dira d’eux: « J’épouserais la Madone que je ne parviendrais pas à étonner les Parisiens. » Il va cependant tout faire pour les étonner. Qu’on en juge: le 11 frimaire de l’an XII de la République Une et Indivisible (soit le 2 décembre 1804), il fait froid. Ciel de neige, vent du nord, trois degrés. Les Parisiens ont tout vu depuis 1789 et pas que des joyeusetés: du sang sur le pavé, des têtes au bout des piques, des charrettes cahotant vers les échafauds, des massacres, des cris, des larmes mais aussi des cortèges joyeux d’énergumènes en carmagnole, bonnet rouge, piques, fusils, canon, bref, tout ce qu’un peuple peut produire quand plus rien ne le retient.
Mais, par ce matin déjà hivernal, c’est un cortège de carnaval qui se dirige vers Notre-Dame: carrosses rutilants dorés et surdorés, chevaux piaffant portant et emportant toutes les Excellences du nouveau régime, les Altesses Impériales toutes fraîches encombrées de leurs nouveaux titres: princes, princesses et même des rois ou en passe de le devenir! Et ces soldats-citoyens, ces combattants de Valmy, de Jemappes, de Fleurus, d’Italie, d’Allemagne et d’Égypte, devenus maréchaux du nouvel empire! Et pas un parmi eux qui ne trouve cela extravagant? On en a tant vu que, oui vraiment, plus rien n’étonne: qu’un fils de tonnelier de Sarrelouis (Ney) côtoie un fils d’aubergiste (Murat) devenu le Prince Joachim Murat (et beau-frère de qui vous savez, en plus!) et personne n’éclate de rire? Allons. Est-ce possible? Mais où court donc tout ce beau monde emplumé, empanaché, engoncé dans des habits neufs, ces femmes empêtrées dans des robes dont les traînes requièrent tant de mains secourables?
Tout ce peuple court vers la cathédrale où le pape Pie VII – rien moins – va sacrer et sanctifier aux yeux du monde le fils d’un Corse pauvre comme Job (le père défunt, Charles), un ex-lieutenant d’artillerie boursier du roi, et personne ne hurle: « Remboursez, remboursez! » La cérémonie du sacre, c’est Disneyworld et Hollywood revus et mis en scène par Cecil B. DeMille. Ici, le metteur en scène, c’est Isabey, le peintre quasi officiel du régime. Tout est décorum, soie, brocart, dorures, diamants, robes interminables, pages et chambellans, encens, rubans, croix et crachats3, toques, plumets, manteaux écrasants dorés et surdorés, brodés et surbrodés. C’est kitsch, de fort mauvais goût, emphatique. Certains pourraient même affirmer: « À vouloir le trop beau, on a réussi le très laid. »
Et Clio, là-haut, se tient les côtes. Elle en pleure et son rire va rebondir sous les voûtes centenaires du glorieux monument. Alors? Toujours blasés?
Par centaines de milliers, les spectateurs assistent à la cavalcade à mi-chemin du corso fleuri et du carnaval de Nice. Ah! je vois, de-ci, de-là, quelques regards haineux: de vieux républicains (il en reste) et des royalistes légitimistes irréductibles (il en est encore). Écoutons – ou plutôt lisons – ce qu’écrit l’un d’eux à son roi en exil: « Toute cette pompe n’était qu’une mascarade… depuis les trois sœurs impériales qui avaient quitté le savonnage de leurs chemises à Marseille4 pour venir, empanachées et couvertes de diamants porter la queue de la vieille maîtresse de Barras… jusqu’à la petite culotte de peau du Treize vendémiaire (il parle là de Bonaparte, bien sûr)5. Il y avait dans cette saturnale de quoi rire ou de quoi pleurer. » Ouf! Toute cette cérémonie prend, avec le recul, un air nouveau-riche avec petits fours, champagne tiède et doigt en l’air qui m’a toujours fait sourire. Le sacre, c’est bien le triomphe du parvenu. D’ailleurs, prenant son frère à part, dans un couloir des Tuileries, Bonaparte, pas dupe, lui murmure: « Joseph, si notre père nous voyait! » Car lui, toujours lucide, voyait fort bien le côté ridicule de tout ce fatras.
Fort bien. Riez car bientôt vous pleurerez.6
Ainsi donc, c’est pour en arriver là qu’on a détruit l’ancienne France, tué son roi et sa reine, massacré tant de monde, proclamé la Liberté et l’Égalité, mis le feu à l’Europe? Pour un cortège de carnaval? Là, chère Clio, tu exagères, vraiment. Il y avait des bornes à ne pas franchir mais, ainsi que l’a dit un humoriste: « Une fois les bornes franchies, il n’y a plus de limites. » Le parcours, les limites? Des faubourgs d’Ajaccio à l’île de Sainte-Hélène en passant par Brienne-le-Château, Milan, Le Caire, Vienne, Berlin, Madrid, Moscou. Toujours blasés? Pourtant, vous qui paraissez prendre cette épopée comme allant de soi, comme inéluctable – on nous l’a tant ressassée! – si vous saviez comme tout cela aurait pu ne jamais avoir lieu. Voyons ensemble.
Je me suis concentré sur une courte période de trente mois, celle qui va de mai 1798 à décembre 1800, nous l’avons vu; j’y ai relevé six évènements qui eussent pu tout arrêter si… Durant ces deux grosses années, le destin du Corse a tenu à un fil, à rien, à un souffle. Mais quel diable a bien pu piquer Clio pour que le charme – c’est vraiment le mot – de la magie s’accomplît?
Alors, Napoléon aura-t-il lieu?
Chapitre 1
Bonaparte, l’homme:une tentative d’approche
« Ce grand homme reste de plus en plus inconnu. » Stendhal
« Cet être colossal. » Baron Thiebault – un détracteur, précisons-le.
« Napoléon est un raccourci du monde. Sa vie fut la vie d’un demi-dieu. » Goethe
« Il était étranger au monde. Tout en lui était mystère. » Lermontov
Ah! Voici madame de Staël (une ennemie): « J’avais vu des hommes très dignes de respect, j’avais vu aussi des hommes féroces: il n’y avait rien dans l’impression que Bonaparte produisit sur moi qui pût me rappeler ni les uns ni les autres. J’aperçus assez vite que son caractère ne pouvait être défini par des mots dont nous avons coutume de nous servir; il n’était ni bon ni violent, ni doux ni cruel… c’était plus ou moins qu’un homme. Sa tournure, son esprit, son langage sont empreints d’une nature étrangère. » (On a un peu l’impression qu’elle parle d’un monstre ou d’un extraterrestre!)
Et Nietzsche: « Napoléon est la dernière incarnation du dieu Soleil, d’Apollon »!
Et Hugo; dans Les châtiments:
Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli
Comprenant qu’ils allaient mourir dans cette fête,
Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.
Et Léon Bloy, cet illuminé: « Napoléon est inexplicable et, sans doute, le plus inexplicable des hommes… »
Laissons le mot de la fin à Bonaparte lui-même: « Toujours seul d’un côté et le monde de l’autre. Tout le monde m’a aimé et m’a haï » (plus qu’aimé, il fut vénéré et adulé par les humbles, les petits, ce qui est autre chose que le simple amour) mais surtout, surtout: « Des milliers de siècles s’écouleront avant que les circonstances accumulées sur ma tête aillent en puiser un autre dans la foule pour reproduire un même spectacle. » Conclusion: on l’a dit mégalomane? Je vois là, au contraire, une grande lucidité et un grand étonnement devant son incompréhensible histoire. Dernier éclair de lucidité décalée: « L’avenir nous apprendra s’il n’eût pas mieux valu pour le repos de la terre que ni Rousseau ni moi n’eussions jamais existé. » Oh, oui!
Le Bonaparte que nous allons côtoyer durant ces trente mois est fort différent d’aspect de l’Empereur empâté, un rien bedonnant, petit corps, grosse tête que nous sommes accoutumés de voir sur ses innombrables portraits, statues, etc. C’est un césar romain que l’on nous montre. Ce n’en était pas un en 1798. À l’époque, le conquérant de l’Italie est encore ce loup maigre, au teint jaune, aux cheveux plaqués, coiffé « à l’oreille de chien ».1 Physiquement, c’est un homme de taille moyenne (1,69 m, on le sait depuis qu’on a mesuré son corps en l’inhumant à Sainte-Hélène) qui passe même pour assez petit. Certes, plus tard, en prenant du ventre, comme tous les potelés, il semblera rétrécir. Ceci dit, les Français de cette fin de siècle étaient peut-être plus grands que nos grands-pères de 1914. Les Français de 1796, quasiment tous paysans, mangeaient plutôt bien, leurs enfants ne souffraient pas du rachitisme qui frappera la classe ouvrière de Balzac ou Zola.2 Donc, au milieu des colosses républicains comme Augereau, Bonaparte passait pour petit. Stendhal, qui l’a vu, dit de lui dans son « Napoléon » qu’il avait « un petit corps pâle, maigre, chétif » (en 1796). Tenez, une anecdote pour illustrer ce propos: relisez les cahiers du capitaine Coignet qui, lui, vraiment petit, pour entrer dans la Garde (la taille minimum requise était de 1,76 m ce qui laisse supposer qu’en ce temps les hommes de plus de 1,80 m n’étaient pas si rares), devra glisser deux jeux de cartes dans ses chaussettes avant de passer sous la toise. Ce qui frappait, c’était son regard, des « yeux à transpercer la tête », et même, son côté fille, qu’il assumait pleinement, lui donnait le regard caressant, celui, velouté, du parfait séducteur. Revenons à Stendhal: « Naturellement emporté, décisif, impétueux, violent, il avait l’étonnant pouvoir de se rendre charmant et, par des déférences bien ménagées et un enjouement flatteur, de faire la conquête des gens qu’il voulait gagner. » Un séducteur, très latin, basculant aisément de la colère plus ou moins feinte au charme le plus irrésistible. Bien peu y résistaient. Voici pour le physique; ce n’est pas l’essentiel. Creusons un peu.
Est-il un génie? Non, sans doute. En son temps, Goethe, Beethoven, Mozart peuvent être qualifiés ainsi. Non, Bonaparte n’est pas un génie; il a du génie, nuance. Et d’abord, avant tout, du génie politique. On ne voit plus en lui que le combattant, le conquérant. Cela, faire la guerre, c’était son métier, son job. Il avait été formé pour cela. C’était avant tout un professionnel. D’ailleurs, on le verra bien en Espagne. Rappelons-nous: 1808, il poursuit une armée anglaise en retraite à travers les bourrasques de neige de la sierra de Guadarrama et là, marchant au milieu de ses hommes, un grenadier l’entend distinctement grommeler: « Foutu métier. »3
Je parlais de son génie politique; j’insiste. C’est tout de même lui qui, ayant hérité d’une France en guerre (extérieure doublée d’une guerre civile) et d’une Europe en feu, mit fin à tout cela: paix intérieure (Vendée) sans les horreurs de 1794; paix européenne (paix d’Amiens); paix précaire certes mais paix tout de même. Elle ne devait pas durer; elle ne pouvait pas durer.4
Politiquement, il a eu cette idée géniale de la « fusion » entre l’ancienne société réactionnaire et la nouvelle « progressiste » née en 1789. Fusion, réconciliation, paix religieuse (le Concordat). Sur le plan de la politique intérieure, on peut dire qu’il « a tout bon ».
Mais revenons à l’homme Bonaparte. C’est un militaire doublé d’un autodidacte culturel. Sans le sou, le jeune souslieutenant d’artillerie qui bat le pavé de Paris n’a qu’un loisir possible: lire. Il lira tout, sans trier et comme il est doté d’une mémoire prodigieuse (cela personne ne le conteste), il retient tout, en vrac. Cela va de Corneille aux juristes romains (cela estomaquera les auditeurs du Conseil d’État. Il donnait l’impression de tout savoir!), de Rousseau le moraliste à Guibert le théoricien militaire. Tout, disais-je.
De plus, il a du bon sens ce qui est l’absolu contraire d’un dogmatique. Il sait trier le bon grain de l’ivraie. Un bon sens doublé d’un véritable sens de l’observation, et critique en plus. Il a assisté à toutes les horreurs de la Révolution: massacres de Septembre après ceux du Dix-Août aux Tuileries. Il a su l’abomination de la guerre de Vendée – c’est d’ailleurs pour cette raison que, en 1794, nommé général de brigade, il refusera d’y aller et sera rayé des cadres. Il évitera soigneusement de se mêler aux répressions qu’entraîne toute guerre civile. Ainsi, après la reddition de Toulon, il demeurera dehors afin de ne pas tremper ses mains dans le sang des Toulonnais. En forçant le trait, on pourrait dire de lui qu’il fut apolitique, sans idées préconçues, sans blocage. Il voulut faire le gouvernement de tous les talents, d’où qu’ils vinssent, quels qu’ils fussent, prenant à gauche et à droite. D’ailleurs, il le dit, parvenu au pouvoir: « J’assume tout, depuis Clovis jusqu’au Comité de Salut Public. » Il avait les factions en horreur, ayant trop vu de quoi elles étaient capables. Un autre aphorisme le définit en politique: « Ni talon rouge (les aristocrates), ni bonnet rouge (les extrémistes de gauche). »
Fin politique, il voit ce qu’il convient de faire et les écueils à éviter. C’est pourquoi son œuvre législative dure encore et encore, que ses institutions nous sont parvenues quasi inchangées et que cela marche! À Sainte-Hélène, en 1818, il s’exclamera, fièrement: « Ma gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles; ce que rien n’effacera, ce qui durera éternellement, c’est mon code civil et les procès-verbaux au Conseil d’État. » Oh, certes! Finalement, ce qu’il aimait, c’était légiférer, parce que, faire des lois, des lois justes et sages, c’est construire l’avenir. Il fut un bâtisseur. La guerre fut son boulet; il le traîna, par force mais sans plaisir.
***
Il fut « l’apaiseur » – si vous me permettez ce néologisme – celui qui sut éteindre l’incendie allumé en 1789. Il rejettera les extrêmes, qu’ils vinssent de droite (les royalistes bornés) ou de gauche (les excités du genre Marat, Hébert, les « Septembriseurs » comme il disait; dans sa bouche, c’était un opprobre). Il se voulut du « juste milieu ». Il voulut le gouvernement de « la jeunesse et de tous les talents. » Démocrate? Sûrement pas. Liberté, Égalité, Fraternité? Que nenni! La Liberté – négation des libertés – c’est le désordre, l’anarchie. La France avait trop souffert pendant dix ans pour déifier la Liberté. « Pas de liberté pour les ennemis de la Liberté », a dit Saint-Just. C’est tout dire. La Liberté, il la mettra sous l’éteignoir et, de fait, les Français s’en accommodèrent assez bien puisqu’en contrepartie il leur apportait la paix, la jouissance calme de leurs biens et la fierté d’être de la Grande Nation.
La Fraternité – on se demande bien ce qu’elle vient faire là! – ne fut mise en exergue que pour satisfaire les loges maçonniques qui avaient grandement œuvré pour la Révolution. Ce n’est, au fond, qu’une fiction grammaticale.
Mais l’Égalité, oui! Il la donna aux Français. Tout le monde, pourvu qu’il ait du talent, pouvait espérer atteindre les plus hauts sommets. Chaque soldat avait, dans sa besace, son bâton de maréchal; chaque artiste, chaque industriel pouvait être soutenu, aidé, élevé sans arrière-pensée pourvu qu’il ait de la valeur. C’est un peu du darwinisme social mais, après tout, c’est préférable à la lutte des classes ou à une société figée dans ses privilèges. L’Égalité devant la loi et devant les carrières, c’était, enfin, la porte grande ouverte sur l’avenir et la modernité. Il suffisait d’agir. On a dit de lui qu’il fut « la poésie en action ». Qui agissait avec talent trouvait chez lui une oreille attentive. Les imbéciles bornés demeuraient ce qu’ils étaient. Point final.
Démocrate? Non. « Une république de trente millions d’hommes est une utopie », a-t-il dit. N’est pas suisse qui veut. Tyran? Non. Despote? Oui, bien sûr. Pas tout à fait comme Frédéric II de Prusse mais enfin, le despotisme éclairé était un héritage des Lumières. Certes il admira Frédéric II. Parmi les intellectuels français, à commencer par Voltaire, le roi de Prusse fut un héros, une star; on ne vit en lui que le roi-philosophe en oubliant le rapace sans parole et sans cœur qu’il fut aussi.
Bonaparte fut aussi, et c’est un trait fort de son caractère, indulgent (et parfois d’une indulgence coupable, frisant la faiblesse). Pourquoi? Parce que, même chez ses adversaires, il savait reconnaître le talent: Chateaubriand, Talleyrand, par exemple. Le vicomte breton, il eût pu le fourrer au bloc5; il se contenta de lui faire donner de l’argent afin qu’il pût acheter la Vallée-aux-Loups! Comme lieu d’exil, on peut trouver pire! Pourquoi? Parce que, lui-même homme de lettres, voyait en Châteaubriand un colosse littéraire.
Talleyrand? « Vous êtes de la merde dans un bas de soie! » Il aurait pu le faire fusiller pour trahison et complot. Napoléon étant en Espagne en 1808, Talleyrand et Fouché se rabibochèrent, eux qui passaient pour ennemis irréductibles, et complotèrent afin d’envisager « l’après-Napoléon ». Quand celui-ci eut vent de leurs manigances, il rentra à Paris en toute hâte et destitua les deux ministres mais sans les punir davantage. Pourquoi? Parce que Fouché était dangereux – il se contenta de l’exiler dans sa sénatorerie d’Aix afin de s’y faire oublier – et parce qu’il aimait Talleyrand, ce brillant séducteur, ce diplomate de talent. La preuve? Partant pour la guerre, il se fait accompagner jusqu’à Strasbourg par Joséphine et le prince de Talleyrand-Périgord. Là, au moment de les quitter, il pleure. Oui, il pleure et il leur dit: « Comme il est difficile de quitter les deux êtres que j’aime le plus. » Cela ne s’invente pas.
***
J’ai parlé de Bonaparte homme de lettres. Comme beaucoup de soldats français, il fut écrivain. C’est une constante dans l’armée française: Laclos, Vigny, de Gaulle, Montluc. Les militaires sont souvent atteints du prurit scriptural. Pourquoi? J’ignore pourquoi (j’ai moi-même été soldat de carrière…).
Quand je dis Bonaparte écrivain, n’en doutez pas. Ses proclamations, ses Bulletins sont assez bien torchés: « La victoire marchera au pas de charge et l’Aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame » (au retour de l’île d’Elbe en 1815). Pas mal, non? Il faut lire ses écrits de jeunesse: Clisson et Eugénie (roman préromantique), ses nouvelles quasi fantastiques (Le comte d’Essex). Mais son grand œuvre, incontestablement, ce sera Le Mémorial de Sainte-Hélène (dicté à Las Cases mais bien de lui). Le mettant en parallèle avec Chateaubriand, j’ai, un jour, intitulé Le Mémorial: « Les Mémoires d’Outre-mer ». Écrivain, donc. D’ailleurs, en 1814, que dit-il dans la cour des Adieux, à Fontainebleau, à ses soldats qu’il doit quitter? Il leur dit qu’il se consacrera à relater (donc à écrire) les exploits accomplis par eux et lui; des Mémoires, quoi. Réaction d’écrivain.
Écrivain, sans doute, mais qui écrit « comme un cochon », si tant est qu’un cochon écrive. Sa pensée allait trop vite pour sa main. Il confondait Elbe et Èbre, utilisait enfanterie pour infanterie et tout à l’avenant. Plus tard, il finira par dicter plutôt que d’écrire lui-même.
En savons-nous plus sur Bonaparte? Un peu. Mais convientil de creuser davantage? Eh bien! Creusons.
Abordons le problème de ses idées politiques. On sait qu’il fut jacobin, voire robespierriste. Il faut lire Le souper de Beaucaire cet opuscule très engagé, écrit avant Toulon, dans lequel il expose clairement et sans détours son adhésion à la politique de Robespierre. Ce n’est pas un hasard si ses deux premiers « protecteurs » furent Salicetti (un Corse) et Augustin Robespierre, le frère de qui-vous-savez. Plus tard, après la chute de l’Incorruptible, il reniera son livre et n’aura de cesse de le faire détruire. Robespierriste? Au point que, après Thermidor, on l’arrêta et qu’il faillit bien passer sous le rasoir national (la guillotine) comme complice du tyran déchu.
Ensuite? Eh bien, il tourna sa veste. Il fut pour l’apaisement et jugeait son républicanisme comme une de ces erreurs de jeunesse, de ces emportements politiques qu’ont souvent les jeunes gens. Les Révolutions sont affaires de gamins; les hommes mûrs sont plus circonspects. Disons que, ayant jeté sa gourme, il devint « bonapartiste », c’est-à-dire tenant à un exécutif fort appuyé sur le consensus populaire (par le plébiscite), ce qui revient à passer par-dessus les représentants élus, à rejeter la voie parlementaire. Pourquoi? Parce que la France n’est pas l’Angleterre; parce qu’il a vu les excès commis par le monocamérisme (le pouvoir concentré dans une seule assemblée, sans contre-pouvoir) et les ministres devenus de pâles exécutants menacés de révocation, voire pire. En fait, la Convention concentrant tous les pouvoirs, y compris judiciaire, ne pouvait conduire qu’à la tyrannie. Bonaparte n’eut donc de cesse, parvenu au sommet, de museler les représentants des assemblées. Il ne voulait pas d’un « gouvernement d’avocats », c’est-à-dire de parleurs, de rhéteurs, se grisant de belles formules, s’enivrant de s’écouter parler. Lui, il voulait agir. Despote, oui, puisqu’il eut ce mot: « Moi seul sait ce qu’il