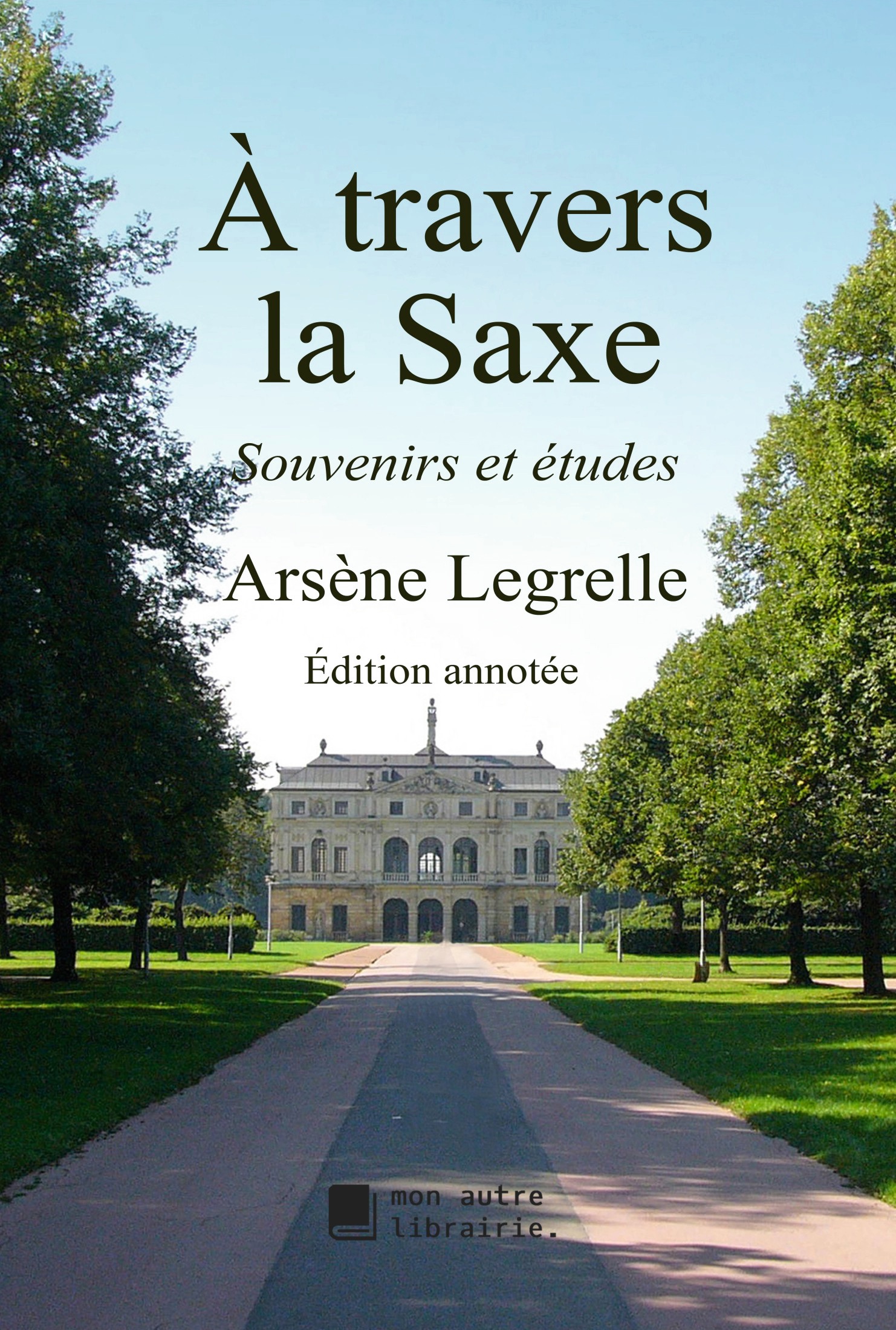
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Rencontre attendrie d'un germaniste amoureux de son pays d'élection avec une des régions les plus chargées d'histoire de l'Allemagne. Simplicité et cordialité d'un peuple encore très traditionnel, paysages sauvages ou agricoles idylliques, villes bruissantes d'une activité intellectuelle et commerciale bouillonnante, traces encore vives des plus grands écrivains d'Europe, la Saxe est un coeur qui bat. Il s'arrêtera quelques décennies plus tard, écrasé par les abominations politiques et militaires du XXe siècle. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À travers la Saxe
Souvenirs et études
Arsène Legrelle
(Édition annotée)
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Hachette, Paris, 1866.
1re de couverture : Dresde, Grand Jardin.
__________
© 2020, Mon Autre Librairie
ISBN : 9978-2-491445-35-5
Table des matières
À Monsieur Émile Délerot
I. – Le jubilé d’Iéna
II. – La forêt de Thuringe
III. – Les fêtes de Schiller
IV. – Weimar en hiver
V. – Un musée de journaux
VI. – La foire de Leipzig
VII. – Une université allemande
VIII. – Huit jours à Dresde
IX. – La suisse saxonne
X. – De Dresde à Magdebourg
À Monsieur Émile Délerot
Mon cher ami,
Permets-moi d’inscrire ton nom en tête de ce petit volume dont une partie a été écrite auprès de toi, à l’époque déjà bien éloignée où nous faisions ensemble nos premiers pas dans les âpres sentiers de la grammaire et du dictionnaire germaniques. Tandis que tu commençais à faire le siège en règle de la littérature de Goethe, afin de mieux pénétrer jusqu’au cœur de son génie, je me contentais de laisser ma curiosité se promener librement, au risque de faire parfois l’école buissonnière, à travers tout ce que l’Allemagne nous offrait alors d’original et de nouveau. C’est de cette attention quotidienne et soutenue, quoique bien éparse et trop discursive, je le crains, qu’est né au jour le jour ce modeste recueil de causeries familières sur les mœurs contemporaines d’outre-Rhin et sur quelques-unes des beautés pittoresques de la vieille Saxe. Peut-être eût-il été plus sage et plus habile de livrer immédiatement au souffle de la publicité ces pages légères, détachées toutes fraîches encore de mon carnet de voyage. Je me console toutefois du retard qu’elles auront mis à se présenter au public, en songeant que j’ai pu, grâce à ce retard, améliorer sur bien des points mes premières et trop rapides esquisses. Pendant les séjours réitérés que j’ai faits en Allemagne à la suite de notre commun et fraternel hivernage à Weimar, l’horizon de mes études s’est peu à peu élargi devant moi, et il était tout naturel que mon premier travail profitât de cet éclaircissement continu, de cette vision plus précise et plus générale dont je goûtais chaque jour davantage l’attrait. Je reconnais même, pour être tout à fait sincère, que mon lecteur aura le droit de s’étonner plus d’une fois en m’entendant parler de Berlin ou de Francfort, alors que je me suis engagé tout simplement à le conduire d’Iéna à Magdebourg. Aussi lui demandé-je pardon d’avance, ainsi qu’à Aristote, des libertés coupables que je me suis permises avec les unités de lieu et de temps. Mais ce qui me console plus que tout le reste de la paresse avec laquelle je me suis décidé à faire à ces essais leur toilette définitive – la toilette du condamné sans doute – avant de les lancer dans l’insondable peut-être de l’appréciation publique, c’est qu’ils vont précisément en affronter les périls au moment où un ministre, qui paraît ne point connaître d’obstacles, mais qui en rencontrera pourtant quelque jour, se prépare à effacer de la carte de l’Europe l’Allemagne confédérée que j’ai pris tant de plaisir à étudier, pour lui substituer une Allemagne uniformément et exclusivement prussienne. Personne ne peut dire encore de quel côté le stock d’ignorance et de naïveté populaires, dans lequel M. de Bismarck cherche depuis une semaine un contrepoids au bon sens libéral des classes moyennes et éclairées, fera finalement pencher la balance. Il n’est pas tout à fait impossible cependant que je me trouve avoir esquissé, sans le savoir, une Allemagne à l’agonie et que ma photographie avec retouches prenne inopinément l’intérêt d’un portrait avant décès. Quoi qu’il en soit, et que l’Allemagne revienne ou non en masse vers la douce églogue du moyen âge, duceetauspice Bismark, on en trouvera ici une portion décrite sincèrement, telle que je l’ai vue et telle qu’elle était, entre les années 1858 et 1865. Assurément, j’aurais pu, dans ce long tête-à-tête, songer à dérider plus souvent le lecteur aux dépens de nos voisins. Hélas ! poveretto, je ne suis pas même bien certain qu’il y ait dans ces quatre cents pages une seule anecdote scandaleuse. Décidément, ce n’est pas un livre d’actualité, et nos Athéniens du boulevard n’y trouveront pas le moindre grain de mil. Puisse du moins cet humble album d’un touriste lui valoir quelques amitiés excellentes comme la tienne. C’est toute la grâce que je lui souhaite.
A. L.
Paris, ce 25 avril 1866.
I. – Le jubilé d’Iéna
Il y avait au plus vingt-quatre heures que j’étais arrivé à Weimar et j’avais eu à peine le temps de goûter les premières douceurs de l’hospitalité allemande, lorsque je m’entendis répéter de toutes parts : « Que n’allez-vous à Iéna ? Iéna est en fête. L’Université va célébrer pour la troisième fois son jubilé séculaire. Vous n’avez que le temps de partir. » Quand on vient de parcourir près de trois cents lieues, il n’en coûte guère d’en faire quatre ou cinq de plus, surtout quand il s’agit de voir une Université qui a trois cents ans et une fête qui doit durer trois jours. Je consultai du regard mon compagnon de voyage. Il fut décidé sur-le-champ que nous irions à Iéna.
Munis de billets délivrés par l’administration de la poste, nous nous présentâmes à l’entrée de la cour d’où s’ébranlent chaque jour, dans cinq ou six directions différentes, les berlines monumentales du prince de Thurn et Taxis, grand-maître héréditaire des postes du saint empire germanique. Mais l’excès de l’encombrement avait été plus puissant que la régularité traditionnelle du service. Les carrosses noirs et orangés de l’administration étaient depuis longtemps épuisés et nous dûmes nous contenter d’un bout de planche fixée transversalement le long d’un chariot effilé, auquel on avait attelé des chevaux plus effilés encore. Évidemment, cet utile et modeste véhicule, bien que surmonté d’un berceau de feuillage et pavoisé aux couleurs nationales, sortait d’une grange voisine. C’était un surnuméraire faisant pour un jour les fonctions de chef d’emploi. En un clin d’œil ce char éminemment agricole n’en fut pas moins pris d’assaut, ainsi que tous ceux qui l’accompagnaient. La foule montait, montait, pacifiquement tumultueuse, dans ces omnibus par à peu près. Il y avait là des familles entières, de toutes les classes, dans tous les costumes, le visage épanoui, l’imagination en suspens, heureuses déjà avant d’avoir vu, très impatientes cependant de voir. L’affluence était telle qu’on eût pu supposer que la population tout entière de Weimar déménageait. Weimar n’était plus dans Weimar, mais bien sur le chemin d’Iéna. Les équipages improvisés au profit de la curiosité publique se suivaient sur la route comme les anneaux d’une chaîne sans fin qui aurait eu Weimar et Iéna pour points d’appui. D’un côté, fuyaient au grand trot les voitures vides, volant au secours des attardés et des différés. De l’autre s’avançaient à la queue l’une de l’autre les charrettes pleines jusqu’aux bords d’une fourmilière humaine. Cette longue émigration, défilant entre une double haie de peupliers mêlés de sorbiers, chantait, riait, criait, en dépit des cahots et des tourbillons de poussière. Enfin, sur le sommet de ce vaste plateau où Napoléon et Davout infligèrent, en quelques heures, une si rude leçon à l’ambition prussienne, Iéna apparut tout à coup au fond de la plus jolie vallée du monde, sur les rives verdoyantes de la Saale. À ce moment un long hurrah s’éleva de toutes les poitrines et les chapeaux s’agitèrent au-dessus de toutes les têtes. C’était à qui saluerait le mieux de la voix et du geste ce groupe de maisons aux tuiles brunes qu’on apercevait dans le lointain. Mais bientôt l’apparition s’enfonça sous terre, et nous commençâmes à descendre une interminable côte dont les sinuosités se déroulaient entre de hautes collines de marne et de chaux sur lesquelles des bouquets clairsemés d’arbres verts paraissaient avoir de la peine à se maintenir.
Au bas de la côte, les cris redoublèrent. Des bandes de promeneurs, venus d’Iéna à la rencontre de leurs amis et même un peu de tout le monde, examinaient les arrivants au passage avec une sorte d’avidité amicale, et les saluaient tous indistinctement de la main, du regard, de paroles hospitalières. Un arc de triomphe, flanqué de deux portes latérales, plus basses et moins larges, par où s’écoulait en sens inverse le double torrent des piétons, nous reçut pompeusement à l’entrée de la ville. Ce monument éphémère, chargé de souhaiter la bienvenue aux étrangers et de leur donner à l’avance une haute idée des pompes universitaires, était construit uniquement avec des branches et des pommes de sapin ou d’épicéa. La ville tout entière avait adopté le même genre de décoration végétale et odorante. Ce n’était partout que frais rameaux, que torsades de feuillage vert sombre, que guirlandes suspendues le long des murs et où les baies rouges du sorbier s’entremêlaient aux dépouilles des chênes. Toute une forêt avait dû être sacrifiée aux préparatifs de la fête et employée, sous toutes les formes possibles, à sa splendeur. Des deux côtés des rues principales, des arbustes résineux, ou tout au moins de fortes branches d’arbres de cette espèce, avaient été plantés sur une double ligne et figuraient une avenue naissante. De longs drapeaux attachés au faîte des maisons complétaient l’ornementation des façades avec des tapis de foyer encadrés de verdure et formant trumeau. Rien toutefois n’y attirait autant le regard que les médaillons entourés d’immortelles qui révélaient au passant le nom des hôtes célèbres de la maison avec la date de leur séjour. Que de grands souvenirs dans ces rues étroites ! Que d’éloquence dans ces simples et brefs écriteaux ! L’histoire de l’Université était là tout entière. Évidemment le grand siècle à Iéna, c’est la fin du siècle dernier. Les noms de Schiller, de Goethe, de Hegel, de Humboldt, de Tieck, de Kreutzer, de Winckelmann, de Kotzebue, de Savigny, et de tant d’autres, disent assez clairement quel encombrement de génie il y eut alors dans ce village. Parmi toutes ces maisonnettes de si humble apparence où travaille aujourd’hui quelque obscur artisan, il n’en est guère une qui n’ait reçu, à cette époque de crise politique et intellectuelle, les premières confidences de quelque esprit éminent promis à la gloire. Sur une petite place, je vis apposé au même mur l’écusson du père, du fils et du petit-fils, tous les trois successivement professeurs à l’Université. Les maisons d’Iéna, on le voit, ont aussi leur blason. Celle où nous envoya le comité chargé de loger les étrangers appartenait à un honnête cordonnier, ce qui ne l’empêchait pas de porter ses armoiries universitaires tout aussi fièrement que les autres. Après tout, aurait pu dire le compatriote et confrère posthume de Hans Sachs, l’humanité, pour marcher, n’a pas moins besoin de souliers que de savants, et une bonne paire de bottes la fait avancer quelquefois beaucoup plus que certaines doctrines.
Le jubilé avait commencé avant notre arrivée, dès cinq heures du soir, par l’entrée solennelle de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar-Eisenach. Comme on le pense bien, l’Université s’était portée en corps au-devant de son souverain, qui se trouve être en même temps son chef académique. Bien qu’en effet l’Université d’Iéna dépende à la fois de tous les princes de la Thuringe, elle a choisi tout naturellement pour RectorMagnificentissimus le grand-duc de Saxe sur le territoire duquel elle est établie et à qui d’ailleurs sa généalogie, non moins que son titre presque royal, confère une sorte de droit d’aînesse sur tous ses cousins du voisinage. Au compliment d’usage prononcé par le prorector, M. le Dr Luden, suivi des doyens des quatre Facultés et d’une foule compacte, avait succédé le remercîment de rigueur de la part du chef de l’État et de l’Université, et le cortège grand-ducal, réuni à celui des professeurs, s’était rendu au château en traversant la ville. Vers huit heures, le son des cloches et des détonations réitérées annoncèrent l’arrivée de la nuit qui allait rendre l’Université d’Iéna trois fois centenaire. En même temps, des feux follets se mettaient à errer de tous côtés sur les montagnes voisines, à la recherche les uns des autres, tandis que la Saale commençait à faire miroiter ses eaux vives à la clarté de la lune. C’étaient des étudiants invisibles en train d’organiser une illumination aussi féerique que possible. La vérité cependant est qu’un très petit nombre seulement avait eu assez de dévouement pour aller entretenir des feux de joie sur les hauteurs par une nuit aussi claire, et assez d’argent pour acheter la quantité de torches exigée par ce rôle de Vestales intérimaires. L’immense majorité de cette belle et tapageuse jeunesse était restée dans la ville, et remplissait déjà de chansons et de discours tout ce qui pouvait lui servir de lieu de réunion. Imaginez-vous des salles où la fumée empêcherait d’apercevoir les murs et permettrait à peine de distinguer confusément les têtes, puis, dans cette lourde et nuageuse atmosphère, des rangées de tables et de bancs parallèles encombrés d’étudiants en manches de chemise, avec peu ou point de cravate, une cruche de bière en bois blanc devant chacun d’eux, dans un coin un tonneau du même liquide à moitié défoncé et passé à l’état de fontaine perpétuelle, un orchestre de cuivres assis à une table spéciale, un feu de file de speechs et de toasts partant sans trêve ni répit de toutes les tables, les bravos frénétiques adressés aux orateurs, les silentium énergiques lancés aux interrupteurs, les trépignements à la fin des belles tirades, les chœurs au bout de certaines allocutions, une émulation infatigable à porter des santés à tout le monde et à choquer les petits seaux de bois blanc, les trompettes prolongeant à pleins poumons un trille victorieux assez analogue à une pâmoison indéfinie, et vous n’aurez encore qu’une faible idée de ces joyeuses assemblées de l’Allemagne de l’avenir, derniers souvenirs de l’Allemagne du passé. Il faudrait le burin d’un Callot ou le pinceau d’un Jordaens pour rendre, dans toute sa turbulence un peu grossière, ce tohu-bohu de blonds et impétueux adolescents aux heures nocturnes où la bière et l’éloquence coulent à flots pressés sur leurs lèvres, également altérées pour avoir déjà trop parlé et n’avoir pas encore assez bu.
Le jour enfin se leva, le véritable jour de la fête. C’était un dimanche. Dès neuf heures et demie, les députations appelées à figurer dans le cortège, après s’être réunies une à une dans la nouvelle bibliothèque, se mettaient en marche vers l’église. Assaillis par une averse malencontreuse, invités et professeurs durent marcher bravement au sermon sous une pluie battante. De minute en minute, l’eau tombait plus dense et plus froide, sans rompre les rangs de la procession ni décourager la curiosité de la foule. Une musique d’amateurs ouvrait la marche plutôt qu’elle ne la réglait. Puis venaient les élèves des pensions et du gymnase, marquant le pas en cadence comme de vieux troupiers. Les étudiants formaient le corps de bataille. Chaque Université de l’Allemagne avait envoyé sa députation, chacune des Associations locales s’était fait un point d’honneur de se trouver là au grand complet, si bien que les groupes et les drapeaux se succédaient les uns aux autres sans qu’on en pût voir la fin. D’une main, le senior tenait l’étendard de soie brochée, et de l’autre, son épée levée. Les simples Burschen se serraient autour de lui en grand costume. Sur un grand et robuste jeune homme de vingt à vingt-cinq ans, généralement peu élégant et presque inévitablement blond, placez par la pensée une petite toque en velours ou en drap soutachée d’arabesques en filigrane et retenue en arrière par une ganse élastique qui se perd dans les cheveux, supposez-lui de plus une veste trop longue ou une redingote trop courte, comme il vous plaira, en velours noir et ornée de brandebourgs sur la poitrine, une écharpe multicolore nouée en travers, un pantalon blanc à moitié absorbé par des bottes montantes, des éperons sonores et une flamberge munie d’une coquille lourde et disgracieuse : voilà l’étudiant allemand en habit de gala. Le vulgaire, sans doute, ne comprend pas bien au premier abord pourquoi il est d’usage de se déguiser ainsi en Fra Diavolo quand on n’a d’autre ambition que celle de commenter plus tard avec onction saint Luc ou saint Matthieu devant des paysans endimanchés, ni pourquoi il est absolument indispensable de traîner plusieurs années un sabre sur les pavés d’une petite ville avant d’arriver à faire charrier en temps opportun du fumier sur les terres d’une grande ferme. Mais ce sont là de ces mystères que le sage ne songe point à approfondir de peur de ne pas rencontrer la sagesse au bout de ses recherches. Ces accoutrements d’opéra-comique avaient du moins le mérite de faire la part de la fantaisie et d’égayer le coup d’œil. La longue colonne mouvante de savants à lunettes d’or qui formait comme le second tome du défilé ne se faisait plus remarquer que par la monotonie uniforme de ses redingotes et de ses habits noirs. Les hauts fonctionnaires de l’Université portaient seuls le béret et la pèlerine de velours écarlate, qui sont les insignes de leur dignité. Les palmes vertes de l’Institut de France désignaient également à l’attention publique le Nestor de l’érudition parisienne, le docte et vénérable M. Hase, qui n’avait pas voulu manquer une si belle occasion de revoir son pays natal et de se retrouver pour un jour au milieu de ses vieux camarades du gymnase et de l’Université. Bien d’autres étrangers que lui avaient aussi répondu à l’appel qui leur avait été adressé, et, de tous les points du monde civilisé, étaient venus honorer de leur présence, en ce jour mémorable, l’antique forteresse des idées luthériennes. M. de Humboldt, il est vrai, n’avait pas pu quitter Berlin, mais M. Böckh représentait à sa place la Prusse scientifique. Un prince russe avait apporté de Saint-Pétersbourg, en guise de cadeau, des lettres inédites de Lavater. La Suisse, la Hongrie avaient également envoyé des députés et un souvenir. Un peloton de soldats weimariens formait l’arrière-garde, et ajoutait à l’éclat de la procession académique un peu terni par la pluie les reflets incertains de leurs armes bien fourbies et de leurs casques à flamme de cuivre.
L’église était bien étroite pour contenir à la fois tant de générations d’anciens disciples de l’Université et tant de curieux accourus de tous les coins de l’Allemagne. Aussi fallut-il s’y serrer les coudes, malgré la chaleur accablante de cette journée orageuse, pour entendre le discours de M. Schwartz. Les cérémonies religieuses une fois terminées, étudiants, professeurs, délégués et fonctionnaires se remirent en ordre de bataille pour se transporter jusqu’à la place du marché, où il s’agissait d’inaugurer la statue de Jean-Frédéric, électeur de Saxe et fondateur de l’établissement universitaire d’Iéna. Nous aperçûmes bientôt en effet, au milieu d’un large vide entouré de maisons, un grand fantôme vêtu d’un drap blanc et agitant d’une main qu’on ne voyait pas un long glaive doré. Cette énigme en calicot, posée sur un piédestal de pierre, provoquait à l’avance la plus vive curiosité parmi la multitude de têtes qui garnissaient les fenêtres à tous les étages, et dont la plupart se trouvaient naturellement encadrées dans des décorations de verdure. Les toits eux-mêmes étaient transformés pour le moment en bivouacs. Sur la place, une tente couverte avait été réservée au grand-duc, à sa famille, à sa cour, aux professeurs et aux invités de première classe. Deux autres tribunes latérales et découvertes s’ouvrirent également aux députations privilégiées, et bientôt la chaire, érigée en plein air et tendue de draperies, n’attendit plus que l’orateur chargé de prononcer l’éloge de Jean-Frédéric.
Ce fut M. Seebeck, curateur de l’Université, c’est-à-dire représentant officiel des princes qui contribuent de leur bourse à sa prospérité, ce fut M. Seebeck, dis-je, qui vint l’occuper. Panégyriste et historien tout à la fois, M. Seebeck rappela les exploits de ce glorieux athlète du protestantisme naissant qui, vaincu à Mühlberg par les troupes impériales, s’empressa, le 15 août 1558, d’instituer une Université à Iéna pour remplacer celle de Wittenberg, enlevée aux disciples et à la défense des idées nouvelles par les succès militaires de Charles-Quint. Devant un auditoire protestant, le sujet, on le voit, prêtait à l’éloquence. La péroraison fut saluée par des salves d’applaudissements justement dues à la vaillance de l’électeur et au talent de M. Seebeck, et, immédiatement, comme pour remercier l’orateur et le public de leur admiration rétrospective, la statue fit tomber son manteau blanc. L’imposante figure de Frédéric le Magnanime apparut alors à la foule dans toute sa majesté. Assurément ce n’était point une femmelette que ce Jean-Frédéric, et la nature, qui l’avait doué d’une âme énergique, avait eu soin de mettre cette âme dans une robuste et solide enveloppe. Tout grand homme qu’il était, ce n’en était pas moins avant tout un gros homme, et, si je ne craignais de commettre un crime de lèse-majesté posthume, je dirais même qu’il y avait quelque chose du rhinocéros dans ce belliqueux ami de la réforme religieuse et de la libre pensée. Au reste, la plupart de ses contemporains ont aussi cette encolure massive et ces airs de colosse. Voyez Luther, voyez n’importe quel portrait de Cranach ou de Holbein ; presque toujours ce sont des têtes à peu près entièrement rondes, d’une ossature vigoureuse, opulentes en chair et plantées sur un cou puissant qui s’élargit sur de vastes épaules. Le seizième siècle, le siècle par excellence des fortes convictions et des caractères héroïques, n’a guère produit un autre type. M. Drake eût donc été impardonnable de ne point respecter une vérité historique aussi irrévocablement constatée, et de s’inquiéter outre mesure du reproche de n’avoir pas donné un pendant à la baigneuse de Falconet dans la personne de ce formidable porte-glaive vêtu d’une longue robe féodale et dont la barbe s’épanouit librement sur une ample poitrine. Telle fut sans doute aussi l’opinion du successeur de Frédéric le Magnanime, du grand-duc de Weimar, car M. Drake fut décoré de sa main sur le champ de bataille, non pour avoir détruit un grand nombre de ses semblables, mais tout simplement pour avoir fait revivre par son art l’un des plus illustres parmi ceux du seizième siècle.
Une fois cette résurrection solennelle accomplie, la foule se répandit dans les rues en quête d’un dîner trop longtemps différé au gré de son estomac. Il n’avait pas fallu moins qu’une fête aussi exceptionnelle pour faire oublier à tant de braves gens du village ou de la campagne l’heure immuable du dîner germanique. Quant aux convives de l’Université, au nombre desquels se trouvait le grand-duc, ils ne se mirent à table dans sa Bibliothèque qu’après que la population des hôtelleries eut avalé sa dernière bouchée de rôti et commencé à déguster son café mal sucré. C’est qu’aussi l’Université avait tenu à ce que ses hôtes ne remportassent d’Iéna que des souvenirs gastronomiques de la nature la plus agréable, et les chefs-d’œuvre culinaires, comme tous les chefs-d’œuvre du monde, exigent de longs préparatifs. S’il eût été besoin de prouver que l’Allemagne est l’un des premiers cordons bleus de l’Europe, il est certain que le chef des cuisines de l’Université d’Iéna eût ce jour-là clos la bouche à ses adversaires par des arguments les plus substantiels et les plus variés du monde. Gargantua eût estrangement écarquillé les yeux et fait claquer les mâchoires à la vue des pâtés, des jambons, des entrées, des rôtis, des poulets, des gigots, des lièvres, des perdrix, des légumes, des tourtes que l’inépuisable et heureux Vatel lançait incessamment du fond de ses grottes souterraines et du milieu de ses jeunes collaborateurs, justement alléchés par l’odeur de ces mets préparés, hélas ! pour d’autres avec tant de sollicitude. Toute l’arche de Noé, mise à la broche et à la casserole, passa sur la table en bon ordre. Tour à tour on vit apparaître, après le potage léger dans lequel nagent des milliers de grains de fécule ou flottent quelques tubes de macaroni, les petits pâtés à la romaine, les tranches de bœuf flanquées de pommes de terre et de concombres au vinaigre, le poisson bouilli entouré d’herbes aromatiques, le quadrille de menus plats dont il s’agit de ranger avec art les échantillons aux quatre coins de son assiette, le ragoût savant où les écrevisses surnagent sur des flots de sauce poivrée, comme les Tritons et les Naïades dans les bassins de Versailles, le rôti superbe traînant après lui tout un état-major brillant de compotes de toutes les nuances et de salades d’un beau vert, enfin le pouding, couronnement de l’édifice, baba monstrueux bourré de raisins de Corinthe, éponge délectable et nourrissante qui appelle impérieusement après elle, outre les présents de Bacchus, les produits digestifs, mais de mauvaise odeur, de l’Helvétie contemporaine.
Tour à tour aussi on vit défiler sur la table les meilleurs crus de la vallée du Main et de la Saale, ces vins clairs et limpides, à peine nuancés d’une teinte d’or pâle, et qui, en tombant sous la forme de globules mignons dans la coupe colorée en rose ou en vert, reproduisent l’image en miniature de la grappe dont on les a exprimés. Puis arrivèrent les vins mousseux et pétillants, enfouis jusqu’au col dans des seaux de glace, et en un clin d’œil, de la Thuringe, on se trouva transporté en pleine Champagne. Alors commença la partie oratoire du banquet. De temps à autre, l’un des assistants se levait au milieu du bruit des conversations, et prononçait un discours dont la brièveté extrême faisait valoir encore davantage les intentions aimables. La conclusion obligée « Dreimal Hoch » était accueillie par un concert instantané de « Hoch, Hoch, Hoch », partis simultanément du fond de toutes les poitrines. Puis les verres de se heurter et de se vider bien vite comme en signe d’adhésion au vœu exprimé et d’accord parfait avec toutes les personnes voisines. Quand le prorecteur de l’Université, après un court et libéral éloge de la branche Ernestine de la maison de Saxe, porta un toast au grand-duc de Weimar en qui elle se personnifie aujourd’hui, les manifestations redoublèrent d’entrain, et l’assemblée entière, se levant d’un élan unanime au bruit du choc cristallin des verres, dirigea de respectueux et sympathiques regards vers Charles-Alexandre, le petit-fils de Charles-Auguste.
Un Fackelzug était annoncé pour le soir. Le Fackelzug, qui a sa place marquée à l’avance dans toute fête universitaire, est tout simplement une promenade non pas aux flambeaux, mais bien aux torches. Il va sans dire que les promeneurs sont des étudiants. Le rendez-vous avait été pris pour huit heures du soir, sur la place du Marché au bois. Avant l’heure indiquée, quelques bons vieillards, bûcherons ou appariteurs, tenant en main un faisceau de torches, les allumaient lentement les unes après les autres à deux ou trois foyers de résine enflammée. Les vrais acteurs de l’illumination ambulante qui se préparait arrivèrent peu à peu par bandes de cinq ou six amis, les uns avec leur justaucorps de velours noir et une plume double au sommet de leur Mütze,1 ce qui leur donnait parfois un faux air de hanneton faisant mouvoir ses antennes, les autres avec une simple casquette bordée d’un liseré de nuance claire et un vieil habit prudemment retourné de peur des taches et des brûlures, ceux-ci le sabre levé et le fourreau traînant, ceux-là un tartan gris jeté sur les épaules et une lanterne vénitienne à la main. On se forma par escouades, le senior en tête et le drapeau au vent, et l’on se mit en marche vers le château, après avoir entonné la Marseillaise épicurienne des Universités allemandes :
Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus.
Une musique aigre-douce précédait cette joyeuse armée de lampadaires et soutenait les chœurs en frayant le chemin. Il faisait vraiment beau voir ces centaines de jeunes gens, portant sur l’épaule leur torche de rechange déjà garnie par le bas d’un petit carré de carton en guise de bobèche, et secouant de l’autre main des gerbes de flammèches et des traînées d’étincelles. Le passage de chaque détachement projetait une lumière rougeâtre sur les visages radieux des philistins indigènes ou exotiques et faisait passer des clartés fantastiques sur les façades des maisons enguirlandées. Sous les fenêtres du château on fit halte, et un salut du grand-duc répondit à la démarche dont sa personne était l’objet. Avant de revenir à son point de départ, la longue file de candélabres vivants parcourut le plus de rues qu’elle en put trouver dans Iéna. Du haut du Fuchsthurm on eût pu croire la ville enlacée et dévorée à l’intérieur par un serpent de feu. Il fallut toujours bien cependant finir par arriver à la grande place, si forte envie qu’on eût de l’éviter. Là, les torches à demi consumées volèrent dans les airs à la façon de fusées, traçant des demi-cercles de flamme dans le vide noir de la nuit. Tant bien que mal ces brandons résineux retombaient à côté les uns des autres sur le milieu de la place, et formèrent bientôt une mer de lave brûlante qui se mit à couler sur les pavés. Et plus fort que jamais le chœur répétait les strophes du vieux chant :
Pereat tristitia !
Pereant osores !
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores !
Il n’y a point de grande fête sans lendemain. Celle d’Iéna avait même un surlendemain. C’est que l’enthousiasme en Allemagne n’est pas affaire d’un jour ou d’une heure. Lorsque d’ailleurs une fête ne revient qu’une fois par siècle, il est bien juste qu’elle dure un peu plus de vingt-quatre heures : à cet égard Aristote n’a point laissé de règles. Le lundi donc, le discours latin fit enfin son apparition dans le jubilé, comme un hôte en retard, mais de la venue duquel personne n’avait désespéré. Après que M. Göttling eut raconté dans la langue de Cicéron l’histoire de l’Université, et qu’on eut exécuté une partie de la seconde messe en musique de Liszt, sous la direction même de l’illustre maître de chapelle de Weimar, les verres à vin et les brocs de bière s’emplirent de nouveau pour se vider de plus belle, et, comme la veille, on eût cru assister aux noces de Gamache célébrées par une foule de Girondins en herbe. En somme pourtant, ce lundi fut plutôt un intermède qu’un acte véritable dans cette grande pièce en trois journées. C’était le mardi, à la suite des promotions au doctorat d’honneur faites par les quatre Facultés, que la fête devait prendre un caractère et un intérêt tout nouveaux.
Cette troisième journée, en effet, n’appartenait plus au corps enseignant : c’était la journée des étudiants. L’étudiant d’Iéna n’est point en Allemagne le premier étudiant venu. Pour attirer au pied des chaires de leur Université le plus grand nombre d’étudiants possible, les petits princes de la Thuringe ont été obligés de tout temps d’y tolérer bien des privilèges, et souvent même bien des abus de la vie académique, si bien que l’esprit de liberté, ou de licence, si l’on veut, n’a guère cessé de souffler sur cette aimable vallée. Ainsi ce fut à Iéna que s’organisa après les guerres de l’Empire cette vaste association de jeunes gens connue sous le nom de Burschenschaft et qui se pourrait assez bien définir la conscription universitaire de l’armée du progrès. Ce fut Iéna qui envoya à la Wartburg cette bande d’étourneaux politiques dont l’autodafé bibliographique ne servit qu’à déchaîner une tempête réactionnaire contre le parti libéral. Ce fut enfin d’Iéna que partit Karl Sand pour assassiner Kotzebue. Ces souvenirs, plus souvent néfastes que glorieux, n’en ont pas moins fondé une tradition durable parmi la jeunesse studieuse de l’Université, et la Burschenschaft, tout en célébrant l’institution de l’électeur de Saxe, tenait à profiter de l’occasion pour rappeler au monde germanique son existence et son passé. Telle était la pensée de la bruyante réunion qui, sous le nom de Commerz, eut lieu en plein air le dernier jour de la fête, et qui ne comptait guère moins de deux mille personnes. On avait espéré y voir apparaître le célèbre étendard de la Burschenschaft, soustrait prudemment depuis 1848 à la curiosité de toutes les polices de l’Allemagne. Mais le dépositaire inconnu de cette précieuse relique avait jugé sans doute plus sage d’attendre encore avant d’ouvrir de nouveau ses plis au souffle des chants patriotiques et des acclamations enthousiastes. Le fait est que cette tête de Méduse de feue la sainte Alliance ne parut point. Je ne sais si ces agapes fraternelles et oratoires ont reçu le nom de Commerz parce qu’il s’y fait de la part des étudiants un grand commerce d’amitié ou bien parce qu’elles donnent lieu à un énorme commerce de comestibles et de liquides. Ce qu’il y a de certain, c’est que de harangues en rasades et de rasades en harangues, l’assemblée resta attablée jusqu’à la nuit close et au delà, soulevant en même temps les questions les plus brûlantes et les pots de bière les plus lourds, tout entière en un mot aux grands intérêts du pays et au plaisir de boire frais. De temps en temps, au bruit des chansons et en vertu d’une tradition assez bizarre, un grand coup de rapière perçait l’une de ces charmantes petites calottes en velours brodées de passementeries d’or et d’argent, qui sont outre Rhin le signe distinctif de toute tête soumise à la culture universitaire. Deux fois le grand-duc, accompagné du prince héréditaire, parut au milieu de ce congrès de buveurs et fit le tour des bancs, en plaçant çà et là la faveur d’une parole aimable ou d’un geste poli. La lumière électrique projetée à rayons continus sur la scène acheva de donner toute latitude à l’éloquence attardée des derniers improvisateurs.
On se sépara définitivement le jour suivant, ravi du bonheur de s’être revu ou heureux simplement de s’être entrevu, l’esprit rempli d’excellents souvenirs et le cœur effleuré par l’aile des regrets agréables. Pendant quelques semaines encore, les échos des discours prononcés se répercutèrent à travers toute l’Allemagne, les comptes rendus et les vers inondèrent les gazettes publiques, les diplômes d’honneur accordés par l’Université arrivèrent à leurs heureux destinataires, des décorations parties de toutes les chancelleries de l’Europe se rencontrèrent dans le coffre de la voiture postale d’Iéna, en un mot des félicitations et des remercîments de toute espèce se croisèrent en tout sens, et il fallut un mois entier au moins pour calmer l’émotion produite. À l’heure qu’il est, Iéna a depuis longtemps repris son paisible sommeil à l’ombre des aulnes de la Saale. Le jubilé n’est plus qu’un souvenir pour la génération présente, en attendant qu’il redevienne une espérance pour une génération future. Puisse encore, en 1958, le Français amené par le hasard au milieu de ces grandes assises de la science germanique y admirer, comme nous l’avons fait, la plupart des vertus qui sont l’apanage ordinaire des peuples jeunes, j’entends par là ce culte du passé, cette foi confiante dans un grand avenir, ce sérieux général, cette participation spontanée des classes populaires à une fête de savants, cette cordialité ingénue des mœurs et des hommes, cette simplicité ordinaire en toute chose, ces sentiments de fraternité, ce calme habituel de l’âme qui lui rend l’enthousiasme plus facile, tout ce dont, enfin, j’ai eu la douce surprise et le mémorable spectacle à Iéna en 1858 !
II. – La forêt de Thuringe
Ce n’est pas seulement à Iéna et à Weimar, c’est à vingt lieues à la ronde, depuis Cassel jusqu’à Leipzig, qu’une excursion à travers la forêt de Thuringe est devenue l’une des distractions les plus ordinaires, je dirai même l’une des plus indispensables de chaque automne. Donnez à un étudiant ou à un fonctionnaire trois jours de congé : vous pouvez être assuré à l’avance que l’un aussi bien que l’autre n’aura rien de plus pressé que de décrocher son bâton de voyage et de partir d’un pied léger pour cette antique et mystérieuse retraite où semble encore errer aujourd’hui l’âme de l’Allemagne féodale. Sans doute le plaisir hygiénique de la locomotion pédestre et méditative, le besoin de changer d’air et de milieu, l’espoir de rentrer au logis à la fois plus robuste et plus dispos au travail figurent toujours au nombre des raisons décisives de ce pèlerinage pittoresque. Il n’en est pas toutefois de plus puissante ni de plus générale que l’amour exceptionnel et vraiment touchant de l’Allemagne pour les muettes beautés de ses grands bois, que son attachement instinctif et presque religieux pour ces vivantes solitudes où le faible bruit d’un pas humain vient si rarement se perdre dans l’étendue indéfinie de plantations séculaires.
Cette intelligence mélancolique et subtile de la nature forestière dont la race germanique semble avoir le privilège, que de fois les lettres et les arts n’en ont-ils pas donné la preuve chez elle ! Avec quelle bonhomie épique Beethoven ne décrit-il pas le silence solennel qui se fait dans le calme des bois au moment où le coucou jette son cri monotone aux échos d’alentour ! Avec quelle pénétration exquise Weber ne réussit-il pas à tirer de la profondeur même de ce silence les plus suaves mélodies et des accents d’une indicible et si pure tendresse ! Feuilletez les poètes, les romantiques par exemple, Uhland, Novalis, Tieck ; partout vous rencontrerez chez eux, exprimée avec une précision aussi originale, l’image embellie, quoique sincère, de la vie obscure en pleine forêt, le bûcheron matinal qui lance joyeusement ses coups de cognée à travers la tige squameuse des pins, le chasseur ou le garde au collet vert qui suit tranquillement, la carabine sur l’épaule, la lisière de son district, l’intrépide mineur qui fait ses adieux au beau soleil avant de s’enfoncer sous terre à la poursuite d’un filon précieux. Tandis que la poésie française du dix-huitième siècle errait encore, Horace à la main, dans les bocages chers à Chloé, Goethe, en une heure de tristesse inspirée, écrivait, du haut de l’une des cimes qui environnent Ilmenau, huit vers sublimes, immortels, intraduisibles et inimitables, qui sont l’une des perles les plus fines de la poésie allemande. Cela n’est rien, et cela pourtant contient toute une âme, une âme rêveuse qui s’envole prématurément, au-dessus de l’immensité boisée, vers le repos éternel. Ajoutez que ce don d’émotion et d’intimité, que cette influence sympathique peut, dans certains cas, s’élever à la hauteur d’une passion maladive, et conduire de la folie jusqu’au crime. Il y a quelques années, à Pfalzheim, dans le Palatinat, un bourgmestre avait eu l’impiété d’abattre une avenue de tilleuls, une avenue de ces beaux arbres dont les fleurs rendent la santé et dont la feuille affecte la forme d’un cœur. Quelques jours après la profanation accomplie, un jeune homme de bonne mine se présente chez le bourgmestre, demande à lui parler, et, sans le moindre préambule, lui tire un coup de pistolet à bout portant. Interrogé sur-le-champ, il répondit qu’il avait voulu venger l’avenue de tilleuls. Ce ne sont pourtant pas les tilleuls qui menacent de manquer à l’Allemagne, pas plus au reste que n’importe quelle autre essence d’arbres. Plus d’un cinquième de la Prusse, un quart de l’Autriche, un tiers du Württemberg, quatre dixièmes des duchés de Nassau et de Meiningen appartiennent encore à la sylviculture. Peut-être même, au contraire, l’importance exceptionnelle du régime forestier outre Rhin expliquerait-elle mieux que toute autre considération l’espèce de piété publique qui attache si visiblement l’Allemagne moderne à tout ce qui lui reste des vieilles forêts de la Germanie. Grâce, en effet, à son extrême abondance, le bois est employé par elle à mille usages que nous soupçonnons à peine. Le même sapin, qui sert à chauffer les locomotives sous forme de bûches résineuses, se transforme à volonté en charpente et en murailles légères pour devenir un gracieux chalet. Mettez-le entre les mains d’un ébéniste, il se métamorphosera en meubles élégants et commodes. Coupé à l’état d’arbuste, il décorera les rues les jours de fête, et la veille de Noël apparaîtra au milieu de la famille assemblée comme un messager chargé des présents du Christ. C’est donc un peu le bienfaiteur, presque l’ami de tout le monde, et il y aurait en vérité quelque ingratitude à ne pas sentir la poésie secrète des lieux tranquilles où ce serviteur pour tout faire, ce Caleb qui est en même temps un Protée, croît par troupes innombrables dans une paix profonde.
Parmi les diverses régions forestières qui sont en possession, depuis des siècles, de fournir un aliment constant à ce besoin de contemplation affectueuse et émue de l’Allemagne, il n’en est peut-être pas une qui invite l’esprit à un recueillement plus sympathique que la forêt de Thuringe, ou qui soit plus propre à produire par ses grands spectacles et ses mœurs rustiques une sorte de purification intérieure chez tous ceux qui l’abordent avec respect. Si vous consultez tout d’abord la géographie sur son compte, la forêt de Thuringe est une chaîne de montagnes d’environ dix myriamètres de long sur vingt-cinq kilomètres de large, dont les anneaux se déroulent depuis la vallée de la Saale à l’est jusqu’à la vallée de la Werra à l’ouest. Mais comme la nature s’est plu à jeter une nappe continue de verdure éternelle sur les ondulations de ces hautes collines, la langue populaire a transformé en une forêt la chaîne de montagnes. Un poète pourrait encore la définir une agrafe d’émeraude qui réunit le Rhöngebirge, c’est-à-dire la région orographique de la Hesse située au delà de la Werra, au Fichtelgebirge, c’est-à-dire à la partie montagneuse de la Franconie située au delà de la Saale. Cette enfilade de monts et de monticules juxtaposés ne suit pas toutefois une direction absolument droite. Vers le milieu, au lieu de continuer à courir directement de l’est à l’ouest, elle se relève doucement vers le nord-ouest pour aller se perdre aux environs d’Eisenach dans la plaine immense de l’Allemagne septentrionale. Lorsqu’on est à Gotha, qui se trouve à peu près au centre de cet arc de cercle, on peut assez bien se rendre compte, en présence du lointain hémicycle de hauteurs azurées qu’on découvre à l’horizon, de cette disposition topographique de la forêt de Thuringe. Pour le touriste qui chemine à pied et pour qui toutes les routes sont bonnes, surtout les mauvaises, il y a au reste un moyen extrêmement simple d’en bien comprendre la configuration générale. Un chemin, vieux comme la forêt, et qu’on appelle soit le Rennweg, soit le Rennsteig, la parcourt dans toute sa longueur de Rudolstadt à Eisenach, en suivant toujours les sommets les plus élevés. C’est, en quelque sorte, l’épine dorsale de ce système vertébré de hauteurs parallèles. Quand on parcourt en effet de l’œil, sur la carte, ce cordon longitudinal de sentiers plus ou moins effondrés, on voit de droite et de gauche toutes les petites vallées de la forêt descendre, l’une après l’autre, vers la plaine. On est donc là visiblement sur l’arête culminante qui sépare deux bassins hydrographiques et du haut de laquelle deux rangées de ruisseaux s’enfuient, en se tournant le dos, jusqu’à la mer du Nord, où les apportent de la Thuringe le Rhin, le Weser et l’Elbe.
Grâce à cette ligne de partage des eaux qui a l’avantage ici de n’être pas simplement une ligne idéale, on peut par la seule pensée embrasser facilement à vol d’oiseau l’ensemble de la forêt de Thuringe, et être sûr à l’avance de ne pas s’y perdre plus d’une demi-journée. Toutefois, en arrivant à Rudolstadt, qui devait être le point de départ de mon excursion, et où j’avais eu soin de n’arriver que par une limpide après-midi de septembre, je m’étais bien promis de ne profiter de ce curieux vestige des ponts et chaussées du moyen-âge que comme d’un fil d’Ariane pour me retrouver au besoin dans le labyrinthe des montagnes bleuâtres dont j’avais déjà devant moi les premiers contreforts, plus sablonneux et beaucoup moins bien boisés que je n’aurais supposé. Avant tout, j’avais entendu me réserver cette liberté des zigzags, de laquelle seule peuvent naître les émotions de l’imprévu, et je comptais bien tirer à ma guise de capricieuses bordées sur cet océan de verdure, partout où m’attirerait une ruine ou une légende, un panorama renommé ou une curiosité minéralogique.
Ma première étape en partant de Rudolstadt devait être Schwarzburg. Schwarzburg est une Burg, c’est-à-dire un château bâti sur les bords de la Schwarza et qui sert de résidence d’été au souverain de la principauté de Schwarzburg-Rudolstadt. Soit dit en passant, la Burg germanique, qui, dans les provinces rhénanes, prend plus volontiers le nom de Pfalz, est l’équivalent assez exact de l’alcazar espagnol. Un promontoire de rochers ou un tertre gazonné, voilà la principale différence imposée par la géologie aux architectes de ces donjons gothiques. La vallée tournante qu’on remonte pour arriver à Schwarzburg ne manque pas d’une certaine sauvagerie. Représentez-vous une grand-route et une rivière torrentueuse qui se côtoient entre deux pentes abruptes, deux plans inclinés le long desquels pullulent du haut jusqu’en bas des flèches de pins ou d’épicéas, puis au-dessus de cette double étagère de pointes verdoyantes la large bande d’azur du ciel : voilà, pendant deux bonnes heures de marche, tout le paysage. Sans les mille voix irritées ou plaintives de la petite rivière qui de pierre en pierre et de chute en chute se tord convulsivement sur son lit de roc, nul murmure ne viendrait troubler le silence solennel de l’air. Quelques roches feuilletées, d’une nature schisteuse et d’une nuance qui varie entre le gris et le bleu, distraient seules çà et là le regard. Puis, soudain, ce défilé s’élargit des deux côtés, et le voyageur étonné s’arrête à l’entrée d’un cirque à peu près régulier de collines chargées de magnifiques futaies de hêtres, et dont le fond est tout entier tapissé de prairies. Du milieu de ces prairies un mamelon s’élève, comme le renflement inférieur d’une bouteille, portant fièrement un manoir féodal : c’est Schwarzburg.
Conformément aux recommandations qui m’avaient été adressées, je me mis à gravir le versant boisé de droite jusqu’à un petit pavillon d’écorce appelé Trippstein et qui, de l’avis de tous, est l’endroit le plus favorable pour bien goûter cette symphonie végétale en vert majeur, exécutée par d’innombrables chœurs d’hamadryades invisibles. Rien de plus frais, de plus calme, de plus harmonieux, en effet, que cette perspective onduleuse, ce tapis vert sans fin où le velours tendre des gazons alterne seul avec l’épaisse moquette des forêts. La vie elle-même semblait s’être retirée de ce suave et paisible tableau, comme pour laisser toute la place au verdoiement indéfini de l’espace. Cependant, je pouvais encore distinguer sur les pelouses voisines des taches fauves qui se levaient de temps en temps pour disparaître un instant après sous les grands bois déjà imperceptiblement jaunis par les premiers feux de l’automne : autant de taches, autant de cerfs, de daims ou de chevreuils. Plus au loin, le tintinnabulum argentin des clochettes suspendues au col des troupeaux révélait encore çà et là les mouvements cachés d’êtres animés, et jetait une grâce de plus dans la paix de l’étendue. Enfin, quelques maisonnettes groupées au pied du castel seigneurial, sur le bord de la rivière, annonçaient aussi, non sans produire une certaine surprise, la présence de l’homme dans ce désert de verdure, d’où montait jusqu’à moi une sensation inexprimable de fraîcheur et de quiétude.
Ravi et reposé, je descendis lestement le sentier qui conduit de cet observatoire si justement vanté jusqu’au château. Je n’oubliai pas en passant de m’assurer d’une chambre à l’auberge du Cerf, dont la bonne mine et la façade nouvellement blanchie à la chaux me promirent tout de suite bon souper et bon gîte. Un vétéran des armées de terre de Schwarzburg-Rudolstadt consentit de la meilleure grâce du monde à me faire les honneurs du manoir où, en qualité de porte-clefs, il se repose des longs travaux de la guerre. Il y a dans ce manoir qui fut celui d’un empereur d’Allemagne, de l’empereur Gunther, et qui n’est plus guère qu’un pavillon de chasse, il y a entre ces murailles, un peu moisies et assez tristes, une multitude de portraits en pied, la lance au poing et le casque en tête, des armures, des panoplies, une immense collection de bois de cerfs fixés aux lambris, mais rien qui sente le luxe ou qui paraisse moderne. Le goût de la chasse et le culte des ancêtres, voilà les deux passions que l’ameublement de ces longs corridors et de ces hautes salles trahit chez le maître du logis. Au moment où je sortais, un beau vieillard à moustache grise descendait dans la cour d’honneur d’une sorte de cabriolet à deux chevaux et jetait les rênes à un domestique : c’était justement le prince. Depuis, cet alerte sexagénaire a contracté une alliance morganatique avec une jeune fille d’une condition bourgeoise. Les petits princes se marient quelquefois de la main gauche : les grands princes n’épousent bien souvent que de la troisième.
Il y avait à l’auberge du Cerf une réunion nombreuse et fort animée. Les longues bouteilles de verre jaunâtre se dressaient pêle-mêle sur des nappes d’une irréprochable blancheur, à peu près comme les pièces d’un jeu d’échec vers la fin de la partie. Les beefsteaks accommodés aux oignons brûlés fumaient dans des assiettes de faïence indigène, à côté des truites pêchées dans les eaux claires de la Schwarza et accompagnées d’un renfort substantiel de pommes de terre bouillies. L’appétit ne faisait aucun tort à la conversation. Les mots wunderschön, bildschön, bezauberndschön, prachtvoll, wie niedlich, nein, zu reizend, toutes les formules en un mot de l’enthousiasme allemand volaient de bouche en bouche. Les jeunes gens, époux ou fiancés, se souriaient et se pressaient la main, sans s’inquiéter du qu’en dira-t-on ou des regards jaloux. Les mères attentives partageaient équitablement entre Röschen, Gretchen, Lottchen, Paulchen, Karlchen, Fränzchen et tutti quanti les tartines délicates de pain bis, tandis que le père, tout entier à ses préoccupations de chef de caravane et de sergent-fourrier, demandait à l’hôtelier, amicalement interpellé, des renseignements pour le dîner et le coucher du lendemain. Il ne restait aux touristes solitaires d’autre consolation que de chercher à démêler tout seuls leur itinéraire futur parmi l’écheveau embrouillé des petites raies noires qui, sur les cartes des guides, figurent les chemins et les sentiers.
Un bruit sec de bois entrechoqué et de chutes pesantes ne tarda pas à me faire relever la tête. À quelques pas de la porte d’entrée, je trouvai un jeu de quilles installé à la lumière de quelques quinquets sous un long hangar, et le village assemblé tout autour. Le Kegelspiel est pour les Allemands juste ce que le cricket est pour les Anglais, une distraction essentiellement nationale. Ce qui s’abat de quilles outre Rhin en une saison effraierait même un professeur de calcul infinitésimal. Chaque jeu de quilles se compose de huit paysans et d’un roi, tant il est vrai que le principe monarchique se retrouve partout en Allemagne. Cette monarchie en petit est mise d’aplomb sur ses neuf pieds à l’extrémité d’une galerie couverte et bien sablée, dont le milieu seul est occupé par un madrier soigneusement raboté. Une sorte de gouttière en bois, placée contre le mur à hauteur d’appui et doucement inclinée, complète le matériel de la salle de jeu et sert à ramener à leur point de départ, c’est-à-dire entre les mains des joueurs, les grosses boules en bois que recueille un éphèbe rustique en sentinelle auprès des quilles. Il s’agit, je ne l’apprendrai à personne, d’en abattre le plus possible avec trois ou quatre boules consécutivement lancées. Le secrétaire de la partie inscrit les points de chacun sur une ardoise, avec la scrupuleuse exactitude d’un teneur de livres, si bien que ce jeu, excellent pour fortifier la poitrine, ne l’est pas moins pour apprendre l’arithmétique. On joue à décompter. La partie est terminée quand le nombre des points au-dessus de 0 se trouve juste égal au nombre des points au-dessous de 0, de telle sorte, par exemple, que le joueur qui a 101 points puisse se faire payer son excédent au-dessus de 100, soit 1 point, par celui qui n’en a que 99. Deux ou trois parties font passer la soirée, et, le falot à la main, on rentre chez soi, le corps assoupli par un salutaire exercice et l’esprit enrichi des nouvelles locales.
Après un déjeuner frugal composé d’œufs frais et arrosé d’une bière où la chimie eût sans hésitation dénoncé l’addition de chatons de sapins brassés et fermentés avec l’orge, je dis un dernier adieu à ce site enchanteur, à cette large et profonde coupe de verdure, et pris à travers champs la direction de Paulinzelle. J’y arrivai de bonne heure, car les ruines de l’ancien cloître de Sainte-Pauline se réchauffaient encore dans la plaine à la blonde lumière du soleil. Ces ruines, l’attrait principal de l’aimable vallon du Rottenbach, sont tout ce qui reste aujourd’hui d’un cloître construit en 1106 par une princesse catholique du nom de Pauline. À la suite de la guerre des paysans, il fut sécularisé par le prince Heinrich XXXIV. Un siècle plus tard, en 1614, la foudre acheva la destruction commencée par l’abandon. À l’heure qu’il est, on ne voit plus s’élever sur la prairie constellée de frêles colchiques aux pétales violets que des pans de murs supportés par des arcs bien découpés, des piliers dont le chapiteau tétragone déroule des feuillages de fantaisie et des monstruosités symboliques, enfin une tour carrée relativement assez bien conservée. Il fut un temps cependant où dix-neuf villages appartenaient aux Bénédictins du couvent et où plus de cent autres lui payaient la dîme. Le soir venu, appuyé contre un fût de colonne au haut duquel grimaçait une tête bizarre, je regardai longtemps en silence la nuit se faire au-dessus de la nef béante. Le crépuscule, avivé déjà par les premiers scintillements des mondes célestes, semblait lui rendre sa voûte d’azur, parsemée sans doute autrefois, comme maintenant, d’étoiles d’or, à la mode byzantine. Sans doute je n’allais pas tarder à voir s’avancer devant moi les ombres encapuchonnées des anciens hôtes du monastère, psalmodiant gravement la liturgie du jour. Mon attente fut déçue. Un cheval échappé, poursuivi par un palefrenier lourdaud, entra brusquement, fouettant de son sabot les pierres sépulcrales à demi cachées sous l’herbe et galopant avec une grâce effarouchée sous les arceaux déserts. Mon rêve se trouva brouillé, et la vision attendue ne vint pas.
Il n’y a en tout que seize maisons dans l’humble village qui s’est élevé auprès de ces débris croulants. Mais la seizième est une auberge dont le confortable relatif étonne justement au milieu de ces retraites sylvestres. Comme la veille, on m’offrit le choix pour souper entre un beefsteak succulent ou une truite bleuie par la cuisson. Comme la veille aussi, le fracas des quilles, infatigablement bouleversées par la main robuste des bonnes gens du pays, m’attira un instant de l’autre côté de la route. Comme la veille enfin, une gaieté communicative régnait parmi les joueurs, dont la plupart avaient retiré leur veste de gros drap, afin de lancer d’un bras plus sûr l’énorme sphère de sapin. Mais ici, au lieu d’une simple planche, un revêtement de marbre couvrait le milieu de l’allée destinée au roulement des boules. Les beaux coups faisaient furore. Un vieux compère, qui venait de retirer d’entre ses dents son chibouk pour boire un bon coup de bière avant de viser, fit table rase avec sa première boule. « Alle neune »2 cria en pur thuringien, et de la voix victorieuse d’un coq qui annonce le lever de l’aurore, une chevelure de filasse en train de se baisser au bout de la galerie. Cette voix et cette chevelure, c’étaient celles du petit redresseur de quilles, à qui ce bel exploit valait de droit une gratification de trois pfennigs. Je rentrai à l’auberge après ce triomphe. Deux jeunes paysans d’une vingtaine d’années avaient pendant mon absence ouvert le piano de la salle. Un piano est un meuble presque indispensable dans les auberges de ce pays, qui a vu naître l’illustre famille des Bach. Pendant que sous les doigts des deux apprentis virtuoses les rythmes de danse succédaient aux improvisations machinales, un monsieur qui se trouvait à côté de moi entama la conversation et une heure durant me parla d’architecture byzantine. Il n’y a pas d’autre question à traiter à Paulinzelle. Mon obligeant interlocuteur m’apprit qu’à Stadtilm et à Arnstadt il y avait encore deux belles églises antérieures au plein épanouissement de l’art ogival et que les restes de l’abbaye de Georgenthal n’étaient pas moins importants pour l’histoire archéologique de la Thuringe. Je ne doutais pas avoir eu affaire au moins à un architecte. Le lendemain matin, avant de partir, je consultai le registre du Wirthshaus. Mon architecte putatif était un simple apothicaire.
Pour se rendre de Paulinzelle à Ilmenau, on chemine sous de longs bois de pins et d’épicéas dont le soleil, ce jour-là, perçait de ses flèches d’or le feuillage métallique. Pour la première fois, je traversais une de ces vastes superficies abandonnées à la libre expansion de la grande et odorante famille des conifères. Pour la première fois, je m’avançais solitaire sur un sourd tapis d’aiguilles desséchées et rousses, à travers les sveltes et innombrables colonnettes qui surgissaient de toutes parts, supportant toujours sans fléchir la voûte ininterrompue des rameaux verts aux lourdes franges lamellées. Il me semblait par moments que je fusse emprisonné dans l’immensité d’une cathédrale de végétation gothique, élevée et prolongée sans cesse autour de moi par la puissance taquine d’un enchanteur inconnu. Vainement j’écoutais, immobile, de tous côtés : il n’arrivait à mon oreille que de graves harmonies tirées par le vent comme d’un orgue gigantesque. Vainement j’essayais de découvrir un horizon quelconque à travers la moindre éclaircie : je n’apercevais au-dessus de moi qu’un fouillis pressé de croix vertes à deux ou trois branches, de croix épiscopales ou archiépiscopales dominant partout des absides informes. Vainement je hâtais le pas dans ce dédale inextricable de travées et de piliers indéfiniment renaissants sous des dais de feuillée opaque. Je ne pouvais épuiser l’étendue de cette colonnade irrégulière à plaisir, ni deviner le plan de son bizarre architecte. De carrefour en carrefour, j’arrivai sans m’y attendre à l’illusion complète, car je me perdis réellement, et sans un poteau, muni d’un nom de village et d’un doigt allongé, que le hasard me fit rencontrer, je n’aurais pas aisément gagné la plaine. OWegweiser ! muet et infaillible conseiller qui attends patiemment aux endroits difficiles le voyageur éperdu, humble fonctionnaire de bois qui coûtes si peu et qu’on ne décore pas, sans doute parce que tu n’as jamais eu qu’une opinion, reçois ici les remercîments sincères d’un de ceux qui, pas une seule fois, n’ont levé en vain vers toi un œil inquiet et suppliant.
Ilmenau n’est plus dans la principauté de Schwarzburg-Rudolstadt ; c’est le chef-lieu d’une enclave qui appartient au grand-duché de Saxe-Weimar. Mais pour un lecteur ou un ami de Goethe, Ilmenau est avant tout un buisson de souvenirs qu’il suffit de battre, une biographie du poète à la main, pour en faire partir toute une volée d’anecdotes authentiques et attachantes. À l’origine, ce furent les parties de chasse du duc qui y conduisirent son glorieux ami. On passait parfois la nuit dans une clairière, en cercle autour d’un grand feu. Pendant le jour, Goethe laissait courir aux autres le cerf et le sanglier, et, resté seul, dessinait. Quelques années plus tard, chargé de la direction des travaux publics dans le duché, il conçut le projet de faire rouvrir les mines abandonnées d’Ilmenau et, le 24 février 1784, il avait en effet la joie d’inaugurer la reprise de cette importante exploitation par un discours empreint d’une mâle et touchante piété. Les bénédictions d’en haut, que le grand philosophe avait appelées sur son œuvre, ne la protégèrent cependant pas contre un éboulement terrible qui se produisit en 1795, et anéantit tout ce qui venait d’être fait pour la prospérité de la contrée. L’échec éprouvé par le fonctionnaire n’empêcha pas heureusement le poète de fréquenter, comme par le passé, les sommets arborescents du Kickelhahn, à une heure de marche d’Ilmenau, sommets chers à sa muse, où il avait jadis écrit cette bluette d’une adorable mélancolie à laquelle j’ai fait allusion plus haut, et où il revint tant de fois contempler les larges espaces étalés sous ses yeux. Le quatrième acte d’Iphigénie en Tauride naquit également, en une après-midi sereine, sur une hauteur voisine. Plus tard, quand il commença Hermann et Dorothée, ce fut encore à Ilmenau qu’il vint chercher le calme dont il avait besoin pour composer la plus épique des idylles. L’auberge ZumLöwen





























