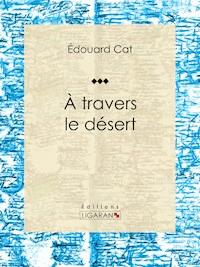
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le Sahara ou Grand Désert a été pendant longtemps une des régions les moins connues de l'Afrique. L'imagination populaire se donnait libre carrière à son sujet ; on se le figurait volontiers comme une immense plaine brûlante, qui retentissait des rugissements des lions et où le simoun soulevait les sables en énormes tourbillons engloutissant les caravanes ; d'autres, avec plus de prétention scientifique, y voyaient le fond sablonneux d'une vaste mer desséchée, ..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049985
©Ligaran 2015
Le Sahara ou Grand Désert a été pendant longtemps une des régions les moins connues de l’Afrique. L’imagination populaire se donnait libre carrière à son sujet ; on se le figurait volontiers comme une immense plaine brûlante, qui retentissait des rugissements des lions et où le simoun soulevait les sables en énormes tourbillons engloutissant les caravanes ; d’autres, avec plus de prétention scientifique, y voyaient le fond sablonneux d’une vaste mer desséchée, parsemée de loin en loin d’oasis, qui auraient été des îles et des archipels, dans les temps qui précèdent l’histoire. Sur l’étendue même, sur les limites du Grand Désert, on n’avait pas non plus de données précises ; on le cherchait tout près de nos villes d’Algérie, d’Alger, de Bône, d’Oran. Nos soldats de 1830 croyaient l’apercevoir du littoral, dans tout paysage aux tons fauves, sur lequel se détachait à l’horizon quelque palmier élancé ou l’étrange silhouette d’un chameau. Aujourd’hui le Sahara est nettement délimité ; tous les géographes sont d’accord pour appeler de ce nom la vaste contrée aride et peu habitée, qui va des flots de l’Atlantique jusqu’au sillon où coule le Nil, du pied de l’Atlas marocain et algérien jusqu’au Sénégal et au Niger, sur une longueur de 5 000 kilomètres, avec une largeur moyenne de 1 500 à 1 800 kilomètres, contrée couvrant une surface de 6 millions de kilomètres carrés, grande par conséquent treize fois comme la France. Cette immense étendue de terres a été traversée plusieurs fois dans le sens de l’Ouest à l’Est et du Sud au Nord ; des réseaux d’itinéraires tracés par de courageux voyageurs, s’y croisent en tous sens, et, si on ajoute à cela les renseignements qu’on a pu obtenir des indigènes sahariens, on verra que cette immense surface est aujourd’hui assez bien connue.
Avant d’aborder l’étude de cette région, il n’est pas inutile de rappeler les noms des vaillants explorateurs du Sahara, de faire connaître les résultats de leurs travaux. Au XVIIIe siècle, on n’avait sur cette partie de l’Afrique que des notions vagues, empruntées à Léon l’Africain, écrivain d’origine arabe, et du XIVe siècle. On connaissait de nom une ville populeuse à l’extrémité sud du désert, Timbouctou, où un matelot français, Paul Imbert, avait été retenu prisonnier en 1670 ; on en faisait la capitale du Sahara, une ville merveilleuse, pleine de monuments somptueux et de richesses de tous genres. En 1788, l’Association pour l’exploration de l’Afrique qui se constitua en Angleterre inscrivit dans son programme des voyages aux régions sahariennes. Ledyard, le premier de ses missionnaires, mourut au début même de l’entreprise, en Égypte ; la même année, le major Lucas, qui cherchait à pénétrer au Désert par le sud de la Tripolitaine, fut arrêté par une guerre civile des tribus de ce pays, mais rapporta du moins quelques renseignements utiles ; en 1791, le major Houghton essaya de gagner, par la Sénégambie, le Sahara occidental, mais fut assassiné ou mourut de faim à Djarra, après une course de quelques jours dans le désert. Hornemann, en 1799, pénétra dans la grande oasis du Fezzan, où il fut bien accueilli, et rapporta de précieuses observations. Le capitaine Lyon, qui refit le même voyage vingt ans après, émit l’opinion que du Fezzan on pourrait facilement traverser le Sahara et arriver au Bornou. L’Association anglaise donna des instructions en ce sens à une mission composée du docteur Oudney, du capitaine Clapperton et du major Denham ; elle partit de Tripoli au printemps de 1822, s’arrêta longtemps au Fezzan, passa par le pays des Tibbous, arriva en 1823 au Bornou et consacra dix-huit mois à l’exploration des contrées voisines, et enfin revint en Europe par le Fezzan et Tripoli. Cette grande exploration est une des plus importantes qui aient été faites dans le nord de l’Afrique et marque un progrès considérable dans l’histoire de la géographie.
Cependant la mystérieuse cité de Timbouctou demeurait invisible. En 1824, la Société de géographie de Paris promettait un prix de 10 000 francs à celui qui, le premier, y parviendrait et donnerait sur elle des renseignements précis. Un Anglais, qui avait déjà fait un voyage d’exploration dans la Sénégambie, le major Laing, partit de Tripoli avec l’intention d’aller à Timbouctou. Il visita Radamès, puis In-Salah, qu’il quitta le 10 janvier 1826, après en avoir observé avec soin la longitude et la latitude. À la suite d’une des nombreuses caravanes qui vont vers la ville qu’il voulait atteindre, il traversa le désert crayeux du Tanezrouft ; le onzième jour, vingt Touareg se joignirent à la petite troupe et peu après l’attaquèrent. Laing fut blessé assez grièvement ; pourtant il poursuivit courageusement sa marche et parvint, le premier des Européens, à la mystérieuse cité des bords du Niger. Il y séjourna quelque temps, puis reprit la route du Nord. Depuis, on ne reçut plus de ses nouvelles. Ce n’est qu’en 1828 qu’on apprit par un voyageur français dont nous parlerons bientôt, René Caillié, qu’il avait été attaqué de nouveau par les Touareg et massacré par eux. D’autres voyageurs, comme Barth et Lenz, apprirent aussi le sort du malheureux Laing et recueillirent de la bouche des indigènes des versions assez diverses sur la manière dont il était mort. Ses papiers, qui étaient d’une grande importance pour la science, étant donnée l’exceptionnelle valeur de Laing comme explorateur, ont été dispersés et sont perdus. Si la postérité lui reconnaît le mérite d’avoir le premier visité Timbouctou, du moins ses contemporains n’en purent rien savoir, et le programme proposé par la Société de Géographie, programme qu’il rêvait de réaliser, demeurait encore inexécuté en l’année 1828.
Le 3 octobre de cette année, M. Delaporte, vice-consul de France à Tanger, eut le plaisir d’apprendre à la Société de Géographie de Paris, que la longue et difficile traversée venait d’être accomplie par un Français. Quelques jours auparavant, en effet, notre consul avait vu un derviche mendiant, en haillons, maigre et pâle, la besace de cuir sur le dos, se jeter sur le seuil de sa porte et lui demander, non l’aumône, mais la protection due à un compatriote qui venait du Sénégal par Timbouctou et le Désert. M. Delaporte ne pouvait en croire ses yeux, mais il dut se rendre à l’évidence. La Société de Géographie aussi hésita quelque temps, tant la faiblesse du voyageur et la modicité de ses ressources étaient peu en rapport avec la grandeur des actions et l’héroïsme montré : l’enquête qu’elle ouvrit démontra que le jeune et pauvre René Caillié avait bien accompli le mémorable voyage, et il ne resta plus d’incrédules que parmi les Anglais ; ils ne pouvaient admettre qu’un Français eût réussi dans la tâche où leur compatriote avait échoué et péri.
Triste et touchante histoire que celle de René Caillié ! Né de parents pauvres, près de Niort, il n’avait pu recevoir qu’une instruction primaire et avait dû gagner sa vie dès l’enfance. À peine âgé de seize ans, en 1818, il avait été pour la première fois au Sénégal et avait fait 160 lieues à pied, à travers un pays désert ou habité par des populations hostiles, pour aller rejoindre à Bakel, en qualité de volontaire, la mission anglaise d’exploration du major Gray. Une maladie grave, causée par le séjour dans un pays insalubre, le força de revenir en France. À peine remis, la passion des voyages le reprend et il se rend de nouveau à Saint-Louis du Sénégal avec une pacotille. Séduit peu après par le programme qu’avait tracé la Société de Géographie, il va vivre une année entière chez les Maures Brakna, apprend à parler leur langue, s’initie à leur religion et à leurs coutumes, s’habitue à leur manière de vivre, puis, s’étant ainsi préparé à pouvoir traverser le Désert, il demande quelques subsides au gouvernement de notre colonie pour accomplir ses projets. On le tient pour un rêveur, pour un fou ; peu s’en faut qu’on ne le traite d’aventurier, de charlatan. À cet enthousiaste qui voulait s’illustrer par de grandes choses, on propose une place de jardinier ou d’empailleur d’oiseaux. Méconnu à ce point, il ne réclame plus qu’une somme de 100 francs qui lui était due, puis, comme il dit lui-même, « secouant la poussière de sa chaussure arabe sur le sol de Saint-Louis, il quitta cette île inhospitalière, se fit conduire en canot dans le Cayor, et seul, à pied, sans passeport, sans lettre de recommandation, sans autre ressource que ses 100 francs, il atteignit Gorée ». De là, il gagna Freetown. Le chef de cette colonie anglaise, qui avait entendu parler de ses projets, chercha à le fixer et lui confia la direction d’une fabrique d’indigo, emploi qui rapportait 3 600 francs. En un an, Caillié mit de côté 2 000 francs. « Cette somme, dit-il, me parut suffisante pour aller au bout du monde. » Trois années s’étaient écoulées depuis que l’idée de traverser le Désert avait commencé à hanter son imagination ; il avait mûri son projet ; l’heure de partir était enfin venue.
Il s’abouche d’abord avec des Maures dont il gagne l’amitié par quelques cadeaux ; il leur raconte sous le sceau du secret qu’il est né en Égypte de parents arabes et qu’il a été emmené en France dès son bas âge, que maintenant qu’il a été affranchi par son maître, il a pour vœu le plus cher de retourner dans son pays natal et d’y reprendre les pratiques de la religion musulmane. Il récite quelques versets du Coran à ses interlocuteurs ; le soir, il dit la prière avec eux. Sous son costume de marabout, avec son teint bronzé par le soleil, nul ne reconnaîtrait l’enfant des Deux-Sèvres. La fable qu’il a imaginée s’accrédite et va lui permettre de traverser l’Afrique du Nord-Ouest.
Il part en avril 1827, vêtu d’un burnous et recommandé par un commerçant français du Rio-Nunez à un chef noir, nommé Ibrahim. Il emporte avec lui une pacotille d’objets destinés à lui tenir lieu de monnaie et qui pèse 100 livres ; un esclave foulah porte ce modeste bagage sur sa tête. Partout, la fable du faux musulman racontée par Ibrahim avec de nouveaux développements vaut au pauvre voyageur une réception cordiale ; il traverse ainsi tout le Fouta-Djallon et arrive à Cambaye où s’arrêtait Ibrahim. Il s’y repose vingt jours et en repart avec une quinzaine de compagnons conduits par un vieux noir, et qui allaient faire du commerce sur le Niger. Il y parvint après une marche longue et pénible, après avoir dû demeurer cinq mois à Timmi, dans le Bambarra, les pieds ensanglantés, miné par le scorbut et la fièvre, soigné par une vieille négresse qui avait pris pitié de lui. La vue du Niger à Djenné, du fleuve majestueux et encore mal connu, le dédommagea de ses rudes épreuves et ranima ses espérances. « J’arriverai à Timbouctou, disait-il, ou je mourrai. J’aurai les 10 000 francs promis par la Société de Géographie, ou bien ma sœur les recevra avec la nouvelle de ma mort. » Le 28 avril 1828, en effet, plus d’un an après son départ, il entre dans la mystérieuse cité ; il ne la trouve ni aussi peuplée, ni aussi somptueuse qu’on l’imaginait et il n’y aperçoit qu’un millier de maisons en terre avec quelques places et mosquées ; pourtant, c’est un des grands marchés du centre de l’Afrique, car des caravanes y viennent du Sénégal, du Haoussa, du Bornou, du Fezzan et des pays barbaresques. Caillié obtient de se joindre à une de ces caravanes qui repartait pour le Maroc ; après quinze jours passés à Timbouctou, il peut songer au retour. Maintenant qu’il a atteint le but longtemps rêvé, il veut revenir dans sa patrie pour dire tout ce qu’il a vu et observé ; mais que le monde civilisé est loin encore ! Il y a tout le Désert à traverser, et le voyageur, qui sur sa longue route a épuisé toute sa pacotille, n’a plus de quoi payer une poignée de farine ou une goutte d’eau les Maures l’injurient et le frappent ; les plaies qu’il avait aux pieds se rouvrent et il marche pourtant, sous la chaleur accablante, parce que rester en arrière, c’est la mort certaine et horrible ; c’est pis encore ; c’est l’avortement de sa noble entreprise, c’est la destinée du major Laing. Caillié se traîne pendant trois longs mois à travers le désert par Araouan, Taodeni, Bel-Abbas, El Harib, le Tafilelt et arrive au Maroc. Là, nouvelles transes : malheur à lui s’il est reconnu pour un chrétien. Courant la nuit pour ne pas être découvert, se cachant le jour dans les broussailles, il gagne R’bat, où il doit y avoir un représentant de la France. Hélas ! celui qui y fait les fonctions de vice-consul est un israélite indigène ; il jette Caillié, qui a l’air d’un mendiant, à la porte de sa demeure, et il faut encore au malheureux longer le littoral pendant 200 kilomètres pour arriver à Tanger. Découragé par sa réception à R’bat, presque honteux de ses haillons et de sa mine de squelette, c’est en tremblant qu’il franchit le seuil du consulat de France. Les domestiques indigènes le traitent de chien et ne le laissent pénétrer près de leur maître qu’après de longues heures d’attente et pour se débarrasser de lui. Mais là, tout change. M. Delaporte a bientôt reconnu dans le pauvre derviche un compatriote et un vaillant ; il le serre dans ses bras, lui fait donner des soins, le ranime et le réconforte. Il le cacha quelques jours dans sa maison, car il ne fallait pas révéler aux Marocains la présence d’un infidèle qui avait traversé l’empire, et lui ménagea ensuite le moyen de revenir en France sur un bateau de l’État. Le nom de Caillié, du jour au lendemain, devint illustre, mais le grand voyageur ne jouit pas longtemps du repos et de la gloire ; il mourut huit ans environ après son retour, victime, lui aussi, de cette Afrique, qui a déjà dévoré tant de braves.
Le rôle de la France dans les explorations sahariennes avait été brillamment inauguré : bientôt les longs et périlleux voyages accomplis au Désert par nos compatriotes n’auront plus seulement pour but le progrès de la science ; ils auront aussi un intérêt national. La conquête de l’Algérie, restreinte d’abord aux limites du Tell, puis s’étendant à la zone des Hauts-Plateaux, va nous mettre en rapports directs avec les populations du Sahara. Notre armée plante son drapeau à la bordure du Désert, à Biskra et à Laghouat, en 1844 ; le colonel Géry conduit nos troupes à Brizina en 1845 ; en 1847, Cavaignac les mène à l’oasis de Tyout. De ces divers points on voit s’ouvrir devant soi le désert infini ; on sonde du regard ses mystérieuses profondeurs ; on veut connaître ses vrais aspects, les mœurs de ses populations. En 1848, un commerçant audacieux, M. Zill, part de Biskra, traverse les oasis pressées et populeuses de l’Oued-R’ir, visite Touggourt, la capitale des sultans Ben-Djellab et revient par les localités éparses dans les sables du Souf.
Dès lors, nos possessions algériennes touchaient à la partie septentrionale du Sahara ; celui-ci d’autre part, au Sud-Ouest, confinait à notre colonie déjà ancienne du Sénégal. Il devenait d’un grand intérêt pour nous de bien connaître la grande surface qui séparait nos établissements africains, de voir quelles routes pouvaient les relier. Ce fut le but du voyage de Léopold Panet, qui en 1850 refit en se maintenant un peu plus à l’Ouest la même grande traversée du Sahara qu’avait faite René Caillié. Parti de Saint-Louis du Sénégal au commencement de l’année 1850, en compagnie d’un juif indigène, Youda, il longea d’abord le littoral de l’Océan, parcourut le pays des Trarza, puis tournant au Nord-Est, gagna Chinguit, capitale de l’Adrar. Tout ce pays montagneux et pittoresque, une des plus belles oasis du Désert, n’avait encore été vu par aucun Européen ; on n’avait à son sujet que les données vagues et déjà anciennes des géographes arabes. Panet y fut retenu une trentaine de jours par des difficultés de tous genres, puis il reprit sa marche en compagnie d’une famille de la tribu des Ouled-bou-Sba. Après avoir traversé toute la partie la plus occidentale du Sahara, il atteignit la rivière de Saguiet-el-Hamra, puis l’Oued-Draa et Mogador, rapportant des renseignements précieux.
En même temps, le Sahara oriental et central étaient l’objet d’une grande exploration qui marqua comme une ère nouvelle dans l’histoire de la géographie africaine ; je veux parler de l’expédition de Richardson, Barth, Overweg, Vogel, qui dura de 1850 à 1856 et qui fit connaître à la fois une portion notable du grand désert et la plus grande partie du Soudan. Richardson, qui avait fait avec succès un voyage de Tripoli à Radamès et de Radamès à Rhat et au Fezzan, avait soumis au gouvernement britannique l’idée d’une vaste expédition qui aurait pour but d’ouvrir au commerce les contrées populeuses et mal connues du Bornou, du Haoussa et pays voisins. Son projet accepté, il voulut s’adjoindre un Français et vint dans ce but à Paris ; mais on lui répondit par des fins de non-recevoir et il s’adressa alors à l’Allemagne qui eut l’honneur de lui offrir deux jeunes collaborateurs, Henri Barth, déjà connu par une exploration archéologique de la Cyrénaïque, et le docteur Overweg. Au mois de janvier 1850, ils étaient tous trois à Tripoli avec un matériel considérable. Il y avait là des instruments pour les observations scientifiques, des armes, des vêtements, des pièces d’étoffes, des verroteries, des montres, des bijoux et des présents de tous genres destinés aux rois et aux chefs des tribus ; mais l’objet le plus considérable était un bateau en fer, démonté et destiné à naviguer sur le lac Tchad. Le tout fut installé sur des chameaux, qui formaient une longue file, et les voyageurs prirent la route qui conduit les caravanes à l’oasis du Fezzan. Ils traversèrent des plateaux calcaires profondément ravinés et coupés çà et là de plaines sablonneuses, visitèrent les petites oasis de Mizda, Ederi, Jerma et arrivèrent à Mourzouk au milieu du mois de mars. De là ils s’enfoncèrent vers l’Ouest, dans le pays des Touareg, les écumeurs du Désert. Pendant le jour, quand rien de suspect n’avait paru à l’horizon, l’ordre de marche était à peu près toujours le suivant : devant, marchaient les guides, derrière eux la longue file de chameaux porteurs, ensuite les domestiques, puis Richardson qui surveillait les bagages et maintenait l’ordre. Overweg, à droite et à gauche de la caravane, étudiait l’aspect et les formes du sol et recueillait des échantillons de minerais et de pierres. Barth, courant çà et là, explorait tout le pays ou bien causait avec des guides intelligents et recueillait de leur bouche des renseignements précieux sur les routes du Sahara. Une fois, entre Mourzouk et R’hat, s’étant éloigné de la caravane pour aller étudier des inscriptions gravées sur les rochers, il s’égara dans un inextricable dédale et serait mort de soif, sans l’arrivée d’un des Touareg de la caravane envoyé à sa recherche. Au milieu du jour et au coucher du soleil, on s’arrêtait auprès d’un rocher, auprès d’un puits, quand il y en avait sur la route, et l’on faisait un frugal repas de figues, de dattes, de riz, d’un peu de farine ; parfois quelque oiseau, abattu par les chasseurs, variait ce menu monotone. Puis, les marabouts disaient à haute voix la prière, et bientôt s’éteignaient les derniers bruits du soir dans le désert. Mais alors même les Européens ne pouvaient se livrer au repos : les uns devaient, à tour de rôle, veiller pour défendre aux Touareg pillards d’approcher, les autres, cependant, rédigeaient le Journal du grand voyage. On s’arrêta quelque temps dans la petite ville de R’hat, puis on recommença à cheminer dans le Désert, tantôt formé de grandes plaines de sables et de cailloux, tantôt de ravins et de rochers aux formes bizarres. Au fur et à mesure qu’ils avançaient vers le Sud les voyageurs devaient redoubler de vigilance, car les Touareg devenaient chaque jour plus incommodes et plus disposés à voler. Il fallut gagner la protection des chefs par des présents considérables. À Tintelloust la mission fut retenue trois mois par le chef des Kelouis, le sultan An-Nour, et Barth mit ce retour à profit pour aller visiter la ville jadis florissante mais alors ruinée d’Agades, à sept jours de marche ; il y fut bien reçu et la description qu’il a faite de ce pays, l’Air ou Asben, est demeurée la meilleure que nous ayons. La mission put enfin partir de Tintelloust et en un mois elle atteignit le Soudan ; la première partie du voyage s’effectua à travers de vastes solitudes, tachetées de loin en loin par de maigres herbages et des bouquets de gommiers ; mais dans la seconde partie des troupeaux de moutons et de bœufs de plus en plus nombreux, des habitations éparses, un système de culture régulier annonçaient l’approche du Soudan. À Tagelal, dans le Damergou, la mission se sépara afin d’étudier une plus grande surface de pays ; Richardson alla vers l’Ouest, vers Zinder, où il devait mourir de la fièvre, le 2 février 1851 ; Overweg alla vers l’Est, où il mourut en septembre 1852, tandis que Barth explora le Bornou, l’Adamoua, le Soudan occidental jusqu’à Timbouctou où il séjourna de septembre 1853 à mai 1854. Il ne revint en Europe qu’en 1855, rapportant de ce long voyage une relation qui est un chef-d’œuvre d’exactitude et de conscience scientifique.
Ainsi attaqué de tous les côtés à la fois, le Désert commençait à livrer ses secrets et on peut dire qu’à la date de 1856 les lignes essentielles de sa géographie étaient connues. La bordure septentrionale, du Maroc à la Tripolitaine, avait été visitée par le major Laing et en partie levée par nos officiers ; l’est, le centre et le sud du Sahara avaient été explorés autrefois par Oudney, Denham et Clapperton, plus récemment par Richardson, Barth, Overweg, Vogel ; enfin l’ouest avait été traversé en des points assez éloignés les uns des autres par René Caillié et Panet. On avait reconnu un Sahara tout différent de celui qu’on imaginait jadis : on y avait vu des montagnes, des rivières plus ou moins asséchées, des lacs ou des marais, un commerce relativement actif, de vraies routes de caravanes, un certain nombre de lieux habités et presque partout des familles ou des tribus nomades. Le Désert, mieux étudié, avait perdu de son horreur ; on en vint presque à dire que le vrai Désert n’existe pas, que cette barrière qui avait limité l’expansion du monde antique ne pouvait contenir l’expansion du monde nouveau ; on songea dès lors à conquérir le Sahara à notre influence et à notre commerce. De 1856 jusqu’à nos jours telle a été la pensée de bien des hommes généreux, ardents, pleins d’enthousiasme et de science ; malgré des insuccès nombreux, en dépit de sanglantes défaites, le projet n’a point été abandonné et l’avenir nous réserve peut-être de le voir un jour réalisé en partie.
À cette époque, on parlait beaucoup du commerce florissant que les pays barbaresques faisaient jadis avec le Soudan et l’on constatait que ce trafic avait cessé ; on pensait que par suite de notre occupation de l’Algérie, le courant commercial s’était détourné des directions de Ouargla et Touggourt pour se porter sur Radamès et on désirait entrer en relations, s’il était possible, avec les habitants de cette oasis qui passait pour un des grands marchés du Désert. Le général Desvaux qui, après avoir vaincu les indigènes de l’Oued-Rir et du Souf, s’occupait activement de leur créer des sources de prospérité, songea dès 1856 à nouer ces relations. Il en chargea un capitaine de spahis, M. de Bonnemain, qui devait à une éducation exceptionnelle et à de curieuses aventures le privilège de monter un cheval et de parler l’arabe comme un fils du Désert. Il lui donna mission de prendre des renseignements sur la route à suivre pour arriver à Radamès, sur l’organisation des caravanes, sur le négoce de ces régions, sur les profits à espérer, et aussi d’inciter les habitants de l’oasis à se mettre en rapport avec les commerçants algériens. Bonnemain mit vingt et un jours à franchir la région sablonneuse qui s’étend d’El-Oued à Radamès, et, en sa qualité de chrétien, de roumi, fut d’abord assez froidement accueilli par les autorités ; la franchise de ses manières et de son langage, ses qualités personnelles et quelques présents distribués à propos lui gagnèrent bientôt l’amitié du gouverneur, ou hakem, et des membres du midjelès, ou conseil des notables. On l’assura qu’on était très désireux d’entrer en relations avec l’Algérie, mais qu’il y avait à craindre que les Souafa, les Châmba, les Ouled-Yakoub et autres tribus sahariennes s’y opposassent, pour garder le monopole de ce trafic. Il parut d’ailleurs à Bonnemain, que Radamès n’était qu’un lieu d’entrepôt ; c’était plutôt par des rapports avec Rhat, grand marché entre le Sahara et le Soudan, qu’on pouvait espérer d’attirer vers notre colonie, le commerce de ces régions. La mission spéciale qui lui avait été confiée était remplie ; il partit de Radamès suivi jusqu’à quelque distance par une foule sympathique et rentra à El-Oued le 7 janvier 1857, ayant recueilli de curieux renseignements.
L’année suivante, toujours sur l’initiative du général Desvaux, on essaya d’entrer en relations d’affaires avec les gens de Rhat, comme l’avait conseillé Bonnemain. Les circonstances paraissaient assez favorables ; on était assuré de l’amitié de Si-Othman, chef influent des Touareg-Azgueur, qui était venu s’établir quelque temps près de Ouargla ; il promettait de nous aider de son influence près de ses compatriotes, qui étaient presque les maîtres de Rhat. On chargea d’aller avec lui en cette ville Bou-Derba, Arabe algérien fort intelligent et qui s’était distingué comme interprète militaire à notre service. Parti de Laghouat le 1er avril 1858, il rejoignit Si-Othman non loin de Ouargla. La caravane, composée de vingt-cinq chameaux et de quinze personnes dont cinq Touareg, s’enfonça dans la direction du Sud-Est ; elle passa à travers la grande zone de dunes qui s’étend de Nefta à El-Goléa sur une profondeur de 55 à 80 lieues et qu’on appelle El-Oudje, séjourna aux puits d’Aïn-Taïba, d’El-Byodh, à la zaouia de Temassinine, aux puits de Aïn-Tebalbalet et d’Aïnel-Hadjaje et enfin en vue de la chaîne de hauteurs où Barth, quelques années auparavant, avait failli périr égaré. La ville de Rhat apparut alors aux yeux du voyageur, le 26 septembre, près de deux mois après son départ de Ouargla. Il avait parcouru une distance de plus de 1 300 kilomètres ; le long de la route on avait recueilli des bruits peu rassurants ; le Sahara était plein de querelles et de troubles ; notre ennemi, le chérif Mohammed-ben-Aballah d’une part, de l’autre Ben-Snoussi, l’instigateur du récent massacre à Djeddah des résidents européens, agitaient les populations sahariennes par leurs appels à la guerre sainte ; il y avait alors une de ces recrudescences de fanatisme qui sont comme périodiques dans les pays musulmans. Bou-Derba avec sa petite troupe ne put entrer dans Rhat ; il campa au milieu des Touareg, amis de Si-Othman, qui à certaines époques de l’année établissent leurs tentes près de la ville et y forment comme un village temporaire. Il apprit là que les habitants de Rhat, excités par un marabout, avaient juré de ne pas laisser entrer l’étranger et de ne permettre à personne de communiquer avec lui. Bou-Derba passait pour un chrétien déguisé et des lettres venues de Mourzouk dénonçaient Si-Othman comme vendu aux Français. L’agitation qui régnait dans la ville se calma cependant un peu ; des présents, la distribution gratuite de remèdes contre les ophtalmies, l’appui de quelques Touareg, parmi lesquels Ikhenouken, le chef des Azgueur, permirent à l’explorateur, non de pénétrer dans la ville, mais d’entrer en relations avec les principaux personnages et de recueillir des données précieuses sur le commerce de Rhat, l’origine et les mœurs de ses habitants. Après avoir rempli du mieux qu’il était possible sa difficile mission, Bou-Derba, qui voyait ses chameaux dépérir faute de pâturages et qui avait d’ailleurs à redouter de nouvelles excitations des Senoussi, reprit le 4 octobre la route de l’Algérie. Il fut accompagné par Ikhenouken jusqu’à Tebalbalet et par Si-Othman jusqu’à Ouargla, où il parvint le 20 novembre. La relation intéressante de cette grande course à travers le Désert est une de celles qui ont le mieux fait connaître le Sahara central.
C’est à cette époque que se consacra tout entier à l’exploration du Désert, un jeune homme qui y appliqua toutes les ressources d’un esprit curieux, formé à l’observation méthodique, voyageur consommé à peine au sortir de l’enfance ; j’ai nommé Henri Duveyrier. En 1856, à l’âge de seize ans, il rêvait de marcher sur les traces de Barth, dont le nom venait d’acquérir une gloire immortelle ; pour cela il commença à apprendre l’arabe, étudia les diverses branches des sciences naturelles et s’exerça à la pratique des instruments d’observation. Ainsi préparé, il vint s’établir dans le Sahara algérien au printemps de l’année 1859 et commença une série de courses qui devaient avoir pour résultat une connaissance plus exacte de cette région. Il alla d’abord de Biskra au M’zab par une route peu fréquentée, puis du M’zab à El-Goléa qu’aucun Européen n’avait encore vue. Il espérait trouver là une occasion favorable d’aller au Soudan par la voie du Touat, mais le fanatisme des populations l’obligea de renoncer à cette entreprise et de revenir sur Metlili et Laghouat. Pendant l’automne de la même année, on le vit étudier en détail l’Oued-R’ir et le Souf ; au commencement de 1860, il retourna à Ouargla par une route mal connue, puis revint dans l’Est et se livra à de longues recherches scientifiques dans la région des Chotts tunisiens.
Tout en accomplissant ces divers voyages, il avait noué des relations avec le chef touareg, Si-Othman, et était même devenu son ami ; il put songer alors à exécuter la grande exploration qui était le rêve caressé par lui depuis si longtemps, à savoir l’étude du pays des Touareg ! Parti de Biskra en plein été, il alla à Radamès par Touggourt, El-Oued et Berresof ; une excursion le conduisit de cette oasis à Tripoli par le Djebel-Yefren et le Djebel-Nefouça, puis il revint à Radamès par une autre voie. En décembre 1860, il partit pour Rhat où il arriva le 8 mars par le chemin qu’avait suivi Bou-Derba. De Rhat, il revint enfin à Tripoli en septembre 1861, après avoir visité le Fezzan et Mourzouk. Les itinéraires de l’infatigable voyageur couvrent, on le voit, la majeure partie du Sahara septentrional ; il rapportait aussi de précieux renseignements recueillis de la bouche des indigènes, des observations astronomiques et scientifiques très nombreuses. À lui seul et avec de modiques ressources, il avait fait faire à la géographie d’importants progrès. Après tant de grands travaux et de fatigues, lorsque l’entraînement et la fièvre de son aventureuse entreprise ne le soutinrent plus, Duveyrier, de retour à Alger, tomba gravement malade ; longtemps il resta entre la vie et la mort ; il guérit pour nous donner son beau livre sur les Touareg du Nord et pour devenir un des représentants les plus éminents de la science géographique française.
Les voyages de Bou-Derba et de Duveyrier nous avaient donné des Touareg une opinion favorable ; Si-Othman parmi eux, avait ouvertement protégé nos deux explorateurs et ils lui avaient dû de pouvoir faire avec une sécurité relative des excursions qui eussent été autrement très périlleuses. Ce même chef intelligent vint à Paris à la fin de l’année 1861 avec un de ses compatriotes, et on put voir deux grands guerriers touareg, le litham ou voile noir sur le visage, promener leur allure solennelle sur nos boulevards, au milieu de la foule curieuse. Si-Othman se fit fort d’amener ses compatriotes à une sorte de traité de commerce avec la France ; moyennant le payement de certains droits, ils assureraient la sécurité des routes du Désert pour nos marchands, et on pouvait espérer de cette manière détourner le commerce saharien de la route de Radamès-Tripoli pour lui faire prendre celle de Radamès-Alger. Quelque temps après que Si-Othman fut reparti pour négocier avec les Touareg, une mission française composée des officiers Mircher et Polignac, de l’ingénieur Vatonne et de l’interprète Bou-Derba fut envoyée à Radamès par Tripoli ; elle fit, chemin faisant, des observations curieuses, fut bien accueillie des indigènes et au nom de la France signa avec Ikhenouken, chef des Touareg-Azgueur, un traité de commerce, dont par malheur les circonstances allaient empêcher l’exécution.
En même temps qu’on cherchait par l’Est une route de l’Algérie vers le Soudan, on en étudiait une autre, peut-être plus facile par l’Ouest, par le Touat. Deux officiers, Colonieu et Burin, s’étaient joints en l’automne de 1859 à une caravane partant de Géryville ; ils suivirent d’abord la vallée sèche de l’Oued-Gharbi, puis contournèrent un plateau rocailleux et traversèrent dans toute leur largeur les dunes de l’Erg. Ils entrèrent alors dans la grande oasis du Gourara, puis dans celle d’Aouguerout. Ils allaient poursuivre leur entreprise et visiter le Touat, mais les démonstrations hostiles des indigènes de ce pays les forcèrent à battre en retraite au commencement de l’année 1861.
Des explorations analogues se faisaient en sens inverse par notre autre possession africaine, le Sénégal. L’homme si remarquable qui gouvernait cette colonie, l’illustre Faidherbe, envoyait en 1860 le lieutenant Vincent explorer la région de l’Adrar. Le voyageur suivit d’abord le littoral de l’Atlantique, puis se tenant un peu à l’ouest de la route parcourue par Panet en 1850, il arriva à El-Mofga dans l’Adrar et revint à la côte, au banc d’Arguim par le Tasiant. L’année suivante, un de ceux qui l’avaient accompagné, indigène sénégalais au service de la France, Bou-el-Moghdad, voulant faire le pèlerinage de La Mecque, s’engagea dans les mêmes régions et, par une route un peu différente, explora le pays jusqu’à l’embouchure de l’Oued-Noun, au Maroc. Les relations de Vincent et de Bou-el-Moghdad sont parmi celles qui ont le plus contribué à faire connaître le Sahara oriental ; on peut dire même que jusqu’à ces dernières années, elles étaient, avec le récit de Panet, le seul document à consulter à ce sujet.
Ainsi, dans la plus grande partie du Sahara, c’est à des Français que revient surtout l’honneur des explorations scientifiques ; pourtant l’impartialité nous force à parler ici des grands voyages d’un homme qui n’est pas de nos amis, et qui, à plusieurs reprises, a été soupçonné de fomenter contre nous les révoltes des indigènes, l’allemand Gerhard Rohlfs. Après avoir servi en Algérie dans la légion étrangère, s’y être familiarisé avec la langue et les mœurs des Arabes, il séjourne quelque temps au Maroc ; là, il obtient du chérif d’Ouazzan une lettre de recommandation, et avec de faibles ressources tente de traverser le Sahara, de l’Ouest à l’Est. Parti de Tanger, il pénètre dans le Grand Atlas en 1864, visite les oasis du Tafilelt et du Touat, est retenu plusieurs mois à In-Salah au milieu d’une population fanatique qui faillit plusieurs fois le massacrer, se rend ensuite par une route pénible à Radamès, puis à Tripoli ; à peine remis de ses fatigues et de ses blessures, le 20 mai 1865, il repart, visite le Fezzan, traverse tout le Sahara du Nord au Sud, puis le Soudan et, deux ans après, débouche sur l’océan Atlantique, ayant accompli un grand voyage de deux années. Il mérite par ces expéditions aventureuses d’occuper une belle place parmi les explorateurs africains. Peu après l’Allemagne fournissait encore un grand voyageur, Nachtigal qui, parti de Tripoli en 1869, traversa aussi le Désert, portant au sultan du Bornou les présents du roi de Prusse, qui désirait manifester sa reconnaissance au souverain, qui avait bien accueilli Barth et Gerhard Rohlfs : Nachtigal visita surtout le pays des Tibbous ou Tedas, peuple qui n’est bien connu que depuis la relation de son remarquable voyage.
Pendant la période qui s’étend de 1862 à 1873, la France ne put s’occuper beaucoup d’explorations sahariennes. La grande tribu des Oulad-Sidi-Cheikh s’était soulevée contre nous en 1864 et, entraînant un grand nombre de tribus soumises à son influence religieuse, nous avait fermé la route de l’Ouest ; en même temps la puissance grandissante du chef de l’ordre des Senoussi avait pour effet de réveiller le fanatisme et l’intolérance des Touareg et de nous interdire aussi les routes sahariennes du Centre et de l’Est. La guerre contre l’Allemagne appelait ensuite toutes nos forces d’un autre côté. Un peu de calme étant enfin revenu, les Oulad-Sidi-Cheik ayant pu être châtiés, des explorateurs audacieux s’aventurèrent de nouveau dans le Sahara. Donnons un souvenir aux malheureux Dournaux-Duperré et Joubert, qui atteignirent Radamès, puis s’engagèrent sur la route de Rhat et furent massacrés après quelques jours de marche par leurs guides Châmba (1874). Soleillet fut plus heureux ; il put, par El-Goléa, gagner le Tidikelt et arriver en vue d’In-Salah, le marché principal du pays, la ville où s’approvisionnent les Touareg-Hoggar. Mais la djemaa ou conseil de cette ville lui interdit d’en franchir les portes et il dut revenir assez précipitamment vers nos établissements algériens (1874).
C’est à cette époque que commence à prendre consistance un projet jusqu’alors vaguement conçu et dont on parlait comme d’une chose en l’air, celui d’un chemin de fer transsaharien. Il ne s’agissait de rien moins que de relier par une voie ferrée l’Algérie et le Soudan, régions séparées par plus de 2 000 kilomètres. Avec ce moyen de communication rapide et relativement économique, on ouvrirait une nouvelle ère au commerce de l’Afrique centrale ; on pourrait exporter de là-bas toute sorte de matières, que leur poids et leur volume, hors de proportion avec leur valeur, ne permettaient pas de transporter par le moyen coûteux des caravanes ; en revanche, on importerait vers le Soudan le sel de la selka d’Amadghor et de l’oasis de Bilma et surtout nos produits manufacturés, ce qui donnerait un puissant essor à notre industrie. Ce projet grandiose paraît avoir été soutenu et développé avec ardeur, d’abord par Soleillet et Duponchel ; il fut aussi combattu très vivement.
L’idée du Transsaharien, livrée à l’opinion publique, suscita de suite de nouvelles et plus précises explorations du Sahara. On examina les voies et moyens d’exécution ; on chercha quel tracé serait le meilleur, on procéda à toutes les études préliminaires qui étaient possibles dans le voisinage de notre colonie algérienne. Largeau et Say s’avancèrent même à une certaine distance dans le pays des Touareg. Ce ne furent, à vrai dire, que des promenades un peu pénibles ; on y eut l’occasion de constater qu’il y avait peu à espérer des relations commerciales avec Radamès, et que loin de pouvoir compter sur les Touareg, il fallait au contraire s’en défier beaucoup. Quelques-uns d’entre eux, venus à Alger en 1878 et bien accueillis par nous, avaient promis de conduire quatre missionnaires catholiques à Radamès ; à peine avaient-ils dépassé la zone du Désert directement soumise à notre influence qu’ils se jetèrent sur les malheureux prêtres sans défense et les égorgèrent. L’hostilité de ces pirates du Désert empêcha plusieurs voyageurs, notamment Largeau et Say, d’aller jusqu’au Hoggar.
En 1879, la question du Transsaharien entra dans une phase nouvelle. L’ingénieur Duponchel publia un chaleureux plaidoyer en faveur de cette entreprise et M. de Freycinet, alors ministre des travaux publics, nomma une commission chargée d’en étudier l’exécution. On décida qu’il y avait lieu d’étudier les trois tracés proposés, par l’Ouest, le Centre et l’Est, et trois missions furent envoyées pour examiner sur le terrain les difficultés ou les facilités que présenteraient les diverses voies.
La mission Pouyanne, partie de Mecheria (province d’Oran) étudia le pays jusqu’à Tiout, à 450 kilomètres de la côte, mais fut empêchée par les tribus marocaines de s’avancer au-delà vers le Touat. La mission Choisy étudia la ligne de Laghouat à El-Goléa et de Biskra à El-Goléa par Ouargla ; elle trouva ce dernier tracé préférable à celui par Laghouat, se ralliant ainsi à une opinion déjà émise par de nombreux géographes. La troisième mission, beaucoup plus nombreuse que les précédentes, avait à remplir une tâche autrement longue et difficile ; gardant un caractère absolument pacifique, malgré la force de son escorte, elle devait étudier la vallée des Ighargaren, le versant oriental du Hoggar et atteindre le Soudan ; il lui était prescrit de s’aboucher avec les chefs Touareg, de gagner leur amitié et leur appui. Elle avait pour chef le lieutenant-colonel Flatters, qui avait fait un long séjour dans le sud de nos établissements algériens et connaissait fort bien la langue et le caractère des indigènes.





























