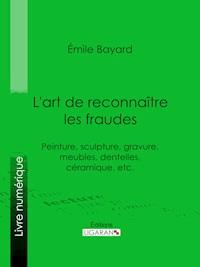
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le mirage de l'antiquité, en matière d'art, a souvent nui à la qualité de l'amateur qui, très souvent, a passé dédaigneusement devant la beauté de son temps pour se pâmer sur des ruines sans valeur. Le critérium esthétique de certains amateurs est, ainsi, borné au moindre délabrement, à la moindre poussière des temps, plus ou moins vénérables, selon l'artifice..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En Hommage amical à Monsieur Alphonse Chautemps
E.-B.
Le mirage de l’antiquité, en matière d’art, a souvent nui à la qualité de l’amateur qui, très souvent, a passé dédaigneusement devant la beauté de son temps pour se pâmer sur des ruines sans valeur. Le critérium esthétique de certains amateurs est, ainsi, borné au moindre délabrement, à la moindre poussière des temps, plus ou moins vénérables, selon l’artifice.
Malgré que, logiquement, le maquillage soit réservé au mensonge de la vieillesse, d’aucuns ne sauraient se contenter de la jeunesse sans fard, et c’est ainsi que l’artifice se venge cruellement de l’ignorance ou de son aggravation pédante : le snobisme, en présentant du faux vieux.
C’est le faux vieux suffisant, tant à la satisfaction bourgeoise, pour son économie, qu’à la prétention artistique pour son prix élevé, mais c’est le faux vieux hélas ! trompant l’amateur éclairé, lorsque la fraude est devenue un art. Aussi bien le bourgeois s’illusionne selon une somme égale à la laideur pressentie, qu’il prend, intimement, pour de la beauté et, comme le faux connaisseur n’estime un achat qu’il sa cherté, il ne nous reste guère à plaindre que l’amateur éclairé, souvent converti, il est vrai, à une beauté frauduleuse qui le dépasse ! Du moins ce truquage de la beauté le console-t-il de son erreur, au point qu’il se demande souvent jusqu’à quel point il s’est trompé, puisqu’il a frissonné comme en présence de la beauté véritable.
N’était le dépit d’avoir été dupé et parfois, coûteusement, on ne devrait, logiquement n’en vouloir qu’à soi-même d’une mauvaise acquisition, car le sincère désenchantement esthétique ne peut provenir d’une révélation matérielle.
Si le bibelot que vous chérissez depuis des années, vous apparaît soudain hideux de n’être pas authentique, vous faites réellement tort à votre goût. Il faut avoir foi en la jeunesse, malgré même un acte de naissance implacable et, la garantie de vieillesse porte en elle tout autant sa conviction. Conviction basée avant tout sur de la beauté, d’où qu’elle vienne, et non sur de la vétusté fatalement vénérable. Cette dernière appréciation appartient en propre à l’archéologie qui collectionne les pierres du passé, qui rêve sur des débris, scientifiquement, et non idéalement.
L’antiquité, au surplus, n’a pas produit que des chefs-d’œuvre et il ne faut pas confondre la curiosité avec la beauté. L’horreur n’équivaut à la splendeur que dans l’expression suprême de l’étonnement, et notre snobisme s’est malencontreusement mépris sur le caractère de cette expression ; d’où une perversion « distinguée » du sens critique.
C’est ainsi que nos sculpteurs modernes ont créé des statues mutilées, pour rivaliser avec la statuaire antique dont la beauté nous est parvenue, souvent détériorée, à travers les temps. Cette caducité, avec ses tares, aussi logiques que regrettables, constitue premièrement la beauté, chez les sots qui ne sont pas éloignés d’admirer la Vénus de Milo uniquement parce qu’elle est dépourvue de bras et, de même, la radieuse Victoire de Samothrace parce que la tête lui manque.
Comme si les admirables auteurs de ces statues les avaient ainsi conçues, initialement ! Comme si ces marbres désormais immortels, devaient leur immortalité à leur âge – tout comme le vin gagne en cave – et à leur décrépitude ! Et voici que pour plaire à la niaiserie de l’heure, nombre de statuaires modernes, malicieusement, offrent en pâture à leur public, tout un monde d’éclopés, de décapités, d’hommes et de femmes « troncs », manchots, culs-de-jatte, et autres débris humains, résultant d’une catastrophe ou en rupture simplement, de quelque cour des Miracles !
Qu’importent à ce public les lois de l’esthétique ! La beauté intacte est comme l’esprit sain, une banalité, et rien ne vaut la curiosité, la rareté » de l’absurde. L’incompréhensible devient ainsi du génie et l’art jaillit au spectacle d’une plaie !
Mais ce qui est vieux n’est donc pas fatalement beau ? Sentez-vous l’écueil de l’enthousiasme non averti, en faveur de toute ruine quelle qu’elle soit ?
Du côté de la peinture, même observation. La moindre craquelure est sympathique et, lorsque le sujet du tableau disparait sous la crasse, le « connaisseur » est bien prêt de crier au chef-d’œuvre !
La poussière des temps tient ainsi du miracle, tout comme le nébuleux garde un mystère avantageux.
Dans la nuit, l’imagination voit des choses extraordinaires, et les pierres cachées sous la mousse sont singulièrement privilégiées. Les insinuations sont plus éloquentes que les paroles et, lorsque l’on s’entend à demi-mot, on se comprend bien davantage. Quel excellent parti à tirer, dès lors, de la crédulité humaine ! Quelle ressource inépuisable pour les dispensateurs de cette ambiguïté, qui confond le bibelot rare avec le faux bibelot, sous la même poussière !
La parole énigmatique d’un marchand tient aussi lieu d’une garantie vis-à-vis de l’acheteur incompétent dont la bonne foi, en réalité, n’a pas été surprise, puisque la somme de mystère qu’il emporte, est à la mesure de son illusion.
Au surplus, puisque marchand et amateur se réjouissent, chacun de son côté, d’avoir fait une « bonne affaire », c’est qu’ils se félicitent de s’être mutuellement « roulés ».
Combien cela est loin d’un achat de beauté pour le seul plaisir d’acquérir de la beauté ! Et combien le « connaisseur » est mal fondé, souvent, de récriminer sur une acquisition qui « l’emballa », lorsque le doute sur la qualité esthétique de cette acquisition coïncide avec un soupçon d’inauthenticité. Malheureusement, la passion du collectionneur n’est pas toujours élevée, et l’on pourrait ranger parmi les maniaques, ces enragés de la vieillerie pour la vieillerie, qui accumulent, sans souci d’art, des vestiges du passé, avec le même empressement qu’ils entasseraient des cartes postales ou des tickets d’autobus.
Écoutez, d’ailleurs, les erreurs singulières engendrées par l’enthousiasme frénétique à l’égard du passé. Nous découpons dans un article de la Presse, les lignes suivantes : « On achève en ce moment une église anglicane, avenue de l’Alma. Elle est toute neuve, toute blanche, curieuse à voir. Et les connaisseurs de grommeler : « Les architectes d’aujourd’hui ne savent plus rien faire ! Hélas ! où sont les sublimes artistes du XIIIe siècle, qui faisaient jaillir du sol de si beaux clochers vers le ciel ! » Or, le hideux clocher de l’avenue de l’Alma est la copie scrupuleusement fidèle d’une admirable église de Caen, Saint-Étienne, qui date du XIIIe siècle… »
En poursuivant la lecture du même article, le mirage flatteur de l’antiquité s’accentue : « … Je connais, dit M. Klotz, un marchand de produits chimiques, très enrichi par l’aniline, qui avait acheté les ruines d’un château féodal. Il a dépensé des millions à rendre au manoir son primitif aspect. Rien ne manque à la clef : ni pierres massives, ni fossés traîtres, ni pont-levis hypocrite. Pourtant le paysan des alentours, lui-même, sent « que ce n’est pas ça ». Pourquoi ? Faut-il en trouver le motif dans cette belle strophe de Victor Hugo :
Mais la poésie jouit d’une immunité due à l’élévation pour le moins théorique, de la pensée. Elle plane et auréole tout, par essence. Emportée « sur l’aile du Verbe », elle se rit de l’esthétique, un sens exact ; sa générosité déborde. Sentimentale, grandiloquente, la rime s’égare génialement hors de la raison. Néanmoins, malgré que la beauté se confonde charitablement avec la laideur, dans la religion et la poésie ; malgré souvent que le vice triomphe de la vertu au bout d’un beau geste oratoire ; malgré encore que la pensée magnifie tout dans un sentiment respectable où communient le souvenir et le regret du passé ; il n’empêche que l’esthétique ainsi que la vertu, reposent sur des lois fondamentales.
Que les préférences personnelles discutent ces lois, soit ! mais l’art ne se paie pas de mots, et, si la conscience est la pierre de louche de la vertu, la compétence est l’honnêteté du jugement artistique.
La « croix de ma mère » peut être esthétiquement hideuse, en dépit du sentiment qu’on y attache, et si le temps présente avantageusement un monument, un tableau, un meuble, encore faut-il que la qualité intrinsèque de l’œuvre domine la piété du passé. Je sais bien que la sensation d’art et le caractère, prétendent rivaliser avec la saine évidence de la beauté. Autre hérésie à combattre. D’abord, la sensation d’art ne peut résulter d’un malaise, elle ne doit émaner que de l’esprit normal et expérimenté. L’hystérie mentale a comblé l’impressionnisme, du « tachisme » au « cubisme ». La sensation d’art des snobs est d’une « rareté » stupide et, si les bananes pourries charment leur palais, les roses malodorantes prisent leur odorat, sans nous surprendre.
Les étoffes (et les tableaux) à l’envers, font harmonieusement les délices, encore, de ces invertis, et leur sensation d’art naît simplement de leur ignorance compliquée. Quant au caractère, il ne faudrait pas davantage exagérer son excuse.
Certes, nombre de visages ingrats et de si les galeux immunisent le caractère jusqu’à se réclamer de la beauté. Nous ne contredirons pas, non plus, à la puissance du charme – cet autre expédient de la beauté – mais encore siérait-il de ne pas laisser l’incompétence errer sur des nuances qui lui échappent.
Concédons donc aux seuls vrais connaisseurs le soin de juger et de détailler, en tout équilibre, ces phases délicates de la vision et du sentiment. Malheureusement, le retour à la naïveté a voulu faire échec à l’entendement sain, au savoir basé sur l’expérience.
Cette apothéose de la niaiserie, pour faire diversion, fut nécessairement saluée par nos snobs. Du coup, ceux qui savent allaient être désorientés ! Et l’on recourut encore au passé mystérieux, sanctifié de sensation d’art et de caractère, ces deux échappatoires, – renforcées de naïveté – à l’ignorance.
C’est ainsi que les graveurs retournèrent au canif, les musiciens à l’épinette et les auteurs dramatiques aux théâtres de la nature. Cette exhumation du primitif était d’une originalité !
Ainsi donc, l’exquise naïveté allait accentuer la débâcle de l’erreur prétentieuse ! et voici que l’on se pâma sur des maladresses, sur des laideurs, sur des œuvres nulles qui jouaient à la fraîcheur de l’ingénuité.
Ainsi donc notre siècle « roublard » allait assister à cette singulière rénovation de l’innocence, sous les auspices de l’hystérie !
Comment avoir le cœur, après cela, de blâmer les profiteurs-marchands lorsqu’ils trompent sur la qualité de la laideur vendue ! Le goût suit la mode, les marchands emboîtent le pas.
Un lapidaire avait vendu à la femme de l’empereur Gallien des pierreries que l’on reconnut pour fausses. Gallien fit arrêter ce marchand malhonnête et le condamna aux lions : mais, quand le moment du supplice fut venu, il ne fit lâcher contre lui, dans l’amphithéâtre, qu’un chapon. Et comme chacun s’étonnait et cherchait le sens de cette énigme, un héraut expliqua la pensée du monarque : « Cet homme a voulu tromper, il est attrapé à son tour. »
À cette anecdote où nous voyons un dupeur généreusement dupé, nous joindrons cette autre qui prouvera aux marchands que souvent le mieux, en matière d’imitation, est l’ennemi du bien. Phèdre raconte dans une de ses fables, qu’un célèbre histrion était chargé d’amuser le peuple en imitant le cri d’une oie. Un paysan avant voulu surpasser l’histrion fit crier une oie véritable qu’il avait cachée sous son manteau : il fut sifflé.
Ce qui intéressait le peuple romain, ce n’était pas le cri de l’oie, mais l’heureux effort de l’histrion pour imiter ce cri. On a écrit justement que les Romains, avant de piller la Grèce, n’étaient que des « bourgeois ». « Leur consul disait à ses intendants militaires que, s’ils cassaient une statue de Phidias, ils seraient obligés d’en fournir une autre du même marbre et de même dimension. »
Mais les marchands n’en sont point à cela près de créer de toutes pièces des « Phidias » pour de faux connaisseurs qui n’ont, en réalité, que ce qu’ils méritent.
Souvenez-vous plutôt de l’aventure de la tiare de Saïtapharnès (fig. 1), de cette œuvre d’art tant prônée, jusqu’au moment où l’on apprit qu’elle était moderne !
Ainsi s’évanouissait à cette révélation, le miracle de sa beauté ! Nos savants avaient écrit monts et merveilles sur cette tiare soi-disant antique, trésor du musée du Louvre, coûteusement acquis, et ils s’étaient longuement répandus en érudition sur la description, tant esthétique qu’historique, du motif de ciselure principal…
Que d’étonnantes et doctes choses ne lurent-ils pas ces savants, sur cette ciselure qui, cependant, était de pure invention moderne !
Mais, le ridicule confondit surtout la qualité de cette admiration, lorsque l’artiste polonais Chouroumousky auteur de la fameuse tiare, se dénonça… Le chef-d’œuvre d’hier, soudain n’était plus, et il descendit de son trône, que dis-je, il fut honteusement exclu du Louvre !
Cela nous rappelle la visite d’un artiste chez un « amateur » dont les extases sont particulièrement acquises à un certain buste de la Renaissance. L’artiste examine le buste, il est fort beau. Pourtant, l’original de ce buste se trouve à Florence et l’amateur n’a, en sa possession, qu’un excellent moulage. « Un moulage ? s’écrie l’amateur furieux, vous en êtes bien sûr ? – Certain. – En foi de quoi, le moulage fut brisé. L’authenticité de l’œuvre importait donc, seule, à cet « amateur » comme il y en a tant !
Restaurations : Pièce aux cheveux à droite et au côté de leur nœud derrière, oreille droite, partie du sourcil et de l’œil gauche. Menton, bouche et bas du nez avec un peu des joues, bas du cou et un peu du baudrier, deux pièces à l’épaule droite, principal du bras, mains (avant-bras), poignard, son fourreau, plusieurs pièces de la tunique, pièce au jarret droit, cuisse, jambe, pied gauche avec la plinthe et l’arbre !
Voici un exemple analogue. Il s’agit, cette fois, d’une suite au « bluff d’Antinoë » mais moins tapageuse. Le musée Guimet vient d’inaugurer de nouvelles salles et une nouvelle exposition des fouilles de M. Gayet, en Égypte. « Oit est le temps, observe le Cri de Paris, où le Tout-Paris se précipitait au musée Guimet pour admirer les momies de la pseudocourtisane Thaïs (fig. 2) et du pseudo-anachorète Sérapion (fig. 3) ? Où est le temps où M. Gayet, qui n’a jamais rapporté une inscription pour authentiquer ses dires, disait gravement au public en montrant ses macchabées : « Ceci est une prophétesse ; cela c’est une bacchante. » Ces temps maintenant semblent légendaires ; cette année, l’explora leur se contente d’explorer des cadavres sans les désigner plus explicitement. »
Nous allons voir l’intérêt artistique s’envoler singulièrement aussi, dans le récit suivant : « On se souvient dit le Journal, de ce buste de cire (fig. 5) que le docteur Borde, conservateur du musée de l’empereur Frédéric, à Berlin, a payé 231 250 francs, comme étant un Léonard de Vinci authentique (l’empereur Guillaume II, au surplus, s’était porté garant de l’authenticité de ce buste !) et qui a été ensuite reconnu être d’un sculpteur anglais du nom de Lucas décédé à peu près inconnu.
Restaurations : principal du nez, raccords au front, de la bouche et au menton, cou !
« Quatre-vingt-dix œuvres de ce dernier ont été vendues dernièrement aux enchères, chez Christie, à Londres, et, malgré la réclame faite à Lucas par l’affaire de Berlin, le moulant de la vente ne s’est élevé qu’à 10 000 francs.
« Un groupe ; Mère et Enfant, dont la facture rappelait beaucoup celle du fameux « buste de Léonard » du docteur Borde, n’a pas dépassé 197 francs !… » Nous avons dit les déconvenues d’amour-propre, plutôt que les déconvenues d’art, de ces fureteurs d’antiquité à tout prix, et nous savons que le désir de faire une « bonne affaire » est le plus souvent inséparable de la manie d’acquérir. Il ne s’agit plus que de s’entendre sur les nuances de cette bonne affaire.
La rareté, pour certains, se mesure au peu d’ardent débourse. On se dit connaisseur et le marchand ignorait soi-disant la valeur de son trésor. On l’a eu « pour une bouchée de pain ». Ici, c’est le marchand qui aurait été volé, il y a des exemples de cette anomalie.
Pour d’autres, la forte somme est une condition sine qua non, de la « bonne affaire ».
D’où deux sortes d’amateurs : ceux qui achètent pour le plaisir et ceux qui achètent « pour la galerie ».
Les premiers prétendent savoir acheter et, en tout cas, ils donnent toujours à leurs bibelots une valeur supérieure au prix qu’ils les payèrent ; les seconds affirment « que l’on en a toujours pour son argent », et ils font sonner haut, comme une référence (et comme une garantie donnée à leur ignorance) l’importance de leurs débours. En tout cas, l’amateur qui parade devant son Velasquez « qu’il a payé un million » n’est pas plus intéressant que celui qui se vante d’avoir acquis « pour cinq francs » son Corot. Il y a des extrêmes stupides.
Restaurations (plâtre) : principal du bras, du corps et des jambes, pieds, rocher, plinthe !
Au résumé, les deux manières ne valent que par la qualité de l’achat qui justifie seule la qualité de l’acheteur, malgré qu’il y ait la différence de la joie que l’on s’offre.
D’autre part, il est piquant de remarquer que cette double clientèle ne satisfait pas moins le marchand et, pour ne pas inquiéter le marché, il importe simplement que le plus heureux des trois ne soit pas celui qu’on pense. Nous verrons, d’ailleurs, combien le marchand connaît ses clients, suivant les degrés de l’illusion à servir, du goût à satisfaire, de la manie à contenter, et, d’ores et déjà, soyons indulgents à la fraude lorsqu’elle nous venge de la sottise.
Si l’antiquité est une religion, ses faux prêtres – certains marchands – trouvent leur excuse dans la masse saugrenue des fidèles.
Les trésors de l’antiquité, logiquement, s’épuisent, en raison directe d’une foi insatiable, et le marchand doit avant tout, satisfaire sa clientèle. D’où une fabrication intensive de vieilleries, d’où le truquage – mensonge pieux à la beauté consacrée, vis-à-vis de ses adorateurs sacrilèges. Mais qu’importe, pourvu que l’illusion demeure ! « En Angleterre, écrit M. le Dr F. Jousseaume (les Vandales du Louvre), qu’un tableau soit intact ou rafistolé, qu’il soit signé ou non, on le vend tel qu’il est. Si on a des renseignements sur sa provenance, on vous les donnera. S’il a été expertisé, on le dira ; mais, lorsqu’il est vendu, il n’y a plus de recours. Ce qui est vendu est vendu.
« En France, ce n’est pas tout à fait la même chose. Ce qui est vendu est vendu pour le marchand, mais ne l’est pas toujours pour l’acquéreur. Nous avons partout de petites restrictions. Il faut bien que tout le monde vive ; que deviendraient les médecins sans malades et les magistrats sans procès ? »
Or, cela concerne la brocante en général, et, cependant, le commerce des illusions a consolé bien des maniaques, a ravi bien des snobs avant de tromper des connaisseurs. Aussi bien, il apparaît singulièrement injuste de voir la loi mêlée à des questions sentimentales. Le client ne doit s’en prendre qu’à lui-même de son désenchantement, car, en réalité, l’importance de la somme versée en échange du désir satisfait n’est que proportionnée à la mesure du désir. Les satisfactions intimes ne regardent personne, et la vanité seule ose s’offenser d’une déception, vis-à-vis des autres.
« Un homme achète une maison ou un tableau : il croit la maison solide ou le tableau authentique. Il s’est trompé dans son acquisition. C’est son affaire ; en quoi cela peut-il intéresser la société ? Est-ce qu’un vendeur ne cherche pas à faire le meilleur marché possible et l’acquéreur également ? » Et M. F. Jousseaume, à qui nous empruntons encore ces lignes, observe non moins logiquement, que « nos législateurs sont vraiment trop aveugles lorsqu’ils placent judicieusement sur le même plan les objets de fantaisies et de collections et les choses agréables indispensables à la vie. »
D’ailleurs, puisqu’il n’y a point de critérium en art, aucune sanction n’est admissible. Au surplus nous verrons, quand nous aborderons le détail de notre objet, que la valeur d’une œuvre artistique, en dehors du sentiment personnel, est le jouet de la mode, du caprice, de la banque les marchands, de la presse et autres facteurs déconcertants.
Restaurations : le bout du nez, les ailes presque entières, les bras, les avant-bras et les mains, les pièces de raccord de la jambe droite, le pied droit, une partie de la cuisse gauche avec la jambe et le pied, plusieurs parties du manteau, les tenons de l’arbre, la plinthe :
« Un tableau ou un autre objet d’art, quelles que soient ses qualités artistiques, est sans valeur s’il n’a pas été chaudement baptisé par les journalistes et confirmé par les experts. Il faut le tambourin, le tam-tam, la grosse caisse, pour attirer sur lui l’attention et le faire passer d’une valeur négative à une valeur positive.
« Un tableau sans sacrements ne vaut rien, et, après son baptême et sa confirmation, il vaut des centaines de mille francs. » (Les Vandales du Louvre.)
Comment, dès lors, s’attarder sérieusement aux déboires de l’idéal ! Passe encore pour les esprits avertis qui demeurent fidèles à leurs premières amours et vieillissent au milieu de leurs bibelots ; mais que penser de ces « collectionneurs » par genre, qui n’attendent que l’occasion fructueuse de disperser leurs coûteux achats ! Ah ! ceux-là, soyez-en certain, se moquent bien de l’art, et, leur ignorance de la beauté trouve sa compensation dérisoire dans la valeur marchande. Lorsque la valeur est bien cotée en Bourse, ils vendent, voilà tout.
Et ces collectionneurs-là sont seuls impitoyables, naturellement, à l’inauthenticité, puisqu’ils sont insensibles à la beauté qui se donne, souvent pour rien, quand on sait, la cueillir et, d’autre part, que leur illusion tient seule dans la garantie du marchand.
En revanche, qu’importe le plus souvent, au connaisseur, cette authenticité ! Il se délecte simplement d’une jolie chose, et sa joie n’est jamais déçue.
Restaurations : bas du nez, parties de l’oreille gauche, partie du bord de l’oreille droite, nuque, creux de la gorge et buste !
Quelle différence faites-vous, artistiquement, entre une œuvre originale et sa copie parfaite ? Savez-vous que nombre d’auteurs eux-mêmes s’y trompèrent, et vous voudriez vous montrer plus royaliste que le roi ?
En ces temps de copie, de truquage, de maquillage extraordinaires, pourquoi analyser excessivement les satisfactions que l’on ressent ! Il n’y a, au résumé, que la foi qui sauve ; l’art ne doit être qu’un article de foi, qu’un contentement délicat du goût raffiné, et, nous abandonnerons à ses déboires, sans intérêt, le goût mesuré aux seules largesses du porte-monnaie, l’enthousiasme borné à un souci de provenance, à la parole d’un marchand.
D’ailleurs, comment s’y reconnaître parmi tant d’expressions ! Du vrai au faux en passant par le rafistolage, le simili-vrai et le demi-faux ! Nous verrons le miracle des patines, le déroutant des placages, le troublant accord des artifices. Et puis, les beautés ne sont-elles pas diversement décrétées par la vogue ?
Nous ne parlons plus, maintenant du véritable amateur dont les joies sont érudites, mais de ces oisifs brocantant par « chie », de ces dilettanti du bric-à-brac, de ces fureteurs d’art improvisés, de tous ces ignorants prétentieux, maniaques ou malades, enfin, pour lesquels on fabrique des antiquités.
Comment s’y reconnaître ? Vous saurez d’abord – ô élève amateur – que le plus grand nombre de nos pièces de musées sont d’authenticité précaire. Aussi bien, on a tellement abusé des « répliques » que nous pouvons toujours concevoir un doute à leur égard et, le plus souvent, une réplique n’est qu’une copie quelconque ; le mot sauve la chose.
Du côté des restaurations, même hésitation ; où commence une restauration et où finit-elle ? Voyez plutôt les fâcheuses restaurations de certains antiques, au Louvre (fig. 8 à 15) ! Restaurations excessives autant qu’inutiles, dues à des artistes très inférieurs. Du côté des reconstitutions, pareille indécision ; et que valent, au point de vue de l’authenticité, les sereines classifications modernes ? Ne vous fiez pas, surtout, à une signature, rien n’est moins probant, et, en attendant que, matière par matière, nous conseillions au lecteur des moyens rationnels de vérification, poursuivons l’énumération des risques d’erreur promulguée en haut lieu. Oui croire, grand Dieu ! si nos musées nationaux, eux-mêmes, ne sont point infaillibles ! Et cependant, voisinant avec de prudentes attributions, que d’étonnantes affirmations, que d’inutiles hérésies imposées à l’admiration innocente !
Restaurations : nez, partie de la joue gauche, principal de la lèvre supérieure, l’autre lèvre, menton, pièces et raccords au voile, à la tunique auprès des mains, attributs, manteau au-dessous de l’avant-bras gauche et le devant de la frange, pièces du reste du manteau, bas de la tunique, pieds, plinthe !
Le catalogue d’un musée est le pédantisme même ; il est victime du renseignement forcé ; sa lecture, le plus souvent, initie moins qu’elle consterne.
Gardons-nous, surtout, d’en lire la préface, qui semble le frontispice d’un tombeau.
Si, d’autre part, nous recourons à un ouvrage d’art pour étudier une œuvre, fuyons le livre du littérateur égaré dans les choses de l’art ou celui de l’universel pédagogue, généralement incompétent, si tant est que l’on ne peut tout savoir.
Les belles images, en ce cas, dispensent avantageusement de la littérature oiseuse.
Malheureusement, c’est dans la littérature incompétente que se rééditent les lieux communs, les aberrations du passé, toutes les vieilles « balançoires », enfin, que, religieusement et aveuglément, les époques se repassent.
Restaurations : nez, lèvre supérieure, grande partie de l’inférieure. Côté gauche du sourcil, menton, bas des joues et cou, partie des oreilles, parties de la couronne de chêne et raccords du front !
Ainsi Winckelmann a-t-il voulu faire de l’Apollon du Belvédère un pur chef-d’œuvre, alors que cette statue, avec ses tares incontestables, se rattache ni plus ni moins à la décadence grecque.
Winckelmann, savant archéologue, sortit cette fois, fâcheusement, de son rôle ; il est vrai que l’archéologie empiète volontiers sur le domaine de l’art et, rependant, l’âge des choses n’a rien de commun avec l’esthétique, non plus que la philosophie, qui amena, par exempte, le père de l’éclectisme, le grand Victor Cousin, à comparer dans Le Vrai, Le Beau, Le Bien, l’église de la Madeleine… au Panthéon !
Mais passons, non sans constater – pour ajouter au désarroi du néophyte – que la critique d’art est, le plus souvent, confiée de nos jours, à d’étonnants improvisateurs. Cette anomalie, au reste, est un signe des temps. Les artistes de profession, les vrais connaisseurs, seraient incapables de la souplesse d’opinion exigée aujourd’hui. Ils se refuseraient à violer leur conscience, à nier leur science, pour un caprice de la mode. Tandis que la critique d’art improvisée, fort honnêtement souvent, mais avec l’ingénuité de l’ignorance, se met, au contraire, volontiers, dans le mouvement.
Admettez, au surplus, que des influences soient vénalement mises au service de certains trafiquants, et voici que des œuvres abominables pénètrent au musée qui les cote, leur donnant une valeur marchande, à défaut d’une valeur artistique.
Restauration : bout du nez, cou, ailes excepté la naissance de la droite, bras droit, avant-bras et mains, majeure partie du bras gauche, majeure partie de la cuisse droite, jambe et pied, jambe gauche, pied, carquois, arbre, plinthe !
C’est le mouvement moderne opposé au vieux jeu, prétentieux argument qui masque élégamment une impuissance ou une loyauté qui n’est plus de mise. Il faut être de son temps, que dis-je ? de son heure.
Hélas ! plus nous développerons notre idée, plus s’accentuera le chaos du critérium artistique chez ceux dont le goût et le jugement n’est pas fixé, chez ceux dont l’éclectisme ne cache que de l’incompétence.
Pour en revenir à notre amateur, nous admettrons maintenant, qu’il a trouvé le chemin de sa documentation, théoriquement du moins, puisque nous avons pris nécessairement notre exemple parmi les profanes.
Ici donc, la mode va intervenir. Autre trouble. On décrète aujourd’hui que les peintres « impressionnistes » ont seuls de la valeur (nous ne disons pas : du talent) et que le meuble moderne fait prime.
Alors, notre néophyte donnera facilement raison à l’engouement et au chic traditionnel, en réservant dans son esprit, sinon dans sa galerie, une place pour les « impressionnistes » à côté des peintres du vieux temps. Et, comme il ne s’y connaît point encore (s’y connaîtra-t-il jamais ?), le choix de ses peintres anciens sera aussi détestable que celui de ses impressionnistes, mais le snobisme sera satisfait, normalement si l’on peut dire.
Du côté des meubles, pareille incohérence. Après tout, quand on collectionne sans discernement, les mauvais meubles modernes valent bien les mauvais meubles anciens.
Bref, malgré les efforts de la mode, l’antiquité triomphe toujours, au point que, répétons-le, ses plus laides manifestations même, sont acclamées. Le snobisme joue sur le mot de « rareté ». L’antiquité se fait rare, et certaines audaces modernes sont d’un rare mauvais goût, que les snobs prennent pour le chic suprême.
Peu importe, cela est rare, original, puisqu’il n’y en a pas partout. L’excentricité ne peut être commune sans faillir à l’excentricité essentielle et, pour ne pas être banal, on se distingue, au mépris de la manière. Sans quitter le point de vue général, car nous reviendrons sur la peinture, séparément, nous retournerons au musée, censément, logiquement, l’éducateur le plus qualifié du goût et de la véracité.
Nouvelles déceptions. Nombreuses erreurs de styles pour les meubles et, quant aux tableaux, aux statues, n’allez pas croire qu’ils sont tous admirables, malgré le miracle hallucinant de leur vétusté ! Ah ! la foi dangereuse des cartouches, tantôt d’une témérité risible, tantôt d’une savante obscurité. Ah ! le boniment fallacieux du gardien de musée, du guide. Nous ne parlons pas des fausses antiquités, abondantes, des classifications imprudentes ou impudentes. Pourtant, Dieu que tout cela est savant ! Comment voudriez-vous, aussi, que la science sache tout ? À côté de l’évidence, n’est-ce pas ? il y a la docte hypothèse, le verbiage à côté de l’utile parole et puis, l’intention, la volonté, le devoir de renseigner quand même. C’est votre faute, voyons, pourquoi êtes-vous si curieux ?
Ainsi, certaines vastes armures exposées au musée d’Artillerie, si peu en rapport avec notre plus haute stature actuelle, vont vous rendre rêveur, et vous allez sans doute en déduire l’amoindrissement de la taille humaine à travers les âges ? Quelle erreur est la vôtre (après celle des conservateurs du musée) ! Ce sont des enseignes d’anciens armuriers allemands.
Notre néophyte, en fin de compte, accentue son ahurissement.





























