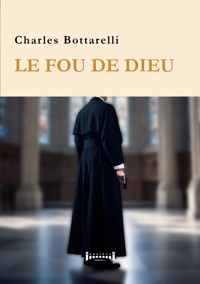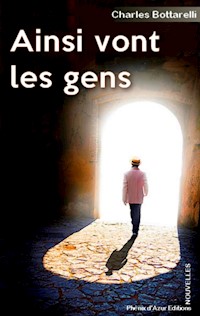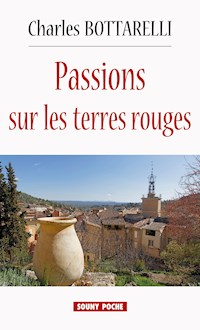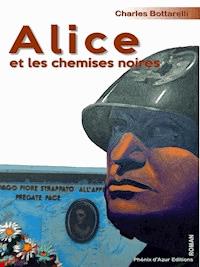
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phénix d'Azur éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le destin d'une femme sous Mussolini.
En parcourant les allées du cimetière d’un village lombard, l’attention de l’auteur est attirée par une pierre tombale portant la photo d’une jeune femme. Au vu des dates, il réalise que la presque totalité de sa vie s’est déroulée sous Mussolini. Il ne sait rien d’elle et éprouve l’envie irrésistible d’imaginer ce qu’a pu être la vie de l’enfant, puis de l’adolescente, et enfin de la jeune femme qui n’a connu que le régime fasciste. Cette biographie imaginaire est l’histoire de la prise de conscience d’un être qui veut s’arracher à sa condition, mais aussi un prétexte pour brosser un tableau de vingt-trois ans d’un pays opprimé. On y fait quelques rencontres étonnantes ; l’irruption des premières émissions de radio, du cinéma parlant, ou encore celle d’un musicien célèbre nommé à la direction de l’Opéra de Florence, mais surtout militant actif de la Résistance. Et on constate que cette histoire de nos voisins nous renvoie souvent à la nôtre…
A travers la biographie imaginaire d'une jeune femme, découvrez un récit retraçant 23 ans d'histoire italienne.
EXTRAIT
Alors, comme elle l'avait fait pour Mario, l'an dernier, elle a décidé d'intervenir sans prévenir personne. Cette fois, la partie est plus difficile. Avec Clara, elle a des rapports d'amitié. Avec Martelli, c'est bien différent : tout le monde tremble devant lui. Elle ne peut compter que sur la déliquescence qui gagne la hiérarchie fasciste, et qui conduit chaque notable à prendre seul la décision qui l'arrange, tout en démontrant qu'elle procède de la volonté du Duce.
Elle attend depuis dix minutes dans l'antichambre. Elle était précise au rendez-vous, mais la faire entrer tout de suite serait d'une banalité que Martelli ne saurait se permettre. Elle repense à ce que Giacomo lui a dit hier soir, à ses espoirs de devenir permanent à Rome. Et à cet étourdissant moment d'amour, où pendant un instant elle a cru perdre la raison.
Quand Martelli la fait entrer, il ne lui dit pas de s'asseoir. Sur son bureau, elle remarque un gros cendrier de cristal, un sous-main de cuir rouge à la bordure dorée. Au mur, un portrait de Mussolini, et un diplôme sous verre.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Charles Bottarelli est né en novembre 1941 à Toulon, de parents ouvriers horticoles. Il a vécu toute son enfance et son adolescence dans sa ville natale. Il en conserve un goût marqué pour l'histoire de sa région. Le choix d'une carrière dans la fonction publique l'amènera successivement à Lyon, Paris et Marseille, avec retour à Toulon en 1970, Entre 1995 et 2006, il s'investit dans le mensuel satirique
Cuverville qui combat l'extrême-droite installée à la mairie. Le temps de la retraite professionnelle venu, il décide de se consacrer à l'écriture. Un premier livre, à caractère documentaire, est publié en 2004 :
Toulon 40, chronique d'une ville sous l'Occupation. Puis, en 2006, c'est un roman
Alice et les chemises noires, qui est la biographie imaginaire d'une jeune fille sous Mussolini.
D'une façon générale, il veille à situer précisément ses personnages dans le lieu et dans le temps, n'hésitant pas à mêler la fiction pure à des situations réelles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alice
et les chemises noirs
ROMAN
Charles BOTTARELLI
Qu’est-ce à la fin que l’être emporte
Dans la fixité de ses yeux
Qu’y reste-t-il qui fut les cieux
Avec lui quelle étoile avorte
ARAGON (Les Poètes)
« J'ai reçu ton livre ce matin, et depuis je marche en Italie, sous le soleil de juillet ou la brume de novembre. On invente une Alice et on en tombe amoureux, surtout lorsqu'elle est aussi audacieuse et belle. Ton Italie aussi est forte, sensuelle, et pleine de vie ».
Un après-midi de juillet
Le soleil qui s'abat en début d'après-midi sur San Giovanni in Croce semble avoir figé toute vie. Quelques maisons, pour la plupart de vieilles fermes, rassemblées autour de la route nationale. Les automobilistes traversent ce petit village de Lombardie sans même le remarquer, sans ralentir.
Rien n'attire l'attention, rien n'arrête le regard. Les demeures sont basses et allongées, le bourg se fond dans la plaine qui l'entoure. La place principale est déserte en cette heure sacrée de la sieste. Seul se distingue le jardin ombragé qui la borde à l'est et qui doit servir de terrain de jeux aux enfants de l'école proche.
Celui qui trouve une raison de s'arrêter ici se prend à imaginer quelques trésors cachés derrière les murs épais, quelques signes discrets d'une prospérité qui n'ose pas s'afficher. C'est qu'avant d'arriver, le voyageur a longé des champs de maïs à n'en pas finir, des décors de vert tendre malgré la chaleur, des canons à eau jetant d'impressionnantes rafales nourricières. Il a croisé au hasard des routes des machines agricoles rutilantes et compliquées, comme autant de preuves d'opulence. A quelques kilomètres du Pô, San Giovanni semble tirer de la terre fertile une tranquille aisance.
Cependant, la modestie des plus vieilles maisons ramène vite le voyageur aux réalités.
Avant l'ère des paysans modernes, on imagine des hommes rugueux et secs. On les devine, le visage taillé par l'effort, dans un incessant combat livré contre le sol. Une lutte inégale pour arracher à la plaine pas encore fécondée par les travaux d'irrigation de quoi faire survivre une famille qui ne cesse de s'agrandir. Une lutte toujours perdue et toujours recommencée parce qu'on n'a que le choix entre s'épuiser sur place ou partir.
A l'aube du vingtième siècle, les plus courageux, les plus entreprenants, ou, peut-être, les plus désespérés, ont choisi d'aller chercher un autre destin au-delà des Alpes. Fatigués de recevoir si peu d'une terre à laquelle ils donnaient leur vie, ils fuyaient vers l'ouest, croyant y trouver leur pain blanc.
Ce voyageur, qui aujourd'hui fait le chemin inverse dans l'espoir de retrouver ses racines, pénètre dans le petit cimetière. Il est d'abord surpris par la beauté du lieu. C'est un endroit soigneusement abrité du reste du monde par un haut mur. Au fond, une petite chapelle surmontée d'un dôme. De part et d'autre, des sépultures fières, à l'architecture élancée. Celles des notables, sans doute. Le voyageur pense que la mort, contrairement à ce qu'on dit, n'abolit pas les barrières sociales. La plupart des tombes ont été refaites récemment, en granit ou en marbre. Il ne reste plus que deux ou trois allées de tombeaux en ciment brut. Toutes sont propres, ornées de fleurs et de statuettes, pimpantes en quelque sorte. Elles sont parfaitement rectilignes, aucun brin d'herbe ne vient en perturber l'ordonnance. Ici, le culte des morts (ou de la mort ?) semble relever d'une suprême élégance.
Sur la droite, deux vieilles femmes s'affairent autour d'une sépulture. L'une, de ses mains noueuses arrache les mauvaises herbes. L'autre, la tête enveloppée dans un fichu noir, arrose par petites touches. De temps à autre, elles s'interrompent pour observer le visiteur du coin de l'œil. Leurs gestes sont lents, trop lents pour ne pas révéler que leur attention est en réalité tournée vers l'homme. Que peut bien venir faire cet intrus dans leur domaine quotidien, sur leur terrain privilégié ?
Le voyageur arpente en tous sens les allées étroites, à la recherche d'une dalle qui porterait son propre nom. La curiosité des deux vieilles femmes ne fait que grandir devant ce qu'elles considèrent comme un manège bizarre. Elles le dévisagent maintenant sans retenue.
N'ayant pas trouvé, il s'en va consulter les plaques apposées sur le mur du columbarium, côté gauche. Presque toutes sont garnies d'un bouquet séché, et d'une ampoule allumée en permanence. Il parcourt lentement les noms et les dates gravés quand son regard est retenu par une photo sertie dans un médaillon. Sur le panneau de ce marbre rose qu'on trouve dans la région, il peut lire : "Alice BATTISTONI, 2-11-1924, 16-7-1947". La photo montre une jeune femme très belle, aux grands yeux noirs, au visage plutôt arrondi, avec des traits fins, presque fragiles. Pourtant, il y a dans le regard une détermination sereine, comme une force irrépressible. On devine une femme active, sûre d'elle-même, de l'avantage que lui conférait sa beauté.
Les dates de sa naissance et de sa mort retiennent l'attention du voyageur. Fin 1924, quand elle vient au monde, il y a déjà huit mois que les fascistes ont installé une majorité à la Chambre, six mois qu'ils ont assassiné le député socialiste Mattéotti. Dans deux mois, Mussolini annoncera la fin du régime parlementaire. Et quand elle mourra, il n'y aura guère plus de deux ans que son pays aura pu se défaire du dictateur.
Alors, les questions se bousculent. Cette femme, dont la presque totalité de la vie s'est déroulée sous le fascisme, qui était-elle ? Quelle a pu être son existence ? Que faisait-elle ? A-t-elle eu le temps d'avoir des projets ? Des amours ? À quoi croyait-elle ? Pourquoi est-elle morte si jeune ? Et d'autres interrogations moins importantes comme la raison de ce prénom à consonance française.
Le voyageur, tout en s'attardant sur la régularité de ses traits, se demande comment elle a vécu. Il est intrigué par l'expression de modernité de son visage. S'il n'avait eu que la photo, sans les dates, il l'aurait prise pour une femme d'aujourd'hui. Était-ce une fille de notable terrien, ce qui expliquerait son air assuré, ou une enfant de la misère s'arrachant à sa condition ? Et surtout, pourquoi l'injustice fondamentale de la mort l'a-t-elle frappée à moins de vingt-trois ans ? Maladie, accident, crime, suicide ?
À partir de là, il ne peut que formuler des hypothèses. Il dispose seulement de trois éléments concrets : son nom, la date de sa naissance, et celle de sa mort. Ce que fut sa courte vie, il ne peut que l'imaginer. La photo a sans doute été prise peu de temps avant sa disparition, car c'est celle d'une femme à l'aube de sa maturité. Avait-elle à ce moment-là des raisons de craindre une fin prochaine ?
Peu à peu, cette belle inconnue lui devient familière. Il la sent proche de lui, et ne peut se résoudre à détourner le regard. Lentement, une à une, les choses se précisent, s'agencent harmonieusement, se vérifient les unes les autres. Il voit Alice naître, puis grandir dans les rues de San Giovanni, entourée de nombreux frères et sœurs. Il entend ses éclats de rire. Le timbre de sa voix parvient jusqu'à ses oreilles. Il ne sait plus très bien s'il imagine, ou si sa mémoire lui renvoie des images qu'il croyait enfouies, quelque écho affaibli d'une vie antérieure.
Très vite, il n'a plus à solliciter son imagination. Oui, il la connaît, il la reconnaît. Le personnage prend vie devant lui. Il va se contenter de l'observer, de l'épier, de détailler ses gestes et ses paroles. Puis il tentera d'en parler aussi fidèlement que possible.
Il est certain qu'il ne se trompera pas, qu'il ne la trahira pas, qu'il sera au plus près de la réalité. Il est sûr de ne pas profaner la vie possible d'Alice BATTISTONI car, ainsi que l'écrivait Boris Vian, "Les quelques pages de démonstration qui suivent tirent toute leur force du fait que l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre".
Là-bas, les deux vieilles, enfin rassurées, ont repris avec application le cours de leurs travaux.
1924
Dans la brume du petit matin, dans le froid, Mauro Battistoni est déjà arcbouté sur sa terre. A l'aide d'un sarcloir dont il vient de refaire le manche avec une branche de chêne, il racle les dernières herbes. Ensuite, il coupera les choux-fleurs. Demain, c'est jour de marché à Casalmaggiore. Dès l'aube, il attellera le vieux cheval. Il rejoindra son emplacement habituel sur la Place de l'Hôtel de Ville. Il essaiera de vendre tout ce que l'automne finissant lui aura permis d'extirper de son champ.
Mais il n'est pas très à l'aise, Mauro Battistoni. C'est que nous sommes le 2 novembre, jour des Trépassés. Il est probable que, de là-haut, Dieu n'est pas trop satisfait de le voir travailler aujourd'hui. Pourtant, il faut bien nourrir la famille. Les six enfants ont de plus en plus d'appétit. Et il y a Marisa, qui est encore enceinte, qui doit accoucher bientôt. Elle est toujours si pâle, la fragile Marisa. On se demande comment elle tient debout. On se demande comment elle fait pour accomplir tout ce travail, tenir sa maison, ses enfants propres, et par-dessus le marché, donner un coup de main aux champs. On se demande où elle va puiser toute cette énergie, elle qu'un souffle de vent pourrait renverser. Elle ne se plaint jamais. Mais un jour, c'est sûr, elle finira par s'écrouler d'un coup. Pour repousser ce moment le plus loin possible, il faut bien trouver le moyen de lui offrir de temps à autre un morceau de viande. Elle en a besoin pour se refaire le sang, et du sang on se demande si elle en a vraiment, elle qui est si blanche sous ses cheveux noirs.
C'est vrai, il faut respecter Dieu. Mais il faut aussi s'occuper de la famille. Travailler aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un gros péché si c'est pour sa femme et ses petits. Mauro a trouvé : il ne travaillera que le matin, espérant faire plaisir à tout le monde. Dieu doit pouvoir comprendre ça. Il suffit que Mauro pense très fort au fond de sa tête. Qu'il pense à la douleur au creux de l'estomac de l'enfant quand il pleure de faim. S'il y pense très fort, Dieu ne se fâchera pas.
Il crache dans ses mains et reprend l'outil. Le soleil commence à percer la brume mais il fait encore frais. Il faut profiter de la fraîcheur pour en faire le plus possible. On travaille mieux, plus vite.
Quand il se redresse pour masser ses reins, il reconnaît, très loin, la silhouette d’ "Il Giornalista". En fait, il reconnaît plutôt le grand chapeau noir surmontant la cape, et le bâton de berger qui heurte le sol avec une régularité d'horloge. Depuis toujours, Eugenio de Carli est désigné par le surnom d'Il Giornalista. Retraité des chemins de fer, il est l'un des rares, avec l'institutrice et le curé, à savoir vraiment lire. Il est abonné à plusieurs journaux de Rome et de Milan. Il passe son temps à expliquer au village entier la marche des affaires. On l'arrête souvent pour lui demander des explications sur la politique, le comportement des gouvernants. On l'invite à prendre un verre pour s'enquérir des risques d'une nouvelle guerre. À force de renseigner les uns et les autres sur la marche de la planète, il a acquis une compétence universelle, une autorité indiscutée. On le consulte sur le nom d'un médecin de Cremone pour les rhumatismes, l'adresse d'une sorcière qui enlève le feu, les horaires du car pour Parme. Eugenio est devenu un oracle indispensable à la vie du village. Quand il n'a pas de réponse immédiate, il cherche et finit par trouver. On se demande comment on ferait s'il n'était pas là, et on souhaite qu'il meure le plus tard possible.
Heureusement, il n'a pas l'air disposé à mourir. Grand et large, une tignasse blanche mais encore bien drue, les moustaches lissées comme pour aller au bal, il porte beau sa retraite toute fraîche. Veuf depuis des années, il n'a pas tardé à s'attacher les services de Stefania, plus jeune que lui de quinze ans, qu'il présente comme sa gouvernante. Chacun sait que la prestation de Stefania s'étend bien au-delà des travaux domestiques. Mais Il Giornalista est trop précieux pour qu'on y trouve à redire.
De loin, il agite son bâton dans les airs. Il doit avoir une nouvelle importante à diffuser.
- Mauro, ta femme est en train d'accoucher !
C'est toujours ainsi. Il se laisse toujours surprendre. Jamais il ne parviendra à être présent dès le début. Chaque fois qu'il y a une naissance sous son toit, c'est toujours au bout du champ qu'on vient le prévenir. Il se dit qu'il mourra sur cette saloperie de terre, que c'est sa destinée.
- Je suis allé chercher Sandra, dit Eugenio, c'est la meilleure sage-femme de toute la Lombardie. T'en fais pas, avec elle, ça se passera bien. Elle a dit que ça irait vite, c'est normal pour le septième.
Mauro pense que ce n'est pas le septième, mais le huitième puisqu'il y a eu cette fille morte.
- Va, file devant, dit Il Giornalista, je ne marche pas aussi vite que toi.
À travers ses semelles trouées, il ne sent même plus les cailloux du chemin. Travaillant souvent pieds nus, sa peau est devenue corne. Il marche, il court, et sa pensée va aussi vite que lui. Le septième, pourvu qu'il vive. Des frais supplémentaires. Il faudra louer le terrain de Mazzoni, qui ne l'exploite plus. Il lui en a déjà dit un mot, l'autre paraissait d'accord. Giovanni, l'aîné, va sur les seize ans. Il pourra bientôt se rendre utile. Mais il faudrait s'arrêter d'avoir des enfants. Celui-là arrive le jour des Trépassés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce un signe de chance ou de malédiction ?
Une fois de plus, il se remémore les naissances précédentes : Giovanni, en 1909, Paola en 1911. Renata, c'était en 1914, le jour où il avait tant plu que l'étable était inondée. Mario en 1916, Lucio en 1918, et Claudio en 1922. Et aussi ce nuage dans sa tête. Cette fille née avant terme en 1919, morte après quelques jours. Morte peut-être de la fatigue de sa mère. Du poids des seaux d'eau soulevés. De la courbure excessive du corps sur le parquet à frotter. Des efforts pour tirer la lessiveuse hors du feu. De trop de bois coupé. Du manque de sommeil, les nuits passées à surveiller la fièvre des uns et des autres. Il a oublié son prénom. Ou plutôt, il ne veut plus s'en souvenir. Il a tiré un voile dessus. Elle est seulement cette petite lueur qui vacille au fond de sa mémoire. Il n'en parle jamais.
Ce sera un garçon. D'abord, Marisa avait le ventre pointu. Et les derniers temps, on sentait des coups de pied d'une force extraordinaire, comme un cheval fougueux. Déjà un homme. Carolina, la vieille boulangère, l'avait dit. Depuis quarante ans, Carolina prédisait le sexe des bébés. Il s'appellerait Bruno, comme son grand-père. Pourvu qu'il vive.
Sur le pas de la porte, il entend des voix et des bruits d'ustensiles. Dans la cuisine, il y a déjà beaucoup de monde. Il ne prend pas le temps de saluer et se précipite dans la chambre.
Sandra s'affaire avec autorité tout en encourageant :
- Pousse, Marisa, je vois ses cheveux.
Elle a disposé les bassines d'eau chaude. Elle n'a voulu personne avec elle. Parfois, elle accepte le père, mais pas toujours. Elle entend bien user totalement du privilège de celle qui donne la vie, de la souveraineté que lui confèrent son savoir et sa réputation. Cette chambre, pour le moment, lui appartient. Mauro reste planté à deux pas du lit, les bras ballants. Marisa pousse et crie, ses joues sont étonnamment roses. Il pense que son visage n'est coloré que lorsqu'elle accouche. Il voudrait la voir toujours ainsi. Ne sachant trop que faire, il entrouvre la porte de la cuisine et appelle Paola :
- Viens avec moi, à treize ans tu es bientôt une femme, toi aussi tu feras des enfants.
Il découvre la présence d'Anna, la voisine.
- C'est bien d'être venue, Anna. Je te remercie, mais je n'aurais pas aimé que ce soit ton mari.
- Quand j'ai vu passer Sandra sur sa bicyclette, j'ai pensé que je pouvais me rendre utile, alors je suis venue.
Timide alibi pour tenter d'atténuer des années de froide discorde. Il y a longtemps que Mauro et Giulio, le mari d'Anna, s'ignorent pour des raisons qu'ils ne connaissent pas bien eux-mêmes. Dans le temps, leurs pères se sont battus pour une histoire de clôture déplacée. On n'a jamais su qui avait commencé.
Mauro pénètre dans la chambre en tenant Paola par la main. Sandra jette un bref regard noir tout en massant le ventre de Marisa. La tête est dehors, toute ronde.
- Le plus dur est fait.
Puis quelques poussées, un peu plus longues, avec des gémissements qui inquiètent Paola.
- Voilà, c'est une fille, s'exclame Sandra. Dieu tout puissant, comme elle est belle ! Pas une ride, des cheveux bien fournis, c'est une princesse.
Elle a vite fait de libérer le cordon, et présente l'enfant à Marisa. La surprise et l'épuisement creusent le visage de la mère.
Mauro et Paola l'embrassent. Puis la porte s'ouvre, car l'exclamation de Sandra a été entendue. On vient embrasser Marisa, sauf Anna qui n'ose pas déjà aller aussi loin. Elle sait qu'on doit respecter les formes dans les réconciliations. Chacun s'extasie et donne son avis sur la ressemblance avec la mère, avec le père, avec les frères et sœurs. Dans un coin, Carolina entame une courte prière pour que soit assuré le bonheur de la nouvelle née.
- Allons, sortons, vous voyez bien qu'on la fatigue, dit quelqu'un.
Et tous se retrouvent assis autour de la grande table de la cuisine. A la demande de son père, Giovanni a sorti les verres et sert le vin cuit de la maison.
Elles sont toutes là. Celles qui sont présentes à chaque naissance ou à chaque enterrement, avec leur fichu gris sur leur robe noire. Elles sont là chaque fois qu'il se passe quelque chose. Comme pour rendre officiel l'événement, pour rythmer la vie de San Giovanni. Quand l'une meurt, l'une de ses filles la remplace. Anna, Carolina, Martha. Martha qu'on n'aime pas trop, à cause de son passé. De tous ces hommes qu'elle a eus. Mais il faut bien la supporter car elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Et Louisa, grande, sèche, qui n'arrête pas de tousser. Louisa toujours emmitouflée, toujours malade, mais toujours à courir partout. Elle finira centenaire. Elle viendra à notre enterrement.
Et aussi le seul homme du groupe, Nello, qui s'occupe comme il peut depuis qu'il n'a plus la force d'aller aux champs. Nello qui tire sur sa pipe éteinte, coincée entre les deux dernières dents du haut.
Quelques-uns des enfants sont là aussi. Giovanni, qui vient de servir à boire pour la première fois. Il a bien compris qu'aujourd'hui commence sa vie d'adulte car il faudra deux hommes ici désormais. Paola, recroquevillée sur sa chaise, qui a un peu de mal à comprendre ce qu'elle vient de découvrir, que la vie commence dans une immense douleur. Renata et Mario jouent aux osselets sur le seuil.
Les deux plus jeunes, Lucio et Claudio, sont hébergés depuis quelques jours chez une sœur de Marisa à Casalmaggiore. C'est ainsi : chaque fois qu'une des deux est sur le point d'accoucher, l'autre prend les plus jeunes en pension pour alléger un peu le fardeau.
La brume s'est levée, la journée sera belle. Une de ces matinées qui font oublier la proximité de l'hiver. Un franc soleil éclaire la cuisine. Nello commente :
- Elle a de la chance, cette petite. Dans mon pays, on disait : « celle qui vient par beau temps aura beaucoup de soupirants. »
- Oui, mais, tout de même, dit Louisa, qu'elle arrive le jour des Trépassés, je me demande si c'est bien bon. Dimanche, je ferai brûler un cierge pour elle.
- Ça, c'est des histoires, dit Martha. Qu'elle arrive le jour des Trépassés ou un autre, qu'est-ce que ça change ? Je vous demande un peu.
Personne ne répond. Martha a toujours été un peu originale, il vaut mieux la laisser dire. Et puis, on ne va pas se disputer dans la maison d'une accouchée.
Pour chasser l'ange qui passe, Nello propose :
- Si vous lui faisiez sa soupe de midi, les femmes. Elle en aura besoin pour se remettre.
Et chacune de s'activer. Les pommes de terre, les carottes, les poireaux, et un bon morceau de lard se retrouvent vite au fond de la marmite. Martha remet du bois et Louisa actionne le soufflet. L'odeur de soupe monte dans la pièce et délie les langues.
- Sacrée Carolina, dit Nello, cette fois tu t'es trompée en leur annonçant le garçon. Avec ça, on ne sait pas comment ils vont l'appeler cette fille.
- Eh oui, je me suis trompée, mais c'est la première fois.
On fait semblant de la croire.
Sandra les a rejoints et se sert une louche de bouillon dans lequel elle verse un peu de vin.
- C'est toujours avec ça que je me remonte, et cette année le vin est bon.
- Je vais fleurir la Vierge, dit Carolina.
Au bout du chemin qui mène sur la route de Casalmaggiore, se trouve un petit oratoire construit par le père de Mauro. Il avait voulu remercier la Vierge en 1880, pour avoir sauvé sa femme, atteinte d'une fièvre qu'on avait crue mortelle. C'est une construction un peu maladroite, surmontée de trois rangées de tuiles rondes, d'environ deux mètres à son sommet. En son centre, une niche contient la statuette de la Vierge. Elle est en permanence comme neuve, car repeinte fréquemment par ceux qui pensent avoir une dette envers le Ciel, ou ceux qui ont à se faire pardonner.
Au bord du chemin, Carolina a cueilli les rares fleurs sauvages de la saison, auxquelles elle a ajouté quelques branchages. Elle dispose le bouquet devant la statuette quand arrive Mazzoni sur sa charrette tirée par un vieux cheval.
- Je fête l'événement, dit Carolina.
- Je suis au courant, il y a une bouche de plus ici. Il Giornalista est en train de l'annoncer partout. Il ne va pas manquer de travail, le Mauro. Il m'avait dit qu'il louerait peut-être une partie de mon champ. Tu pourras lui dire que ça tient toujours. J'irai le voir.
Eugenio est revenu. Il a fini de diffuser l'information dans le village. Autour de la table on fait silence, puisqu'on sait qu'il va parler.
- J'en ai appris une belle. Hier soir, les miliciens sont venus chez les Ruggero. Tout ça, parce que deux fils Ruggero étaient l'autre soir au café. Ils ont parlé un peu trop fort en disant que la vie était moins chère avant Mussolini, qu'on s'en sortait mieux que maintenant. Carlo a même dit que le Duce, avec sa façon de marcher et ses coups de gueule, il serait mieux au théâtre qu'au Palais du gouvernement. Ils n'avaient pas vu, qu'au fond du café, il y avait deux étrangers qui n'en perdaient pas une. Hier soir, ils sont arrivés à six dans une voiture. Ils avaient des matraques. En arrivant, ils ont dit : « on vient vous apporter le bonjour du Duce. » Les matraques se sont mises à voler. La vieille a crié qu'ils étaient de bons Italiens, que son frère était mort à la guerre pour défendre son pays. Elle croyait que ça les calmerait, mais rien à faire. Il y en a un qui est monté sur le banc et qui a pissé dans la marmite. Ils ont cassé de la vaisselle. Un autre avait attrapé la cadette et lui passait la main sous les jupes. On aurait dit des fous furieux, ils avaient peut-être un peu bu avant. Et la vieille qui n'arrêtait pas de leur crier que dans la famille ils étaient tous de bons Italiens et de bons chrétiens. Elle a fini par recevoir deux baffes pour la faire taire. Elle en a encore mal aux mâchoires.
- C'est un peu leur faute, aussi, dit Louisa. Ils n'avaient pas besoin d'aller parler politique au café, à quoi ça leur sert ? Moi, je dis toujours à mon homme de ne pas se mêler de ces choses. Mussolini ou un autre, c'est pareil. Si tu critiques, il y aura toujours quelqu'un pour te faire la peau.
- Et quand ils ont eu fini de casser, il y en a deux qui ont attrapé le vieux pour le ceinturer. C'est qu'il se défend encore bien, le bougre. Ils arrivaient à peine à le tenir. Un troisième lui pinçait le nez pour l'obliger à ouvrir la bouche. Ils lui ont fait avaler l'huile de ricin, il en a les tripes retournées.
Giovanni écoute en silence, mais le monde des adultes lui paraît un peu curieux.
- En sortant, ils ont dit qu'ils reviendraient un de ces jours. Aussi, les Ruggero n'ont pas dormi de la nuit. Dès qu'ils entendaient un petit bruit, ils craignaient de les voir revenir. Surtout qu'avant de partir, un des mabouls était allé à la grange et il avait essayé de mettre le feu. Heureusement, ça s'est vite arrêté. Le vieux a encore trouvé la force d'aller chercher son fusil, mais ils étaient loin avec leur grosse voiture.
- Des choses de cette sorte, dit Anna, on m'avait dit que c'était arrivé le mois dernier à Pieve d'Olmi. C'était pareil, ils avaient tout cassé puis mis le feu. Quelle époque, tout de même.
- L'huile de ricin, c'est bon pour la constipation, dit Nello. Il est tranquille pour un moment. Enfin, ne croyez pas que ça me fasse rire. Moi, je trouve que certains se conduisent plus mal que des bêtes sauvages. Et la pauvre petite qui vient de naître, on ne sait pas trop comment sera son avenir, avec tout ce qui se passe.
- Mais non, mais non, dit Louisa. Chacun n'a qu'à tenir sa place, et voilà. Les jeunes n'auront qu'à faire comme nous avons fait. L'essentiel, c'est de ne pas être feignant, et de ne pas s'occuper des affaires des autres.
- Tu parles, répond Martha. Aller dire qu'on se crève pour ne pas mettre un sou de côté, ce n'est pas s'occuper des affaires des autres. C'est s'occuper des siennes et de l'avenir de ses enfants. Si on était un peu plus nombreux à le dire, les choses changeraient. Mais ils sont tous comme toi, Louisa, ils crèvent de leur misère et ils trouvent que c'est normal.
- On voit bien que tu as vécu à la ville, toi. Tu parles comme ces filles qui ont toujours reçu les alouettes toutes rôties.
Louisa se verse une louche de bouillon pour se calmer.
- C'est vrai, Louisa, que je suis encore là et que j'ai mon pain tous les jours, reprend Nello. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait deux catégories de paysans. Il y a toi, moi, ceux qui sont ici, qui sont nés pauvres et qui mourront pauvres sur leur petit morceau de terre. Mais il y a aussi les gros. Tu en connais, pas loin d'ici. Ceux-là ne se plaignent pas du fascisme, et ils ne savent même plus quoi faire pour le remercier. A quelques-uns, ils possèdent la moitié de la vallée du Pô. Pour eux, le fascisme est une bénédiction.
- Il a raison, ajoute Il Giornalista. La bande qui est venue chez Ruggero, ce n'est pas nécessaire d'être de la police pour savoir qui l'a envoyée. C'est sûrement Farinacci, de Cremone. Il tient la région mieux qu'un préfet. Il a ses espions et ses hommes de main. Je me demande même si Mussolini ne le craint pas. Rien ne se décide ici sans l'accord de Farinacci. Il a même déjà été en bagarre avec Mussolini, et ça recommencera parce que chacun essaye d'être plus fasciste que l'autre. Mais, en même temps, ils ont besoin l'un de l'autre pour se renforcer. Et nous, on est au milieu, on compte les coups, mais aussi on les reçoit.
Giovanni essaie d'y voir clair. Il se dit que la politique est un jeu compliqué réservé aux initiés. Qu'il est cependant utile de comprendre ces choses-là, et qu'Il Giornalista a bien de la chance d'en savoir autant. Peut-être un jour osera-t-il lui demander de lui prêter ses journaux.
- En tout cas, ce qui les excite en ce moment, ce doit être les suites de l'affaire Matteotti.
Giovanni trouve enfin l'occasion de se mêler à la conversation.
- C'est quoi, cette affaire ?
- Matteotti était un député socialiste. Jeune et brillant, il avait un grand avenir devant lui. Les fascistes ne l'aimaient pas, naturellement, mais aussi le Vatican, parce qu'il était le seul capable de ramener le socialisme au pouvoir. Il était souvent menacé, et parfois ses amis devaient le cacher. Pendant la dernière campagne électorale, il avait été malmené avec quelques autres, et même torturé. Mais il était courageux, et il savait ce qu'il risquait quand il est monté à la tribune, le 30 mai, pour répondre au discours de Mussolini. Ce jour-là, il a dénoncé les trafics et les combines qui avaient permis aux fascistes de remporter les élections. Il a tenu la tribune pendant quatre heures, en portant des accusations précises. Mais, en même temps, il a signé son arrêt de mort. Le 10 juin, il était enlevé, poignardé, puis enterré à la campagne par les hommes de la Ceka.
- C’est quoi, la Ceka ? S’inquiète Giovanni.
- La Ceka, c'est une escouade spécialisée dans l'intimidation. On y trouve surtout des criminels que Mussolini a fait sortir de prison tout exprès. Au début, on a essayé de faire courir le bruit que Matteotti s'était enfui à l'étranger. Mais la vérité peu à peu faisait son chemin, et même des fascistes ont commencé à quitter leur parti. L'opinion s'est enfin émue, mais pour renverser le cours des choses il aurait fallu un grand mouvement populaire. Personne n'a bougé, c'est la preuve que l'intimidation a bien fonctionné. Ce renard de Mussolini a repris la situation en mains, mais il n'empêche que son parti s'est trouvé pas mal secoué. C'est pourquoi il y a sûrement en ce moment des règlements de comptes qui se font sur notre dos.
Mauro est resté longtemps silencieux, assis sur le bord du lit. Il se penche sur le berceau. Tous ses enfants se ressemblent à la naissance. Ou alors, il les voit toujours de la même façon. Il prend la main de Marisa. Il ne le fait pas souvent. Les sentiments se vivent à l'intérieur, ils ne s'affichent pas. Mais aujourd'hui...
- Elle est belle, dit Marisa. Je voulais un garçon, mais ça ne fait rien.
- On prend ce qui vient, dit Mauro. C'est la vie.
Et il regrette aussitôt ses paroles car il craint de paraître résigné, ou même déçu d'avoir une fille. Il s'empresse de rectifier :
- Mais je suis bien content. On en fera une belle femme. Je ferai un lit plus grand pour Renata. Avec leurs dix ans de différence, l'aînée pourra s'occuper d'elle. Demain, j'irai voir Giuseppe. Il voulait me donner du beau bois pour faire un lit quand Claudio est né. A l'époque, on n'en avait pas besoin. Là, je vais le faire.
Marisa sourit :
- Te voilà bien pressé, elle va rester dans le berceau quelque temps, quand même !
- Tu n'as peut-être pas vu, mais Anna est venue. Elle n'a pas osé entrer te voir, mais elle est à côté.
- C'est bien qu'elle soit venue. Si tu veux, je parlerai à Giulio. On est juste à côté, on a tous besoin les uns des autres, surtout en ce moment. On pourrait s'aider un peu.
- Je crois que tu as raison. Tout à l'heure, j'ai parlé à Anna contre son mari. J'aurais sans doute mieux fait de me taire. Tiens, regarde ma fille, on dirait qu'elle sourit.
- Ta fille, ta fille, il faudrait bien qu'on lui trouve un prénom. Tu y as un peu pensé ?
- Je n'ai pas trop d'idée. On a déjà pris les prénoms des grands-mères. C'est qu'il va falloir que j'aille la déclarer !
Marisa semble hésiter.
- J'ai une petite idée, mais je ne sais pas ce que tu en penserais. Tu te souviens de cette nièce française d'Anna ? Celle qui était venue passer ses vacances chez eux une fois. Tu te souviens comme elle était jolie, et si gentille quand elle venait nous voir en cachette de Giulio ? Anna a tant pleuré quand elle a appris sa mort. Elle restait des journées entières enfermée chez elle, malade de son chagrin. Puisque Anna a eu ce bon geste aujourd'hui, elle serait sûrement touchée qu'on appelle notre fille comme sa nièce, Alice.
- C'est d'accord, on l'appelle Alice. Je vais le dire à Anna, et la faire entrer.
Et Mauro se lève, comme soulagé d'avoir un problème en moins.
- Tu pars déjà ?
- C'est que je n'ai rien préparé pour le marché de demain. Je vais travailler jusqu'à midi. A côté, elles ont fait la soupe, n'aie aucun souci.
Une fois seule, Marisa se redresse légèrement sur ses coudes pour contempler sa fille.
- Tu t'appelles Alice. Alice Battistoni.
Puis, fatiguée, elle s'allonge sur le côté. Elle enfouit son visage dans l'oreiller, et se met à pleurer tout doucement, comme chaque fois.
1932
Tous les matins d'école débutent de la même façon. On s'aligne en rang par deux et on attend que sœur Constance ait agité la cloche. On commence à avancer puis on marque un bref temps d'arrêt devant sœur Maria. On lui présente la paume des mains, puis le dessus. Sœur Maria s'assure qu'il n'y a pas la moindre tache, et que les ongles sont bien courts. Puis, sur le pas de la porte, on s'arrête plus longuement devant sœur Alberta qui plonge ses doigts ridés dans les cheveux, qui écarte les mèches, qui fouille. Sœur Alberta a prévenu : les poux sont des créatures de Satan, il ne faut pas les laisser entrer en classe.
Puis chacune rejoint son bureau, mais on reste debout. Quand sœur Maria tape une première fois dans ses mains, on récite la prière du matin. Il faut la savoir par cœur, et faire comme si on parlait au crucifix qui est au-dessus du tableau. Certaines, parfois, ne se souviennent plus très bien, et font semblant de réciter en remuant les lèvres. Mais sœur Maria s'en aperçoit toujours, et gare aux coups de règle sur les doigts !