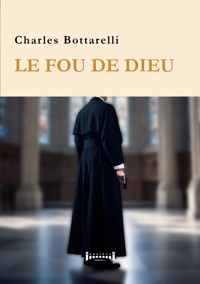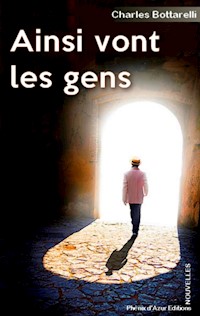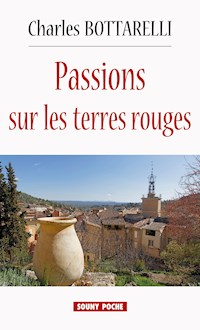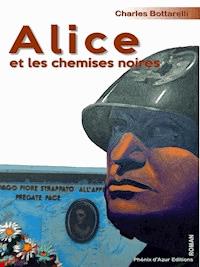Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phénix d'Azur éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Escroqueries, manipulations et crimes.
« Georges Sarret, Avocat-conseil ». Cette plaque apposée sur sa porte n’est qu’un des mensonges de Sarret, et pas le plus grave. Peu lui importe, ce qu’il cherche surtout c’est la notoriété, en même temps qu’une activité lucrative. Grâce à ce titre ronflant, il parvient à s’imposer dans la bonne société et à monter de nombreuses escroqueries qui, parfois, trouvent leur aboutissement dans le crime. Dans le Marseille trouble des années trente où les politiciens et les voyous entretiennent des relations coupables, son sens de l’organisation et de la manipulation fait merveille. Amant de deux sœurs, il en fait facilement ses esclaves pour mettre au point aussi bien ses escroqueries que ses crimes. Arrogant et cynique, ce monstre froid pris dans une fuite en avant effrénée aura passé sa vie à jongler avec la loi et avec la morale.
A travers ce roman, plongez dans le Marseille trouble des années trente où les politiciens et les voyous entretiennent des relations coupables et découvrez le destin de Georges Sarret, escroc et bandit.
EXTRAIT
- Ne me remerciez pas, si on peut ainsi améliorer sa condition, j’en serai suffisamment remercié.
Philomène se mit à fréquenter la Conception. La première fois, elle eut un haut-le-cœur en pénétrant dans la salle commune. Elle n’avait jamais été vraiment confrontée au spectacle de la misère et du dénuement, et surtout, il y avait l’odeur. Une odeur mélangée de savon et de chimie qui n’était pas sans lui rappeler les derniers jours à la villa Ermitage. Une odeur de mort.
Elle venait deux fois par semaine, laissait parfois des bonbons, ou un billet que Marguerite trouvait quand elle passait, avant ou après avoir effectué les quelques ménages qui permettaient de survivre. Comme la jeune femme, le jour où elle avait rencontré Philomène au chevet de Lorenzo, lui avait demandé pourquoi elle laissait cet argent, celle-ci avait répondu, pour clore la discussion, que c’était pour les enfants. Au retour, Philomène tenait l’avocat au courant de l’évolution du mal.
Sarret consulta son carnet d’adresses pour voir s’il n’avait pas quelque contact dans une compagnie d’assurances. Il tomba sur Brion, un cadre de la Bâloise, dont il était incapable de se souvenir dans quelles circonstances il l’avait rencontré. Mais peu importait. S’il se trouvait dans son répertoire, c’est qu’à un moment donné l’autre avait eu affaire à lui. Et s’il avait conservé son identité, c’est qu’il l’avait considéré sur-le-champ comme quelqu’un qui pourrait un jour lui être utile. C’était l’occasion de l’utiliser.
Il décrocha son téléphone et l’appela. Au ton de l’autre, il comprit aussitôt qu’il lui avait laissé un bon souvenir et que le quidam était très honoré de l’avoir au téléphone.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Charles Bottarelli est né en novembre 1941 à Toulon, de parents ouvriers horticoles. Il a vécu toute son enfance et son adolescence dans sa ville natale. Il en conserve un goût marqué pour l'histoire de sa région. Le choix d'une carrière dans la fonction publique l'amènera successivement à Lyon, Paris et Marseille, avec retour à Toulon en 1970, Entre 1995 et 2006, il s'investit dans le mensuel satirique
Cuverville qui combat l'extrême-droite installée à la mairie. Le temps de la retraite professionnelle venu, il décide de se consacrer à l'écriture. Un premier livre, à caractère documentaire, est publié en 2004 :
Toulon 40, chronique d'une ville sous l'Occupation. Puis, en 2006, c'est un roman
Alice et les chemises noires, qui est la biographie imaginaire d'une jeune fille sous Mussolini.
D'une façon générale, il veille à situer précisément ses personnages dans le lieu et dans le temps, n'hésitant pas à mêler la fiction pure à des situations réelles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un assassin si distingué
Charles BOTTARELLI
Phénix d’Azur Éditions
Chapitre 1
Je vous connais, Georges Sarret. Je vous connais à travers cette photo granuleuse dans la coupure d’un journal de 1931. Elle n'est pas de très bonne qualité. Vous la trouveriez désobligeante pour un homme de votre notoriété. On venait de découvrir votre dernier crime. Dans les tout prochains jours, on allait en connaître d’autres. Tous ? Ce n’est même pas certain.
Donnons-nous un peu d’air. Il y a heureusement quelques sujets moins sinistres dans le journal. Sur une autre page, on nous apprend que René Clair tourne en ce moment A nous la liberté. Vous n’appréciez peut-être pas le sel de la coïncidence. Aux États unis, les Américains construisent un gratte-ciel qui sera encore plus haut que celui de Chrysler : l’Empire State Bulding, 380 mètres. Les premiers résultats de la ligne de voyageurs Marseille-Damas-Saïgon, ouverte en janvier, sont satisfaisants. Vous n’aurez pas l’occasion de la prendre. Au fond, ce qui se passe autour de vous aujourd’hui, doit assez peu vous importer. Ce qui vous importe, ce qui vous indigne, c’est qu’on ait pu vous arrêter, vous. Inconcevable !
Vous avez le visage rond du notable bien nourri. Vous avez le cheveu en brosse du type qui affiche sa rigueur et rassure le client. Vous êtes photographié en buste, mais on devine une carrure imposante. Votre cou est orné d’une cravate comme on en fait à l’époque, une espèce de gros nœud entre le foulard et le nœud papillon. Je ne peux m’empêcher de penser à ce qui va se produire dans cette zone de votre personne un an plus tard. La lame luisante de la guillotine. Il est vrai que le jour de l’exécution vous ne porterez pas la cravate. L’aide du bourreau aura d’abord découpé largement votre chemise autour du cou. Il ne faut pas que le tissu entrave le bon fonctionnement de la machine. Imaginez le ridicule : la lame coincée par un bout de chiffon ! Le ridicule ajouté au déshonneur.
Justement, la veille de votre mort, une autre coupure de journal vous montre pendant le procès. Vous avez beaucoup vieilli en peu de temps. Vous bajoues ont fondu. Un début de calvitie attaque votre chevelure. La mauvaise qualité de la photo m’amène à douter, mais il me semble que vous portez maintenant des lunettes. Vous tenez entre les mains un dossier, comme si vous aviez rédigé à l’avance ce que vous deviez répondre à la Cour. Cette humilité ne vous ressemble pas. Et surtout, vous êtes un peu voûté, votre tête descend entre les épaules. On dirait que vous avez perdu de votre morgue. C’est sûrement le cas, car vous êtes un type intelligent. Et, depuis le début, vous savez à quoi vous en tenir. La lame, Sarret, la lame. Froide.
Vous n’avez fait que changer de côté. Dans une vie antérieure, alors que vous étiez plus ou moins journaliste, il vous est arrivé de suivre des procès d’assises. Vous avez vécu en spectateur ces moments terribles où on annonce au prévenu qu’il aura la tête tranchée. Vous n’avez pu oublier ces regards de condamnés qui se perdent dans l’infini comme s’ils cherchaient une sortie. Les cris de bête blessée de certains. Les injures hurlées par d’autres comme un dernier et inutile défi. C’est bientôt votre tour, et votre souci du moment, c’est de savoir comment vous allez faire bonne figure, encore une fois.
Ironie tragique, dans une colonne voisine on voit la silhouette de Deibler, le fameux bourreau qui va vous ôter la vie. On voit, plutôt on devine. Les téléobjectifs de l’époque devaient être taillés dans du cul de bouteille. C’est une image floue, irréelle, d’un bonhomme à l’allure tranquille, qui marche. Il porte un grand manteau et un chapeau-feutre. Il est de profil, la tête légèrement penchée en avant. Ce pourrait être n’importe qui d’autre : un banquier pensant à ses bénéfices, un notaire envisageant une opération immobilière, un paisible commerçant. Ce pourrait être aussi un homme qui aurait pratiqué la même profession que vous, et qui n’oubliait pas de devoir inspirer confiance. Ce pourrait même être vous. Cocasse, non ? Mais ce n’est que Deibler, l’homme tranquille qui a déjà assassiné une foule de gens avec les compliments de la République. Votre ennemi irréductible. Il avance, serein, de ce pas tranquille que vous ne pourrez arrêter. Cette ombre qui va droit devant, c'est la mort qui vient vers vous.
Je vous connais, Georges Sarret. D’abord, vous ne vous appelez pas Sarret. Votre vrai nom est Sarrejani. Mais vous avez toujours eu le souci du paraître. C’est une des raisons qui ont causé votre perte. Et dans Marseille où vous revenez en 1919, au retour de la guerre, vous pensez que les noms en « i » sonnent mal. C’est que quelques immigrés italiens ou des bandits corses alimentent à profusion la rubrique judiciaire. Alors, il ne faudrait pas confondre. Un tel rapprochement serait mauvais pour votre prestige. Vous, Sarrejani, vous voulez devenir quelqu’un qui compte, qu’on salue chapeau bas. Quelqu’un qui sera reçu dans les soirées de la meilleure société, qui gagnera beaucoup d’argent, et même en distribuera pour faire constater sa réussite. Vous voulez émerger de la multitude. La politique vous paraît être ce moyen de vous placer au-dessus du vulgaire. Vous vous y essayez. Vous pensez que vous serez Poincaré ou rien. Vous entendez mettre toutes les chances de votre côté. Donc, ce sera Sarret et non Sarrejani.
Vos origines mêmes auraient pu cependant vous incliner à la modestie. Dès votre naissance vous étiez un déraciné. Vous êtes né à Trieste alors que cette ville était autrichienne. Vos parents, eux, étaient d’origine grecque. Quand vous êtes arrivé en France, vous aviez quatre ans. Vous avez demandé la naturalisation vingt ans plus tard. Alors, quelle importance, ce nom en « i » ? Si ce n’est celle que vous lui supposiez.
Dans le journal, on voit aussi les photos des deux femmes sans qui rien ne serait arrivé. Disant cela, je regrette aussitôt ma phrase. Avec vous, le pire étant toujours possible, il serait fatalement arrivé quelque chose. Ces femmes ne portent donc pas seules la responsabilité des actes qui vous conduiront à l’échafaud. Simplement, elles ont été les instruments consentants de vos crimes, des alliées bien utiles qui trouvaient aussi leurs avantages dans le service de votre ignominie. Mais si elles n’avaient pas été là, vous auriez inventé d’autres moyens, comme si une fatalité devait vous conduire sous la lame. Je vous fais confiance.
Elles sont d’origine allemande. Philomène a le visage un peu fort, des cheveux longs plaqués en arrière. Autant qu’on puisse en juger à travers une photo de presse de l’époque en noir et blanc, elle paraît brune. Elle est élégante, avec des cils bien marqués et des pendants d’oreille. Elle a quarante-trois ans au moment où on découvre vos turpitudes. La presse dit qu’elle est moins belle que sa sœur. Sa sœur s’appelle Catherine et elle a sept ans de moins. Son visage est gracieux, elle porte des cheveux courts, et elle est souriante. Tous ces détails vous importent peu, Sarret, puisque vous avez été l’amant des deux, sans qu’on parvienne à faire dans vos relations la part de l’amour et celle du calcul. La part de l'amour? Là encore j'ai du mal à trouver les mots. Quand on fait le bilan de votre vie, on se demande si vous avez jamais été capable d'amour. Peut-être envers vous-même seulement, et encore.
Je vous connais, Georges Sarret. Mais je n’en sais pas assez. Que se passe-t-il dans la tête d’un homme quand il tue ? Au moment de l'acte décisif s'imagine-t-il qu'il est assez malin pour ne pas se faire prendre ? C’est déjà une question grave, mais j’en ai une bien pire. Comment un être humain peut-il envisager de faire ensuite disparaître les cadavres en les dissolvant dans l’acide sulfurique ? Quel cheminement dans son cerveau aboutit à imaginer un tel dispositif sans que son esprit chancelle, sans que sa main hésite ? Et sans qu'il vomisse ? Est-il vraiment conscient de ce qu’il fait, ou alors, a-t-il acquis une forme de conscience qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas comprendre ? Est-ce qu’il vit dans un univers qui n’est plus le nôtre ? Comment fait-il, après cet acte qui dépasse l’entendement commun, pour retourner vaquer à ses petites affaires, sortir au cinéma, au restaurant, lire un livre, faire l’amour ?
Je vais essayer de comprendre, Georges Sarret, à travers notre conversation impossible, notre dialogue aléatoire. Là où vous êtes, vous ne pouvez me répondre. Bien sûr, les seules paroles que je puisse espérer de votre part ne peuvent résider que dans l’évocation de vos actes. Ils parleront pour vous, comme on dit dans les prétoires.
***
Aix, le dimanche 8 avril 1934, un ouvrier des chemins de fer avait vu arriver en gare un équipement étrange. Il s'était dit que cet attirail ressemblait fort aux bois de justice. Et il avait propagé cette intéressante observation dans son entourage immédiat.
La nouvelle s’était alors répandue dans toute la ville. On y conservait en mémoire le procès qui s’y était tenu voilà un peu moins de six mois. En rencontrant des connaissances dans la rue, les gens cherchaient à savoir si l’autre en savait un peu plus qu’eux. C’est que la ville entière exécrait maintenant cet arriviste dont on savait avec certitude qu’il avait tué trois personnes. Mais selon les apparences, il pouvait bien en avoir liquidé quelques autres. Et on attendait son exécution comme une délivrance. Comme un exorcisme pour éliminer de cette ville la pourriture que vous y aviez répandue.
Sarret, entre ses murs, demeurait confiant. Il se demandait quel serait le résultat de la visite de son avocat au président de la République, mais il ne voyait pas pourquoi il ne bénéficierait pas de la grâce présidentielle. Pourquoi aurait-on refusé à Sarret, à Maître Sarret, ce qu'on accordait à bien d'autres, de moindre envergure ? Il était bien au-dessus du lot commun, de ces minables tueurs d'encaisseurs de banque, de ces amants rejetés étranglant celle qui ne voulait plus d'eux, de ces vulgaires. Tout bien pesé, il n’avait eu dans ces affaires qu’un rôle mineur, celui d’un homme trop bon dont deux excitées avaient voulu exploiter la générosité.
« Vous direz au président Lebrun que, après tout, il n’y a pour m’accuser que deux femmes, et quelles femmes ! Des menteuses, des folles, qui ont cherché à rejeter leurs responsabilités sur moi. Il ne peut pas me refuser la grâce. Ce serait un déni de justice ! »
Étant revenu de Paris avec une réponse négative, l’avocat, par humanité, avait jugé bon de lui laisser croire qu’il n’avait pas encore obtenu l’audience à la Présidence.
Ce soir-là, à dix-huit heures, à la relève des gardiens, il a salué Mangeot, de service de jour, d’une façon enjouée.
- A demain, on fera peut-être une partie de cartes !
Mangeot ne le reverra plus.
Dans la nuit, vers trois heures et demie, la troupe encerclait le palais de Justice. On pouvait entendre le hennissement de quelques chevaux, et le pas cadencé des hommes du régiment d’infanterie coloniale qui se mettait en place. Au plus profond de son sommeil, Sarret n’entendait rien. Les gendarmes faisaient circuler les badauds qui commençaient à s’entasser derrière les barrages. Certains avaient apporté une échelle double pour être sûrs de ne rien manquer du spectacle. D’autres s’étaient juchés sur les marquises des magasins. Autour de la place, les fenêtres des immeubles voisins commençaient à se garnir.
Vers quatre heures, le bourreau et ses quatre aides affrontaient un vent violent sur le cours Mirabeau où les branches s’entremêlaient. Ils partaient vers la gare de marchandises pour donner l’ordre d’amener le fourgon contenant la guillotine. Un quart d’heure après, le montage de l’engin commençait dans un bruit de marteaux.
Réveillé par le bruit, Sarret appelait le gardien.
- Que se passe-t-il ? Ce n’est pas la guillotine ?
- Ce n’est rien, c’est le marché qui se prépare. Dormez tranquille.
Le bourreau tenait à essayer lui-même le couperet. La lourde lame, lâchant un éclair dans la pâle lumière des lanternes, s’abattait avec un déclic de nature à rassurer son utilisateur. Tout était dans l’ordre.
Les officiels pouvaient alors se rassembler autour de la machine, puis franchir la porte de la prison qui se refermait sur eux peu avant cinq heures. Le froid de l’aube, aggravé par le mistral, figeait les badauds mais aucun d’eux n’aurait laissé sa place.
Quand les officiels pénétrèrent dans la cellule, ils trouvèrent un Sarret parfaitement réveillé. Il ne laissait paraître aucune émotion.
- Ayez du courage, votre pourvoi est rejeté, annonça l’avocat général.
- C’est bon, je suis victime d’une injustice, mais faites vite.
On lui fit remarquer que, dans le cortège, il y avait l’aumônier de la prison, ainsi que l’archimandrite, pour le cas où il souhaiterait choisir pour l’assister entre la religion catholique et l’orthodoxe.
- Merci, je n’ai pas besoin du concours de la religion.
Deibler entrait pour la toilette. Muni de ciseaux, un aide échancrait la chemise.
Puis on lui proposait la cigarette et le verre de rhum, ce qui parut l'agacer.
- Je n’en veux pas, arrêtons ce cirque, faites vite !
Se tournant vers son avocat, il retira son alliance et la lui tendit.
- Vous la remettrez à ma fille. Et pour elle, poursuivez la révision de mon procès.
Disant cela, il affichait comme un vague sourire.
Puis on lui désignait le chemin de la sortie et le cortège démarra doucement. Un murmure dans la foule salua l’ouverture de la prison. Sarret avançait, le visage impénétrable, avec la même allure froide qui était la sienne lors de son procès, escorté par les aides. Une fois sur la bascule, il eut un léger mouvement de recul, mais il était trop tard.
La lame s’abattait. Ainsi périssait le monstre.
Alors, Sarret, quelle est la mort la plus haïssable ? Celle de la balle qui vous déchire avant que l’acide dissolve vos cellules, comme l’ont connue Louis Chambon et Blanche Ballandraux ? Celle de cette lame gelée dont, le temps d’un éclair, vous avez senti la brûlure ? Ou encore celle de la pauvre Magali dont vos deux maîtresses, à votre demande, ont entretenu et développé le mal qui la rongeait, précipitant sa mort pour vous permettre d’encaisser plus vite la prime d’assurance ?
Chapitre 2
Assise sur un banc de la gare de l’Est, ce soir du 19 avril 1917, Philomène Schmidt comptait sur l’arrivée de sa sœur Catherine pour retrouver un peu de son moral. Mais, en pleine guerre, un train venant d’Allemagne n’était jamais annoncé avec certitude. Il avait déjà plus d’une heure de retard, et personne ne pouvait dire s’il arriverait vraiment. Une froide humidité tombait sur les quais, et Philomène se recroquevillait comme pour garder sa propre chaleur.
Durant cette attente qui lui devenait de plus en plus insupportable, elle avait pu remonter le fil de sa vie. L’enfance à Friedrichshafen, près de la frontière autrichienne. Le départ au petit matin vers son école. L’hiver qui n’en finit pas. Sa tête est prise dans un bonnet de laine, les galoches font un bruit sec sur la terre verglacée. Les doigts qu’elle a du mal à articuler malgré les gants épais. Le nez gelé d’où pend une éternelle goutte. En arrivant à l’école, on se rassemble d’abord un moment, bras en avant vers le poêle. La maîtresse consent à attendre un peu avant de commencer les cours. Et le retour le soir. Son premier souci, avant même de se déshabiller est de s’asseoir devant le monumental poêle revêtu de céramique blanche et bleue. Sa mère lui a déjà préparé une tisane bien chaude. Sa mère douce, attentive, mais effacée, comme paralysée par la personnalité du père, officier de gendarmerie sec et intransigeant, qu’on n’a jamais entendu rire. Quand elle avait sept ans, la naissance de Catherine, cette sorte de jouet en vrai qui venait la remplir de joie. Les jeux qu’elle inventait pour elle. Les gâteaux qu’elle lui apprenait à faire. Ses dix-huit ans, son premier bal à la fête locale avec Konrad. Plus précisément à dix-huit ans et un mois, pour ne pas braver l’interdiction formulée par le père, à qui ce chiffre paraissait le plancher en dessous duquel il n’était pas imaginable de laisser sortir sa progéniture.
Mais quand sa fille a dix-huit ans et qu’elle ne brille pas par un goût prononcé pour l’école, que peut décider pour elle, pour son avenir, un officier soucieux du respect qu'on lui doit? Qu’est-ce qu’un bourgeois avide de respectabilité peut envisager comme carrière pour une enfant rétive à l’éducation, mais qui doit pouvoir en toutes circonstances briller en société? La solution, c’est le pensionnat, et pas n’importe lequel. L’officier a entendu parler de « English Fraulein », à Kaiserslautern, où l’on forme les jeunes filles afin qu’elles excellent dans les bonnes manières. Elles pourront ainsi devenir, au mieux des femmes d’officiers, au pire des gouvernantes pour les enfants des mêmes. On y apprend l’art de paraître, la cuisine, la religion, les usages à respecter, les langues anglaise et française. On y suit surtout une discipline toute militaire destinée à forger des esprits sains. Douches à l’eau froide, salut aux couleurs, gymnastique et prière obligatoires. C’est le genre d’établissement idéal pour aboutir aux plus dociles obéissances, ou par un malheureux accident de parcours, aux plus violentes révoltes. Avec la langue anglaise, Philomène avait rencontré des difficultés. Pour le français, c’était plus facile. À Kaiserslautern, on avait gardé quelques traces de l’occupation française de 1795 à 1814. La ville avait même été capitale du département français du Mont Tonnerre, et dans de nombreuses familles, certains étaient capables d’articuler les quelques mots français que des ancêtres zélés ou serviles avaient tenu à pratiquer. On rencontrait même encore, au fronton de divers magasins, des enseignes dans cette langue qui avaient résisté au retour à la germanisation.
Après deux ans parmi les dames de chez « English Fraulein », Philomène avait été jugée apte au service qu’on attendait d’elle, s’occuper d’enfants. L’école, en 1909, l’avait placée chez un riche producteur de champagne à Reims.
Puis, les enfants n’étant plus en âge de justifier la présence d’une gouvernante, c’est son employeur lui-même qui l’avait casée à la fin de l’année dernière chez une de ses relations à Paris, un attaché de l'ambassade italienne.
Catherine, quand ce fut son tour, connut les bonnes manières de chez « English Fraulein ». Elle s’y montrait un peu plus rétive à l’ambiance de la maison que sa sœur. Cependant, les enseignantes devaient reconnaître une intelligence plus affirmée, un esprit plus vif. Mais aussi, un visage plus fin, une démarche plus élégante, et un corps plus élancé. En fait, Catherine était plus jolie que Philomène, et cette dernière, qui en avait conscience, essayait de ne pas être jalouse. La différence d’âge était suffisamment importante, ce qui conduisait Philomène à un comportement presque maternel à l’égard de sa cadette.
Et le maudit train n’arrivait toujours pas. N’avait-il pas été retenu sur quelque voie de garage ? Ou encore, comme cela arrivait, ne s'était-on pas trouvé dans l'impossibilité de le ravitailler en charbon ? Sale guerre, qui amenait Philomène à ne plus savoir de quel côté elle devait se placer. Elle avait tout de suite aimé la France, Reims d’abord avec son caractère paisible qui lui rappelait Kaiserlautern. Puis, à Paris, elle avait découvert la griserie d’une ville vibrante, toujours en mouvement, comme en fête permanente malgré les vicissitudes. Elle y avait connu quelques aventures amoureuses, facilitées par le sentiment de ne pas y être connue, et la liberté qui en résultait. Mais être une Allemande ici, par ces temps incertains, ce n’était pas toujours facile. Quand elle se trouvait dans un commerce, ne serait-ce qu’en achetant le pain, elle tentait de dissimuler son accent allemand. Mais elle avait beau faire, elle serait toujours la Boche. Elle lisait les journaux que son patron l’encourageait à parcourir pour, lui disait-il, améliorer sa connaissance de la langue française. Hier, elle avait vu ce titre triomphal, où il était question d’une offensive héroïque de la France entre Soissons et Reims. Il y aurait de nombreux prisonniers allemands. Et ce matin encore la presse évoquait le bombardement de Reims. Elle pensait à Solange et Xavier, les deux enfants dont elle avait accompagné l’éveil au monde adulte, en se demandant s’ils avaient échappé au massacre. Dans la presse, la qualification d’Allemand avait disparu, il n’y avait plus que des Boches.
Quoi qu’il se passât, quoi qu’elle fît, il était dans son destin d’être mal dans sa peau. Elle l’avait bien un peu cherché avec cette affaire stupide des chaussures des enfants Maggiori. Le mois dernier, Enzo Maggiori, son actuel employeur, lui avait demandé de passer chez le cordonnier pour récupérer les chaussures des enfants qu’il avait laissées en réparation. Il lui avait confié quinze francs, en prévoyant largement. Au retour, elle lui avait dit que la réparation avait coûté quatorze francs. Le lendemain, et après réflexion, trouvant que le cordonnier pratiquait tout de même des tarifs élevés, Maggiori s’était arrêté à son échoppe pour lui dire ce qu’il en pensait. Et là, l’artisan lui avait juré qu’il n’avait demandé que six francs.
Très en colère, Maggiori l’avait appelée dès son retour, et lui avait laissé entendre que si cet incident parvenait aux oreilles de sa femme, très à cheval sur les dépenses du foyer, son renvoi était assuré. Comme elle s’efforçait de fondre en larmes, le diplomate lui avait proposé un marché.
- Quand ma femme n’est pas là, nous pourrions passer un petit moment ensemble, et je garderai le silence.
Or, Mme Maggiori tenait à sortir elle-même ses enfants une fois par semaine, au jardin du Luxembourg, le jeudi. Et c’était le jour où l’attaché d’ambassade restait chez lui, pour traiter plus tranquillement son courrier, affirmait-il. Dans une sorte d'indifférence, sans enthousiasme et sans déplaisir, elle était ainsi devenue sa maîtresse. Mais cette liaison commençait à lui peser. Elle ne ressentait aucune attirance pour cet homme, et l’accord qu’elle lui avait donné n’était qu’utilitaire.
Heureusement, la vie allait changer avec la venue de Catherine. Celle-ci souffrait d’une faiblesse des poumons, et le médecin lui avait conseillé de vivre au soleil. Philomène lui avait proposé de s’installer avec elle dans le sud de la France. À l’heure actuelle, leur destination n’était pas encore bien arrêtée. Ne connaissant personne en dehors des proches des Maggiori, Philomène n’avait aucune raison de choisir une ville plutôt qu’une autre.
Enfin, le train était annoncé. Au loin la machine crachotante tirait lentement un lourd convoi, composé d’un nombre de wagons d’autant plus important que les trains étaient rares. Philomène se leva et commença à scruter le quai. Dans le déferlement dense des voyageurs, elle distingua vite la silhouette gracile de sa sœur. Catherine se précipita dans ses bras comme si elle atteignait un refuge.
Et vous, Georges Sarret, à quelques centaines de kilomètres, vous ignoriez parfaitement l’existence de ces deux femmes. Engagé dans l’armée française, vous vous êtes, comme on dit, bien battu. Qu’est-ce que cela signifie ? Que vous n’avez pas hésité au moment d’ouvrir le feu sur un homme qui ne portait pas vos couleurs ? Peut-être êtes-vous de ceux qui ont poursuivi au pas de course un ennemi terrorisé, et qui l’avez achevé en le traversant de votre baïonnette. Peut-être vous êtes-vous fait remarquer en sautant le premier hors de la tranchée pour gagner mètre par mètre. Peut-être vouliez-vous seulement faire oublier – et oublier vous-même - vos origines autrichiennes. Quoi qu’il en soit, vous avez été courageux. Mais de quel courage s'agissait-il ? De quelle hargne se nourrissait-il ? En tout cas, vous avez alors découvert qu’il n’était pas si difficile de tuer un homme.
Ce matin même, Philomène lisait dans le journal que lui avait laissé Maggiori, la phrase suivante : « Partout la vaillance de nos troupes a eu raison de l’énergique défense de l’adversaire entre Soissons et Craonne. Toute la première position allemande est tombée en notre pouvoir. À l’est de Craonne, nos troupes ont enlevé la deuxième position ennemie au sud de Juvincourt. Le chiffre de prisonniers faits par nous jusqu’à présent dépasse dix mille, et nous avons également capturé un matériel important ».
Voilà ce que lisait Philomène, qui savait de moins en moins si elle devait se considérer comme une Allemande ou comme une Française. Et qui ignorait forcément l'existence du sergent Georges Sarrejani.
Vous avez peut-être gagné là les premiers – et les derniers - lauriers de votre existence. Ce n’est pas votre activité professionnelle d’avant la guerre qui aurait pu vous en procurer. Vous aviez été tenté par le journalisme. Avec le recul, il est permis de penser que ce que vous recherchiez à travers cette profession, c’est moins la passion pour l’information, pour l'Histoire qui se construit au jour le jour, que le moyen de vous constituer un solide carnet d’adresses. Pour plus tard.
Vous avez commencé au Petit Provençal. Très vite, vos collègues vous regardèrent d’un air suspicieux. Vous ne faisiez rien pour vous intégrer à l’équipe, comme si ce qui se passait là ne vous intéressait qu’à moitié. Parfois, vous receviez quelqu’un en vous enfermant dans un bureau. On commença à parler de transactions immobilières. N’y tenant plus, un jour votre rédacteur en chef a fait irruption dans une de vos réunions privées. Juste au moment où votre visiteur vous remettait une jolie somme d’argent en rétribution de votre intercession dans l’achat d’une grande propriété. Votre supérieur a compris alors les raisons de vos nombreuses absences. Il ne vous a pas donné le choix entre vos deux activités et vous a licencié sur-le-champ.
Heureusement pour vous, vous aviez eu le temps de commencer à vous constituer le précieux carnet d’adresses. Le patron du Sémaphore y figurait en bonne place, d’autant plus que vous aviez eu l’occasion de l’informer, à tout hasard, que vous partagiez ses idées politiques. Vous vous êtes donc retrouvé dans ce quotidien, où vous pouviez mener vos opérations immobilières sans être dérangé par des obligations subalternes.
Le temps libre que vous laisse votre désintérêt pour votre profession officielle, vous l’employez à entreprendre des études de droit. Vous avez compris que, pour les affaires, c’est une arme indispensable. Et sur une carte de visite, un titre de cet ordre ne peut que rassurer la clientèle. Il faut vous rendre cette justice: votre parcours d’étudiant est plutôt honorable.
La guerre va l’interrompre. À trente-cinq ans, vous vous y engagez avec conviction. Mais les gaz vous procurent un accident pulmonaire qui vous fera réformer au début de 1918. Vous reprenez alors vos études, et sans coup férir, vous obtenez la licence.
- Une ville au soleil, bien sûr, mais pour être sûres de trouver du travail, il faut une grande ville. Bordeaux, Toulouse, Marseille. Alors, pourquoi pas Marseille ?
Catherine n’avait pas discuté le projet de Philomène qui, comme toujours, devait avoir raison.
Quand elles posèrent le pied sur le quai de la gare Saint-Charles, elles furent surprises. On leur avait tant parlé de la douceur du midi. Elles ignoraient tout de ce mistral qui, au mois de décembre, lorsqu’il est d’abord passé sur les neiges de la vallée du Rhône est capable de vous cisailler le corps. Et le vent furieux débouchait en rafales entre les wagons, secouant les panneaux annonçant les départs et les arrivées, faisant vibrer les becs de gaz. Toute la ville paraissait près de s'arracher du sol. Pour l’heure, le souci des deux jeunes femmes était surtout de trouver un hôtel, avant de se lancer le lendemain à la recherche d’un travail. Les fragiles économies de Philomène ne permettraient pas de subsister bien longtemps.
Au sortir de la gare, c’est Catherine qui vit la première une affiche proposant des logements, tracée d’une écriture maladroite.
« À louer, chambres et appartements meublés deux pièces, 21 place des Capucines, prix modérés ».
- On peut toujours aller voir, proposa Philomène.
S’adressant à un employé du chemin de fer, elles se firent expliquer la direction de la place des Capucines. Il leur indiqua qu’il n’y avait pas plus simple : il suffisait de descendre le Boulevard d’Athènes, et la place se trouvait au bout, au niveau des allées. Cependant, mal assurées, elles demandèrent confirmation à un passant. Sous les bourrasques, Catherine commençait à grimacer et se demandait si elles avaient eu une bonne idée en venant ici. Et chacune traînait une valise lourdement remplie.
Elles débouchèrent sur la place où était fixée sur un immeuble la même affiche que celle de la gare. Le bâtiment ne révélait rien de particulier, sinon que sa façade était propre. Il ne paraissait ni luxueux ni modeste, ne laissant pas deviner le niveau de vie de ses occupants. La porte d’entrée était entrouverte sur un long couloir donnant sur la cour intérieure au milieu de laquelle trônait un olivier. L’aspect général leur parut assez sympathique. Elles frappèrent à la première porte dans le couloir. Il en sortit une femme sans âge, d’assez forte corpulence, qui n’eut pas besoin de se faire préciser le motif de leur visite.
- J’ai des chambres à cinquante francs par mois, et des deux-pièces à quatre-vingts francs. Le loyer est payable d’avance.
Philomène manifesta le désir de visiter avant de s’engager. La logeuse les conduisit au deuxième étage. Les escaliers de bois sentaient la cire fraîchement appliquée. La femme ouvrit un appartement qui donnait sur la cour intérieure. Il était petit, mais correctement meublé. La fenêtre était au niveau des plus hautes branches de l’olivier que Catherine regardait attentivement, car elle n’en avait jamais vu de près. Philomène fit une grimace quand la femme signala que les WC étaient au bout du couloir, ce qui fit sourire Catherine.
- Évidemment, chez le diplomate italien, tu as pris des goûts de luxe, dit-elle en allemand, car il n’était pas utile que la logeuse fusse le moins du monde informée sur leur vie antérieure.
Précisément, celle-ci, les entendant s’exprimer dans la langue de l’ennemi du moment, leur jeta un regard dubitatif. Ce qu’enregistra aussitôt Philomène, qui s’empressa de détendre l’atmosphère.
- Nous aimons la France et nous voulons vivre et travailler ici. Nous allons nous faire naturaliser. Nous voulons devenir de vraies Françaises.
Et comme elle extirpait de son sac une liasse de billets pour régler le premier loyer, la femme redevint pacifiste et tendit la main.
Dès le lendemain matin, comme convenu, chacune partit de son côté, à la recherche d’un emploi de vendeuse. Munies d’un plan de la ville, elles s’étaient réparti les rues. Entrant dans les boutiques de vêtements, les commerces alimentaires un peu importants, les quincailleries, les drogueries, les bazars, elles proposaient leurs services. Partout, la réponse était à peu près la même : « Avec la guerre, les affaires vont mal, on ne peut pas se permettre de prendre des employés ». Mais dans cette référence à la situation, elles ne pouvaient s’empêcher de penser que leur accent les trahissait et qu’on les accusait plus ou moins de la responsabilité du conflit. Parfois, et selon l’âge du commerçant, il leur arrivait d’ajouter qu’elles pouvaient également garder des enfants.
Elles passèrent ainsi plusieurs jours à ratisser la ville sans succès. Les économies de Philomène commençaient à présenter un niveau inquiétant quand, un soir, la logeuse vint frapper à la porte.
- Vous cherchez toujours du travail ? On m’a dit qu’au 20 de la rue de Rome, il y a un atelier de confection qui embauche. Si vous savez coudre, vous pourriez toujours aller voir.
Les sœurs remercièrent, sans savoir si la sollicitude de la logeuse était un pur acte de sympathie ou si elle était dictée par le souci d’encaisser régulièrement le loyer. La couture, pourquoi pas ? Cela faisait partie de l’enseignement reçu à English Fraulein, et au moins on était assises.
L’homme qui les accueillit avait plus l’aspect d’un contremaître sur un chantier du bâtiment que d’un tailleur de costumes. La chose se confirma quand il apporta quelques précisions.
- Depuis le début de la guerre, je me suis reconverti. Notre atelier travaille exclusivement pour l’armée, nous faisons les pantalons des soldats. En ce moment, c’est la seule activité qui marche, et le boulot ne manque pas. Il y a une grosse demande, et surtout il faut livrer dans les délais. L’armée ne regarde pas trop la qualité, surtout que beaucoup vont finir dans les tranchées. Alors, l’élégance, ça passe au second plan.
Puis il leur fit visiter l’atelier, un hangar dans lequel crépitaient une douzaine de machines à coudre, activées par les jambes énergiques de jeunes femmes dont beaucoup avaient leur mari à la guerre.
- Certaines ont perdu leur homme sur le front, ou un frère. Là, elles ont un peu l’impression de se venger en travaillant pour notre armée. Mais, je me trompe, ou vous avez l’accent allemand ?
Une nouvelle fois, Philomène s’empressa de préciser qu’elles voulaient s’installer en France, et qu’elles comptaient se faire naturaliser. Simplement, elles attendaient la fin du conflit, car elles pensaient que ce serait peut-être plus facile.
- Oh, moi, ça ne me gêne pas. Mais c’est pour vous. Vous vous rendez compte que vous allez travailler pour l’armée française ? C’est vous que ça pourrait gêner.
Philomène mit dans sa voix toute la conviction possible pour affirmer que ce n’était pas un problème et qu’elles n’avaient plus que leur vieille mère comme attache en Allemagne.
- Bon, eh bien, soyez là demain matin à huit heures.
Folles de joie, elles s’offrirent ce soir-là, avec les dernières économies, un repas dans un restaurant du Vieux-Port.
Très vite, elles constatèrent que l’enseignement reçu à English Fraulein en matière de couture n’avait qu’un lointain rapport avec ce qu’on attendait d’elles. Là-bas, c’était la couture artistique, raffinée, le petit doigt en l’air. Ici, c’était la grosse cavalerie, la course au rendement comme l’avait précisé le patron, sous la surveillance alternée de deux mégères imbues de leur parcelle de pouvoir. Heureusement, le patron savait mettre un peu plus d’humanité dans ses rapports. Finalement, il convenait de laisser éructer les mégères, et de terminer son lot de pantalons dans les délais indiqués. Il suffisait de s’habituer à cette odeur puissante de drap mélangée à celle de la transpiration, qui s’accumulait dans ce local sans fenêtres. Dans l’ensemble, même les veuves de la guerre les regardaient avec une certaine clémence. Deux Allemandes qui voulaient devenir Françaises, c’était un peu quelqu’un qui tournait le dos à l’ennemi, qui ne voulait plus être sous sa coupe. C’était comme une prise de guerre, donc on ne pouvait que leur être favorables.
Les journées se succédaient dans la monotonie, et c’est Catherine qui, un soir, exprima la première sa lassitude.
- Tout de même, il y a peut-être des façons de gagner un peu mieux sa vie. Parfois, je me vois en propriétaire de magasin. Ou en patronne d’hôtel. J’aimerais ça : le monde, le mouvement, l’imprévu.
Et Philomène, dans son rôle de mère de substitution, la ramenait sur terre.
- Bon, eh bien quand nous aurons gagné de quoi acheter un magasin ou un hôtel, nous en reparlerons.
- Qui sait ? reprenait Catherine sur le ton de la plaisanterie. Il y a peut-être en ce moment dans Marseille un gros commerçant qui m’épouserait ou qui t’épouserait, mais il ne nous a pas encore rencontrées. Et celui-là espère peut-être une femme dans notre genre. C’est quand même idiot. Et toi, tiens, tu aurais bien pu t’arranger avec ton Italien.
Philomène n’aimait pas qu’on lui rappelle cet épisode assumé par contrainte.
- Tu m’énerves avec celui-là. De toute façon, je ne l’avais pas attendu. J’en ai connu quelques-uns avant lui.
Catherine, surprise par cette confidence, manifesta son étonnement.
- Ah, mais ! Tu ne m’en as jamais parlé ?
- A quoi bon ? Tu étais bien loin.
- Raconte.
- C’est sans importance, je les ai oubliés, sauf un. Celui-là était dans les affaires, comme il disait. Je n’ai jamais vraiment su ce qu’il trafiquait, mais il me donnait parfois de l’argent en me disant qu’il avait réussi une bonne opération. Il voulait que je m’associe avec lui. J’ai hésité. Puis un jour il a disparu, je n’ai plus eu de nouvelles. Ses amis m’ont dit qu’il était parti à l’étranger, car la police le recherchait. Mais je suis sûre qu’à l’étranger, il se débrouille pour gagner tranquillement sa vie. Parfois, je regrette de ne pas l’avoir suivi. C’est lui qui avait raison. Maintenant je serais riche.
- Et tu m’offrirais un commerce…
Le même soir, Georges Sarret, vous veniez d’apprendre que vous aviez décroché la licence en droit. Pour un étudiant, votre âge, trente-neuf ans, était un peu exceptionnel. Mais pour vous établir, en vous attribuant le titre imposant d’avocat-conseil, comme vous en aviez rêvé, cela était tout à fait convenable. Vous fêtiez le lendemain l’événement au Relais des Chasseurs, à la Valentine. Il y avait là votre deuxième épouse, deux ou trois camarades de Faculté, Liégeois, le directeur du Sémaphore. Il y avait aussi François Villette. Bien qu’accusant quinze ans de plus que vous, ce vieux garçon était votre ami de longue date. Pour vous être agréable, il vous était tout dévoué au moment des élections. Il collait les affiches que vous lui désigniez, déchirait la nuit venue celles des autres dans les secteurs que vous lui affectiez, distribuait vos tracts dans les boîtes à lettres. Il allait avec acharnement porter la contradiction aux adversaires dans les débats sous les préaux d’écoles. Il martelait alors avec une belle assurance les arguments que vous lui aviez fait apprendre par cœur, car il était bien incapable d’avoir sa propre réflexion. En fait, la question ne l’intéressait pas : il voulait seulement, tout en vous rendant service, ne pas manquer une occasion de jouer de ses poings et de sa barre de fer contre les rouges. D’un naturel taciturne, vivant dans votre ombre, il admirait votre aisance et votre réussite. François Villette, tirant parti d’activités mal déterminées, était connu dans la ville comme manipulant volontiers les armes. Était-ce l’une des raisons qui procurait chez vous une espèce de fascination ? Quoi qu’il en soit, il était de ceux sur qui vous pouviez compter. Ce soir-là, autour de la table, il y avait en plus cinq ou six personnages qui espéraient se faire un nom dans la politique.
Chapitre 3
Le 1er octobre 1919, Sarret était radieux. C’était l’aboutissement concret, bien visible, de son projet : un ouvrier apposait une plaque de cuivre sur la porte du 46, Rue de la Palud : « G. Sarret, avocat ». Certes, il n’ignorait pas que l’appellation était assez discutable. Désireux de se faire au plus vite une place chez les notables de Marseille, il n’avait pas même envisagé de suivre le cursus, qui lui aurait demandé au mieux encore deux années, pour pouvoir revêtir la robe en toute légalité. Il ne connaîtrait jamais la griserie de la plaidoirie. Mais il pensait être fondé à s’attribuer le titre correspondant à une fonction mal définie : avocat-conseil. C’est ainsi qu’il se désignait sur le papier à lettres, pensant de ce fait prévenir toute contestation. Mais pour la plaque extérieure, qui était censée séduire le client potentiel, mieux valait jouer le grand jeu. Aussi, dans la fébrilité, il était venu plusieurs fois veiller à ce que l'ouvrier plaçât la plaque dans une horizontalité parfaite. En dehors des transactions immobilières, il ne voyait pas encore très précisément jusqu’où le conduirait cette fonction d'avocat-conseil, mais il était sûr d’une chose : il gagnerait royalement sa vie.
C’est son activité de marchand de biens qui l’avait amené à connaître la disponibilité de ce local. Situé dans une rue calme parallèle à la rue de Rome, à deux pas de la préfecture et de toutes les activités qui comptaient dans la vie de la cité, sa seule position ne pouvait que jouer en faveur du développement des affaires. Il s’agissait d’un ancien cabinet de médecin. Situé au premier étage, on y accédait par un bel escalier à double volée comme on savait les faire sous le Second Empire. Au deuxième étage, il aménagerait son propre appartement.
L’entrée de l’étude donnait sur un large hall d’accueil équipé d’un comptoir destiné à la secrétaire, qui serait Laurence, la propre fille du maître des lieux. À droite, un salon d’attente, à gauche le bureau de Sarret. Derrière le hall, une assez grande salle sans affectation précise pouvait servir pour stocker de la documentation, ou organiser des réunions politiques , comme il l'avait imaginé dès la visite des locaux. Quelques jours de travaux de peinture avaient mobilisé François Villette, aidé de deux comparses au statut social imprécis, pour rendre le lieu plus accueillant. Un mur du hall portait deux sous-verre : le diplôme de licence de Sarret, et une citation pour faits de guerre, ce qui ne pouvait que donner confiance aux visiteurs.
L’ouvrier venait à peine de visser le rectangle de cuivre quand se fit entendre dans l’escalier le brouhaha des premiers invités du cocktail d’inauguration. De nombreuses relations nouées avant la guerre qui en avait enrichi certains, ou de nouveaux contacts établis récemment en pensant à l’avenir. On reconnaissait le député Bergeon, Artaud, qui présidait la Chambre de commerce, l’armateur Giraud, quelques juges du Tribunal de commerce, plusieurs gros commerçants, des conseillers municipaux qui allaient être soumis à réélection à l’occasion de la consultation de novembre, des officiers en retraite…Parmi les invités moins prestigieux, on remarquait encore la première et la deuxième épouse de Sarret. Si elles s’étaient séparées de lui, elles continuaient à lui accorder leur confiance, car il était toujours, moyennant des commissions à tarif d’ami, le gestionnaire de leurs économies. Dans la grande salle, derrière la longue table nappée de blanc, garnie de deux bouquets, François Villette et Laurence veillaient à garnir les plats et remplir les verres.
Informé par Sarret, un journaliste du Petit Marseillais était là, interrogeant les uns et les autres sur ce qu’ils pensaient de cette belle soirée, et prenait des notes pour son papier du lendemain.
Bergeon avait absolument tenu à faire un petit discours dans lequel il se réjouissait de cette étape nouvelle franchie par un de « nos meilleurs amis, un héros de la guerre » à qui il promit un brillant avenir tant sur le plan personnel que politique. Le préfet étant empêché par une réunion de travail dans la capitale, c’est son directeur de cabinet qui donnait à la soirée un ton très officiel.