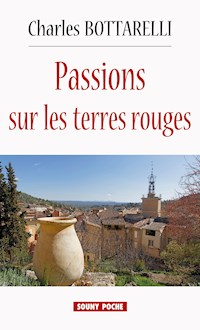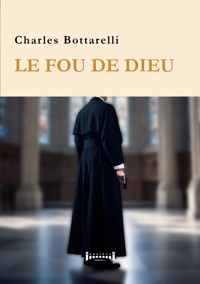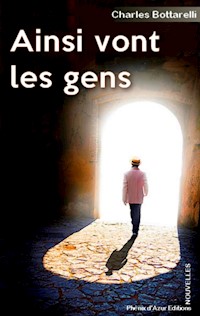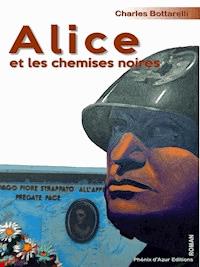1936, le 28 juillet. Après la journée de travail, quand il passe sa main sur son visage, il est toujours surpris. Il
ne sent plus sa peau. Il a l’impression qu’elle s’est couverte d’une pommade sur laquelle glissent ses doigts. Il ne s’habituera jamais. Il regarde le gras de son index, et s’étonne encore de le trouver si rouge. Ce n’est pas une pommade. C’est cette saloperie de poussière écarlate qui l’habille chaque soir de la tête aux souliers. Cette saloperie qui fait vivre les hommes d’ici, et qui peut-être, un jour, les fera mourir. Il sait bien que, lorsqu’il est au fond de la galerie, la damnation ne se contente pas de le recouvrir.
Il l’avale en respirant, elle descend dans la trachée, elle atteint les poumons. Et elle les tapisse peut-être aussi bien qu’elle tapisse sa figure. Elle vit avec lui, elle vit en lui, elle ne le quittera
plus. Chez les mineurs de charbon, il sait que le danger s’appelle silicose. Certains n’y résistent pas. Le médecin les arrête avant l’âge, ils en meurent, c’est la fatalité. Ici, on lui dit que la silicose n’existe pas dans les mines de bauxite. Pourtant, toute cette poussière qui pénètre en lui ne peut pas disparaître comme par magie. Et lui en a vu deux ou trois qui devaient s’arrêter avant l’âge. On parlait de tuberculose. Peut-être était-ce cela, peut-être était-ce autre chose. Les médecins employés par les compagnies n’avaient sans doute pas intérêt à chercher trop loin.
Parfois, quand ils travaillent à proximité d’un ruisseau, certains, à la belle saison, vont, au sortir du labeur, s’y plonger pour chasser la poussière, au moins celle qui est visible. Quand ils sont en groupe, ils s’ébattent comme des enfants, s’aspergent mutuellement, oubliant un moment leur fatigue. Mais il reste toujours
un peu de cette terre rouge qu’ils emmènent chez eux.
Lui ne croit pas qu’il en mourra. Ou il ne veut pas y croire. Mais tout de même. Qui sait ? Il y a toujours ce nuage, cette ombre rouge qui plane au-dessus de ses pensées. À cause d’elle, il n’est pas bien sûr de son avenir. Pas bien sûr de savoir de quoi demain sera fait. Pourtant, ce n’est pas le moment de se laisser gagner par l’inquiétude. Depuis le printemps magique qu’il vient de vivre, le vent de l’espoir souffle jusqu’ici. Lui, Clovis Morelli, secrétaire de la CGT, doit porter la bonne parole. Celle qui évoque les victoires ouvrières déjà obtenues, d’autres qui semblent s’annoncer, et celles qu’on pourra encore désirer. Dans le pays entier, il sent monter le tourbillon. Cet élan qui soulève tout ne va pas s’arrêter. Maintenant, ce sont les ouvriers du textile de la région lyonnaise qui entrent dans la lutte, ce sont les métallos, et ceux de chez Berliet. Les mineurs du charbon y sont déjà. Dans le Nord, ils ont obtenu satisfaction. Ceux de la bauxite, les siens, ont
mené une belle bataille, ils sont sur la voie du succès. Alors, on ne doit pas se laisser démoraliser par la poussière rouge. Et puis, c’est certain, les services de santé vont se développer, on ne peut que progresser dans la prévention et dans la guérison. Demain, tout va changer. Il devrait être gagné par l’allégresse, mais il a ce souci au sujet de son ami Émile. Émile qu’il va devoir aider, mais il ne voit pas encore comment.
La poussière imprègne aussi ses vêtements. Mireille, sa femme, a beau frotter comme une forcenée avec sa brosse de chiendent, l’eau du lavoir tourne au rouge et la trace ne disparaît jamais complètement du tissu. À côté d’elle, les autres lavandières s’exclament parfois en pressant sur le linge, comme si elles faisaient le concours
de celle qui obtiendra l’eau la plus colorée. La poussière s’incruste dans le tissu, elle est la marque du métier exercé par Clovis. Mais c’est parce qu’il traverse le village ainsi recouvert, en apparition rougeâtre, qu’on le regarde avec respect. Les gens d’ici savent bien ce qu’ils doivent à ces hommes d’une autre couleur.
C’est peut-être pour cette considération qu’on leur porte que lui-même n’a pas hésité. Après son certificat d’études, il n’a pas eu à se poser de question. Son père travaillait à la mine de bauxite, il ne pouvait que le suivre. Du plus loin qu’il se souvienne, il n’avait jamais pensé à autre chose.
Son père, Attilio Morelli, chassé d’Italie par la misère, était arrivé ici en 1900, le jour de ses vingt-quatre ans. Il avait d’abord cherché à se faire embaucher comme journalier dans les propriétés agricoles des environs. C’était le chemin que suivaient la plupart de ses compatriotes, quand ils ne
devenaient pas charbonniers dans la forêt des Maures, ou chaudronniers aux chantiers de La Seyne. Mais, très vite, un mineur, venu comme lui de Lombardie, lui avait suggéré de tenter sa chance auprès de l’une des quatre compagnies minières qui exploitaient la bauxite. « Tu verras, ici on n’a pas l’or de l’Amérique, mais on a de l’or rouge. On n’a pas besoin de traverser l’Océan, sauf que chez nous personne ne fait fortune. » L’or rouge. Les ouvriers aimaient cette dénomination qui les valorisait, qui les désignait comme appartenant à une lignée plus noble, qui les distinguait de tous les autres travailleurs de la terre.
Ils n’étaient pas les mineurs de n’importe quel caillou. Ils étaient ceux de l’or. Rouge. C’était aussi une espèce de pudeur qui les amenait à ne pas nommer la cause de leur fatigue. L’expression avait été inventée par un patron qui, lui, pensait plutôt aux profits qu’il en retirait. Pour celui-là, il s’agissait vraiment d’or.
En 1920, sitôt connus les résultats du certificat d’études, Clovis s’était précipité chez Justin Coret, le petit exploitant d’une mine à ciel ouvert du côté de Mazaugues, indépendant des grandes sociétés. C’est par timidité qu’il avait choisi cette exploitation de taille modeste, en pensant qu’il lui serait plus facile de convaincre le patron de l’embaucher. Les grandes compagnies lui paraissaient relever d’un univers compliqué où seuls des adultes pouvaient se faire une place. Mais, déjà, il rêvait de la vraie mine, celle dans laquelle on descend par un puits tout en se
demandant si la terre ne va pas s’effondrer sur vous. Celle où on travaille dans le secret d’un monde souterrain, inaccessible au commun des mortels. L’exploitation à ciel ouvert ne méritait que le nom de carrière. Le puits était la vraie consécration où on atteignait la légende des mineurs du charbon.
Le père Coret l’avait jaugé avec bonhomie mais circonspection. Ce garçon pas encore homme, aux épaules fluettes, à la voix qui muait, lui serait-il utile dans l’exploitation ? Et puis, un enfant de moins de dix-huit ans, c’était bien plus compliqué. Comme pour les très rares femmes des chantiers, il fallait l’inscrire sur un registre spécial, l’écarter des tâches les plus dures, lui accorder des pauses dans la journée. Et même avoir à l’œil le contremaître pour empêcher que, par facilité, celui-ci soit enclin à lui attribuer les travaux que les autres rechignaient à exécuter. Cependant, un de ses ouvriers venait de tomber malade, et il lui fallait
le remplacer très vite. À défaut de bénéficier d’une forte carrure, le gamin semblait poussé par le désir de travailler. Et Coret disposait de bons renseignements sur le père, Attilio. « Soit, avait-il fini par dire, tu commences demain. »
Puis les choses s’étaient enchaînées à grande vitesse. L’une après l’autre, les grandes compagnies s’installaient, absorbant les petits exploitants qui, dans l’incapacité où ils se trouvaient de leur résister, se contentaient d’en devenir les actionnaires. Les ouvriers passaient d’une enseigne à l’autre, et Clovis avait enfin pu se retrouver plus tard dans une « vraie » mine où l’on descendait à soixante mètres ou plus dans une cage branlante. Le temps d’une journée de travail, on appartenait à un autre monde.
Quand il avait décidé d’aller frapper chez Coret, il avait dû affronter les angoisses de sa mère, Emma. Celle-ci avait encore en mémoire les trop nombreux accidents qui s’étaient produits au Val et au Cannet en 1911. Neuf ans s’étaient écoulés, mais la douleur était encore vivante. Et on en reparlait souvent au cours des repas ou dans les
cafés que fréquentaient les hommes. Son enfance avait été accompagnée par ces descriptions de scènes où les ouvriers étaient à la fois inquiets du sort qui pourrait être le leur et fiers d’appartenir à une sorte de caste surmontant le danger. Les maraîchers qui veillaient sur l’arrosage de leurs légumes ou sur la taille des arbres fruitiers ne leur paraissaient pas dignes d’être pris au sérieux. Ils ne risquaient rien de plus qu’une entaille dans un doigt. Le quotidien des mineurs, c’était bien autre chose. Au Val et au Cannet, en raison de l’étroitesse des galeries, il n’était pas rare qu’un wagonnet mal maîtrisé ou échappant soudain à la vigilance des hommes vînt se fracasser contre une paroi en broyant le malheureux mineur qui se trouvait
sur sa trajectoire. Au Val, Attilio avait été le témoin direct d’un de ces drames, et ses mots revenaient souvent à la mémoire de Clovis : « J’étais à quelques centimètres de lui, encore un peu j’y passais aussi. J’ai crié, mais il n’a pas eu le temps de s’écarter. J’ai voulu le tirer par le bras, mais c’était trop tard. J’ai encore dans la tête le drôle de bruit du choc. Et après, après, ce n’était pas beau à voir. Je sais bien que j’ai fait ce que j’ai pu, mais parfois, encore aujourd’hui, je m’en veux. » Et parfois, Attilio interrompait son discours, sa voix hoquetait, et des larmes
n’étaient pas loin de perler.
D’autres fois, il s’agissait d’un éboulement de la roche, soudain, imprévisible, sans qu’aucun signe n’alerte les ouvriers à proximité. Ou encore l’explosif qui partait trop tôt. Ou l’irruption brutale, massive, d’une masse d’eau qu’on n’avait pas soupçonnée. Tout pouvait devenir piège dans cet univers fermé. Il fallait trouver le moyen de s’échapper très vite.
« Pour quelles raisons tu crois que la direction t’offre un jeton avec ton nom ? » lui avait demandé un ancien lorsqu’il avait débuté dans un puits. Et il l’avait averti : « Le matin, quand tu descends, tu prends ton jeton sur le tableau, juste au-dessus
de ton nom. Le soir, en remontant, tu le remets à sa place. Si le chef voit que le jeton n’est pas revenu, c’est que c’est toi qui n’es pas revenu. Alors, là, on commence à s’inquiéter. »
Après la série d’accidents du Val et du Cannet, l’attitude de la direction avait été perçue sévèrement. Les compagnies d’assurances ayant relevé leurs tarifs, certains cadres avaient cru bon d’incriminer le manque d’attention des ouvriers, leur faisant en quelque sorte porter la responsabilité. Évaluer les dangers était pourtant bien le rôle des ingénieurs. Les mineurs, eux, étaient là pour exécuter : on le leur faisait suffisamment sentir. Les directeurs laissaient entendre
que, si les choses continuaient ainsi, il faudrait envisager une réduction des salaires pour compenser le relèvement des primes d’assurance. Un ingénieur avait même eu le cynisme de leur déclarer : « Vous n’êtes pas les plus mal placés des travailleurs des mines. Vous, au moins, vous ne risquez pas le coup de
grisou comme vos collègues du charbon. Et je peux même vous assurer que vous êtes mieux payés. »
Toutes ces difficultés, un peu vagues dans la tête de l’enfant qui n’avait que trois ans au moment de la série d’accidents du Val et du Cannet, étaient bien présentes à l’esprit de Clovis quand il s’était décidé à aller solliciter Coret. Mais le désir de travailler pour gagner son pain comme un grand avait été le plus fort. Il avait obtenu de sa mère qu’elle lui préparât une tenue de travail : un pantalon de toile rêche confectionné à la hâte et un blouson un peu trop grand que son père ne portait plus. À l’époque, les dirigeants ne distribuaient pas encore les deux tenues annuelles,
dites « bleus de mineurs ». On devait se débrouiller. Attilio avait accompagné son fils jusque sur le carreau et avait attendu ce moment d’émotion où l’on avait remis le casque à l’adolescent. En quelque sorte, on consacrait une dynastie. Clovis s’était alors senti devenir un homme, et le ton conciliant du contremaître l’avait rassuré : « Tu n’as pas encore beaucoup de muscles, mais ici tu vas t’en faire avec ça. » Et il lui avait tendu une pelle au manche recourbé dont on lui avait tout de suite enseigné qu’il s’agissait de la pelle-tampon. La forme particulière permettait de mieux ramasser le minerai sur le sol. Le manche portait encore
le nom de celui qui l’avait maniée jusque-là, avant de partir en retraite.
Puis, au sein de l’équipe, il avait dévalé avec un peu d’angoisse le plan incliné jusqu’au mur de roche qui marquait le début de la tranchée qu’on devait continuer à creuser. Un homme lui avait montré comment bien tenir le burin pour pratiquer le trou où viendrait se loger l’explosif. Parfois il s’interrompait, redressant son corps pour soulager la douleur naissante dans le
dos. En levant la tête, il suivait l’évolution du soleil tout en pensant déjà à ce jour où il pourrait vraiment descendre dans les entrailles de la terre. Il connaîtrait alors la magie de ces outils perfectionnés dont parlaient les compagnons de son père, et qui permettaient de progresser rapidement dans la conquête du minerai. En fin de matinée, il s’était étonné de l’agitation fébrile qui régnait autour de lui. La paroi était maintenant constellée d’encoches prêtes à recevoir les charges de poudre noire. Le boutefeu avait entrepris son œuvre en déposant les charges d’explosif et les mèches. Quelques minutes plus tard, il faisait un signe pour dire qu’il était prêt. Le contremaître ordonnait à tous de s’éloigner. L’artificier allumait le briquet et enflammait la mèche. Un moment après, une explosion dont le vacarme était répercuté par les parois de la tranchée provoquait les vivats du groupe. Une pluie de cailloux retombait tout autour
de l’emplacement de l’explosif. Clovis éprouvait comme un sentiment de victoire, celle de l’homme qui savait se rendre plus fort que la nature.
À midi, il avait fait comme les autres. Au coup de sifflet du contremaître, il était remonté sur le carreau, s’était assis à même le sol, et avait sorti de sa musette le repas qu’Emma confectionnait maintenant pour deux. Ses collègues parlaient bruyamment et parfois éclataient de rire pour des motifs qu’il ne comprenait pas toujours. Mais il ne voulait pas avoir l’air de demeurer un étranger, et il s’efforçait de sourire, juste pour montrer qu’il participait. Un mineur dont il ne connaissait pas encore le nom avait levé son verre en lui mettant une main sur l’épaule, et avait lancé à la cantonade : « Je bois à la santé de notre nouveau galibot ! » Et, pour la première fois, il avait bu du vin sans eau.
Pour le premier jour, Emma, toujours soucieuse, avait vu trop grand pour son
repas, et lui avait donné un morceau de pain supplémentaire. Son voisin Victor, qui s’en était aperçu, lui avait dit : « Si tu as un reste de pain, tu peux me le donner, et moi en échange je te donne une rondelle de mon saucisson. » Clovis, qui n’avait plus faim, avait accepté le marché en trouvant bien rassurante cette manière de mettre leurs ressources en commun.
Le soir, il avait repris sa bicyclette pour accomplir les huit kilomètres qui le séparaient de chez lui. Dès les premières côtes, la transpiration se mêlait à la poussière rouge pour faire une espèce de colle qui fixait ses mains au guidon. Mais il n’était pas peu fier de ce signe particulier qui le rendait désormais respectable. Il venait d’entrer dans le monde du travail.
Comme si elle l’avait attendu depuis le matin, Emma se tenait sur le seuil quand il arriva. Elle
le regarda, comme pour se rassurer de le retrouver intact, et le vit plus grand
que la veille.
— Viens, j’ai fait chauffer l’eau. Puisque tu arrives avant ton père, tu passeras le premier.
Elle plaça au milieu de la salle commune le tub de fer-blanc, puis lui demanda de l’aider pour sortir du feu le gros chaudron de cuivre.
Pendant qu’il se déshabillait, il livrait en vrac et en toute hâte les détails de ce qui avait été sa première journée de labeur. Elle se contentait de questions brèves, ne voulant pas interrompre le flot de paroles. Puis, comme elle l’avait toujours fait pour Attilio, elle pressait au-dessus des épaules la grosse éponge, et le ruissellement amena dans le tub un liquide rougeâtre que Clovis contemplait en se demandant comment la poussière pouvait franchir l’obstacle des vêtements. C’était bien là une preuve supplémentaire qu’il était devenu un mineur de bauxite, un maître de l’or rouge.
Les premiers jours se déroulèrent de la même manière, avec leur lot d’ampoules aux mains et de douleurs dans le dos. Le chantier du moment occupait
une position surélevée. Quand on avait poussé les berlines jusqu’au lieu de déchargement, il fallait les descendre au moyen d’un petit treuil à air comprimé qu’on avait surnommé lePygmée. Mais son câble trop usé était parsemé de gendarme1s, et Clovis en eut très vite les mains ensanglantées. Ardent à la besogne, il était bien accepté par le groupe, mais il se trouvait un peu jeune auprès de ces ouvriers dont le moins âgé avait quarante ans. Certains avaient même tendance à se moquer gentiment de lui, l’un allant jusqu’à l’appeler « bébé ». C’est pourquoi il se sentit soulagé quand il fut rejoint, quelques semaines plus tard, par un autre débutant, Émile Bringuier, son aîné de deux ans seulement.
Pensant que l’arrivant serait plus réceptif aux conseils d’un collègue qui avait à peu près son âge, Coret avait demandé à Clovis d’initier le nouveau. Il avait été sensible à cette marque de confiance de son patron. Émile était d’un abord complexe. Autant il se montrait aimable, direct, voire conciliant,
autant il affichait un caractère susceptible quand on s’opposait à lui, avec une tendance à se replier sur lui-même. Mais Clovis sachant se montrer patient et compréhensif, n’attachant pas d’importance aux événements qui n’en valaient pas la peine, les deux jeunes gens devinrent des amis. Et ils
employaient parfois leurs dimanches dans des parties de pêche, ou, un peu plus tard, dans la fréquentation en commun des bals de village.
Ce soir, près de vingt ans après sa première descente, alors qu’il s’achemine vers sa maison après avoir sauté du camion que la direction de l’Union des Bauxites a bien voulu affecter au transport des ouvriers, Clovis
repense à sa jeunesse, à ses débuts, à la pelle portant sur son manche le nom de Maurin, et au chemin parcouru. Et il
pense, une fois de plus, à son copain Émile Bringuier. Celui-là possède l’art de se mettre dans des situations difficiles. Dans son rôle de délégué syndical, il a déjà eu à intervenir pour le défendre. Ses réparties trop franches lui ont parfois valu quelques accrochages avec la hiérarchie. Il ne laissera jamais tomber le camarade de ses débuts. Mais si ce qu’on dit sur son compte est vrai, c’est plus délicat. D’abord, la question ne relève pas de la compétence du syndicat. C’est une affaire toute personnelle, et il n’a pas à s’en mêler. Et au point où en sont les choses, c’est à la justice de se prononcer. Tout juste peut-il l’évoquer avec lui, en tant qu’ami. Mais pour lui dire quoi, au juste ? Ensuite, une fois qu’il sera renseigné, il essaiera de frapper à la bonne porte. Mais, justement, quelle est la porte, pour cette affaire hors
du commun ? Clovis n’a jamais hésité à intervenir, à remuer ciel et terre, pour des causes qu’il pensait justes. Or, cette fois, il se sent bien démuni. Demain, il ira voir sur place, mais ce soir il ne sait pas encore comment
aborder le problème. Il est seulement convaincu qu’il doit aider son ami.
1Gendarme : rupture d’un filament entraînant une saillie blessante.
1912, le 16 février. Comme on disait dans le village, quand on finissait par être convaincu que la rumeur disait vrai : « Tout de même, cette Odette, on lui aurait donné le Bon Dieu sans confession. » Mais, dans l’intonation, on prenait garde à ne pas laisser paraître le moindre reproche. Car tout le monde aimait Odette, ce qui, justement, était une partie du problème.
Toujours souriante, un mot aimable pour chacun, engageant volontiers la
conversation, mais sachant se taire quand c’était utile, Odette Bringuier présentait bien. Certains trouvaient même qu’elle s’habillait un peu au-dessus de sa condition de femme de mineur. Mais on n’en faisait pas une affaire, l’élégance lui allait si bien. Et, après tout, ce n’était jamais que son argent puisqu’elle était employée aux écritures dans l’entreprise de transport de M. Verlaque. Contrairement à la plupart des femmes du village, vouées à travailler durement dans leur maison ou dans le jardin familial sans être payées, Odette, reconnaissait-on, « gagnait sa vie ». Elle avait bien le droit d’employer son salaire dans des tenues vestimentaires. Les vieilles d’ici avaient une expression pour la définir : « c’est une damotte ». Cependant, elles n’y mettaient pas le ton critique réservé à d’autres, c’était tout juste pour insinuer que cette femme du village avait une allure qui
aurait paru naturelle chez les bourgeoises de la ville. Qualité qu’on lui reconnaissait en plus de celles de bonne épouse et de bonne mère. Mère d’Émile, qui allait sur ses douze ans, et de sa cadette Lucette, qui atteignait les
trois. Plus jeune que son mari de dix ans, mère à vingt ans, elle paraissait avoir décidé une fois pour toutes de faire son chemin dans la vie. On lui pardonnait de ne
pas être comme toutes les autres, seulement attachées à tenir leur maison, à laver les vêtements de travail du mari, et à veiller à la bonne marche de la famille. La seule ombre au tableau était qu’on ne la voyait jamais à la messe, même pas à celle de Noël, ni à celle des Rameaux pour la bénédiction du bouquet de laurier. Pour quelqu’un qui se donnait des allures de citadine, c’était une faute de goût. Les vieilles s’en désolaient, mais se disaient qu’elle avait tant d’autres qualités…
Que se passe-t-il parfois dans la tête des gens ? Qu’avait-il pu advenir pour que la route droite et sans cahots d’Odette perde soudain un peu de son prestige ? Par quel mystère Odette Bringuier était-elle devenue, dans l’esprit de certains, la possible maîtresse du mineur Silvio Longo ? Même après le drame, on avait du mal à employer ce terme de « maîtresse », car rien ne prouvait qu’elle eût pu un jour coucher avec lui. Certes, certes, on voulait bien admettre qu’elle avait peut-être éprouvé une attirance, un faible pour le mineur italien, mais c’était sûrement lui qui l’avait séduite. Ces gens-là, on voyait bien ce qu’ils savaient faire. « Les Italiens, ils grattent un peu la mandoline, et les filles tombent comme des
bécasses », disait Lucien, au café, après trois ou quatre verres, dans un débordement de sociologie vineuse. Bon, elle n’était peut-être pas restée insensible à ses avances, mais, quand on a à peine la trentaine, qu’on est une jolie femme avec un cœur en or, n’est-ce pas une sorte de pitié qui pousse à céder à celui qui vous implore ? Et s’il était vrai, comme on voulait le croire, qu’elle n’avait pas commis d’acte charnel, il n’y avait que demi-mal.
Quand on pense que même Ginette Crozier faisait preuve de mansuétude ! Ginette Crozier était la langue la plus acérée du village. Elle faisait, et surtout défaisait, les réputations à grands coups de hache. Ses incisives étaient l’instrument de sa parole. Elle savait tout sur tout le monde, et, au besoin, en
rajoutait beaucoup. Plus d’une femme avait déjà pleuré à cause des racontars répandus par Ginette Crozier. Quelques couples n’y avaient pas résisté. Or, elle était d’une largesse d’esprit étonnante à l’égard d’Odette Bringuier. Peut-être admirait-elle en silence l’allure de cette femme, sa sérénité, la seule à lui en imposer. Et surtout Ginette était comme tout le monde : elle avait quelques doutes sur les relations entre Odette et Longo, mais, à vrai dire, elle ne savait rien.
Quand on évoquait Odette devant elle, Lucienne Lambert, soixante-huit ans, rappelait qu’elle l’avait connue enfant, qu’elle l’avait vue grandir, qu’elle avait très tôt remarqué son intelligence. Elle lui prédisait un brillant avenir, quelque chose comme institutrice, fonctionnaire des
postes et télégraphes, ou même médecin. C’était aussi pour cette raison qu’Odette était tant appréciée : plutôt que de rêver à un destin glorieux, elle avait eu la modestie de se contenter d’un travail aux écritures pour demeurer la compagne d’un simple mineur de bauxite, d’une gueule rouge.
Le 16 février 1912, on sortait enfin d’une longue semaine de pluies violentes comme on n’en connaissait que rarement. La veille, le ciel s’était progressivement éclairci grâce à un vent glacé qui changeait en givre la moindre buée.
Vers le milieu de la matinée, Florent Marsaud, un ingénieur du puits de Peirascas, fit appeler Jules Bringuier et Silvio Longo. Il
avait pris l’habitude de les faire travailler en équipe quand il s’agissait d’une intervention urgente. Expérimentés et consciencieux tous les deux, ils étaient à même de réparer dans les meilleurs délais les ennuis petits ou plus importants qui entravaient parfois la bonne
marche de l’exploitation. Ce matin-là, lorsqu’il était arrivé, Marsaud s’était trouvé devant l’équipe de Peirascas empêchée de prendre son service. Les fortes pluies avaient provoqué de sérieuses infiltrations et la galerie en cours de creusement était complètement noyée, rendant toute activité impossible. Jules et Silvio savaient dénoyer mieux que quiconque et avaient une bonne expérience de la pompe Holix 200 qu’ils utilisaient au mieux de ses capacités. En les voyant ainsi former une équipe de secours, certains les regardaient partir ensemble d’un œil goguenard en pensant à la rivalité supposée entre les deux hommes. « Espérons qu’ils vont pas en profiter pour se taper dessus », ajoutait nécessairement quelqu’un.
Ils trouvèrent Marsaud qui, sur le carreau, manifestait une certaine impatience.
— Il faudrait que ce soit terminé dans la matinée, mais je reconnais qu’il y a du travail. C’est totalement inondé en bas.
Ils enfilèrent des cuissardes de caoutchouc, placèrent la pompe juste en bordure du puits, puis chargèrent les portions de tuyau dans la cage. Au fur et à mesure de la descente, ils stoppaient à intervalles réguliers pour raccorder une nouvelle fraction du conduit à la partie déjà posée. L’un ajustait le tuyau, puis l’autre serrait le collier de maintien. Il leur fallut une demi-heure pour
atteindre le niveau de la galerie, à quarante mètres sous terre. Ils voulurent se diriger vers le bout de l’espace creusé récemment, pour bien constater les dégâts et réfléchir à la méthode à suivre. L’extrémité se situait en contrebas de l’arrivée du puits d’environ un mètre cinquante, de sorte qu’une poche d’eau s’était formée. Plus ils progressaient, plus ils sentaient la résistance du liquide qui était maintenant au-dessus de leurs genoux. Sur les parois, on distinguait les
filets qui suintaient à travers les roches.
— Même en dénoyant le tout ce matin, il y aura encore des infiltrations, il faudra y
revenir, constata Longo. L’ingénieur est toujours pressé, mais dans deux ou trois jours il faudra peut-être recommencer. S’il croit que le travail peut reprendre avant une semaine, il se met le doigt
dans l’œil.
Jules Bringuier eut un mouvement de surprise qui faillit le déséquilibrer. Dans l’eau obscure, son pied venait de heurter un gros morceau de roche. Il se tourna,
inquiet, vers Longo, qui comprit tout de suite.
— L’équipe avait bien nivelé la galerie avant de remonter. Si cette pierre est là, c’est qu’elle est tombée après.
Tous deux levèrent leur lampe vers le plafond. On distinguait parfaitement la cavité laissée par la chute du rocher. Dans cette partie, les boiseurs n’étaient pas encore intervenus pour poser les étais de chêne destinés à soutenir le plafond.
— Si tu veux mon avis, dit Longo, on va se dépêcher. La roche n’a pas encore fini de pisser, et, avec toute l’eau qu’il y a encore au-dessus, il risque de se produire d’autres chutes. On va commencer par poser le tuyau ici, puis on remontera vers le
puits. Là-bas nous serons plus tranquilles, ils ont boisé. Je vais chercher le matériel.
Aussi vite que le lui permettait la résistance de l’eau, Longo rejoignit la cage. Il s’était emparé de plusieurs portions du tuyau quand il eut l’impression d’avoir entendu un grondement. Mais le calme qui suivait le rassura, il s’était trompé. La sérénité ne dura pas. D’un coup, ce n’était plus un grondement mais un bruit assourdissant de roches qui s’entrechoquaient. Affolé, il courut jusqu’au coude de la galerie pour voir l’endroit où il se trouvait quelques instants avant. C’était bien un éboulement qui désormais faisait un barrage entre lui et son camarade. Un petit espace subsistait
entre l’amas de pierres et le plafond. Il appela ; aucune voix ne répondit. Il renouvela les appels, chercha à capter le moindre gémissement qui aurait pu venir de l’autre côté. Rien. Tremblant d’angoisse, il se précipita vers la cage et tira le câble pour donner à ceux d’en haut le signal de la remontée.
Ce fut l’émoi sur le carreau. Marsaud donna ses ordres. La cage ne pouvant contenir plus
de quatre hommes, il désigna deux équipes pour descendre aussitôt en deux voyages. Les mineurs s’équipèrent de pioches et de barres à mine, dans la fébrilité. Ils connaissaient trop ces moments d’incertitude et d’anxiété qui peuvent se terminer parfois au mieux, parfois dans la douleur. L’ingénieur envoya le contremaître téléphoner au médecin de Brignoles qui intervenait généralement dans les accidents de ce genre. Il l’attendit pour descendre avec lui.
En bas, la première équipe tentait l’impossible. Les blocs étaient de forte taille. Deux hommes soulevaient la masse avec une barre à mine, tandis que deux autres avec la pioche la tiraient par son sommet. Par
moments, l’un appelait, mais le silence insupportable persistait. Quand la deuxième équipe arriva, on eut un peu de mal à s’organiser en raison de l’étroitesse du lieu. Il fut décidé que, pour la bonne marche de l’opération, les deux groupes interviendraient à tour de rôle. Enfin, perché sur un bloc, Gustave Massoulier s’exclama :
— Je crois que je le vois, amenez de la lumière !
Les mineurs unirent leurs lampes en se hissant tant bien que mal dans la partie
haute. Certains ne purent retenir quelques larmes en voyant le corps de Jules
Bringuier, à moitié couché contre la paroi, et immergé jusqu’à la taille. Son visage massacré et ensanglanté disait clairement qu’un bloc avait dû le frapper dans l’éboulement. On essaya encore de l’appeler, mais il fallait accepter l’évidence : il était mort. Ils se retirèrent en silence contre la paroi. Quelques-uns, les plus jeunes, n’eurent pas le courage de se hisser pour voir le corps. Il fallait pourtant bien
le sortir de là, et le médecin, qui venait d’arriver, devait faire son travail. Trois hommes entreprirent alors de continuer
le déblaiement. Avec lenteur, comme si la hâte eût été une insulte au mort. Les deux plus courageux le tirèrent au sec, et le médecin ne put que constater le décès.
L’ingénieur envoya un homme chercher une couverture.
— On ne va pas le remonter comme ça, il faut l’envelopper.
On dut le mettre en position semi-assise dans la cage, alors que deux hommes au
sommet avaient été désignés pour réceptionner le tragique fardeau.
On prévint les gendarmes, comme toujours en pareil cas, pour qu’ils viennent recueillir la déclaration d’accident et interroger les témoins. Le plus informé d’entre eux, Silvio, se morfondait en les attendant, répétant à ses camarades :
— C’était bien un grondement que j’avais entendu, j’aurais dû me méfier. Si je l’avais appelé, il ne serait pas mort.
Le contremaître essayait de l’apaiser.
— S’il y a eu vraiment un grondement, si tu l’as entendu, lui aussi a dû l’entendre. S’il ne s’est pas échappé, c’est parce qu’il n’a pas pu le faire. Ou parce qu’il n’a pas estimé que c’était grave. Tu n’es pas responsable.
Devant les gendarmes, Silvio Longo, malgré son trouble, essaya de reconstituer, minute par minute, ce qui s’était passé depuis leur arrivée dans la galerie. L’un des fonctionnaires, un jeune qui paraissait peu expérimenté, lui posait des questions qu’il trouvait stupides. « En arrivant en bas, vous n’avez rien constaté d’anormal ? » Qu’est-ce que ce blanc-bec voulait dire ? Et qu’aurait-il pu constater d’anormal, à part les infiltrations ? Ou encore : « Qu’est-ce qui vous a amené à laisser votre camarade seul à l’endroit dangereux ? » Il eut bien du mal à lui expliquer qu’il fallait bien que l’un des deux s’en retourne vers la cage pour récupérer le tuyau, et que, tant que l’éboulement ne s’était pas produit, on ne pouvait penser que cet endroit était plus dangereux que bien d’autres qu’ils fréquentaient chaque jour. Les mineurs, qui faisaient cercle autour d’eux, hochaient la tête ou réagissaient avec un murmure selon la nature des questions. Il s’en trouva deux ou trois pour penser, sans oser le dire, que, peut-être, cet accident arrangeait bien Longo. Mais aucun d’entre eux n’avait envie de reprendre le travail immédiatement, ce que comprit l’ingénieur.
— Reposez-vous jusqu’à cet après-midi. Moi, je vois ce qu’il me reste à faire, et c’est bien pénible. Je vais prévenir la famille. Il est bientôt midi, sa femme devrait être à la maison.
Il se fit préciser l’adresse des Bringuier. Un silence poisseux retomba sur le carreau. Des groupes
se formèrent pour commenter l’événement à voix basse. Personne ne se sentait disposé à tirer son repas de la musette.
La petite maison des Bringuier était située à la sortie du village. On voyait qu’on avait voulu lui donner récemment l’aspect du neuf. Les murs avaient été passés à la chaux. Les volets tranchaient par leur vert soutenu. Des pots, vides en
cette saison mais qui déborderaient sûrement de fleurs aux beaux jours, garnissaient le rebord des fenêtres. Sur le devant, un jardinet fraîchement bêché révélait le passe-temps favori des occupants. Plus qu’un passe-temps, c’était surtout le moyen de se nourrir à moindres frais. Marsaud se sentit soudain honteux de venir détruire ce qui ressemblait au simple bonheur de vivre.
Il fit effort sur lui-même pour pousser le petit portillon fait de planches grossièrement rabotées, et du même vert que les volets. À travers la fenêtre, Odette l’avait vu entrer. Elle savait quelle était la fonction de cet homme, car Jules lui en avait parlé un jour qu’il traversait la place. Elle crut comprendre en un éclair. L’ingénieur qui se déplaçait en personne, cela ne se voyait jamais, mais le jour où cela se produisait, c’était mauvais signe. Et elle en fut convaincue en ouvrant, l’homme portant sur son visage le masque de celui qui n’annonce rien de bon.
— Soyez courageuse, commença-t-il.
Après, elle n’entendit plus ses paroles et poussa un hurlement de douleur. Ce moment-là, elle avait toujours pensé qu’il risquait d’arriver. Et il était arrivé. Marsaud essayait de dire des mots apaisants, mais elle n’entendait rien. Elle pleurait avec des sanglots rauques.
En entendant son cri, Émile avait surgi. À douze ans, lui aussi avait déjà pensé que cette échéance pouvait arriver. Il regarda pendant un instant cet homme porteur de
catastrophe avant de se réfugier dans la robe de sa mère, et ils pleurèrent ensemble. Marsaud ne savait plus quel comportement adopter. Parfois, il
posait sa main sur l’épaule d’Odette, mais elle se dégageait comme s’il était coupable. Puis il voulait parler, cherchant les mots qui pourraient les
calmer, mais il ne parvenait pas à finir ses phrases. Il disait « l’homme de valeur », « l’ouvrier dévoué », ne se rendant pas compte qu’ainsi il le tuait un peu plus dans la tête de sa femme.
Enfin, il voulut expliquer l’accident. Elle n’entendait que des bribes, comprenant que Jules était descendu avec Silvio pour un dénoyage. Elle entendit le mot d’éboulement, comprit que Silvio s’en était sorti. Sa douleur redoubla quand elle eut conscience que Jules avait été écrasé sous la roche. La mort ne s’était pas contentée de le faire disparaître, encore avait-il fallu qu’elle le massacrât.
Marsaud profita d’un moment d’accalmie pour dire toute l’estime qu’il avait depuis toujours pour le disparu, puis il précisa que la compagnie allait s’occuper des obsèques, ce serait un souci de moins pour elle, c’était normal. Elle ne songea pas à remercier, le seul mot d’obsèques l’ayant un peu plus plongée dans la terrible réalité. Son mari allait disparaître, définitivement, absorbé par cette terre qu’il avait appris à dompter chaque jour. Puis l’ingénieur prit congé, non sans avoir renouvelé ses souhaits de courage.
Émile s’était retiré dans un coin de la pièce. Assis à même le sol, il n’avait rien perdu des explications de l’ingénieur. Une chose était certaine : il ne verrait plus son père. Mais déjà un sentiment d’injustice montait en lui. Les mineurs étaient descendus à deux, un seul avait été tué, celui qu’il ne fallait pas. Pourquoi lui ? Qu’avait-il fait pour mériter ça ? Et qu’avait-il fait, lui, Émile, pour perdre à jamais ce père qui jouait avec lui ? Plus jamais ils ne courraient ensemble autour du jardin. Plus jamais il ne lui
ramènerait, l’été, une cigale dans une boîte d’allumettes. Plus jamais, il ne sentirait sa large main se plaquer sur son front
pour vérifier qu’il n’était pas fiévreux. Il enfouit son visage dans ses mains et s’aperçut qu’il ne pleurait plus. Tout son corps vibrait seulement d’une immense colère.