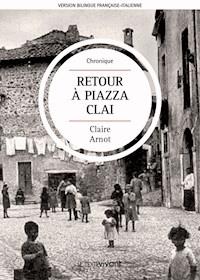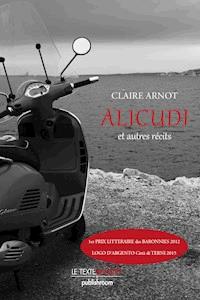
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Texte Vivant
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Un ensemble de textes aux folles aventures pour les amoureux du français et de l’italien
Alicudi, la plus sauvage des îles éoliennes, où se déroule le 1er récit, prête son nom à ce recueil bilingue de nouvelles primées entre 2012 et 2015, en France et en Italie (1er et 3ème Prix littéraire des Baronnies, 2012 , Logo d'Argento Città di Terni 2015).
Ces histoires courtes, presque toutes liées à l’Italie d’hier et aujourd’hui, saisissent le lecteur par leur chute noire, tendre ou cocasse mais toujours surprenante.
Un savoureux recueil à l’écriture fluide et dynamique que l’on ne peut que dévorer !
EXTRAIT
Quand il avait débarqué du bac, le dernier jour de septembre, il ressemblait ni plus ni moins à ces vieux touristes de l’arrière-saison qui viennent réchauffer leurs os au bon soleil de Sicile avant d’affronter l’hiver. Chez nous, à Alicudi, la plus occidentale des îles éoliennes, on ne pose pas de questions. En tout cas pas directement. On n’est qu’une centaine entre l’artiste peintre, le hameau d’allemands et nous, les autochtones, à passer l’hiver sur l’île sans eau ni électricité.
On remarqua sa haute silhouette sur le port. Il portait un gros sac en cuir dans lequel, on le découvrit plus tard, il y avait une machine à écrire. Il parlait un peu italien. Il penchait la tête en souriant quand il posait une question. Il demanda où il pouvait loger. Tout naturellement, on lui indiqua la pension de Pina, ma mère, dans la montée de l’église. Il parut enchanté de la chambre blanchie à la chaux, le crucifix en bois d’olivier au -dessus du lit et surtout de la terrasse qui surplombait le toit. Comme tout le monde, nous y étendions nos draps, y faisions sécher des câpres, des tomates et surtout y récoltions l’eau de pluie.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Claire Arnot, française, née en 1963, vit en Ombrie depuis plus de vingt ans. Traductrice, elle fut animatrice dans une radio locale de Terni, metteur en scène et comédienne de spectacles français pour le jeune public italien, elle est aujourd’hui enseignante de français dans un lycée à Rome. En 2012, Claire Arnot a remporté le 1er prix de la nouvelle du Concours de prose de la ville de Nyons, le 3e prix du concours de prose de Buis-les Baronnies. Elle collabore aussi avec le tout jeune webzine genevois
Catapultes.
Claire Arnot è francese e nata nel 63 ; vive in Umbria da più di vent’anni. Animatrice in una radio locale a Terni, regista e attrice, ha allestito spettacoli in lingua francese per il giovane pubblico italiano. Oggi insegna il francese in un liceo a Roma. Nel 2012, Claire Arnot ha vinto il primo e il terzo premio di due concorsi di racconti in alta Provenza. Collabora pure con il giovane webzine svizzero
Catapultes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Version française
Claire ARNOT
ALICUDI
et autres récits
Recueil de Nouvelles primées lors de concours littéraires de 2012 à 2015
« Lire, c’est aller à la rencontre de quelque chose qui va exister. »
– Italo Calvino
Je dédie ce recueil à ma grand-mère Jacou qui un jour a dit à mon futur mari : « Prends bien soin de ta femme parce qu’elle sait raconter des histoires…
Avec toute mon affection
ALICUDI
Nouvelle sur le thème : Écrivains d’ici ou d’ailleurs.
Premier prix de la Nouvelle Prix littéraire des Baronnies
à Nyons - mai 2012.
Quand il avait débarqué du bac, le dernier jour de septembre, il ressemblait ni plus ni moins à ces vieux touristes de l’arrière-saison qui viennent réchauffer leurs os au bon soleil de Sicile avant d’affronter l’hiver. Chez nous, à Alicudi, la plus occidentale des îles éoliennes, on ne pose pas de questions. En tout cas pas directement. On n’est qu’une centaine entre l’artiste peintre, le hameau d’allemands et nous, les autochtones, à passer l’hiver sur l’île sans eau ni électricité.
On remarqua sa haute silhouette sur le port. Il portait un gros sac en cuir dans lequel, on le découvrit plus tard, il y avait une machine à écrire. Il parlait un peu italien. Il penchait la tête en souriant quand il posait une question. Il demanda où il pouvait loger. Tout naturellement, on lui indiqua la pension de Pina, ma mère, dans la montée de l’église. Il parut enchanté de la chambre blanchie à la chaux, le crucifix en bois d’olivier au -dessus du lit et surtout de la terrasse qui surplombait le toit. Comme tout le monde, nous y étendions nos draps, y faisions sécher des câpres, des tomates et surtout y récoltions l’eau de pluie.
Laszlo (son nom de famille était imprononçable) prit l’habitude d’y monter tous les jours. Il s’installait à la petite table en bois que nous utilisions pour faire des conserves. Il respirait à pleins poumons, fermait les yeux en souriant puis les rouvrait et les plissait pour contempler le bleu étincelant de la Méditerranée, le blanc aveuglant des toits du village dont les ruelles se nouaient et se dénouaient à ses pieds.
– Le client idéal, disait Pina. Il est toujours content, que je lui fasse des pâtes ou du poisson, de la soupe ou de la caponata. En plus il a payé trois mois d’avance.
– Il vient d’où ?
– C’est écrit Hongrie sur le passeport.
– C’est où ?
– Boh… vers la Russie, non ?
– Il est écrivain ?
– Peut-être.
– C’est bizarre qu’il soit venu tout seul. S’il était célèbre, il recevrait du courrier, il y aurait une secrétaire, des journalistes…Il écrit beaucoup ?
– Jamais. Il passe son temps à bader sur ma terrasse. Parfois il va se promener sur le port ou sur la plage.
– Peut-être qu’il cherche l’inspiration ?
Ma mère haussait les épaules en secouant sa crinière noire :
– Moi, tant qu’il me paye…
Devenue veuve à vingt-cinq ans à cause d’une tempête effroyable qui engloutit quatre barques de pêcheurs en une seule nuit, Pina savait garder les pieds sur terre. La saison d’été tirait à sa fin et avoir un client, même un seul, à demeure tout l’hiver, était une somme garantie pour elle et moi, alors âgé de douze ans.
Très vite, Laszlo fit partie du paysage : on le croisait le matin sur le port, qui observait amusé la vente du poisson pêché dans la nuit, puis à midi en plein soleil qui remontait manger à la pension. Il sortait de nouveau en fin d’après-midi, marchant le long de la plage, les mains aux poches, une pipe éteinte entre les dents. On le saluait, il répondait en souriant puis allait s’asseoir au bout de la jetée pour sculpter des bouts de bois rejetés par les vagues. En novembre, les journées raccourcirent ; Laszlo s’installa au café. D’abord, il regarda les vieux jouer aux cartes et aux dominos. Puis, un dimanche après-midi, il entra muni d’un damier dessiné sur un carton et de curieuses pièces en bois sculptées à la main. Moins farouche que mes copains parce qu’il séjournait chez nous, je m’approchai. En une heure, il nous enseigna à jouer aux échecs.
À partir de ce jour-là, je ne vis plus le temps passer. Nous passions des heures à jouer en tête à tête. Ma mère ne savait pas si elle devait se réjouir ou s’inquiéter de ma nouvelle passion. Je pouvais m’absorber des heures dans une partie et quand je relevais les yeux, il faisait nuit.
L’hiver passa ainsi en compagnie de Laszlo qui bientôt fut adopté par notre petite communauté. Il avait appris quelques mots de dialecte pour se faire comprendre des pêcheurs avec qui il rafistolait désormais les filets. Il était habile de ses mains. Il sortit en mer avec eux. Notre peintre local fit son portrait : avec son visage tanné par le soleil, ses cheveux clairs et ses yeux bleu délavés, il ressemblait à un de ces siciliens descendants des normands. On ne lui posa jamais de question sur sa profession ; pour nous il était « l’hongrois » ou « l’écrivain » même si la Remington posée sur la table restait muette.
Pina était heureuse d’avoir un homme aussi doux et serviable à la maison. Il ne se passa jamais rien d’immoral entre eux, mais je sentais qu’elle guettait son pas dans l’escalier et chantonnait en cuisinant.
Avec les premiers beaux jours arrivèrent aussi les premiers touristes… comme les oiseaux migrateurs, ils revenaient s’égayer sur nos petites plages de galets. Même si Alicudi est hostile sur tout un versant, et qu’on n’y circule qu’à dos de mulets, elle exerce une forte attraction quand elle se couvre des mille couleurs du printemps. Elle devient destination d’un jour pour les visiteurs séjournant à Lipari.
En début de saison, l’artiste organisa une exposition pour vendre ses toiles peintes en hiver. Il y eut beaucoup de monde pour l’inauguration : touristes, curieux, collectionneurs et bien sûr journalistes de Messine, Naples et Palerme. Il avait même invité des représentants de la presse étrangère, sachant qu’il vendrait la plupart de ses tableaux aux touristes français et allemands. Ce fut l’un d’eux, un Allemand, qui s’extasia devant le portrait de Laszlo.
– Qui est-ce ? demanda-t-il.
On le lui présenta. Ils se saluèrent dans sa langue maternelle.
– Votre visage me dit quelque chose.
Laszlo se raidit, bredouilla un salut en italien et disparut pour toute la journée.
Une semaine plus tard, alors que les genêts en fleurs embaumaient le maquis, le journaliste allemand revint accompagné de deux carabiniers de Lipari. Il était midi. J’étais descendu à la cave, une grotte naturelle où nous conservions nos aliments, pour prendre de l’eau fraîche à la citerne. D’en bas, j’entendis le pas lourd des trois hommes gravir notre escalier de pierre. Au ton alarmé de ma mère, je compris qu’elle avait peur. Ils cherchaient Laszlo pour un contrôle d’identité.
Je remontai silencieusement de la cave et me glissai dehors. La lumière m’aveugla un instant et comme un mulet piqué par une guêpe, je courus jusqu’à la plage avertir notre ami que la police le recherchait. Je me disais qu’il n’avait certainement rien à se reprocher, mais instinctivement, j’eus envie de l’avertir.
– Laszlo, les carabiniers… ils veulent contrôler tes papiers.
Le hongrois me dévisagea, d’abord surpris, puis avec une infinie tristesse. Il prit ma tête brune entre ses mains et me souffla :
– Merci.
Au lieu de remonter vers le village, il retourna sur ses pas et longea la grève. Il disparut derrière une barque abandonnée et de mon côté, le cœur gros, je remontai vers la pension.
On le chercha partout. Les gendarmes appelèrent du renfort. Deux jours durant, ils sillonnèrent l’île en long et en large. Désormais on savait que Laszlo s’appelait Marcus. C’était un anarchiste allemand responsable de plusieurs attentats et recherché par toutes les polices d’Europe. Son dernier méfait avait été de cambrioler la maison d’un journaliste hongrois, emportant avec lui, argent, vêtements et machine à écrire… c’est pourquoi le collègue allemand l’avait reconnu : la photo de Marcus avait trôné longtemps en première page des quotidiens.
Laszlo-Marcus disparut comme il était venu pour se perdre un soir d’été, à Alicudi, au bout de l’Europe. Malgré l’incrédulité générale, aucun reproche ne sortit de nos bouches. Pour nous, il restait le « hongrois », l’étranger discret qui avait su s’insérer, le professeur d’échecs, le réparateur de filets, le pensionnaire idéal qui fit chantonner ma mère… Et aujourd’hui encore, alors que je suis devenu adulte, je remercie le faux Laszlo de nous avoir laissé la Remington grâce à laquelle je suis devenu écrivain.
DESCENDANCE
Nouvelle sur le thème :
Fleurs 3e prix du Concours littéraire de Buis-les-Baronnies sous le nom de Descendance (juin 2012).
À Nyons on ne savait pas vraiment depuis combien de générations la famille d’Iris vendait des fleurs devant le cimetière. Au moins trois, si ce n’est plus.
Iris, elle, savait parfaitement qu’elle descendait d’une longue lignée de femmes fleuristes, issue d’une malédiction plus que d’une tradition de famille.
La première était Rosa son arrière-grand-mère, d’origine napolitaine. Elle avait débarqué à Nyons en 1906, à la suite d’une riche famille de commerçants, petite servante aux doigts agiles, arrachée à la côte amalfitaine. Enfant, déjà, elle tressait l’ail, cueillait des citrons et formait des bouquets pour orner les tables des banquets. Toute la famille de ses patrons en route pour Paris succomba à un mal étrange : une sorte de dysenterie qui noircit leurs visages et vida leurs tripes. Rosa survécut... tant et si bien qu’on la soupçonna d’avoir empoisonné ses maîtres. La malédiction était née. Ils furent enterrés sur place et la servante hérita du contenu de leurs valises. Elle fut recueillie dans un couvent. Puis, à vingt et un ans, ne désirant pas du tout embrasser une carrière ecclésiastique, elle vendit son petit héritage et ouvrit un kiosque à fleurs devant le cimetière. Elle aimait les plantes et tout naturellement, elle fit le tour des fermes des environs pour acheter roses, dahlias et glaïeuls et inciter les paysans à cultiver des mimosas, les premières fleurs de la fin de l’hiver. Ce petit bout de femme noiraude à l’accent chantant, savait se faire respecter. Des soupçons planaient encore sur elle. Elle ne fréquentait ni l’église ni le lavoir. Les femmes la méprisaient mais les hommes lui tournaient autour. Elle cédait parfois les soirs d’été, après le bal, offrant son corps à la peau mate mais pas son cœur qu’elle n’abandonna qu’une seule fois. Il s’appelait Alfred, fils de notaire à particule, blond et racé. Ils se connurent lors d’un mariage alors que Rosa fleurissait l’autel de l’église. Il la suivit jusqu’à sa cabane. Il lui promit une maison bourgeoise, le mariage, la grande vie… Elle voulut y croire et s’enflamma pour lui. Un beau matin il ne revint plus : son père, mis au courant de leur relation scandaleuse, l’avait envoyé à Lyon pour créer une nouvelle étude de notaire. Rosa pleura longtemps sur son ventre arrondi… et une nuit du printemps 1920, accoucha seule d’un joli bébé blond aux yeux noirs. Elle l’appela Viola, comme sa mère qu’elle n’avait plus jamais revue.
Viola grandit au milieu des fleurs et dans les jupes de sa mère. Un sang noble coulait dans ses veines et même sans avoir jamais connu son père, elle en avait la beauté et l’indolence. Elle apprit le secret des plantes, fréquentant peu l’école. Rosa l’obligeait à tenir le kiosque pendant qu’elle remplissait sa carriole dans les serres des environs. Il y avait plus de concurrence car un fleuriste s’était installé au centre de Nyons. Cependant Rosa maintenait la tête hors de l’eau en ouvrant dès l’aube, tous les jours de la semaine. Ce rythme eut raison de sa santé. Elle mourut d’une pneumonie mal soignée au début de la Seconde Guerre mondiale. Viola, beaucoup moins déterminée que sa mère, se retrouva soudain seule dans une ville hostile. Elle vivota du commerce familial, puisant dans leurs maigres économies. Elle vendit la carriole, puis le mulet.
Un jour, pour une assiette de soupe, elle faillit vendre aussi sa baraque. Son instinct de survie la guida jusqu’à la maison close. Tous les samedis, elle y portait des fleurs fraîches, ce jour-là, elle s’y abandonna toute entière. Les Allemands occupaient la ville et on avait besoin de chair tendre... La patronne l’embaucha. Viola fut déflorée par un lieutenant rougeaud qui puait l’alcool, puis elle détacha la tête de son corps et subit la vie de fille de joie (sans joie) pendant toute la guerre. Elle mangeait à sa faim, trinquait parfois avec de jeunes soldats allemands, mais ses fleurs lui manquaient. Elle tressait des couronnes de lavande pour orner les cheveux de ses compagnes. Ses rares jours de congé, elle revenait contrôler son kiosque désormais abandonné. Elle rendit trois fois visite à la faiseuse d’anges puis la guerre finit. La Libération fut pire que l’Occupation : on rasa ses beaux cheveux blonds et ceux de ses compagnes, la patronne s’enfuit de nuit abandonnant les filles à la huée de la ville. Viola, bouleversée, échoua dans sa baraque en ruines, enceinte de trois mois. La malédiction continuait. Elle survécut grâce à la pitié d’Auguste, le vieux gardien du cimetière. Bossu, marqué d’une tache de vin, les doigts déformés par l’arthrose, il l’aida tout de même à reconstruire sa cabane. Les tombes malheureusement nombreuses avaient besoin d’être fleuries et le commerce repartit. Viola emprunta une petite somme au gardien et remonta son kiosque. Elle vivait dans son arrière-boutique où naquit Marguerite début 46, noiraude comme sa grand-mère napolitaine mais longue et fuselée.
Marguerite se révéla vive et précoce. Elle était curieuse de tout et tourmentait de questions le pauvre Auguste qui lui servit de père et de grand-père. Sur son lit de mort, le gardien demanda la main de Viola qui la lui accorda, les larmes aux yeux. En fin de compte, c’était le seul homme qui aurait pu la rendre heureuse mais il avait gardé le secret de son amour au fond de son cœur. Viola hérita de la maison d’Auguste avec vue sur le cimetière.
Marguerite était née rebelle ; elle s’ennuyait ferme avec les morts comme voisins. Elle apprit malgré elle le secret des fleurs et critiqua vivement sa mère qu’elle trouvait molle et résignée. La jeune fille s’enfuit du lycée bien avant son bac pour courir le vaste monde. C’était le début de la période hippie, elle vécut en communauté. Elle passa par la Californie en pleine révolte contre le Vietnam ; elle toucha à tout : de la Marijuana au LSD. Pour vivre elle dessinait sur le trottoir à la craie les fleurs qu’elle ne faisait plus pousser. À trente ans elle atterrit à Barcelone. Sa mère, atteinte d’un cancer, la rappela à son chevet. Marguerite y consentit, rentra accompagnée d’un Andalou et fit la paix avec ses origines incertaines. À la mort de sa mère, elle se réinstalla dans la maison près du cimetière. Elle peignait sur soie de jolis motifs floraux qu’elle vendait à sa boutique et sur les marchés provençaux… Juanito, en théorie, devait assurer la vente de fleurs au kiosque qui était devenu un bâtiment en dur doté d’une vitrine. Un soir, à la fermeture du magasin, Juanito disparut avec la caisse. Marguerite était enceinte de six mois. La malédiction se perpétuait : lignée de fleuristes condamnées à élever leur enfant sans père…
Iris naquit durant la canicule de l’été 1976. En elle bouillonnait un sang méditerranéen. Elle eut une enfance mouvementée. Marguerite s’entoura d’amis anticonformistes dans la mouvance des années 70. Elle entraîna sa fille dans des concerts rock, des manifs et des nuits blanches sur le Larzac. Affectivement, Iris grandit cahin-caha, s’attachant à des pères de passage, à des amis d’un soir. Elle comprit que pour échapper à l’inconstance de sa mère, elle devait trouver sa voie. Pour couper court à cette enfance bohème, Iris choisit une école de commerce à Paris. Dans les années 90, ce fut le boum des bonzaïs. Iris suivit une formation auprès d’un maître japonais et décida de rentrer à Nyons. Marguerite, victime du blues de la cinquantaine, se réfugiait de plus en plus dans l’alcool et ne venait presque plus au magasin. Iris décida de reprendre les choses en mains. En fin de compte elle descendait d’une lignée de fortes femmes qui étaient souvent reparties de zéro. La culture des bonzaïs fut une bonne intuition. Iris agrandit la boutique familiale, et au bout de deux ans en ouvrit une autre à Vaison-la-Romaine. Elle devint femme d’affaires sous le regard perplexe de Marguerite qui disait : « Je ne reconnais plus ma fille… » Et pourtant Iris se sentait plus que jamais héritière de ce curieux matriarcat. Elle fit une psychothérapie qui la réconcilia avec ses origines obscures.
Puis Marguerite se suicida presque sans le vouloir en mélangeant, un soir de déprime, alcool et somnifères. Iris en fut beaucoup plus touchée qu’elle ne le croyait. Elle sentit un vide immense. Le chaos pathétique de sa mère lui manqua énormément. À trente-cinq ans sonnés, elle n’était riche que d’argent. Aucun homme dans sa vie de peur d’être abandonnée, encore moins d’enfant. En femme d’action, elle décida de le planifier. Tant qu’à faire, ce serait sciemment qu’elle élèverait seule son bébé. Une petite fille douce et intelligente au prénom de fleur bien entendu mais qui saurait affronter la vie sans être ballotée par le destin. Aujourd’hui, les moyens d’Iris le lui permettaient. En ville, elle était respectée.
Elle choisit donc l’insémination artificielle. La grossesse solitaire se déroula sans encombre. Elle choisit même d’accoucher par césarienne dans une clinique privée le premier jour du printemps. Elle aurait appelé sa fille Lila, une plante résistante, au bois dur et au parfum intense.
Le médecin sortit le bébé vagissant et annonça :
– C’est un garçon !
Iris ne se démonta pas :
– Alors je l’appellerai Olivier, il sera fort comme un arbre et protègera sa maman.
– Madame, il est trisomique…
Iris tressaillit puis tendit les bras :
– Cinquième génération… la malédiction continue.
MYSTÈRE en OMBRIE
Nouvelle sur le thème : La sorcellerie – 4e prix du Concours de nouvelles de la ville de Chalabre sous le nom de Rencontre en Ombrie (août 2012).
Cette nouvelle fait partie du recueil collectif
L’antre des Sorciers.
Collection Noire Éditions Rivière Blanche.
L’automne dernier, mon mari et moi sommes allés en vacances en Ombrie, une région du centre de l’Italie belle et sauvage, moins célèbre que sa voisine la Toscane mais tout aussi passionnante. Nous avions besoin de repos après deux tentatives de fécondation in vitro qui avaient échoué…En outre, à cause du travail de Marc, nous venions de quitter Toulon pour Milan où, de mon côté, j’étais encore à la recherche d’un emploi.
L’agritourisme où nous logions se trouvait au pied d’un bourg fortifié. De la fenêtre de la chambre, on distinguait au loin les sommets des Appenins enneigés puis leurs pentes boisées au pied desquelles moutonnaient de sages collines cultivées, vignes, blé et oliviers, piquetées çà et là de fiers cyprès. Les toits des villages perchés se répondaient de loin en loin miroitant sous le soleil d’automne. Cette mosaïque de tons et de couleurs enchantait la vue et l’esprit. Cependant, comme aimantée par un appel muet, je me surpris plus d’une fois à tourner le regard vers le maquis sombre et touffu qui délimitait la propriété.
Toute la semaine, nous visitâmes les charmantes villes d’Orvieto, Todi, Assise et Pérouse. Le dernier jour, nous décidâmes d’un commun accord de nous reposer à l’agritourisme avant d’affronter le voyage du retour en voiture. Marc, plutôt flemmard et citadin, plongea dans une profonde sieste réparatrice ; moi, je me préparai enfin à découvrir la « macchia » comme les italiens d’Ombrie surnomment leur forêt méditerranéenne. Giulia, qui nous hébergeait, m’indiqua quelle direction suivre pour atteindre une petite clairière où, à une heure de marche environ, surgissait une source d’eau pure. Enchantée à l’idée de sortir enfin seule après deux mois de repos forcé, je glissai dans mon petit sac à dos une polaire, un appareil photo, mon portable et une bouteille d’eau. Je laissai un billet à mon mari et franchis allègrement la barrière qui séparait le jardin du sentier.